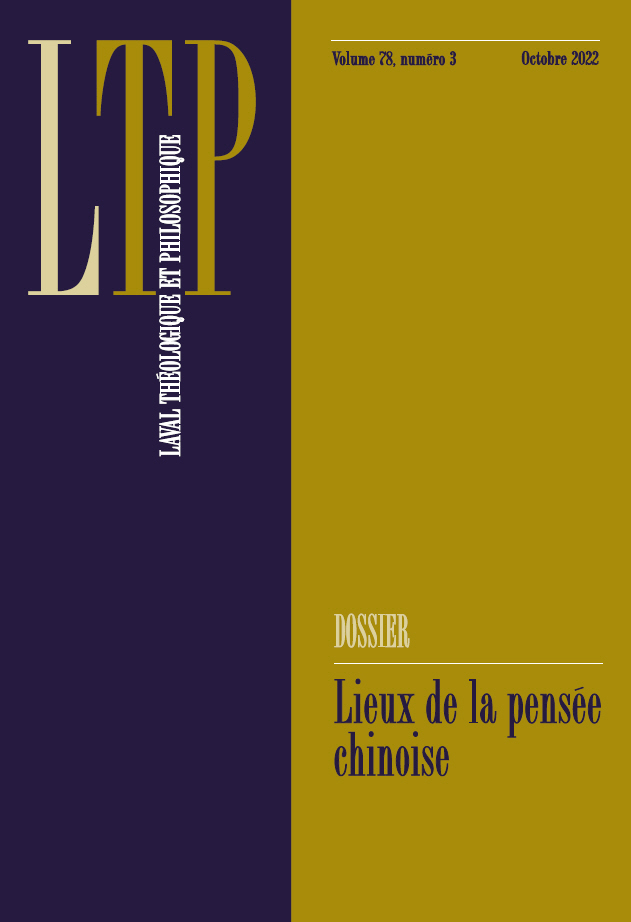Résumés
Résumé
Dans cet article, après un essai de définition de ce que l’on entendait par « rites » dans les premiers traités normatifs qui leur furent consacrés, sera retracée l’évolution ayant mené à la constitution d’un « système rituel » à visée totalisante. Or, la recherche de « l’ordre parfait » à laquelle s’adonnaient les ritualistes a suscité des débats infinis et n’a pu aboutir à construire un édifice aussi solide que ces derniers l’auraient souhaité. Pour l’anthropologue Philippe Descola, ce mélange de fascination pour un système quasi totalitaire et d’incapacité à se mettre d’accord sur sa physionomie réelle caractérise l’ontologie analogiste qui fut celle de la Chine à l’époque où ces traités ont été rédigés (la fin de la période des Royaumes Combattants). C’est la première cause, d’ordre logique, que l’on peut trouver à la fragilité d’un système décrit par Yuri Pines comme « the Universal Panacea ». La deuxième cause est plutôt d’ordre psychologique. Elle trouve sa source dans le doute et l’anxiété provoqués par la pression qu’exerce sur les sujets l’injonction de recréer en soi un ordre idéal et toujours déjà perdu. Cette dernière partie s’appuie sur les travaux récents de deux auteurs, Mark Csikzentmihalyi et Michael David Kaulana Ing, lesquels montrent, à partir d’une analyse détaillée de deux ouvrages normatifs : le Wuxing 五行 (Les Cinq types d’actions vertueuses) et le Liji 禮記 (Livre des rites), comment furent abordées les questions de la faillite du rituel et de la faillibilité humaine, indiquant ainsi la voie vers une sortie possible du fantasme de l’ordre parfait.
Abstract
In this article, after an attempt at defining “rites” as they were evoked in the first normative treatises, will be described the subsequent evolution leading to the constitution of a “ritual system” conceived as a totality. However, the ritualists’ search for “the perfect order” gave rise to infinite debates and has not succeed to build a structure as solid as they had awaited. For the anthropologist Philippe Descola, this combination of a fascination for a quasi-totalitarian system and an inability to agree on its real physiognomy is characteristic of the analogistic ontology, that was prevalent at the time those texts were written (the end of the Warring States period). This is the first, logical, frailty, of a system characterized by Yuri Pines as “the Universal Panacea”. The second frailty is rather psychological. It originates in the doubt and anxiety provoked by the injunction to recreate within oneself an ideal order that is always already lost. This last section builds on recent publications by Mark Csikzentmihalyi and Michael David Kaulana Ing, showing, from a detailed analysis of two normative treatises : the Wuxing 五行 (The Five Types of Virtual Actions) and the Liji 禮記 (Book of Rites), how the issues of ritual failure and human fallibility were examined, leading to a possible way out of the fantasy of the perfect order.
Corps de l’article
Comme le soutient Barbara Cassin dans la réflexion qu’elle poursuit de longue date sur la notion « d’intraduisible », l’indispensable passage d’une langue à l’autre peut mettre au jour des impasses de la pensée. Buter sur des impensés, c’est le risque que nous courons lorsque nous abordons la question du rite, du rituel et de la ritualité en Chine avec les outils conceptuels de « nos » langues (essentiellement ici le français et l’anglais). Peut-être rebutés par la difficulté de s’accorder, ne serait-ce qu’à titre provisoire, sur la définition des termes, les philosophes d’Occident se sont peu intéressés à cette question[1], la laissant aux théologiens[2], aux historiens des religions et aux anthropologues. La Chine, en revanche, peut se prévaloir d’une longue tradition d’écrits normatifs, souvent présentés comme « philosophiques[3] », portant sur une catégorie spécifique de rites désignés comme li 禮 et, de manière moins systématique, comme yi 儀, ce dernier terme, qui renvoyait au départ à des rites pratiqués par les couches inférieures de l’aristocratie, étant plutôt traduit par « cérémonies » ou « cérémoniels ». À l’origine de cette tradition figurent trois traités qui furent intégrés au début de l’ère commune dans le canon confucéen : le Zhouli 周禮 (Rites de Zhou), le Liji 禮記 (Livre des rites) et le Yili 儀禮 (Cérémonial). Dotés de commentaires et périodiquement remaniés, ces recueils de textes disparates, décrits par Martin Kern comme « des idéalisations composites, normatives et diachroniques émanant de ceux qui imaginaient un âge depuis longtemps révolu[4] », susciteront la réflexion et exciteront l’ardeur polémiste des lettrés et hommes d’État désireux de sauvegarder la société — ou de la réformer — en la soumettant à un ordre présumé naturel, et ceci jusqu’à l’aube du xxe siècle.
Dans cet essai, il sera fait référence plus particulièrement au Livre des rites, un ouvrage qui recevra sa forme définitive entre le iie siècle aec et le ier siècle ec[5]. Rassemblant quarante-neuf « chapitres » attribués aux disciples de Confucius, cet important traité consiste pour l’essentiel en théorisations sur le rituel[6]. La lecture unifiante et totalisante qui en fut donnée par la suite[7] ne peut masquer l’hétérogénéité des sujets traités, ni la foisonnante diversité des pratiques rituelles mises au jour par les historiens et les archéologues, et observées dans des contextes divers par les anthropologues. Non seulement l’étude du rite n’est pas menée de la même manière par ces divers spécialistes, mais elle renvoie à des corpus différents et concerne des pratiques pour lesquels les Chinois usent de termes distincts. « Rite » ou « rituel[8] », dans son sens le plus général, est désigné en langue originale par li 禮 et yi 儀, mais aussi, si l’on se déplace vers les pratiques rangées sous l’étiquette commode de « taoïsme », par fashi 法事 ou fa 法, un mot qui dans d’autres contextes prend les sens de « procédé », « pratique » ou « loi ». On trouve aussi, dans la même tradition, keyi 科儀, un terme dont le composant ke 科 comporte l’idée de segment ou de partie, ce qui donne un indice de la nature séquentielle du rite. D’autres termes sont plus spécifiques, tels zhai 齋, « rituel de purification », pratiqué par les bouddhistes autant que par les taoïstes, ou jiao 醮, spécifiquement taoïste, pouvant être traduit par « service d’offrande[9] ». La liste n’est pas close, mais même s’il existe de nombreux et passionnants travaux menés sur les rituels et les cultes pratiqués de nos jours en Chine, c’est seulement de la littérature canonique portant sur le li dont il sera question ici. Elle sera abordée avec les outils théoriques de l’histoire et de l’anthropologie qui sont les champs disciplinaires dans lesquels je m’inscris.
I. La longue marche vers le tant espéré (et fantasmé) « système rituel »
Li, écrit d’abord 豐[10] puis 禮 et enfin 礼 sous sa forme simplifiée, apparaît dans les inscriptions divinatoires et les écrits sur bronze du début du premier millénaire avant notre ère pour désigner des offrandes en nourriture et boisson aux ancêtres. Gilles Boileau, qui consacra une importante étude au système rituel de la haute antiquité chinoise[11], fait d’ailleurs de li un quasi-synonyme de ji 祭, « sacrifice ». Mais le sens de ce caractère s’élargit par la suite pour s’étendre à des actes plus variés, puis à l’attitude attentive et respectueuse de ceux qui les accomplissent. Ce tournant psychologique et moral se poursuit lorsque li en vient à désigner une vertu et prend le sens de « ritualité », sans doute à partir de Confucius (551-479 aec). Lorsqu’est scellée l’alliance entre le pouvoir impérial et ceux qui s’inscrivent dans la lignée intellectuelle du maître, vers le milieu de la dynastie des Han de l’Ouest (Xi Han 西漢, 206 aec-9 ec), les rites ne sont plus les comportements prescrits aux seuls aristocrates, dont ils ordonnaient les cultes et régulaient la vie sociale et politique, ils s’adressent à une élite plus large comprenant notamment les agents de la bureaucratie impériale. C’est à la suite de cette longue évolution, déjà amorcée au cours de la période des Printemps et Automnes (Chunqiu 春秋 722-453)[12], qu’ils deviennent sous l’Empire, les « constantes culturelles explicites[13] » tenues pour légitimes et désirables par l’orthodoxie et permettant d’opérer le partage entre « barbares » et « civilisés ».
Pour accomplir un tel programme, il a fallu opérer des classifications, instaurer des divisions, séparer ce qui ne pouvait être conjoint. Rappelons les phrases célèbres du penseur confucéen Xunzi 荀子 (310-235 aec) en ouverture de ses « Propos sur les rites » (Lilun 禮論) :
Quelle est l’origine des rites ? L’homme à sa naissance a des désirs. S’il n’obtient pas ce qu’il désire, il n’a de cesse qu’il ne les satisfasse. S’il cherche à les satisfaire sans se donner de mesure et sans répartir des limites, il y a nécessairement compétition. Celle-ci provoque le désordre, lequel entraîne l’épuisement des ressources. Les rois de l’antiquité, par aversion pour le désordre, établirent rites et sens moral en vue d’une répartition qui assouvirait les désirs des hommes et répondrait à leurs besoins, de façon que les désirs ne fussent jamais en excès par rapport aux biens et les biens toujours en adéquation par rapport aux désirs, désirs et biens se développant par leur soutien mutuel. Telle est l’origine des rites[14].
Les rites sont donc dans ce passage du Xunzi ce qui, par l’indispensable limite imposée aux désirs de chacun, assure paix et prospérité à ceux qui se satisfont de leur lot (fen 分, un mot qui, sous sa forme verbale, signifie « répartir », « partager »). Ils accroissent la division par rapport à l’état — utopique — d’unité et de grande communion présenté comme celui des temps anciens, mais ils fournissent aussi les moyens de surmonter ce danger et d’ordonner le divers. Pour Claude Lévi-Strauss, qui fut en contact avec la pensée chinoise, notamment par l’intermédiaire de Marcel Granet : « Les raffinements du rituel, qui peuvent paraître oiseux quand on les examine superficiellement et du dehors, s’expliquent par le souci de ce qu’on pourrait appeler une “micro-péréquation” : ne laisser échapper aucun être, objet ou aspect, afin de lui assigner une place au sein d’une classe[15] ».
Le Liji considère les rites li comme les liens ji 紀 qui tiennent la société ensemble, assemblant dans le bon ordre les éléments qui avaient été correctement distingués, séparés et classés et leur imposant la contrainte d’un ordre présenté comme naturel. Michael Ing repère dans le Liji d’autres métaphores pour li : le compas et l’équerre, la corde enduite de craie permettant de tracer des cercles, les échelles et balances, les instruments de mesure du temps, les digues, cette dernière image étant particulièrement importante, car les rites sont souvent présentés comme ce qui permet d’endiguer et, le cas échéant, de canaliser les flux émotionnels[16]. Comme c’est souvent le cas dans les textes anciens, les mots peuvent avoir plusieurs sens et donner matière à des jeux de mots sérieux sur lesquels se base une partie de la discussion « philosophique ». C’est ce qui amène cet auteur à donner à ji, traduit habituellement par « fil », le sens plus particulier de « noeud[17] ». Il va plus loin en suggérant que ce caractère ne désignerait pas seulement les noeuds qui assemblent et contiennent, mais aussi ceux que l’on faisait sur une corde pour la transformer en instrument de mesure, à la manière des quipus des Incas. Ces noeuds ne servaient pas seulement à compter, ils étaient considérés par de nombreux auteurs aussi bien confucéens que proto-taoïstes comme les ancêtres de l’écriture, des sortes d’aide-mémoire permettant d’enregistrer les choses importantes, ce qu’il résume en une formule frappante : « […] le rituel est une tentative d’enregistrer (ji 記) et de reproduire les standards (ji 紀) du passé dans le présent[18] ». Dans son chapitre virtuose « Les nombres », Marcel Granet soulignait déjà le rôle crucial joué dans la construction de la gamme et du calendrier par les noeuds des tubes de bambou (jie 節) de l’orgue à bouche[19]. Attardons-nous un instant sur les multiples sens de jie : ce mot renvoie à la fois aux rites, à la musique (rythme) et aux vertus morales (modération, chasteté, fidélité). C’est aussi le nom du 60e hexagramme du Livre des mutations (Yijing 易經), qui signifie « modération, moment où un élément modérateur limite les excès et assure l’union[20] ». Nous y sommes.
Opérant un nouage du naturel et du culturel, de l’éthique et de l’esthétique, la musique fait partie intégrante du système rituel. Comme li avec lequel elle partage la recherche de l’harmonie, elle résonne avec l’univers. « La musique, c’est la joie » (fu yuezhe le ye 夫樂者樂也), c’est par ce célèbre jeu de mots — le caractère 樂 ayant deux prononciations et deux significations : yue, « musique » et le, « joie » — que débutent les « Propos sur la musique » de Xunzi (Yue lun 樂論)[21], qui suivent immédiatement ses « Propos sur les rites ». La musique fournit le ciment émotionnel permettant d’unir dans une même jouissance esthétique les membres d’une communauté participant/assistant à un rituel. La barre qui sépare et assemble ces deux verbes est là pour nous rappeler que l’accomplissement d’un rite est aussi une performance[22] et que très tôt se posera la question du « public » et de la sincérité des acteurs. Nous y reviendrons.
C’est à la fin des Royaumes Combattants (Zhanguo 戰國, 453-256 aec), période où s’estompe l’aura religieuse des « cérémonies inspirant crainte et respect[23] » (weiyi 威儀) sur lesquelles se fondait le pouvoir de la noblesse antique, que se tient par écrit un discours proliférant sur le rite. En ces temps déchus, minés par la guerre et la défiance, le tracé d’un cadre rituel réparateur se fait au prix d’une certaine perte de sens, ou plutôt d’une saturation de sens venant brouiller les contours des disciplines qui nous sont familières. En effet, si la description d’un tournoi de tir à l’arc ou l’énumération des rites de deuil figurant dans les traités peuvent donner à l’anthropologue l’illusion, sans doute fallacieuse, d’être en terrain de connaissance, ou s’ils peuvent fournir à l’historien de l’Antiquité occidentale des éléments de comparaison, il n’est pas aisé de comprendre de quoi il est exactement question dans le texte suivant, toujours extrait des « Propos sur le rite » de Xunzi :
[Grâce au rite] le ciel et la terre sont en harmonie, le soleil et la lune brillent, les quatre saisons se succèdent dans le bon ordre, les étoiles et constellations poursuivent leur course régulière, les fleuves et rivières coulent, les dix mille êtres prospèrent. [Le rite] modère les amours et les aversions et donne leur juste expression à la joie et à la colère. Les inférieurs, il les rend obéissants, les supérieurs, clairvoyants. Par lui, les dix mille êtres se transforment sans qu’en résulte le chaos. S’en écarter serait la voie de la perdition. N’est-il pas absolue perfection[24] ?
La même perplexité accompagne le Livre des rites, lequel, selon Michael Ing, « tend à répondre davantage au souci d’expliquer pourquoi certains rituels sont nécessaires qu’au besoin d’expliquer comment les accomplir[25] ». Lors du colloque qui se tint en juin 2018 au Collège de France sur cet ouvrage[26], fut soulignée à maintes reprises la difficulté que l’on pouvait éprouver de nos jours à se représenter le déroulement des rituels effectivement accomplis à partir des descriptions qui y figurent, et surtout à identifier les entités spirituelles auxquelles s’adressaient les paroles et les gestes[27]. L’archéologue Alain Thote s’étonnait ainsi de l’existence d’un écart considérable entre les prescriptions rituelles et les vestiges de tombes mis au jour lors des campagnes de fouilles menées depuis le siècle dernier, tandis que Michael Nylan relatait les efforts — souvent infructueux — effectués par les ritualistes de la période des Royaumes Combattants et des Han (surtout des Han de l’Est, Dong Han 東漢, 36-220 ec) pour « fixer » les rituels, c’est-à-dire réinventer une pratique rituelle qui ferait l’unanimité. L’historienne arrivait ainsi à la conclusion que s’il n’y avait pas à proprement parler de « système rituel », la conviction « qu’il devait y en avoir un » existait chez tous les participants aux débats qui se tinrent au début de notre ère dans les plus hautes instances étatiques sur ce que l’on appelait « les rites majeurs » (ceux qui étaient censés garantir l’ordre cosmique et social)[28]. Toujours dans le cadre de ce colloque, Marc Kalinowski[29] voyait dans cette croyance obstinée en la réalité d’un système et en sa nécessité « le fantasme d’un ordre parfait », un ordre par lequel les rites s’inscrivent dans une cosmologie à visée totalisante. Plus que les constructions numérologiques complexes brillamment analysées par cet auteur, ou, plus loin, par Angus Graham, « cosmologie » désigne ici et dans la suite de cet essai ce que Philippe Descola définit dans son ouvrage devenu classique, Par-delà nature et culture, comme un ensemble de « schèmes plus généraux gouvernant [pour une collectivité à un moment donné de sa trajectoire][30] l’objectivation du monde et d’autrui[31] ».
II. La pensée sauvage transplantée dans les jardins impériaux
Si un auteur a pu donner l’illusion de l’existence de cet ordre parfait, c’est bien Marcel Granet dans La pensée chinoise. Dans la critique — admirative — qu’il fit de cet ouvrage monumental, Angus Graham souligne à juste titre « l’erreur » commise par son prédécesseur, consistant à présenter comme la pensée chinoise l’idéologie qui s’imposa en un temps particulier correspondant à l’affermissement de l’ordre impérial. Plus que sur le rituel, l’intérêt du philosophe se portait sur la cosmologie qui s’élabora dans les derniers siècles de la période des Royaumes Combattants, à partir des catégories opposées et complémentaires du yin 陰 et du yang 陽. Pour lui : « Le grand intérêt d’un système de type yin-yang […] est qu’il tente de rendre explicite l’ensemble des comparaisons et contrastes que d’autres modes de penser laissent implicites[32] ». Cet effet de dévoilement avait déjà retenu l’attention de Claude Lévi-Strauss, même s’il opère par des moyens différents dans les sociétés auxquelles l’auteur de La pensée sauvage consacra ses recherches. Pour Lévi-Strauss, ce sont certaines catégories d’êtres et d’objets du monde sensible qui « ouvrent à l’observateur ce qu’on pourrait appeler un “droit de suite” : celui de postuler que ces caractères visibles sont le signe de propriétés également singulières, mais cachées[33] ». Mais Graham n’éprouve pas la même fascination que le grand anthropologue pour ce qui est présenté dans La pensée sauvage comme de géniaux bricolages. Au contraire, dans l’ouvrage qu’il a consacré à la forme prise par la pensée corrélative dans la Chine des débuts de l’ère commune, il se montre soucieux d’opérer un tri entre ceux qu’il appelle « les philosophes », qui seraient restés largement imperméables au charme des constructions analogiques auxquelles Granet accordait tant d’importance, et les « maîtres des techniques diverses » (fangshi 方士) : astrologues, devins, stratèges, médecins, qui les avaient élaborées. Rejoint par l’historien des Han, Michael Loewe[34], il souligne le fossé qui sépare la pensée de ces derniers de la rationalité analytique sur laquelle est bâtie la science moderne et tente de savoir « à quels critères recouraient les penseurs de la Chine traditionnelle pour décider que leur spéculation corrélative allait trop loin[35] ».
Cette spéculation corrélative allait-elle vraiment « trop loin » ? Et, le cas échéant, quelles étaient les raisons des supposés errements de ceux qui s’y adonnaient ? Et comment opérer le tri entre les « philosophes » et les divers théoriciens de la « pensée sauvage », dans un univers où les frontières entre la croyance et le doute devaient être des plus floues[36], et où l’analogie imprégnait en profondeur le langage des mots et des corps ? Comment échapper à une logique classificatrice dont les critères — « la scientificité », « le caractère philosophique » — sont imposés de l’extérieur ? Pour tenter de répondre à ces questions, peut-être faut-il échapper au tête à tête étouffant entre « eux » et « nous », et faire intervenir des modes de penser élaborés sous d’autres cieux. À cette fin, je voudrais mobiliser des concepts forgés par Philippe Descola dans Par-delà nature et culture. L’anthropologue distingue ce qu’il appelle quatre « modes d’identification » ou ontologies, régissant les relations qu’établissent les humains avec le monde (les « non-humains ») et donnant lieu à ce que Claude Lévi-Strauss appelait des « arrangements ». Ces « filtres ontologiques » donnant naissance à des cosmologies, au sens défini plus haut[37], sont l’animisme, surtout présent en Amazonie et chez les chasseurs de l’arc sibérien, le totémisme, prévalent parmi les populations autochtones d’Australie, l’analogisme et le naturalisme, ce dernier terme désignant l’ontologie « moderne » et de plus en plus « mondiale » née en Occident avec la physique galiléenne. Pour éviter les malentendus, peut-être convient-il de préciser que ces modèles valent essentiellement pour leur valeur heuristique. Il n’existe pas de société qui se présenterait comme une « forme pure » où régnerait sans partage l’une ou l’autre de ces cosmologies. Avec le bonheur d’expression qui le caractérise, Descola parle à ce propos de « “nappes ontologiques” dont les frontières se chevauchent dans des zones d’interface[38] ». Nous trouvons des exemples de cette porosité des frontières entre systèmes dans l’engouement d’une part non négligeable de la population de notre Occident naturaliste pour la médecine traditionnelle chinoise, laquelle participe d’une cosmologie analogiste, et, plus récemment, par l’intérêt montré par des philosophes tels que Vinciane Despret et Baptiste Morizot pour un animisme débarrassé de ses oripeaux New Age.
C’est l’analogisme qui va nous retenir plus longuement ici, car le ritualisme confucéen inlassablement remis sur le métier au cours des siècles participe de ce mode d’identification[39]. Une telle assignation résulte de l’apposition de plusieurs filtres, à commencer par celui qui fut mis en place lors du passage de l’oralité à l’écrit opéré par les rédacteurs des premiers traités de rituel, auquel doit s’ajouter le travail de réécriture des commentateurs successifs. La lecture totalisante de Granet, visant à privilégier la structure sur le foisonnement du vivant, constitue un deuxième filtre, lequel sera renforcé par le prestige dont jouit encore cet auteur auprès d’anthropologues marqués par la pensée structuraliste, comme l’est Philippe Descola. C’est enfin ce dernier qui apposera un dernier filtre sur l’édifice de ses prédécesseurs, par l’opération d’abstraction et de (très relative) simplification en laquelle consiste la création de ses quatre modes d’identification. Cependant, même si « la pensée chinoise » ne peut être réductible à l’image trop parfaite qu’en donne Granet relue par Descola, on y retrouve la plupart des traits caractéristiques de l’ontologie analogiste dégagés par le grand anthropologue, à savoir la pensée corrélative, la hiérarchie, et les jeux d’échelles repérables notamment dans les emboîtements du macrocosme et du microcosme. Dans cet univers où « les parfums, les couleurs et les sons se répondent », sont tissés de vastes réseaux de correspondances entre divers aspects du monde sensible, mais aussi politique et moral. Ainsi, par exemple, au Feu (l’un des Cinq Agents[40] — wuxing 五行 — régulant le parcours cyclique de l’espace-temps) correspondent la couleur rouge, le Sud, l’été, la saveur amère, mais aussi le coeur, l’intestin grêle, la vertu de ritualité li, la joie, la note zhi 徵 (notre sol), la chèvre, le blé… la liste n’est pas close et à partir de chacun des autres Agents (Eau, Bois, Métal, Terre) se déploient des séries analogues.
Caractérisant souvent des sociétés complexes et fortement hiérarchisées, cette manière d’appréhender le monde a donné lieu à un très grand développement du rituel, lequel ne régit pas seulement les relations des hommes entre eux, mais aussi celles qu’ils entretiennent avec le cosmos. Nous trouvons un exemple de raisonnement analogiste particulièrement dense dans ce passage que consacre le Livre des rites aux banquets tenus à intervalles réguliers pour renforcer les solidarités villageoises :
L’invité [principal] est à l’image du ciel ; son hôte l’est de la terre. Leurs assistants sont à l’image du soleil et la lune, et trois [autres] invités, des trois étoiles brillantes. Quand les anciens ont instauré le rituel, ils l’ont tissé[41] (jing 經) avec le ciel et la terre, lié (ji 紀) avec le soleil et la lune et se sont associé les trois étoiles. C’est le fondement du gouvernement et de l’instruction[42].
La fin du chapitre « Le rite en mouvement » (Li yun 禮運)[43] du Livre des rites nous fait entrer dans un monde enchanté, où l’homme qui respecte les rites, débarrassé des fléaux qui accablent les sociétés agraires, côtoie en bonne harmonie les animaux fabuleux et d’autres créatures plus ordinaires :
[…] il n’y aura plus de calamités : inondations, sécheresses, insectes ravageurs. On ne subira pas la famine ni les épidémies. […] Le ciel laissera descendre une rosée suave sur la terre où jailliront de douces eaux printanières. Les montagnes produiront de quoi fabriquer meubles et voitures, et le fleuve Jaune livrera son grand talisman (matu 馬圖)[44]. Les phénix et les qilin[45] vivront dans les bois proches de la capitale, les dragons et les tortues s’ébattront dans les fossés des palais, et les oeufs d’oiseaux et les jeunes animaux pourront rester à la vue de tous[46].
Il ne s’agit pas seulement d’habiter le cosmos, mais de le faire advenir, ou ré-advenir. Le ritualisme est aussi un projet politique. À en croire les auteurs du Livre des rites, les souverains, fils du ciel, auraient régulé le cours du temps en accomplissant un grand rituel décrit dans le chapitre « Ordonnances mensuelles » (Yueling 月令), consistant à prendre place dans les salles du Palais de lumière (mingtang 明堂), appelé aussi Maison du calendrier, et à arborer les emblèmes du mois correspondant à leur disposition spatiale, ceci afin de « caler » le cours du temps sur le parcours de l’espace.
Si l’homme animé par la vertu de ritualité manifeste un tel pouvoir, il n’est guère étonnant que les penseurs aient consacré tant d’attention à cette question au cours des siècles, mais il n’est guère étonnant non plus qu’ils n’aient pu embrasser la diversité mouvante des rites et rituels et ne se soient en définitive accordés que sur « la nécessité d’un système », pour reprendre la formule de Michael Nylan[47]. L’hypothèse qui sous-tend la section suivante de cet essai est que l’imperfection du système de correspondances élaboré dans l’Antiquité tardive et l’impossibilité d’aboutir à un accord entre ritualistes, qui peuvent apparaître comme des menaces pour la stabilité du système, correspondent en réalité à une caractéristique structurelle de l’ontologie analogique mise au jour par Descola :
[…] les voies de l’analogie sont nombreuses, si nombreuses qu’on trouvera toujours entre deux entités plusieurs parcours possibles, plusieurs chaînes de correspondances. À l’instar de ce qu’elles unissent, les relations sont donc très variées, quoique plusieurs d’entre elles puissent s’appliquer aux mêmes existants. La combinaison de ces deux systèmes de différences, entre des termes qui se ressemblent et entre des relations qui portent sur les mêmes termes, donne au mode d’identification analogique son étrange et séduisante ambivalence : les cosmologies qu’il rend possibles sont si parfaitement intégrées et cohérentes qu’elles frôlent l’ordre totalitaire tout en laissant à chacun de leurs habitants une grande liberté herméneutique[48].
Ce mélange de fascination pour un système parfait et d’incapacité à se mettre d’accord sur sa physionomie réelle explique qu’une grande part de la littérature qui s’est développée au cours des siècles sur le rite et la ritualité (li) n’ait pas consisté seulement en tautologies laudatrices (bien présentes dans cette littérature fortement répétitive), mais aussi en débats portant sur l’interprétation des textes et la mise en oeuvre des rituels[49]. Loin de permettre l’instauration d’un ordre parfait, le mode d’arrangement avec le réel dont témoignent les textes rituels laisse une large place au déséquilibre et au doute. Ceci nous ramène à la question initiale : peut-on sortir du fantasme de l’ordre parfait ?
III. Une cosmologie en équilibre instable
Pour Philippe Descola, la cosmologie analogiste, qui englobe le ritualisme confucéen, présente la caractéristique structurelle d’être minée par le doute quant à sa capacité d’insérer la totalité du réel dans un réseau cohérent de correspondances. C’est encore le doute que l’anthropologue américaniste Carlo Severi place au coeur de l’action rituelle : « L’action rituelle construit […] un genre spécifique de fiction, un contexte spécial de la communication, dans lequel toute réponse, positive ou négative, implique le doute, l’incertitude. Tout le monde doit croire, mais personne n’est vraiment convaincu[50] ». Et, plus loin : « La communication linguistique devient rituelle lorsqu’un mode particulier d’élaboration d’une image complexe de l’énonciateur est construit de manière à déclencher cette tension spécifique entre le doute et la croyance qui définit l’effet de l’action rituelle[51] ».
Comme la plupart de ses pairs, Severi voit dans le rituel une forme spécifique d’action[52]. Mais que se passe-t-il lorsqu’une théorie — écrite, savante, canonique — se superpose à l’action, au risque de la rendre inintelligible ? Ne peut-on considérer l’hypertrophie du rôle dévolu aux rites, dont nous trouvons un exemple accompli dans les phrases de Xunzi et du Livre des rites citées plus haut, comme une tentative d’éliminer le doute, de le rendre incongru, voire sacrilège ? Or, le doute revient, qu’il porte sur la sincérité des acteurs[53], ou sur l’efficacité du rituel, voire sur sa nécessité. De nombreuses critiques prononcées à l’encontre des ritualistes, déjà dans le Mozi 墨子 et dans le Zhuangzi 莊子[54], ciblent leur manque de sincérité. Les auteurs du Zhuangzi vont plus loin en considérant que c’est l’insistance mise à imposer les rites et la vertu au peuple qui suscite le trouble[55]. Selon Yuri Pines, la période des Royaumes Combattants à laquelle appartiennent ces ouvrages est la dernière, avant le xxe siècle, où le principe d’un « système rituel » a pu être contesté[56].
Premiers visés par ces critiques, les confucéens n’ignorent pas que pour exercer son pouvoir transformateur et civilisateur, un rituel nécessite l’engagement de la personne tout entière, appelée à manifester la vertu appelée cheng 誠, un mot qui renvoie à la notion d’accomplissement, bien qu’il soit le plus souvent traduit, faute de mieux, par « sincérité ». Nous avons déjà vu le rôle que joue la musique dans la mise au diapason émotionnel des participants à une cérémonie solennelle, mais une telle forme de communion ne suffit plus alors que se délite l’ordre instauré par les anciens rois. Rendre les émotions visibles et lisibles, et par conséquent interprétables, devient une nécessité pour les seigneurs et leurs conseillers. Quoi de plus suspect, en effet, dans un monde en guerre, miné par le soupçon, qu’un courtisan ou un diplomate maîtrisant parfaitement le langage des rites ?
La sincérité se donne au contraire à voir dans le vacillement qui ferait presque trébucher le fils lorsqu’il accomplit les rites funéraires pour ses parents, assisté par son épouse : « Si absorbés et sincères, ils se meuvent comme s’ils étaient incapables de supporter le poids [des objets requis pour les sacrifices] et comme s’ils étaient sur le point de les laisser tomber[57] ». L’état de confusion (huanghu 荒惚) dans lequel les a plongés leur douleur qui rend possible le faux-pas dans l’accomplissement du rituel est précisément ce qui leur permet de participer de l’état liminaire du défunt[58], de se rapprocher des esprits et de répondre à l’intention (zhi 志) profonde du rituel. L’accomplissement des rites, et plus particulièrement des rites funéraires par lesquels le père accède au statut d’ancêtre, va au-delà de la délivrance d’une performance impeccable, il nécessite un réglage émotionnel d’une grande subtilité. Cette question est au coeur de deux études récentes, qui abordent de manière détaillée le lien entre rite et vertu.
C’est à la nécessité de définir les modes d’action proprement vertueux et, de manière plus pragmatique, de se prémunir contre la tromperie que répond le traité Wuxing 五行, un texte dont furent mises au jour deux versions fragmentaires dans des tombes remontant, pour la plus ancienne, à 278 aec, et auquel Mark Csikzentmihalyi a consacré une importante étude[59]. La similitude des caractères ne doit pas nous induire en erreur : xing 行 n’a pas ici le sens d’« agent régulant la marche du monde » qu’il a dans les cosmologies élaborées à la fin de la période des Royaumes Combattants et qu’il gardera par la suite. Dans cet ouvrage, il prend plutôt le sens qui lui est apparenté de « manifestation extérieure d’une disposition intérieure ». Plus spécifiquement, il désigne les conduites morales. Le Wuxing, traduit par Les Cinq types d’actions vertueuses, traite essentiellement de la manière de faire advenir les grandes vertus « classiques » (bienveillance ren 仁, sens du devoir yi 義, sagesse zhi 智, ritualité li et sheng 聖, pour lequel Csikzentmihalyi propose le sens inhabituel de « discernement »), et il établit les critères permettant de distinguer les rites et les actions accomplies pour des motifs vertueux de celles répondant à d’autres desseins[60].
Bien avant les anthropologues contemporains passés en revue par Catherine Bell, ce petit traité donne une réponse originale à une question fondamentale de la théorie du rituel portant sur le lien entre pensée et action. Adopter une conduite véritablement vertueuse implique la présence de trois dispositions mentales : jing 精, traduit par « attention sélective », chang 長, prenant le sens particulier de « capacité de réfléchir aux conséquences à long terme de ses actes », et jing 徑, dont le premier sens est « sentier », mais qui signifie ici le fait d’aller droit au but sans tenir compte d’interférences extérieures[61]. Le développement de ces dispositions implique un entraînement des sens et particulièrement de la vue et de l’ouïe : le but étant de devenir « clairvoyant » (ming 明) et « perspicace » (cong 聰), deux caractères que combine le chinois moderne pour former le mot « intelligence » (congming 聰明), mais qui dans leur sens premier renvoient à une culture du corps. Car, toujours selon Mark Csikzentmihalyi, il ne s’agit pas seulement de parvenir à capter les bons exemples grâce à ses sens aiguisés, mais aussi de se doter des qualités du jade. La métaphore se faisant métonymie, la pureté de cette matière quasi divine viendra en quelque sorte s’incarner dans l’éclat du visage et de la voix des êtres d’exception, les rendant ainsi éminemment repérables. Le physique, le mental et le matériel emprunté au monde non humain se rencontrent pour façonner l’être parfaitement fiable, dont la conduite rituelle reflétera l’ordre du monde au lieu de le menacer.
Cette transformation est rendue possible par l’acquisition d’une aptitude particulière rendue par le terme du 獨. Traduit ordinairement par « solitude », du doit être pris dans ce contexte particulier comme la capacité de se mettre à l’écoute de son intériorité, sans se laisser détourner par des interventions extérieures. Plus en amont encore, et tout à l’origine de ce processus de perfectionnement physique et moral, prend place ce que Csikzentmihalyi décrit comme une forme d’anxiété (you 憂), une insatisfaction éprouvée devant l’état des choses engendrant un état d’intranquillité, auquel il faut remédier par l’adoption d’une conduite modelée par le rite.
C’est à cet affect que Michael Ing s’intéresse plus particulièrement : soulignant le fait que le projet de mener une vie vertueuse peut être générateur d’anxiété, il s’interroge sur ce qui peut menacer l’efficace du système rituel, qu’il décrit classiquement comme une sorte de pis-aller visant à recréer l’ordre perdu des temps mythiques. Le résultat n’est pas garanti, car comme l’expose le « Traité sur les digues » (Fangji 坊記) du Livre des rites, même si l’ordre rituel est institué, il y aura toujours des gens pour le violer. Dans un long discours attribué à Confucius, qui occupe presque la totalité du chapitre, sont énumérés les institutions les plus sacrées et les rites destinés à les préserver, et à chaque fois revient le constat amer de la fragilité de ce qui fait barrage au flot des désirs humains. L’ordre n’est pas parfait et les rites échouent à le préserver. Tel est le constat, bien propre à susciter le doute et l’anxiété, auquel serait arrivé le grand sage, qui lui-même aurait commis des erreurs dans sa pratique du rituel[62].
Si l’on admet que les rites peuvent échouer ou présenter des ratés, à qui ou à quoi faut-il imputer ce ratage ? À celui qui les a — mal — accomplis ? à l’ambiguïté des textes ? ou à une faille venant miner le système rituel en son entier ? Depuis l’époque où furent institués les rites par les anciens rois, les temps ont changé et ils doivent être adaptés en évaluant les rapports de force (quan 權) et en sachant reconnaître ce qui est approprié (yi 義). Les traités de rituel sont d’une grande utilité, car en consignant (ji 記) les exemples du passé, ils permettent par extension analogique (tui 推) de trouver la bonne réponse aux problèmes actuels. Mais, outre le risque toujours présent d’erreur humaine, cette manière de procéder laisse planer une autre menace, inhérente à la nature de l’analogisme : celle de déboucher sur une prolifération prescriptive, sans que jamais les nouveaux rituels ou les anciens remis au goût du jour ne puissent rattraper la diversité mouvante du réel.
Certains échecs ne sont pas imputables à l’erreur humaine ni même à la faiblesse du système, ils font intervenir la notion de destin (ming 命). C’est ce qui amène Michael Ing à recourir à la notion de tragique[63], entendant par là que « la ligne entre la capacité d’agir (agency) et le destin peut s’estomper et [que] le “bon” choix n’est pas toujours évident, même pour un sage[64] ». Ce faisant, cet auteur reconnaît qu’il s’inscrit à contre-courant d’une tradition bien établie dans la littérature sinologique, selon laquelle le sentiment du tragique serait étranger aux Chinois[65].
L’homme rituel est vulnérable et soumis à l’action du temps. Les rituels ne sont pas, comme le soutenaient les auteurs d’un ambitieux ouvrage récent, des « staged productions of timelessness[66] ». Le confort étouffant d’un système présentant un caractère totalisant est menacé par l’inquiétude, le doute et le tragique. Pour Michael Ing, ces affects, en entraînant la nécessité de « faire attention » (shen 慎, un mot pour lequel il propose le composé « cautious-anxiety ») sont ce qui assure le succès paradoxal du rite. Nous ne sommes pas dans la joie évoquée par Xunzi, mais c’est une bonne nouvelle tout de même, car c’est dans ces failles minant un ordre symbolique trop parfait que vient se nicher la créativité humaine.
*
Dans cet essai, j’ai tenté de montrer comment, au prix d’une certaine perte de substance, les rites répertoriés dans les traités constitués en canon à la fin de la période des Royaumes Combattants furent intégrés en « système », ce que Yuri Pines appelle « the Universal Panacea ». Le modèle idéal de « gouvernement par les rites » perdu et à retrouver — gouvernement de soi, du pays et des entités spirituelles qui le peuplent — peut dès lors apparaître comme la forme prise au début de l’Empire par le « fantasme d’un ordre parfait ». Or, cet ordre n’est pas parfait. On peut trouver deux causes à cette imperfection. La première, d’ordre logique, résulte de l’inscription de grands pans de la pensée chinoise dans une cosmologie analogiste, au sens donné à ce terme par Philippe Descola. Pour ce dernier, le propre de l’analogisme est d’échouer à enserrer les collectifs composés d’humains et de non-humains dans des réseaux de correspondances suffisamment solides pour faire barrage aux dangers de dissolution dans l’infini divers. La deuxième cause est d’ordre psychologique. Imposant aux sujets le devoir de mettre en adéquation intériorité et extériorité, de rendre visible et lisible leur for intérieur, le système rituel les engage dans un questionnement angoissant portant sur la qualité de leur performance et la sincérité de leurs sentiments. Michael Ing aboutit ainsi à la conclusion paradoxale que c’est en ratant les rites de deuil, sans doute ceux par lesquels s’exprimait avec le plus de force le sentiment d’appartenance à l’humanité civilisé, que le sujet répondait le mieux à l’exigence éthique qui sous-tend la pratique rituelle. L’ordre parfait recherché par les ritualistes est donc bien un fantasme, mais pour qu’éclate la bulle enchantée du fantasme, il faut en prendre conscience. C’est par l’acceptation de la boiterie inhérente au rite que pourra s’amorcer la traversée du fantasme de l’ordre parfait.
Parties annexes
Notes
-
[1]
On ne trouve rien à son sujet, par exemple, dans Barbara Cassin, dir., Vocabulaire européen des philosophies, Paris, Seuil, 2019. Même silence dans Paul Foulquié, Raymond Saint-Jean, Dictionnaire de la langue philosophique, Paris, PUF, 1962.
-
[2]
Une célèbre querelle des rites opposa pendant plus d’un siècle les théologiens sur l’attitude qu’il convenait d’adopter face à certains rites (ceux que les plus accommodants jugeaient inoffensifs) pratiqués par les convertis d’Asie ou d’Amérique. Elle fut tranchée en 1744 par le pape Benoît XIV, qui interdit les « rites non chrétiens ». Les jésuites, installés en Chine depuis la fin du xvie siècle et partisans d’une adaptation aux coutumes locales, furent les premiers à traduire les ouvrages canoniques en latin pour soutenir leur position dans le cadre de cette controverse, donnant ainsi accès aux textes originaux, d’abord au pape et aux théologiens, puis à un vaste public cultivé (voir Nicolas Standaert, « Chinese Voices in the Rites Controversy : The Role of Christian Communities », dans Ines G. Zupanov, Pierre Antoine Fabre, dir., The Rites Controversies in the Early Modern World, Leiden, Boston, Brill, 2018, p. 56-58). C’est donc à travers ce filtre que nous est parvenue la réflexion sur le rite tenue par les élites chinoises de l’empire finissant.
-
[3]
Je justifie ces insolents guillemets par mon extériorité au champ de la philosophie et aux débats qui s’y tiennent sur la pertinence de l’emploi de ce mot pour qualifier ce qu’Anne Cheng appelle plus prudemment « la pensée chinoise ». « Is “Chinese Philosophy” a Proper Name ? A Response to Rein Raud » (Philosophy East and West, 56, 4 [2006], p. 625-660), telle est la question que se posait il y a quelques années la philosophe et sinologue Carine Defoort. Vue depuis le terrain de l’anthropologue où je me situe, la question de savoir si l’on peut parler ou non de « philosophie chinoise » lorsque ce terme s’applique aux ouvrages anciens, et non pas à l’abondante production actuelle, ne paraît pas cruciale. Dans un brillant article, Joël Thoraval adopte cette position de doute méthodologique et montre l’importance que prit l’institution universitaire occidentale, arrivée en Chine par l’intermédiaire du Japon, dans la constitution de ce qui serait rapidement appelé à devenir une discipline (presque) comme les autres (Joël Thoraval, « Quelques remarques sur le philosophique et le non-philosophique vus par un anthropologue », Ebisu, 37 [2007], p. 47-70). L’Université, donc, et non plus les académies, les temples et les demeures privées, où la recherche de la « sagesse » s’accompagnait de pratiques corporelles et rituelles participant d’un rapport au monde condamné par la modernité à laquelle aspiraient les intellectuels nouveaux. Plus qu’une interrogation sur le nom « philosophie chinoise », ce sont les questions jumelles de la place faite à la « philosophie chinoise », dans l’institution universitaire et des barrières dressées par les disciplines voisines pour préserver leur domaine, ou leur noyau, qui étaient au coeur de la « 11th East-West Philosophers’ Conference » tenue à Hawaï en mai 2016, dont les actes furent publiés un an plus tard dans la revue Philosophy East & West, 67, 4 (2017). On peut y découvrir les contributions de Carine Defoort, « ‘Chinese Philosophy’ at European Universities : A Threefold Utopia », et d’Amy Olberding, « Philosophical Exclusion and Conversational Practices », et la conversation parfois animée qu’elles ont suscitée.
-
[4]
Martin Kern, « Bronze Inscriptions, the Shijing and the Shangshu : The Evolution of the Ancestral Sacrifice During the Western Zhou », dans John Lagerwey, Mark Kalinowski, dir., Early Chinese Religion : Shang through Han (1250 bc-220 ac), Leiden, Brill, 2009, p. 257.
-
[5]
Kenneth Brashier, Ancestral Memory in Early China, Cambridge, London, Harvard University Press, 2011, p. 50, resserre l’intervalle et propose la date de 50 aec comme faisant consensus chez bon nombre d’historiens.
-
[6]
Le jésuite Séraphin Couvreur (1835-1919) en a donné une traduction en français et en latin intitulée Li Ki, ou mémoires sur les bienséances et les cérémonies, 2 vol., Paris, Cathasia, 1950. Sa traduction anglaise, due à James Legge (1815-1897) a été publiée en 1885 à Oxford dans la collection « Sacred Books of the East ». On trouvera une excellente introduction à cet ouvrage et à la notion de li dans le premier chapitre de Michael David Kaulana Ing, The Dysfunction of Ritual in Early Confucianism, Oxford, Oxford University Press, 2012.
-
[7]
Selon Michael Puett, l’idée selon laquelle la pratique rituelle aurait été unifiée dans l’Antiquité est imputable à Zheng Xuan 鄭玄 (127-200). Pour cet important commentateur des ouvrages canoniques, « les contradictions apparues dans les fragments qui ont subsisté résultaient simplement d’une mauvaise transmission ou des connaissances lacunaires des générations suivantes. Une herméneutique correcte impliquait par conséquent de colliger les compendia rituels et d’en rechercher l’unité sous-jacente » (Michael Puett, « Combining the Ghosts and Spirits, Centering the Realm : Mortuary Ritual, and Political Organization in the Ritual Compendia of Early China », dans J. Lagerwey, M. Kalinowski, dir., Early Chinese Religion, p. 71).
-
[8]
Les anthropologues savent combien de chausse-trappes se dissimulent derrière l’usage de ces termes, et c’est avec une pointe de malice que Catherine Bell cite la phrase d’Edmund Leach : « [There is] the widest possible disagreement as to how the word ritual should be understood », en exergue de son influent essai, Ritual Theory, Ritual Practice, Oxford, Oxford University Press, 1991.
-
[9]
C’est le choix qu’opère Alain Arrault, dans son article « En suivant les pas de Yu le Grand. D’un rite exorciste à un rituel d’action de grâce », dans Gladys Chicharro, Stéphane Gros, Adeline Herrou, Aurélie Névot, dir., Le féminin et le religieux. Mélanges offerts à Brigitte Baptandier, Paris, L’Asiathèque, 2022, p. 135-186.
-
[10]
Ce caractère aurait désigné sur les inscriptions oraculaires un grand tambour en usage lors des cérémonies rituelles selon le Grand dictionnaire Ricci de la langue chinoise, 6 vol., Paris, Taipei, Desclée de Brouwer, 2006, vol. II, p. 642. Léon Vandermeersch y voit plutôt le pictogramme d’un vase de type dou 豆, généralement traduit par « patère », dans lequel étaient servis les viandes cuites et les brouets lors des sacrifices ancestraux (Léon Vandermeersch, Wangdao ou la Voie royale. Recherche sur l’esprit des institutions de la Chine archaïque, t. II, Structures politiques. Les rites, Paris, École française d’Extrême-Orient, 1980, p. 275). Dans les deux cas, le lien avec le culte est avéré.
-
[11]
Gilles Boileau, Politique et rituel dans la Chine ancienne, Paris, Collège de France, Institut des Hautes études chinoises, 2013.
-
[12]
Cf. Yuri Pines, Foundations of Confucian Thought. Intellectual Life in the Chunqiu Period, 722-453 bce, Honolulu, University of Hawai’i Press, 2002, chap. 3 et, plus particulièrement, p. 91-92.
-
[13]
Pour reprendre l’heureuse expression de Gilles Boileau, Politique et rituel dans la Chine ancienne, p. 368.
-
[14]
Xunzi 19, dans l’édition de Li Disheng 李滌生, Xunzi jishi 荀子集釋, Taipei, Taiwan xuesheng shuju, 1979, p. 417, cité dans la traduction d’Anne Cheng, Histoire de la pensée chinoise, Paris, Seuil, 1997, p. 214. Ces propos, formulés en des termes très généraux et « moraux », prennent de plus vives couleurs quand on les lit à la lumière des théories de Gilles Boileau sur le sacrifice, et particulièrement sur les pages qu’il consacre au partage de la viande opéré par les rois et les hauts seigneurs de la dynastie des Zhou (cf. G. Boileau, Politique et rituel dans la Chine ancienne, chap. IV, et plus particulièrement p. 286-293). Cette « boucherie sacrificielle » (ibid., p. 394) avait perdu son efficace à l’époque où vécut Xunzi, mais Boileau en repère les traces dans la littérature normative des siècles suivants. Sur la vertu de la différentiation opérée par le rite, voir les p. 172-178 du même ouvrage.
-
[15]
Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962, p. 17.
-
[16]
M.D.K. Ing, The Dysfunction of Ritual, p. 20.
-
[17]
Ibid., et plus loin dans l’ensemble du livre.
-
[18]
Ibid., p. 119.
-
[19]
Marcel Granet, La pensée chinoise, Paris, Albin Michel, 1968 (1re édition 1934).
-
[20]
Grand dictionnaire Ricci de la langue chinoise, vol. I, p. 763.
-
[21]
Xunzi 20, p. 455.
-
[22]
On trouvera une évaluation des avantages et des inconvénients que présente cette approche du rituel dans C. Bell, Ritual Theory, Ritual Practice, p. 37-46. Kenneth Brashier, cité ibid., p. 48, voit les textes rituels comme des « performance scripts » et met moins l’accent sur la dimension « théâtrale » suggérée par le choix de ce terme que sur la possibilité donnée par la performance de fournir un cadre spatio-temporel à l’action. Plus que des représentations, les rituels de deuil sur lesquels se base son analyse sont des expériences.
-
[23]
Yuri Pines, « Disputers of the “Li” : Breakthroughs in the Concept of Ritual in Preimperial China », Asia Major, 13, 1 (2000), p. 9.
-
[24]
Xunzi 19, p. 427.
-
[25]
M.D.K. Ing, The Dysfunction of Ritual, p. 7. La traduction française, dont je suis l’autrice, suit la traduction anglaise de cet auteur.
-
[26]
All about the Rites : From Canonized Ritual to Ritualized Society (21-22 juin 2018). À l’heure où j’écris ces lignes, ces travaux n’ont pas encore été publiés, mais on peut suivre les interventions des participants sur le site du Collège de France, à l’adresse [http://www.college-de-france.fr/site/anne-cheng/symposium-2017-2018.htm].
-
[27]
Cf. « The Funerary Rituals of Early China in the Light of the Archaeological Vestiges from the First Millennium bc », sur le site du colloque.
-
[28]
Cf. « Changes to Imperial Rites from Western to Eastern Han », sur le site du colloque.
-
[29]
Marc Kalinowski, Cosmologie et divination dans la Chine antique. Le Compendium des cinq agents (Wuxing dayi, vie siècle), Paris, Éditions de l’École française d’Extrême-Orient, 1991.
-
[30]
Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005, p. 14.
-
[31]
Ibid., p. 13.
-
[32]
Angus C. Graham, Yin-Yang and the Nature of Correlative Thinking, Singapore, Institute of East Asian Philosophies, 1986, p. 2.
-
[33]
C. Lévi-Strauss, La pensée sauvage, p. 25.
-
[34]
Michael Loewe, « The Religious and Intellectual Background », dans Denis Twitchett, John Fairbank, éd., The Cambridge History of China. Volume I. The Ch’in and Han Empires, 221 bc-ad 220, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, p. 688-692.
-
[35]
A.C. Graham, Yin-Yang and the Nature of Correlative Thinking, p. 14. C’est l’auteur qui souligne.
-
[36]
On peut faire intervenir ici la notion de « frontière épaisse » que les anthropologues ont empruntée aux mathématiciens, dans laquelle la frontière séparant non seulement des aires géographiques, mais aussi des pratiques et des concepts, apparaît comme une zone et non pas comme une ligne. Voir Aude Monod-Becquelin, « Introduction. La frontière épaisse », Ateliers d’anthropologie, 37 (2012) [https://doi.org/10.4000/ateliers.9170.], consulté le 22/09/2021.
-
[37]
Cf. supra, p. 468.
-
[38]
Philippe Descola, Les formes du visible, Paris, Seuil, 2021, p. 264. Les hybridations auxquelles donnent lieu ces superpositions et ces mélanges ont été abordées de manière détaillée à partir d’exemples concrets dans son cours de l’année académique 2017-2018 au Collège de France.
-
[39]
Philippe Descola consacre peu de pages à la Chine, et c’est sans doute mieux ainsi, car en nous faisant goûter à la complexité parfois vertigineuse des cosmologies africaines et amérindiennes, il nous fait échapper à la comparaison classique entre les deux « super-champions » que seraient la Chine et l’Occident — la Grèce —, chacun « pris » dans l’ontologie qui lui est propre.
-
[40]
Le terme xing 行, traduit par « marche », « pas », ou « agent » dans ce cas précis, permet de rendre compte de la marche dynamique et ordonnée de l’univers. Les Cinq Agents (Eau, Bois, Terre, Feu, Métal) jouent un rôle essentiel dans le système de correspondances qui s’élabore à la fin de la période des Royaumes Combattants. Chaque portion de l’espace-temps, à laquelle se trouve associé un nombre croissant d’éléments, est tour à tour régie par l’un de ces Agents, qui lui donne sa coloration particulière avant d’être remplacé par le suivant, par conquête ou par engendrement. Une défaillance de l’un ou l’autre de ces Agents entraîne des déséquilibres plus ou moins graves dans le microcosme et le macrocosme.
-
[41]
Encore une fois, la densité de sens des caractères chinois pose d’épineux problèmes au traducteur. Jing est le nom des fils de chaîne d’un tissage et, par métonymie, ce terme désigne le métier à tisser et même l’acte de tisser (c’est le sens qui a été préféré ici par Michael Ing, et que je reprends, bien que jing soit rarement employé comme verbe). Mais ce mot désigne aussi ce que l’on appelle « les classiques », soit un certain nombre d’ouvrages canoniques, pas tous confucéens, qui constituent l’armature d’une tradition. Le rituel et le textuel s’entretissent ainsi pour mieux lier l’humain par le rite.
-
[42]
Liji 45.13, cité dans M.D.K. Ing, The Dysfunction of Ritual, p. 25. Comme à la page suivante, la traduction française suit la traduction anglaise de cet auteur.
-
[43]
Pour une discussion sur ce titre, cf. ibid., p. 4.
-
[44]
Il s’agit d’un diagramme inscrit sur le dos d’un cheval-dragon jailli des flots, reproduisant les chiffres inscrits dans le carré magique correspondant à la série des Cinq Agents.
-
[45]
Sorte de licorne dont la présence annonce la venue d’un Sage.
-
[46]
Liji 9.36. Cité dans M.D.K. Ing, The Dysfunction of Ritual, p. 184.
-
[47]
Cf. supra, n. 28, p. 467.
-
[48]
P. Descola, Par-delà nature et culture, p. 329.
-
[49]
Il est, par exemple, bien connu que les ritualistes de l’ère impériale, chargés de reconstruire la Maison du calendrier, ne parvinrent jamais à se mettre d’accord sur la forme à donner à ce bâtiment, ni sur la nature exacte des rites qui s’y déroulaient.
-
[50]
Carlo Severi, Le principe de la chimère. Une anthropologie de la mémoire, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2007, p. 228.
-
[51]
Ibid.
-
[52]
C. Bell, Ritual Theory, Ritual Practice, a bien montré la prégnance de la dichotomie entre pensée et action dans les théories occidentales portant sur le rituel, celui-ci étant considéré comme une forme particulière d’action, ou, au mieux, comme le truchement par lequel s’opérait in fine la réconciliation entre pensée et action. Cette position théorique, porteuse de jugements de valeurs plus ou moins explicites dont on trouve un exemple dans l’opposition évoquée plus haut entre « philosophes » et spécialistes des arts divinatoires et rituels, recoupe en partie le postulat de la primauté de l’orthopraxie sur l’orthodoxie en contexte chinois. On se référera notamment au débat qui opposa sur cette question l’anthropologue James Watson à l’historienne Evelyn Rawski dans l’ouvrage qu’ils ont co-édité, Death Ritual in Late Imperial and Modern China, Berkeley, University of California Press, 1988.
-
[53]
La réflexion sur la sincérité et la pertinence de cette notion pour aborder le rituel n’est pas l’apanage des critiques du ritualisme confucéen. Elle se retrouve chez plusieurs chercheurs contemporains. Citons, par exemple, cet ouvrage co-écrit par un spécialiste du fait religieux, deux sinologues, respectivement anthropologue et historien, et un psychanalyste : Adam Seligman, Robert Weller, Michael Puett, Bennett Simon, Ritual and Its Consequences. An Essay on the Limits of Sincerity, Oxford, Oxford University Press, 2008.
-
[54]
Cf. Mark Csikzentmihalyi, Material Virtue : Ethics and the Body in Early China, Leiden, Brill, 2004, p. 35 et suiv.
-
[55]
Ibid., p. 46 et suiv.
-
[56]
Y. Pines, « Disputers of the “Li” », p. 4.
-
[57]
Liji 25.9-11.
-
[58]
M.D.K. Ing, The Dysfunction of Ritual, p. 81-82. Dans un article célèbre, Granet avait déjà montré à quel point le rituel funéraire visait à transformer les participants en quasi-morts : Marcel Granet, « Le langage de la douleur d’après le rituel funéraire de la Chine classique », dans Études sociologiques sur la Chine, Paris, PUF, 1953 (1re édition 1922), p. 222-242.
-
[59]
M. Csikzentmihalyi, Material Virtue.
-
[60]
Ibid., p. 67.
-
[61]
Ibid., p. 75-76.
-
[62]
C’est ce qu’expose Ing dans son chapitre intitulé « The Ancients Did not Fix Their Graves » (M.D.K. Ing, The Dysfunction of Ritual, chap. 7).
-
[63]
Il n’est pas question, bien sûr, d’entamer ici un débat sur l’usage de ce mot, qui peut provoquer d’intenses vibrations chez les lecteurs des textes de notre propre tradition.
-
[64]
Ibid., p. 155.
-
[65]
Ibid., p. 155 et suiv.
-
[66]
Jens Kreinath, Jan Snoek, Michael Stausberg, Theorizing Rituals, Leiden, Brill, 2006, p. 260.