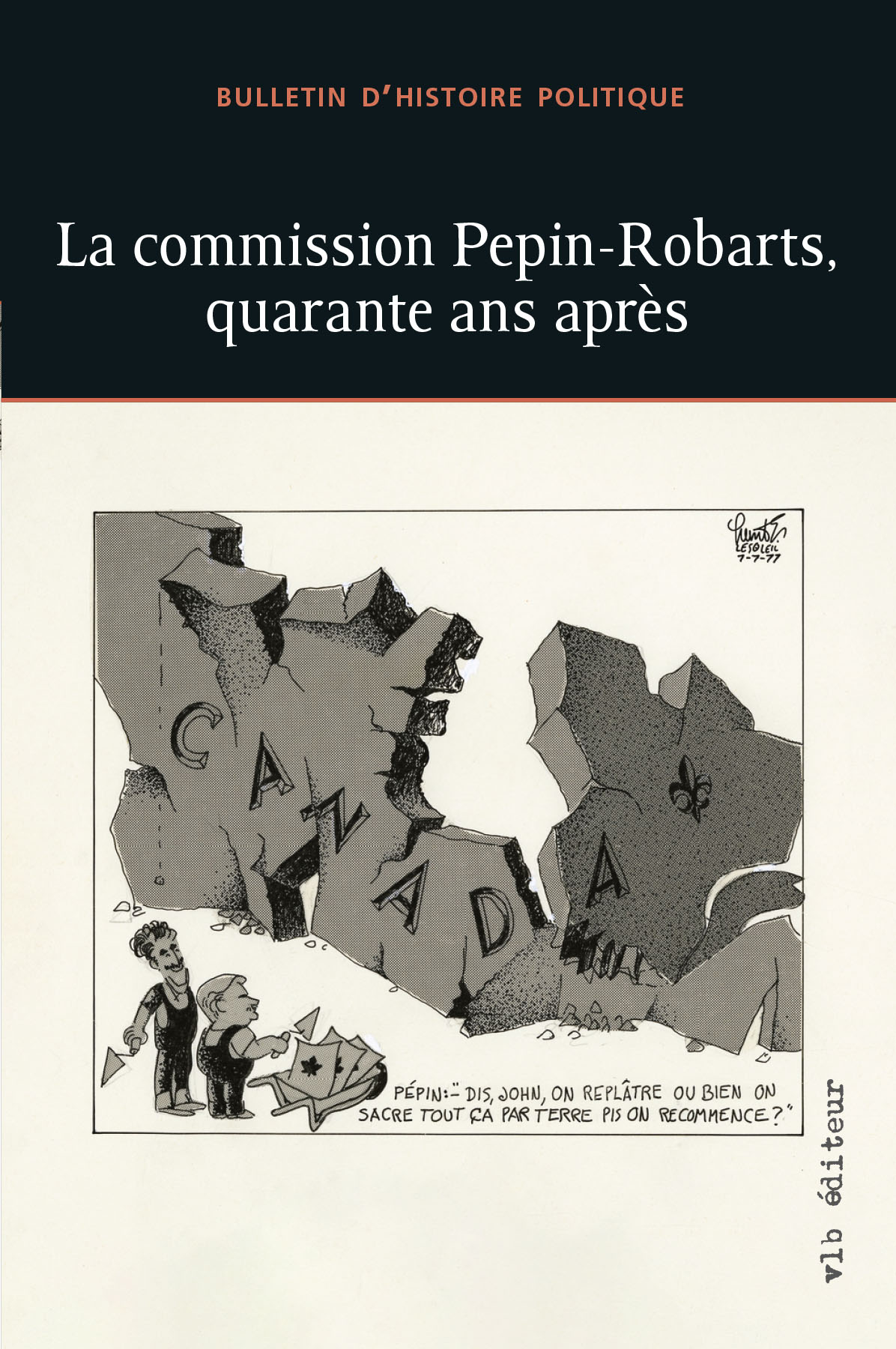Corps de l’article
Dans son tour d’horizon des commissions d’enquête dans le système parlementaire canadien, le politologue James Ian Gow faisait remarquer qu’il faut porter une attention particulière aux intentions des gouvernements qui font appel à elles. Elles permettent, entre autres, d’aborder des questions complexes, peuvent servir à gagner du temps ou préparer l’opinion publique à une intervention gouvernementale. Ses membres peuvent être choisis pour obtenir un rapport qui va dans le sens des attentes gouvernementales[1]. Quoi qu’il en soit, une fois créées, elles jouissent d’une grande indépendance et peuvent interpréter librement le mandat qui leur a été attribué. Cela étant, elles peuvent éventuellement prendre une importance stratégique, même lorsque le gouvernement du jour n’y donne pas suite, dans la mesure où elles peuvent jeter les bases idéologiques donnant une certaine légitimité aux changements proposés qui alimenteront ultérieurement les débats. En d’autres termes, elles peuvent semer des graines qui finiront par germer[2].
À court terme, tel ne fut pas le cas de la commission Pepin-Robarts, dont l’analyse et les recommandations étaient dissonantes par rapport aux transformations institutionnelles qui ont marqué le début des années 1980. Peut-être était-ce l’intention de départ ? Le chef du Nouveau parti démocratique de l’époque, Ed Broadbent, rapportait que « Jean-Luc Pepin [lui avait] dit un jour que chaque fois qu’il y avait une question politiquement sans issue à traiter, Trudeau lui demandait de s’en occuper[3] ». Néanmoins, à moyen terme, l’esprit du rapport a alimenté, pendant un temps, les propositions constitutionnelles à la fois de certaines élites politiques québécoises (notamment le Livre beige de Claude Ryan, qui précisait la position constitutionnelle du Parti libéral du Québec [PLQ] à la veille du référendum de 1980) et canadiennes (d’une certaine manière, les accords de Meech [1987] et de Charlottetown [1992] se sont inspirés de cette vision). Les deux tentatives de modification substantielle de la Constitution se sont soldées par des échecs. La « troisième voie » proposée par le gouvernement conservateur de Brian Mulroney, qui s’inscrivait dans le sillage de la philosophie de Pepin-Robarts, fut rejetée par une majorité de Canadiens et de Québécois (pour des raisons différentes) et les pourparlers à saveur constitutionnelle sont devenus radioactifs pour la classe politique. À long terme, les propositions de la commission semblent être tombées en désuétude.
Depuis 1867, le gouvernement fédéral a mis sur pied pas moins de 370 commissions d’enquête[4]. Peu d’entre elles se sont penchées spécifiquement sur des enjeux associés aux relations intergouvernementales, à l’unité nationale ou aux problèmes constitutionnels. Il y eut, certes, celles portant sur la création de nouvelles provinces ou les « problèmes territoriaux » liés aux Métis et aux Premières Nations (1875, 1876, 1901, 1906, 1923, 1929, 1958 et 1959). Il y eut aussi, pour rendre compte des défis posés par la Grande Dépression provoquée par le krach boursier de 1929, la Commission royale des relations entre le Dominion et les provinces (Rowell-Sirois – 1937-1940), qui a abordé la situation économique et financière du Canada. Elle s’est notamment intéressée à ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler le déséquilibre fiscal, tout en privilégiant une approche centralisatrice et fonctionnelle du fédéralisme canadien qui continue encore largement à servir de point de référence quant à la manière d’appréhender le fédéralisme dans la littérature d’expression anglaise[5]. Toutefois, seulement trois commissions ont directement abordé les tensions pérennes sous l’angle des rapports entre la majorité anglo-canadienne et la minorité d’expression française : la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (Laurendeau-Dunton – 1963-1970), la Commission de l’unité canadienne (Pepin-Robarts – 1977-1979) et le Forum des citoyens sur l’avenir du Canada (Spicer – 1990-1991). Elles correspondent à la période où les piliers du temple constitutionnel canadien étaient ébranlés, voire où l’existence même du Canada comme entité fédérale était menacée, par les revendications autonomistes ou les velléités indépendantistes qui s’exprimaient au Québec.
Il n’en demeure pas moins que s’il existe une abondante littérature sur la commission Laurendeau-Dunton, les travaux portant sur les deux autres se font plutôt rares. Elles s’inscrivent dans un moment particulier de l’histoire politique marquée par l’intensité des débats constitutionnels qui ont précédé, pour la commission Pepin-Robarts, le rapatriement de la Constitution (1981-1982) et, pour le Forum des citoyens, l’entente de Charlottetown et le référendum pancanadien qui s’est ensuivi (1992). Une partie de l’explication tient probablement au fait que les recommandations formulées par les commissaires Jean-Luc Pepin et John Robarts n’ont pas été retenues par le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau, qui avait déjà une idée assez précise de la voie qu’il comptait suivre.
Il a fallu attendre plus de deux décennies pour que la Commission fasse l’objet d’un colloque. En effet, le Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa organise en mars 2001 un colloque réunissant une dizaine de chercheurs qui l’ont principalement abordée sous l’angle de la dualité linguistique, nationale et du régionalisme[6]. Le titre choisi par les organisateurs de ce colloque est évocateur : Le débat qui n’a pas eu lieu. Dans la présentation de cet ouvrage, l’historien Jean-Pierre Wallot souligne que, « hormis pour l’insertion de droits linguistiques dans la Charte des droits de 1982, la plupart de ses recommandations majeures ont abouti “sur les tablettes”, faute de volonté politique pour y donner suite[7] ». Même si les enjeux soulevés par le Québec n’ont pas été résolus, la crise politique qui a justifié la création de la Commission s’est résorbée par l’échec du référendum de 1980, et certains verrous ont été enchâssés dans la Loi constitutionnelle de 1982. Wallot mentionne que de nouvelles questions plus pressantes ont accaparé l’attention de la classe politique : l’insertion du Canada dans la mondialisation néolibérale, la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, les revendications des Premières Nations, les aspirations régionales, la mobilisation des intérêts autour des nouveaux ayants droit reconnus par la Charte canadienne des droits et libertés. En somme, les débats constitutionnels ne sont plus au goût du jour puisque le gouvernement fédéral a, en quelque sorte, répondu sinon bloqué, à sa manière, les aspirations portées par les élites politiques québécoises s’inscrivant dans la mouvance nationaliste. L’affaire est entendue, la crise de l’unité nationale est chose du passé, il faut donc passer à autre chose.
Cela étant dit, les travaux de la Commission ne sont pas irrémédiablement tombés dans l’oubli. Dans l’ouvrage cité plus haut, André Burelle, ancien conseiller constitutionnel des gouvernements Trudeau et Mulroney, souhaitait, deux décennies plus tard, une mise à jour du rapport en réponse à l’héritage laissé par le libéralisme individualiste juridique et économique du premier ministre Pierre Elliott Trudeau[8]. Il proposait que le Canada souscrive à une citoyenneté supranationale qui réconcilierait les nations civiques et territoriales du Québec et du reste du Canada, ainsi que les nations autochtones et qui se traduirait par un fédéralisme décentralisé et asymétrique mettant l’accent sur le principe partenarial. En somme, il proposait un nouveau contrat social et une adaptation du régime fédéral pour donner corps à ce contrat[9]. Comme nous le savons, cet appel n’a pas été entendu. Non seulement le gouvernement fédéral a-t-il fait la sourde oreille, mais certains analystes du Canada anglais, dont le très respecté politologue Alan C. Cairns, se sont opposés à une approche qualifiée de trop décentralisatrice aux seules fins de satisfaire aux doléances du Québec, et ce au risque d’affaiblir l’unité nationale[10]. Pour d’autres, le rapport posait des questions qui avaient le grand désavantage de mettre en lumière les ambiguïtés congénitales du régime politique canadien et de trancher ce noeud gordien en faveur d’une vision à la fois trop favorable au Québec et trop provincialiste, notamment en accordant une reconnaissance constitutionnelle à la notion de dualisme et au caractère distinct du Québec, en redessinant la distribution des pouvoirs, en donnant une légitimité à l’idée selon laquelle le Québec doit consentir à toute modification constitutionnelle, en atténuant le principe de l’égalité des provinces au profit de celui de l’asymétrie, en reconnaissant des droits collectifs et en questionnant l’équilibre entre la suprématie du pouvoir judiciaire et le nécessaire contrôle démocratique[11]. Quoi qu’il en soit, la question du Québec n’intéresse plus le Canada anglais[12].
Dans les travaux portant sur les relations fédérales-provinciales, et plus particulièrement ceux touchant les relations entre le Québec et le reste du Canada, les quelques mentions de la Commission se limitent généralement à faire remarquer, au passage, le fait que ses recommandations aient été ignorées et de s’en désoler. Par exemple, Michel Seymour et Alain-G. Gagnon se contentent de l’inscrire dans la longue liste des tentatives avortées d’adhésion du fédéralisme canadien au principe de l’asymétrie[13]. Pour André Burelle, Pierre Elliott Trudeau avait prêché la voie d’une conception multinationale du Canada qui avait trouvé écho dans le rapport Pepin-Robarts avant de s’en détourner et de refonder le Canada sur la base d’une conception one nation enchâssée dans la Loi constitutionnelle de 1982[14]. Un constat similaire est formulé par le politologue Guy Laforest[15]. En somme, la Commission est inscrite dans la colonne des occasions ratées pour transformer le Canada sur de nouvelles bases plus amènes à reconnaître sa diversité constitutive ou signalée au même titre que les multiples audiences publiques tenues en lien avec les débats constitutionnels de l’époque[16].
D’autres travaux font rapidement référence à certaines propositions issues de la Commission, mais sur des enjeux plus pointus. À titre d’exemple, le politologue Vincent Lemieux rappelle, dans une étude portant sur le système électoral et l’usage du référendum, la recommandation de la Commission à l’endroit du recours à cette procédure dans le cas d’amendements constitutionnels touchant les deux ordres de gouvernement[17]. Dans un texte portant sur le système judiciaire canadien, la professeure de droit Eugénie Brouillet fait référence à son existence dans une simple note de bas de page faisant la liste des rapports ayant traité des propositions de réforme de la Cour suprême du Canada[18]. D’autres juristes s’intéressant aux procédures de modification de la Constitution ont évidemment évoqué les propositions de la Commission[19]. En somme, on s’intéresse moins à la Commission elle-même qu’aux enjeux qu’elle a abordés, sans trop approfondir ni son apport ni la logique qui sous-tendait ses recommandations. L’exception à cette tendance nous semble être la riche étude que l’historienne Valérie Lapointe-Gagnon consacre à l’analyse de la pensée fédéraliste de Solange Chaput-Rolland, commissaire au sein de Pepin-Robarts, adepte de la troisième voie promue dans le rapport[20].
La Commission n’a pas non plus, à notre connaissance, fait l’objet de recherche dans le cadre de mémoires de maîtrise ou de thèses doctorales. Marc Sauvé, dans un mémoire portant sur le pouvoir fédéral de dépenser et la nature centralisatrice de la Constitution canadienne, se contente de faire référence au rapport dans une note de bas en lien avec le modèle de gestion partenariale de l’interdépendance[21]. Dans sa thèse doctorale portant sur l’accord du lac Meech, Mario Fraser y fait mention dans la section portant sur les « demandes traditionnelles » du Québec, en rappelant que, selon Claude Ryan, les revendications du premier ministre Lévesque de 1985 auraient été entre autres inspirées par le rapport de la Commission[22]. Les travaux de cette dernière ne trouvent pas plus d’écho dans le mémoire de maîtrise en histoire présenté par Jessica Riggi portant sur la question constitutionnelle chez les élites québécoises. Le mémoire se contente d’attirer l’attention sur la filiation entre la position défendue par les députés du PLQ, reposant sur le principe de la dualité, à celle qui teinte le rapport Pepin-Robarts[23]. Un dernier exemple de ce silence se trouve dans le mémoire de maîtrise en histoire de Gustavo Gabriel Santafé qui aborde la position constitutionnelle du PLQ de 1960 à 2018[24]. Le rapport n’est rappelé que dans deux notes de bas de page, tout en omettant de souligner que le Livre beige de Claude Ryan s’inscrivait dans la lignée de la philosophie, des constats et des recommandations de la Commission. Il semblerait donc que la commission Pepin-Robarts ne soit pas considérée comme une source d’inspiration et qu’elle demeure dans l’angle mort de la recherche même lorsqu’il s’avère pertinent d’en approfondir à la fois sa pensée et son influence.
Pourtant, la « troisième voie » préconisée par les commissaires s’ancre bien dans les préférences d’une majorité de Québécois : en 1980 ils ont voté « non » à la question du Parti québécois, qui sollicitait un mandat pour négocier la souveraineté-association sur la base d’un renouvellement du fédéralisme ; René Lévesque a défendu l’idée du « beau risque » que représentait l’engagement du Parti progressiste-conservateur de Brian Mulroney de négocier un fédéralisme renouvelé ; c’est aussi une troisième voie que ce dernier a cherché à ouvrir en faisant accepter par les premiers ministres provinciaux les termes de l’accord du lac Meech ; c’est encore ce pari d’un fédéralisme plus ouvert aux demandes du Québec qu’a pris le PLQ en adoptant le rapport Allaire en janvier 1991[25] ; l’entente de Charlottetown de 1992 souhaitait elle aussi réformer le fédéralisme canadien en affirmant le caractère distinct du Québec tout en transformant son architecture institutionnelle ; et plus récemment, c’est toujours cette idée d’une alternative entre le statu quo et l’indépendance qui a nourri les réflexions du PLQ des deux dernières décennies[26]. En somme, hormis les analyses menées dans le cadre du colloque organisé entre autres par Jean-Pierre Wallot vingt ans après le dépôt du rapport de la Commission, celle-ci n’a pas particulièrement retenu toute l’attention qu’elle méritait.
* * *
C’est pour combler en partie ce vide que le présent dossier entend approfondir certaines dimensions qui touchent à la fois au contexte qui a amené à la création de la Commission, à son contenu, au débat politique auquel elle a donné lieu, mais aussi à une évaluation des conséquences potentielles si certaines de ses recommandations avaient été suivies.
Le dossier s’ouvre par un « panorama » dressé par le politologue Kenneth McRoberts. Il rappelle les circonstances qui ont mené à la création de la Commission, les raisons qui ont présidé au choix de Jean-Luc Pepin et de John Robarts pour la présider ainsi que des commissaires invités à les épauler. Il présente les principaux diagnostics du rapport ainsi qu’un tour d’horizon de ses principales recommandations. Après avoir expliqué pourquoi la « troisième option » fut rejetée par le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau, il souligne, en conclusion, que les enjeux soulevés gardent leur pertinence et que la réforme des institutions proposée reste en jachère, faute de courage politique pour emprunter une voie encore inexplorée.
Il est impossible de comprendre pourquoi la Commission a été mise sur pied sans appréhender les transformations qui ont marqué la culture politique québécoise des années 1960 et 1970. À cet égard, l’analyse de la réception du rapport par les animateurs de la revue L’Action nationale proposée par Jean-Philippe Carlos est révélatrice de l’air du temps. Plusieurs intellectuels indépendantistes, critiques au moment de la création de la Commission, ont par la suite accueilli favorablement les propositions du groupe de travail qui étaient ouvertes au principe de la décentralisation. Ils insistent particulièrement sur la reconnaissance de la spécificité culturelle, linguistique et institutionnelle du Québec, voient d’un bon oeil certaines transformations institutionnelles mises de l’avant et la réinterprétation proposée du pacte confédéral de 1867. Ce positionnement illustre que plusieurs ont souscrit au projet indépendantiste par dépit, manifestant ainsi leur désillusion à l’endroit de la possibilité de voir la fédération manifester une quelconque ouverture à l’endroit de la décentralisation jugée essentielle à l’épanouissement du Québec. La mise au rancart du rapport par le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau n’a fait que raffermir leur volonté de voir le Québec se séparer du Canada, revenant ainsi à leur ligne éditoriale antérieure.
Dans la même veine, Antoine Brousseau Desaulniers s’intéresse moins aux « grands personnages » qui ont marqué l’histoire des pourparlers constitutionnels que des acteurs qu’il qualifie de « marginaux », mais qui sont tout de même intervenus lors des audiences publiques tenues entre 1977 et 1979. Ces derniers appartiennent à différents courants de pensée qui sont analysés tour à tour : les fédéralistes réformistes, les indépendantistes, les fédéralistes centralisateurs et, finalement, ceux qui remettent en question l’ordre politico-institutionnel. Au final, le rapport fut plus proche des vues avancées par les réformistes, bien que d’autres groupes, notamment les porte-parole des Premières Nations et des groupes ethniques aient contribué à rendre moins légitime la vision biculturelle de la communauté politique qui s’était manifestée dans les années 1960.
Les trois autres textes se penchent plus spécifiquement sur certaines recommandations qui touchaient certains éléments de l’architecture institutionnelle du régime politique canadien. D’abord, Dave Guénette analyse les trois recommandations qui portaient sur une modification de la formule d’amendement de la Constitution. Il rappelle qu’un élément essentiel de la proposition Pepin-Robarts reprenait à son compte la formule des veto régionaux avancés dans la Charte de Victoria de 1971 (qui n’a pas été ratifiée faute de l’accord du gouvernement du Québec alors dirigé par Robert Bourassa). Il se montre d’ailleurs étonné que hormis la proposition qui visait à « fédéraliser » la Chambre haute, les deux autres, à savoir un veto régional et un veto de ratification, qui n’ont pas été intégrés en 1982, aient fini par se tailler une place dans le processus de modification de la Constitution. Toutefois, l’inscription des veto régionaux par le gouvernement Chrétien, en 1996, ne comporte pas les avantages offerts par la proposition formulée par Pepin-Robarts qui aurait eu pour effet de permettre aux provinces de jouer un rôle plus actif par le truchement de leurs délégués à un Sénat revampé (Conseil de la fédération) et de rééquilibrer les rapports de force entre les provinces. D’autre part, la proposition touchant la ratification d’une modification par voie référendaire avait l’avantage d’être souple, contrairement aux rigidités qui alourdissent la formule de modification actuelle.
Pour sa part, Gustavo Gabriel Santafé aborde le projet de Conseil de la fédération (CDF) avancé dans les pages du rapport. Il analyse cette proposition sous l’angle de l’innovation politique du fédéralisme exécutif et des relations intergouvernementales. Outre le fait de remplacer le Sénat, le nouveau CDF aurait permis un meilleur dialogue entre les pouvoirs exécutif et législatif au sein du Parlement fédéral et une plus grande concertation intergouvernementale en introduisant la tenue de réunions régulières exempte du contrôle exercé par une Chambre des communes contrôlée par le parti au pouvoir. Il présente ensuite de quelle manière les propositions du Parti libéral du Québec se sont inspirées des vues de la Commission, du Livre blanc de Claude Ryan de 1979 jusqu’au CDF proposé les libéraux sous la gouverne de Jean Charest à la suite du rapport rédigé par le ministre Benoît Pelletier déposé en 2001. Il montre en quoi le CDF, mis sur pied en 2003, diffère de ce qui avait été imaginé par les commissaires, notamment parce que cette nouvelle instance où se déploie une partie des relations intergouvernementales (qu’il serait plus juste de qualifier d’interprovinciales) n’a pas remplacé l’actuel Sénat. Les parties constituantes de la fédération canadienne ne peuvent toujours pas exercer d’influence sur les organes exécutifs et législatifs au sein du gouvernement central, tout comme elles sont encore incapables d’intégrer les peuples autochtones à titre de partenaires fédératifs ou d’introduire une dimension citoyenne dans la conduite des rapports intergouvernementaux.
La troisième contribution, à caractère plus institutionnel, s’interroge sur les effets qu’aurait eu l’adoption des changements proposés sur la composition et l’organisation de la Cour suprême du Canada (CSC). Jean-Christophe Bédard-Rudin montre d’abord comment la reconnaissance de la dualité linguistique s’est progressivement historiquement inscrite dans les institutions judiciaires. De plus, l’image véhiculée de la CSC au début des années 1970 en est une d’inféodation aux intérêts du gouvernement fédéral et les commissaires sont sensibles à ces critiques. C’est à ces problèmes qu’ils souhaitent s’attaquer lorsqu’ils proposent que cinq des onze juges doivent provenir du barreau québécois et de subdiviser la dernière cour d’appel en trois bancs, dont l’un qui aurait eu à se prononcer sur les affaires de nature constitutionnelle. L’auteur soutient que les recommandations de la Commission sont particulièrement importantes parce qu’elles formulent, pour la première fois, une conception dualiste de la CSC et, de surcroît, mettent de l’avant des droits linguistiques et des changements administratifs qui rendront nécessaire l’apprentissage du français au sein de la magistrature. Malgré la mise au rancart du rapport Pepin-Robarts, l’auteur conclut que la CSC a tout de même évolué en enchâssant une forme de dualité, tant au niveau de sa composition, du mode de nomination des juges que de la création d’une tradition d’alternance entre francophones et anglophones au poste de juge en chef. De plus, la reconnaissance de l’importance de parler les deux langues officielles – il s’agit plutôt de la maîtrise du français – s’est graduellement imposée et est devenue un enjeu puisque la compétence linguistique des juges nouvellement nommés fait l’objet d’une plus grande attention du public. Pour Bédard-Rudin, la CSC incarne aujourd’hui une forme de dualité qui est à la fois plus complexe et plus ambitieuse que celle envisagée par Pepin-Robarts.
L’enjeu des droits linguistiques avait retenu l’attention de la commission Pepin-Robarts, qui adhérait au principe de l’égalité de statut des deux langues officielles au Canada. De surcroît, elle recommandait d’accorder aux législatures provinciales le pouvoir de déterminer, dans leurs sphères de compétence, la ou les langues qui auraient bénéficié d’un tel statut. Guillaume Deschênes-Thériault et Gilbert McLaughlin présentent une critique néo-républicaine de l’approche du rapport en s’inspirant des travaux du philosophe et théoricien politique Philip Pettit. Ils soutiennent que les recommandations linguistiques excluent les Acadiens du processus de négociation portant sur l’autonomie politique et culturelle de leurs communautés. Ils avancent aussi que si elles avaient été suivies, le nouveau régime linguistique aurait contribué à accroître la domination politique exercée sur les groupes en situation minoritaire puisque la constitutionnalisation des droits de ces derniers aurait été tributaire de la bonne volonté manifestée par le groupe majoritaire.
Le dernier texte de ce dossier porte sur un enjeu contemporain, à savoir la Loi sur la laïcité de l’État (loi 21) adoptée par l’Assemblée nationale en juin 2019. Jade Boivin propose une analyse de cette législation à l’aune de la conception des droits individuels et collectifs qui se dégage du rapport Pepin-Robarts. Elle rappelle que, pour les commissaires, les droits individuels prennent une forme collective par l’affiliation à un groupe, ce qui s’applique particulièrement à la reconnaissance de droits linguistiques. Or, pour les intervenants qui se sont prononcés en faveur de la loi 21, l’exercice des droits collectifs, et donc du droit d’exprimer la spécificité de la société québécoise est lié à des enjeux identitaires et d’autodétermination (interne) du peuple québécois. Quant aux opposants, ils ont davantage insisté sur la protection des droits individuels et trouvent que les limites imposées au port de signes religieux ne sont pas justifiées dans le contexte contemporain, d’autant plus que les éléments constitutifs de la laïcité sont largement reconnus et mis en place depuis la Révolution tranquille. Au final, le recours à la notion de droits collectifs dans les débats entourant la loi 21 fait écho à la conception qu’en avaient les commissaires à la fin des années 1970, à savoir que ces droits sont à mettre dans la trousse d’outils permettant d’assurer la reconnaissance et le développement de la société québécoise. Toutefois, la question des droits collectifs ne s’articule plus autour des conditions d’insertion du Québec dans l’ensemble canadien, mais s’adresse d’abord et avant tout aux citoyens québécois et aux choix de société qui s’offre à eux.
Nous le constatons, le rapport de la Commission mérite qu’on s’y attarde autrement que sous forme de rappel de notes en bas de page. Bien des enjeux qui ont retenu l’attention des commissaires peuvent encore être explorés sous l’angle des recommandations qu’elle a formulées, notamment ceux reliés à l’expression des intérêts régionaux au sein de la fédération canadienne (qui continue à alimenter la vie politique alors que les provinces dépendantes des ressources gazières et pétrolières traversent une nouvelle crise), au statut des langues officielles au moment où le gouvernement entend « moderniser » la Loi sur les langues officielles, à la remise en question des relations avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis sur d’autres bases que celles héritées du colonialisme du XIXe siècle, aux problèmes de création, de diffusion de la production culturelle dans un monde dominé par les GAFA, à la persistance des barrières interprovinciales au commerce, aux pressions exercées dans le but de transformer le système électoral pour y introduire des éléments de proportionnalité, sans parler du statut du Québec au sein de la fédération canadienne, qui demeure en suspend (le Québec n’ayant toujours pas donné son appui à la Loi constitutionnelle de 1982), la (re) constitution du fédéralisme s’inspirant du principe de l’asymétrie, le rôle du Sénat et de la Cour suprême du Canada.
* * *
Les textes présentés dans ce dossier ont d’abord fait l’objet d’une présentation dans le cadre d’un colloque intitulé Se retrouver. 40 ans après le rapport de la commission Pepin-Robarts : l’unité canadienne encore en débat ?, tenu en octobre 2019, organisé par la Chaire de recherche Jean-Luc Pepin de l’Université d’Ottawa dont j’étais alors titulaire. Nous tenons à remercier la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa pour son appui financier et logistique. Nos remerciements s’adressent conjointement à Stéphane Savard, directeur du Bulletin d’histoire politique, et au Comité de rédaction qui ont favorablement accueilli l’idée d’y publier une sélection de textes issus du colloque. Nous ne passons pas sous silence le méticuleux travail fait par les personnes qui ont évalué chacune des contributions et tenons à les en remercier.
Parties annexes
Notes
-
[1]
James Ian Gow, « Le rôle des commissions d’enquête dans le système parlementaire », Bulletin d’histoire politique, vol. 16, no 1, 2007, p. 93.
-
[2]
George J. Bedard, « Constructing Knowledge : Realist and Radical Learning Within a Canadian Royal Commission », Educational Policy, vol. 13, no 1, 1999, p. 152-153.
-
[3]
Ed Broadbent, « The real democratic deficit : our parliamentary system », Policy Option, 1er novembre 2004, policyoptions.irpp.org/magazines/asymmetric-federalism/the-real-democratic-deficit-our-parliamentary-system/.
-
[4]
C’est du moins le chiffre rapporté par le Bureau du Conseil privé du Gouvernement du Canada : canada.ca/fr/conseil-prive/services/commissions-enquete.html.
-
[5]
François Rocher, « La dynamique Québec-Canada ou le refus de l’idéal fédéral », dans Alain.-G. Gagnon (dir.), Le fédéralisme canadien contemporain, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2006, p. 93-146.
-
[6]
S.n., « Colloque Pepin-Robarts : il est encore temps de s’inscrire », Bulletin du CRCCF, vol. 4, no 3, 2001, p. 2.
-
[7]
Jean-Pierre Wallot (dir.), Le débat qui n’a pas eu lieu. La Commission Pepin-Robarts, quelque vingt ans après, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 2002, p. 9.
-
[8]
André Burelle, « Un prophétisme à redécouvrir, celui de la Commission Pepin-Robarts », dans Jean-Pierre Wallot, op. cit., p. 24-26.
-
[9]
Le même constat teinte d’autres contributions au même ouvrage. Voir notamment les chapitres d’Alain-G. Gagnon, « La condition canadienne et les montées du nationalisme et du régionalisme », et de Gilles Paquet, « Pepin-Robarts redux : socialité, régionalité et gouvernance ».
-
[10]
Alan C. Cairns, « Recent Federalist Constitutional Proposals », dans Douglas E. Williams (dir.), The Canadian Political Tradition, Toronto, Methuen, 1987, p. 53.
-
[11]
David M. Thomas, « Turning a Blind Eye : Constitutional Abeyances and the Canadian Experience », International Journal of Canadian Studies/Revue internationale d’études canadiennes, no 7-8, 1993, p. 70.
-
[12]
François Rocher, « The Life and Death of an Issue : Canadian Political Science and Quebec Politics », Canadian Journal of Political Science, vol. 52, no 4, 2019, p. 631-655.
-
[13]
Michel Seymour, « La proie pour l’ombre. Les illusions d’une réforme de la fédération canadienne », dans Alain-G. Gagnon (dir.), loc. cit., p. 213 ; Alain-G. Gagnon, « Le fédéralisme asymétrique au Canada », dans Alain-G. Gagnon, loc. cit., p. 289.
-
[14]
André Burelle, « Rapatriement constitutionnel. Pierre Elliott Trudeau a-t-il trompé les Québécois ? », dans Michel Venne et Miriam Fahmy (dir.), L’annuaire du Québec 2007, Montréal, Fides, 2006, p. 224.
-
[15]
Guy Laforest et Rosalie Readman, « Plus de détresse que d’enchantement. Les négociations constitutionnelles de novembre 1981 vues du Québec », dans François Rocher et Benoît Pelletier (dir.), Le nouvel ordre constitutionnel canadien. Du rapatriement de 1982 à nos jours, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2013, p. 64.
-
[16]
Claude Morin, « L’expérience canadienne et québécoise de révision constitutionnelle : leçons et perspectives », Les Cahiers de Droit, vol. 26, no 1, 1985, p. 41 ; voir aussi Stéphane Savard, « La recherche d’une troisième voie en période de crise. La position constitutionnelle des groupes de pression fédéralistes de 1977 à 1981 », dans Antoine Brousseau Desaulniers et Stéphane Savard (dir.), La pensée fédéraliste contemporaine au Québec. Perspectives historiques, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2020, p. 235-263.
-
[17]
Vincent Lemieux, « La Chambre des communes, le système électoral et l’usage du référendum », Les Cahiers de Droit, vol. 26, no 1, 1985, p. 182-183.
-
[18]
Eugénie Brouillet, « The Supreme Court of Canada : The Concept of Cooperative Federalism and Its Effect on the Balance of Power », dans Nicholas Aroney et John Kincaid (dir.), Courts in Federal Countries : Federalists or Unitarists ?, Toronto, University of Toronto Press, 2017, p. 147.
-
[19]
André Tremblay, La réforme de la Constitution au Canada, Montréal, Thémis, 1995 ; Benoît Pelletier, « La modification et la réforme de la Constitution canadienne », Revue générale de droit, vol. 47, 2017, no 2 p. 459-517.
-
[20]
Valérie Lapointe-Gagnon, « “Paver le boulevard de la fraternité” : la pensée fédéraliste de Solange Chaput-Rolland », dans Antoine Brousseau Desaulniers et Stéphane Savard (dir.), loc. cit., p. 147-204.
-
[21]
Marc Sauvé, Le pouvoir fédéral de dépenser et la nature centralisatrice de la Constitution canadienne de 1867 [mémoire de maîtrise], Montréal, Université du Québec à Montréal, 2008, p.14.
-
[22]
Mario Fraser, L’Accord du lac Meech : dernière bataille idéologique du XXe siècle pour la domination politique du Canada – tome 1 [thèse de doctorat], Québec, Université Laval, 2008, p. 36.
-
[23]
Jessica Riggi, La question constitutionnelle chez les responsables politiques québécois, 1985-1991 : un long désenchantement, mémoire de maîtrise (histoire), Montréal, Université du Québec à Montréal, 2016, p. 78.
-
[24]
Gustavo Gabriel Santafé, Le Parti libéral du Québec et l’enjeu constitutionnel : autonomie, souveraineté, habilitation, mémoire de maîtrise (science politique), Montréal, Université du Québec à Montréal, 2020, p. 89 et 92.
-
[25]
Parti libéral du Québec, Un Québec libre de ses choix : Rapport du Comité constitutionnel du Parti libéral du Québec, Québec, Parti libéral du Québec, 1991.
-
[26]
À cet égard, les positions constitutionnelles du parti sont constantes quant à la promotion de la reconnaissance de la spécificité du Québec et à son inscription dans la Constitution canadienne. Voir Parti libéral du Québec, Un projet pour le Québec : affirmation, autonomie et leadership. Rapport final, Montréal, Parti libéral du Québec, 2001, ainsi que la position adoptée par le gouvernement Couillard, Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, Québécois. Notre façon d’être Canadiens, Québec, Direction des communications, 2017.