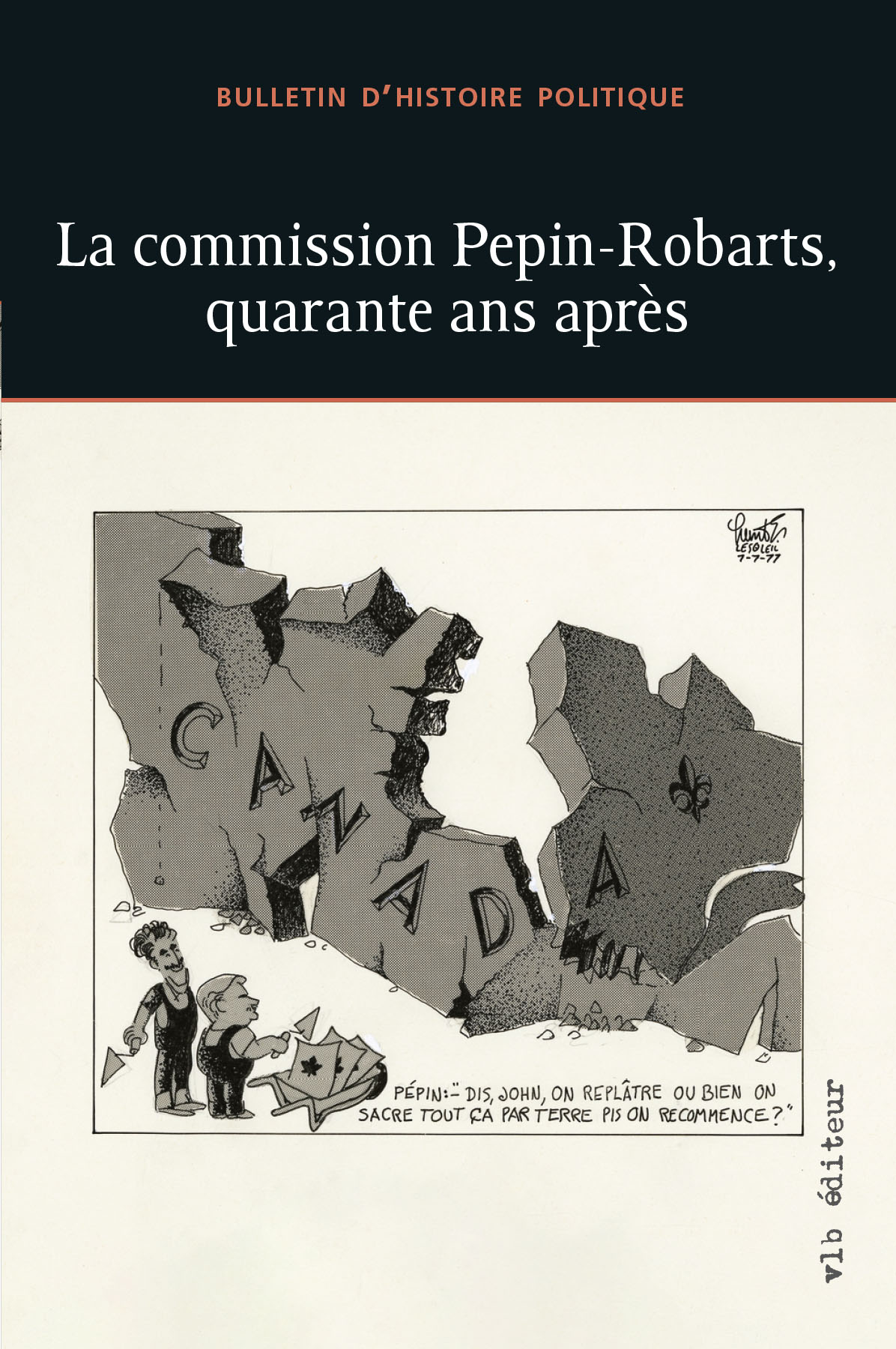Corps de l’article
L’objectif d’analyser et d’interpréter l’évolution historique de l’économie québécoise continue à retenir l’attention de chercheurs, tant les historiens que les spécialistes des sciences sociales, malgré les défis qu’une telle démarche impose. Il y a au Québec une tradition de projets de recherche en histoire économique, depuis les initiatives pionnières des historiens Fernand Ouellet[1], Jean Hamelin et Yves Roby[2] et de l’économiste Albert Faucher[3], dans les années 1960 et 1970. Dans les deux premiers cas, l’approche s’inspire de l’histoire sérielle française qui privilégie les forces économiques dans le développement social et dans le second, c’est l’influence de la théorie des produits de base dite « staple » qui s’applique au Québec dans une perspective continentale. Peu près, les théories marxistes, tout particulièrement l’approche du développement, du sous-développement ou du développement inégal, suscitent de nombreux travaux en histoire de l’exploitation des ressources naturelles, tout particulièrement dans une perspective de développement régional. Dans ce courant, il faut signaler les travaux d’Alfred Dubuc et de Normand Séguin[4]. Depuis les années 1980, les recherches vont dans toutes les directions à l’échelle sectorielle, locale et régionale, plus ou moins influencées par ces cadres d’analyse. La dernière tentative de réaliser une synthèse d’histoire économique du Québec remonte à 1984, par Robert Armstrong, publiée en anglais seulement et très sommaire[5]. Depuis ce temps, l’histoire économique au Québec s’est lentement retirée des recherches et des études tant en histoire qu’en économique, une catastrophe pour la compréhension de l’importance de l’économie dans l’histoire du Québec contemporain.
Dans les débats sur les enjeux du Québec actuel, il y a pourtant un besoin impérieux d’une réflexion historique sur les dimensions économiques et environnementales des politiques de l’État. Un groupe de jeunes chercheurs en sciences sociales, surtout en science politique et en économique, s’est rassemblé depuis 2000 dans l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques, l’IRIS, une organisation indépendante et progressiste qui réalise toutes sortes d’études et de prises de position dans les débats politiques et économiques contemporains. En parallèle avec ces interventions, l’équipe de l’IRIS, avec la participation d’autres chercheurs, a entrepris, réalisé et publié deux synthèses d’une histoire économique du Québec contemporain. La première, parue en 2015, porte sur les ressources et la seconde, parue en 2019, porte sur les institutions publiques et fait l’objet de ce compte rendu. Chacun des deux tomes est dirigé par un des chercheurs de l’Institut, soit Simon Tremblay-Pepin et Philippe Hurteau respectivement, et différents auteurs ont pris en charge chacun des chapitres, portant dans le premier tome sur l’agriculture, la forêt, les mines, l’énergie et l’eau et dans le second sur la santé, l’éducation primaire et secondaire, l’université, la fiscalité et les régimes de retraite.
Dans les deux cas, le même cadre d’analyse s’applique, celui de la dépossession, comme le titre l’indique, une approche dérivée du marxisme développée par le géographe David Harvey selon l’expression « accumulation par dépossession », l’un des deux modes d’accumulation du capitalisme, soit l’expansion et la dépossession. Cette accumulation par dépossession serait un moment exceptionnel, violent et brutal, qui se produit lorsqu’on fait passer dans le monde capitaliste des activités qui n’en faisaient pas partie (tome I, p. 11). Dans le cas des ressources, le modèle de développement s’appuie sur l’extractivisme, soit l’extraction des ressources naturelles en vue d’une exportation immédiate à l’état brut pour transformation à l’étranger au bénéfice de grandes entreprises (tome I, p. 266). Il s’agirait même d’un néo-extractivisme dans la mesure où les gouvernements utilisent les revenus de l’exploitation des ressources pour financer les programmes sociaux ou les dépenses générales de l’État. La Révolution tranquille se comprendrait « comme un passage de l’extractivisme au néo-extractivisme et non comme la sortie d’un régime de dépossession » (tome I, p. 267).
Le tome II aborde les institutions publiques dans la perspective d’une remise en question de l’interprétation traditionnelle des acquis remarquables de la Révolution tranquille des années 1960-1980 soumis à une érosion néolibérale à partir des années 1980. Dans cette perspective critique, la thématique de la dépossession reste bien présente et s’applique aux institutions de santé et de services sociaux, d’éducation primaire, secondaire et universitaire, ainsi qu’à celles engagées dans la fiscalité et les régimes de retraite. Les auteurs retracent l’origine des politiques publiques dans ces domaines, d’abord sommairement avant la Révolution tranquille, puis de façon détaillée et systématique à partir des années 1960. On aurait pu craindre que le schéma d’interprétation de la dépossession pèse lourdement sur l’analyse des politiques, mais ce n’est pas le cas dans la plupart des textes, de sorte que le bilan historique de l’évolution des interventions de l’État se tient très bien par lui-même et permet de suivre les enjeux des transformations des politiques sociales les plus importantes. Il s’agit de la contribution la plus utile des chapitres thématiques de l’ouvrage, construits essentiellement à partir de monographies, de rapports gouvernementaux et d’articles de périodiques.
Dans la perspective des auteurs, la Révolution tranquille a permis à des élites québécoises françaises d’accéder au pouvoir dans l’État québécois et dans les affaires (le Québec inc.) et de remplacer ainsi les élites anglo-canadiennes, dominantes jusque-là. Il s’agit alors d’une reconfiguration des élites dominantes, plutôt que de la promotion « d’une gestion participative qui aurait mieux servi les intérêts de la population » (p. 218). De là « survient la confusion qui perdure : pendant que le peuple québécois croyait se donner un État pour répondre aux besoins de la majorité, les nouveaux technocrates s’affairaient, eux, à construire un État moderne destiné à supporter l’essor du Québec inc. et à veiller à ce que ses principaux porte-étendard soient compétitifs sur les marchés continental et mondial » (p. 219). Ainsi, « l’analyse de l’histoire économique du Québec subit par conséquent une double paralysie : l’incapacité de critiquer ce qui reste du modèle québécois de crainte de faire le jeu des néolibéraux, et l’enfermement dans une défense stérile des “acquis”, même lorsque ceux-ci sont de plus en plus difficiles à défendre tant ils ont été dénaturés ». L’auteur de la conclusion y voit l’explication de « l’essoufflement généralisé de nos ambitions collectives » (p. 220).
Peut-on considérer les deux ouvrages de la série comme une « histoire économique du Québec contemporain », selon le titre commun choisi par les auteurs ? Le premier tome annonçait une intention d’en couvrir différents volets généralement fortement présents dans les autres histoires économiques, soit les ressources naturelles et les politiques de leur mise en valeur. Le second aurait pu aborder l’histoire d’autres secteurs d’activité et des politiques économiques, surtout les industries non reliées aux ressources, les institutions financières, les infrastructures de transports, les activités commerciales, les services personnels, les politiques économiques des gouvernements, les caractéristiques démographiques de la population, les économies urbaines et régionales et les mesures globales de performance de l’économie. Il se concentre plutôt sur des politiques sociales, de première importance certes, dans la santé, l’éducation et la sécurité sociale, qui s’inscrivent dans un contexte économique pertinent, mais essentiellement laissé à l’arrière-plan. Rien n’indique dans les deux tomes ou sur le site web de l’IRIS qu’il y ait un projet d’élargir la série de publications à l’histoire de l’ensemble de l’économie, une option fort souhaitable, surtout dans la même perspective progressiste.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Fernand Ouellet, Histoire économique et sociale du Québec 1760-1850 : structures et conjonctures, Montréal, Fides, 1971, 639 p.
-
[2]
Jean Hamelin et Yves Roby, Histoire économique du Québec, 1851-1896, Montréal, Fides, 1971, 436 p.
-
[3]
Albert Faucher, Histoire économique et unité canadienne, Montréal, Fides, 1970, 296 p., et Québec en Amérique au XIXe siècle : essai sur les caractères économiques de la Laurentie, Montréal, Fides, 1973, 247 p.
-
[4]
Normand Séguin, La conquête du sol au 19e siècle, Québec, Boréal, 1977, 295 p.
-
[5]
Robert Armstrong, Structure and Change : an Economic History of Quebec, Toronto, Gage, 1984, 295 p.