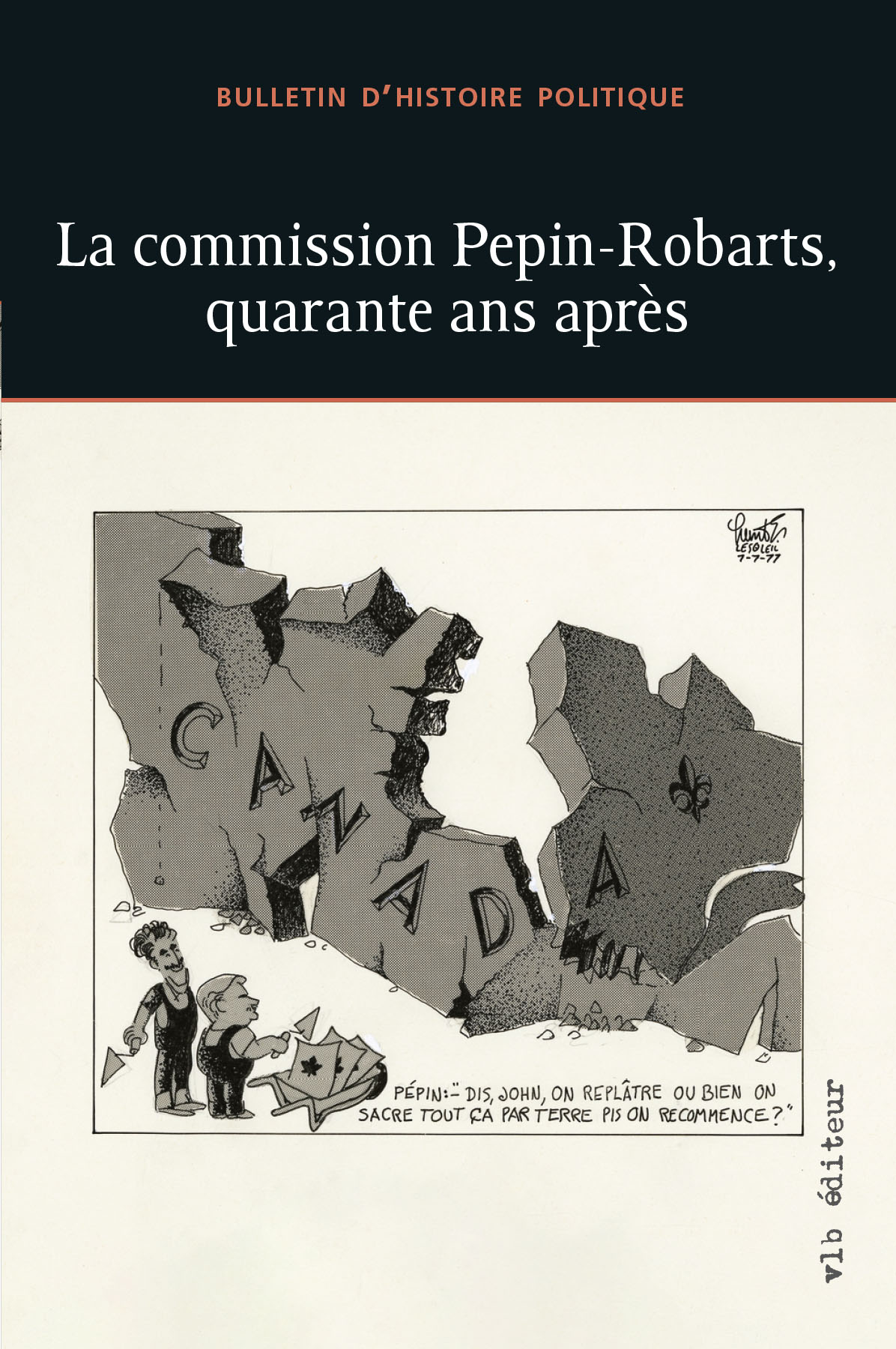Corps de l’article
Louis-Antoine Dessaulles (1818-1895) joue un rôle essentiel dans l’oeuvre d’Yvan Lamonde qui lui consacre d’ailleurs de nombreux autres écrits. Depuis plusieurs années et au fil des essais, l’historien des idées défriche et balise un axe épistémologique consistant à prouver l’existence depuis deux siècles d’une tradition intellectuelle ininterrompue conjuguant libéralisme, anticléricalisme, républicanisme et nationalisme. Dans cette quête, nul doute que le parcours de Dessaulles apparaît particulièrement précieux. Fils du seigneur de Saint-Hyacinthe, neveu de Papineau qu’il idolâtre, le jeune papineauiste se campe ensuite en pur rouge, fidèle au programme libéral de 1854, soutenant jusqu’au bout l’Institut canadien contre Mgr Bourget et portant haut et fier la part républicaine et anticléricale de l’héritage patriote, convaincu que libéralisme et nationalisme demeurent compatibles.
Tandis que Parent se laisse séduire par La Fontaine, qu’Honoré Beaugrand est trop entiché d’américanisme, que Dorion pêche par opportunisme, qu’Arthur Buies manque décidément de courage et que Wilfrid Laurier est bien trop modéré, Dessaulles offre en somme la trajectoire rêvée pour un historien désireux de prouver que le libéralisme politique traverse bel et bien l’histoire moderne du Québec, quitte à surnager durant le long épisode clérico-nationaliste, jusqu’à ce qu’advienne l’élan d’émancipation tous azimuts incarné par la Révolution tranquille.
Si Dessaulles est souvent sommairement décrit comme un martyr du cléricalisme ultramontain, force est cependant d’admettre – et les auteurs Lamonde et Aubin n’en font pas mystère – que c’est d’abord et avant tout à lui seul que le seigneur de Saint-Hyacinthe doit ses déboires financiers et d’être forcé à l’exil en 1875. Intellectuel fougueux à la plume acérée, l’homme se double d’un dépensier impénitent épris de luxe, courant sans cesse d’une chimère à l’autre. Dessaulles se pique notamment de sciences et de techniques et imagine toutes sortes d’inventions, d’un chemin de fer à Saint-Hyacinthe en passant par son spiritomètre censé mesurer le taux d’alcool dans les spiritueux. Résultat, il se couvre littéralement de dettes, hypothéquant sa seigneurie jusqu’au dernier chelin. Entre 1843 et 1866, il fait face à pas moins de 57 procès pour dettes devant la Cour supérieure de Montréal, des procès qu’il perd généralement.
Alors au faîte de sa carrière politique, maire de sa ville natale et greffier à Ottawa, Dessaulles doit donc fuir en août 1875 afin d’échapper à ses créanciers. Sans doute ignore-t-il alors qu’il ne reverra jamais plus sa famille ni sa patrie. Parti par New York, il débarque à Anvers en octobre puis séjourne deux ans en Belgique, surtout à Gand. En mars 1878, il s’installe à Paris où il finit par se fixer à l’hôtel de la Côte d’Or, au 8 rue des Martyrs, et où il passe ensuite 17 longues années, jusqu’à sa mort en 1895.
Durant son exil parisien, Dessaulles adresse 554 lettres, dont 512 à sa fille Caroline, les autres à d’autres membres de la famille. Caroline Dessaulles-Beique est la fille unique du couple formé par Dessaulles et son épouse Zéphirine Thompson. En avril 1875, la jeune fille épouse l’avocat Frédéric-Ligoré Béique, également abonné aux cercles rouges. Sans la moindre source de revenus durant son exil, c’est aux traites que lui verse régulièrement son gendre que Louis-Antoine Dessaulles doit sa subsistance. Les lettres de Dessaulles s’adressent donc autant à sa fille affectionnée qu’à sa seule et unique source de revenus. Lamonde et Aubin ont choisi de reproduire 48 de ces lettres.
Quatre thèmes traversent surtout ces lettres à sa fille. Le premier tient carrément aux problèmes de subsistance de l’exilé qui peine à trouver de quoi manger, se vêtir ou se loger. Dessaulles ne nous épargne aucun détail sur ce plan. Son sort apparaît d’autant plus pénible qu’on voit bien que le dandy, qui avait jusque-là mené grand train, s’avère particulièrement mal préparé à un mode de vie plus frugal. Après avoir traversé les 57 premières années de sa vie à un rythme d’enfer, patriote, maire, conférencier, seigneur, entrepreneur, inventeur, député et greffier, le voilà brusquement, et pour vingt ans, plongé dans la plus totale prostration, isolé et forcé à l’inaction.
Le deuxième thème est sa poursuite inlassable d’une invention ou d’un procédé technique devant lui permettre, tel un phénix, de renaître sur le plan financier. Durant tout son exil, Dessaulles continue à se passionner pour les inventions que lui susurre notamment un ami, le photographe Charles Dion, se privant même de manger pour acquérir de précieux brevets.
Le troisième thème consiste en la vie sociale de Dessaulles le mettant en contact avec quelques amis sincères. Mondain par nature et pour tromper sa solitude, Dessaulles cherche aussi la compagnie d’éventuels mécènes, surtout des femmes incidemment, et en trouve pour compatir au sort du « martyr, victime du clergé catholique canadien ». Il assiste aussi à des concerts gratuits et participe aux célébrations républicaines, tels le 80e anniversaire de Victor Hugo ou l’exposition du centenaire de la Révolution en 1889 et l’inauguration de la tour Eiffel. À Paris, il croise aussi toute une collection d’exilés canadiens, la plupart des libéraux ou des Rouges, tous vaguement en butte à l’ultramontanisme au Québec et venus un temps se rasséréner auprès du républicanisme français : Arthur Buies, Amédée Papineau, Joseph Doutre, Napoléon Bourassa, Alphonse Lusignan, mais aussi Louis Fréchette et même le curé Antoine Labelle.
Le dernier thème enfin, davantage en phase avec la précédente carrière du polémiste anticlérical consiste en son grand oeuvre, l’Église comme obstacle au progrès, de l’Institution des Jésuites en passant par le procès de Galilée, dont Dessaulles rédige d’imposants volumes publiés en partie à Paris à compter de 1894.
Dessaulles meurt le 4 août 1895. Ses funérailles au cimetière de Pantin ne sont suivies que par une poignée d’intimes : le commissaire général du Canada à Paris, Hector Fabre, Louis Fréchette alors de passage dans la Ville lumière, et une amie, Odile-Alphonsine Smith. Sa modeste sépulture est vite laissée à l’abandon puis sombre dans l’oubli.
La langue dont use Dessaulles dans ces lettres à sa fille est étonnamment vivante, fluide et moderne, ce qui rend la lecture particulièrement agréable, faisant revivre le gai Paris à la Belle époque en dépit du désoeuvrement matériel de l’auteur. La langue paraît si moderne et soignée qu’on aurait pu craindre qu’elle ait été adaptée pour le lecteur du XXIe siècle. Il n’en est heureusement rien comme le mentionne une judicieuse notice insérée par l’éditeur. Quant aux notes en bas de page, elles servent surtout à situer les personnes mentionnées dans le cours des lettres, mais sans trop entrer dans les détails, conformément à la méthode à laquelle Georges Aubin nous a habitués au fil de ses ouvrages analogues.
Dommage qu’on n’ait pas jugé bon de dresser la liste des lettres reproduites avec les dates et les destinataires. Dommage également qu’on n’ait pas reproduit la seule et unique lettre que Dessaulles adresse en août 1875 à son épouse Zéphirine Thompson et où l’exilé expose les motifs de son départ sans coup férir. Dommage enfin que l’introduction passe autant de temps sur le cas de Caroline et notamment sur les détails de son voyage de noces. Davantage d’espace aurait pu être consacré à Dessaulles lui-même, notamment sur sa fulgurante carrière précédant son exil. Soyons juste en effet : si ces lettres d’un exilé québécois à sa fille brossent un intéressant portrait de la vie parisienne au début de la IIIe République, l’intérêt à parcourir cette correspondance réside en dernière instance dans le parcours qu’avait auparavant suivi son illustre auteur.