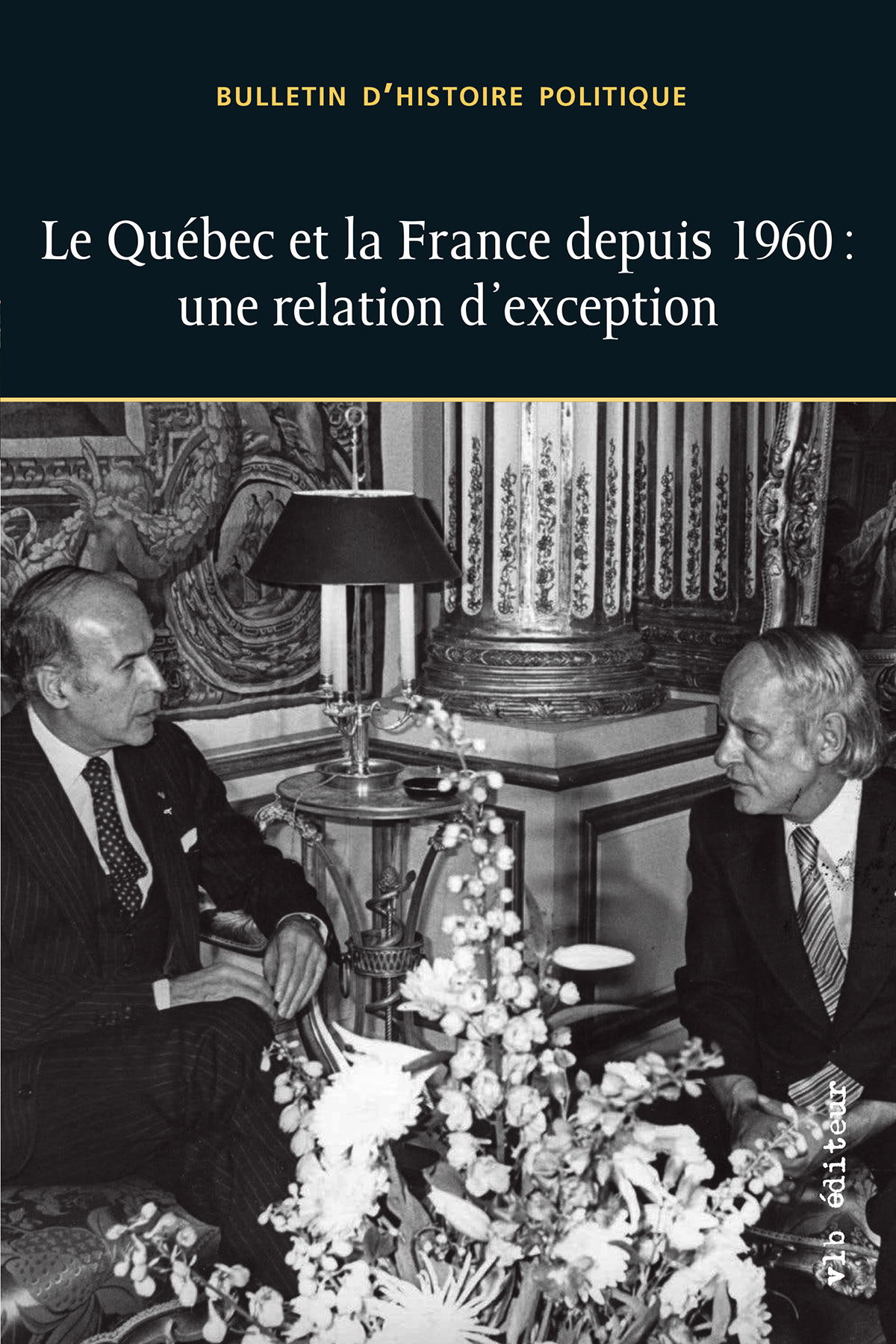Corps de l’article
Le didacticien Félix Bouvier et l’historien Charles-Philippe Courtois proposent une incursion historique, historiographique et militante de l’enseignement de l’histoire au Québec. L’ouvrage se divise en trois parties et compte douze chapitres. Outre l’introduction et la conclusion, les deux directeurs sont responsables de cinq des douze chapitres, ce qui donne à la fois un ton et une structure homogène à leur opus. Cinq collaborateurs complètent les autres textes. Outre une préface anecdotique de Denis Vaugeois, on retrouve, dans chacun des chapitres, une bibliographie des ouvrages cités. Compte tenu de l’ampleur du sujet et du mélange des approches chronologiques et thématiques, on aurait aimé l’ajout d’un index des noms propres et des sujets.
Bouvier et Courtois désirent approfondir les « différentes écoles de pensée “nationale” influençant l’enseignement-apprentissage de l’histoire » (p. 21) par le biais d’une étude exhaustive des manuels scolaires, des programmes et de différents documents gouvernementaux. D’emblée, le sous-titre de l’ouvrage et les explications des deux directeurs posent comme prémisse que l’histoire enseignée au Québec est passée à travers le prisme de deux postures chez les intellectuels, les historiens et les auteurs de manuels : d’un côté, celle du « bon-ententisme », qui cherche par tous les moyens à faire primer l’unité canadienne, à aplanir les différends avec la majorité anglophone et à éluder les points de frictions sur certains événements sensibles. Cela se fait volontairement au détriment de l’identité et de l’expérience historique vécue par la communauté francophone. De l’autre, la « nationaliste », qui valorise « la culture canadienne-française, ou plus tard québécoise, la défense et le progrès de l’épanouissement et de l’autonomie de cette nation » (p. 23). Selon Félix Bouvier et Charles-Philippe Courtois, on retrace la première posture dans le manuel de Joseph-François Perreault (1832) et la seconde dans l’Histoire du Canada de François-Xavier Garneau (1845). Chacune des deux attitudes trouvera ses fins et aboutissements au sein des universités Laval et de Montréal. L’École de Québec, qualifiée de « bon-ententiste » ou de « loyaliste », s’élèvera contre celle dite de Montréal, considérée comme nationaliste. Par la voix de la production historienne des membres des deux Écoles, mais aussi à travers les traces de leurs influences dans les manuels scolaires, la confrontation se poursuivra pendant plus de deux siècles.
La première partie, « L’histoire nationale à l’école et les deux grandes sensibilités historiques avant la Révolution tranquille », offre à travers ses trois chapitres un survol chronologique (1830-1966) d’une large palette de manuels publiés et des principaux aspects enseignés. Le cadre méthodologique et théorique, expliqué par Alex Bureau, surprend par l’absence de références aux nombreuses thèses en histoire et en didactique sur le sujet dans sa bibliographie, tout comme par le peu d’informations sur la sélection des ouvrages et la méthode d’analyse. Ensuite, Courtois fait ressortir la prédominance du « bon-ententisme » dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il expose bien la lente, mais constante réappropriation de l’histoire sous son angle nationaliste. À ce chapitre, l’influence de son principal héraut, Lionel Groulx, commence à se faire sentir, mais on notera, au passage, que cet auteur et d’autres n’abordent pas toujours les faits marquants dans une approche unilatéralement nationaliste. Par exemple, pour les rébellions de 1837 et de 1838, même si la cause peut apparaître juste, l’insurrection, quant à elle, est vertement condamnée (p. 100). Enfin, Courtois termine en comparant les positions et les influences de Lionel Groulx et de ses disciples avec celles du trio Maheu-Roy-Chapais de Québec. Dans les manuels publiés après la Deuxième Guerre mondiale, le groulxisme gagne en importance dans l’enseignement de l’histoire au Québec. Notons, à la toute fin de cette période, des parutions novatrices sur le plan de l’analyse et la présentation des sources appelées à un bel avenir : Histoire du Canada par les textes et le Boréal Express.
La deuxième partie du livre, « La Révolution tranquille et la diffusion de l’histoire nationale », comprend six chapitres, à la fois synchroniques et diachroniques. Les trois premiers plongent dans les bouleversements sociopolitiques qui mènent au rapport Parent et au vaste chantier des réformes du monde de l’éducation, notamment à travers ses effets sur l’évolution des programmes d’histoire, la formation des maîtres et des nouveaux contenus enseignés. Olivier Lemieux avance que c’est moins le rapport Parent que le premier programme rédigé par Denis Vaugeois (1965-1967) qui devrait être regardé comme le référentiel épistémologique de tous les débats subséquents sur l’histoire. Cette section provoquera certainement chez plusieurs spécialistes des réactions. Michel Allard fait ensuite bien sentir la « profonde rupture avec une forme et un contenu d’enseignement de l’histoire nationale mis au service d’une cause. [On lui préfère désormais] une approche rationnelle » (p. 193), avec un recul des aspects « providentiels et divins » aux profits des actions humaines, notamment sur le plan social et économique. A. Bureau termine la première moitié de cette section en continuant son analyse des manuels scolaires d’histoire de 1966 à 2006 et sur différents documents et programmes ministériels. On aurait aimé ici une analyse plus poussée de l’évolution des approches didactiques de l’histoire du Québec ou de leur influence dans la conception des manuels à partir de la fin des années 1970. A. Bureau note bien le souci d’équilibre et d’objectivité des manuels apparus dans les années 1980, mais il constate aussi la lente érosion du courant nationaliste au profit d’un révisionnisme « bon-ententiste ». À notre avis, sa thèse repose sur une lecture imparfaite des programmes d’histoire. C’est sous le Parti québécois, à partir de 1982, que l’attention du programme s’est portée sur le concept plus large de société. Qui sait lire les programmes peut clairement voir que le concept de nation y est toujours présent, mais s’inscrit dans une réalité plus large qui n’a rien à voir avec le « bon-ententisme ».
Les trois chapitres suivants (7, 8 et 9), par Félix Bouvier pour le premier, et Olivier Lemieux et Jean-Philippe Warren pour les deux autres, s’attaquent de manière pointue aux perceptions de l’historiographie et de l’enseignement de l’histoire dans L’Action nationale, Cité libre et Parti pris. Bien qu’elles ne semblent pas cadrer tout à fait avec l’approche retenue dans les six premiers chapitres, leur lecture vaut le détour, car les allégeances intellectuelles variées des trois revues (nationaliste, fédéraliste et marxiste-léniniste) ouvrent à des perspectives différentes sur les deux grands axes que sont le « nationalisme » et le « bon-ententisme » des manuels ou le propos des programmes scolaires. Cela confirme la richesse de ces perspectives sur le sujet. Toutefois, force est d’avouer une petite déception devant l’absence d’une synthèse finale sur ces revues. À la décharge des auteurs, comme l’histoire nationale du Québec n’occupe pas la même place à travers le temps et au sein des publications et n’est pas abordée sous les mêmes angles, l’exercice pouvait apparaître périlleux.
La dernière partie, « Débats actuels en enseignement de l’histoire », couvre en trois chapitres les débats qui secouent la société sur l’enseignement de l’histoire depuis la controversée mise en place du Programme de formation de l’École québécoise en 2006. Notons ici que cette section marque une rupture avec le reste de l’ouvrage, car on quitte la perspective historique. Dans le onzième chapitre, Jean-Philippe Warren et Alexandre Lanoix proposent une analyse comparative, dans une perspective politique, des trajectoires différentes des history wars, sur l’enseignement de l’histoire au Québec et au Canada selon le modèle développé par Chateauraynaud (p. 316). Plus qu’une simple querelle sur des identités différentes, c’est l’objet même de ce qui est enseigné et sa fragmentation en une mosaïque de perspectives qui inquiète du côté canadien, car de nombreux observateurs lui préféreraient un récit canonique centralisé et unifié. Cela explique la création de différents organismes fédéralistes qui tenteront d’influencer le message historique à travers le financement d’émissions de télévision, de prix, de revues et des fameuses « Minutes du patrimoine ». Du côté québécois, c’est la perspective lénifiante, jovialiste, multiculturelle et « bon-ententiste », aux dires de ses détracteurs, qui crée la polémique. Au-delà des visions, les auteurs soulignent que c’est la résonance de ces débats sur l’histoire dans le public et les réactions à chaud qui rendent difficile, sur le moment, une analyse neutre et purement scientifique des contenus et des perspectives choisies. Toutefois on le saisit bien, la table était mise pour une confrontation majeure et le nouveau programme d’histoire de 2006 allait en être le déclencheur.
Dans les chapitres 10 et 12, Bouvier récapitule les affrontements autour des programmes d’histoire des années 1960 à 2017 avec notamment un intéressant survol des rapports identitaires des Anglo-Québécois par rapport au programme dans le dixième chapitre. Comme l’auteur choisit une approche personnelle militante pour aborder les débats autour de l’enseignement de l’histoire du Québec dans le dernier chapitre, cela appelle un certain nombre de commentaires.
L’espace qui m’est imparti ne me permettra pas de discuter de tous les aspects. J’aimerais en souligner certains. D’abord, les différentes moutures des programmes furent âprement discutées dans les écoles et au sein des différents congrès organisés par les associations professionnelles, c’est très juste. Plusieurs enseignants et enseignantes se sont inquiétés de l’absence de certains faits historiques et ils trouvaient la compétence 1 (questionnement) difficile à évaluer, particulièrement au premier cycle du secondaire. De la même manière, plusieurs personnes voyaient l’angle d’interprétation imposé de la compétence 3 comme un peu trop dirigiste. Pourtant, à travers les aléas de la mise en chantier des programmes, la très vaste majorité des enseignants ont maintenu de larges pans du récit national tout en osant des situations-problèmes qui renforçaient les compétences de travail des élèves. Le nouveau programme a provoqué des collaborations et des échanges inédits et cela n’est pas évoqué. Cette histoire « par la base » de la réalité des adaptations, des résistances et des changements au sein de la pratique enseignante reste donc largement à faire et ne se résume pas aux débats faits sur la place publique.
De plus, Bouvier laisse entendre que le débat entre la Société des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ) et l’Association québécoise pour l’enseignement de l’univers social (AQEUS) s’est fait, pour l’essentiel, sur les bases de visions opposées du programme. Il y a, je crois, des nuances à faire. Les débats entre les associations d’enseignants en économie, en histoire et en géographie découlaient davantage, au départ du moins, de leurs problèmes financiers et de leur avenir (surtout pour les spécialistes de géographie et d’économie, qui voyaient transférer certains de leurs thèmes vers les sciences, assistaient à l’abolition de plusieurs cours au sein de ce nouvel « univers social » et observaient la diminution du nombre d’heures d’enseignement). Ce que je veux dire ici, c’est que la problématique évoquée est plus large que le récit national défendu. Au-delà des querelles entre certains administrateurs et des allégeances politiques réelles ou projetées, il faudrait prendre le temps de consulter l’ensemble des minutes des réunions conservées de toutes les associations et interroger tous les membres des conseils d’administration avant de tirer des conclusions sur le soutien réel ou fictif à la cause nationaliste ou fédéraliste.
D’autre part, s’il n’est pas difficile de trouver chez certains didacticiens et historiens des visées qui s’éloignent du nationalisme, il ne faut pas en conclure qu’ils sont tous de « bon-ententistes » ! J’ai des nuances à apporter sur certains traits imposés aux didacticiens Marc-André Éthier et David Lefrançois (p. 350). Je le fais en connaissance de cause, car j’ai pu observer leur travail à titre de professeur invité au département de didactique de l’Université de Montréal en 2014-2015, comme historien et à titre d’enseignant en histoire au secondaire qui collabore à des projets de recherche avec eux, notamment en littératie historique.
Éthier et Lefrançois ne sont pas des adeptes de la perspective nationaliste, c’est vrai. Ils ne sont pas fédéralistes pour autant non plus. Éthier l’a clairement exprimé à quelques reprises[1]. Ils ne sont pas contre le récit chronologie de l’histoire politique, car cela peut être un excellent moyen de stimuler une question chez les élèves en montrant la faille dans un raisonnement avec des preuves à l’appui. J’ai d’ailleurs produit pour des collectifs qu’ils ont édités des tâches dans lesquelles le récit joue un rôle central pour aider les élèves à établir des liens et je n’ai jamais été censuré. Au contraire, ils en saisissaient très bien la pertinence.
Éthier et Lefrançois ne s’opposent pas à l’histoire de la formation de la nation canadienne-française, mais ils sont contre son érection en un (nouveau) récit canonique identitaire. Le nationalisme qu’ils prônent est civique et se fonde sur l’expérience de la majorité francophone, tout en insistant sur les nuances à faire avec celle des minorités à travers les siècles. Nous ne sommes pas dans une approche multiculturaliste, mais bien interculturelle. Si la nation québécoise subit des injustices, cela doit être dénoncé et enseigné, tout comme celles subies par les Premières Nations ou d’autres groupes. Enfin, s’ils n’hésitent pas à se qualifier de socioconstructivistes, ils ne sont pas dogmatiques non plus. Je me permets ici de souligner que les citations de Normand Baillargeon (p. 352-353) faites par Félix Bouvier dans son livre ne tiennent pas compte de la réponse et des précisions apportées par Éthier et Lefrançois[2]. Bref, on aurait aimé un bilan plus nuancé. Pour finir, je le répète, un chapitre sur l’évolution de la vision des programmes et leur vécu par les enseignants et les enseignantes aurait clos la chose de belle manière[3].
Cela dit, ce livre vaut le détour et ne devrait pas être uniquement considéré sur la base du dernier chapitre, car les autres nous plongent dans un objet d’étude fascinant et apportent de nouvelles pierres à l’étude de l’histoire de l’éducation au Québec. Il sera pour les enseignants du secondaire, les professeurs et les didacticiens universitaires, les étudiants en histoire et en sciences de l’éducation ou toutes les personnes intéressées par ce sujet, une source d’information non négligeable ou l’objet de discussions endiablées !
Parties annexes
Notes
-
[1]
Marc-André Éthier « Apprendre à exercer sa citoyenneté à l’aide de l’histoire », Bulletin d’histoire politique, vol. 15, no 2, hiver 2007, p. 53–58. Il le répétait dans la conclusion du collectif : Marc-André Éthier et al., Quel sens pour l’histoire ?, Saint-Joseph-du-Lac, M Éditeur, 2017, p. 98.
-
[2]
Marc-André Éthier et al., « Épilogue sur le débat de l’enseignement de l’histoire au Québec », Historical Studies in Education/Revue d’histoire de l’éducation, vol. 26, no 1, printemps 2014, p. 89-96.
-
[3]
Voir Alexandre Lanoix, Matière à mémoire. Les finalités de l’enseignement de l’histoire du Québec selon les enseignantEs, Saint-Joseph-du-Lac, M Éditeur, 2018, et Sabrina Moisan, « Pas cynique, mais… Représentations sociales de la citoyenneté et de l’éducation à la citoyenneté chez des enseignant.es d’histoire au secondaire », dans Marc-André Éthier et David Lefrançois (dir.), Agentivité et citoyenneté dans l’enseignement de l’histoire, Saint-Joseph-du-Lac, M Éditeur, 2019, p. 27-56.