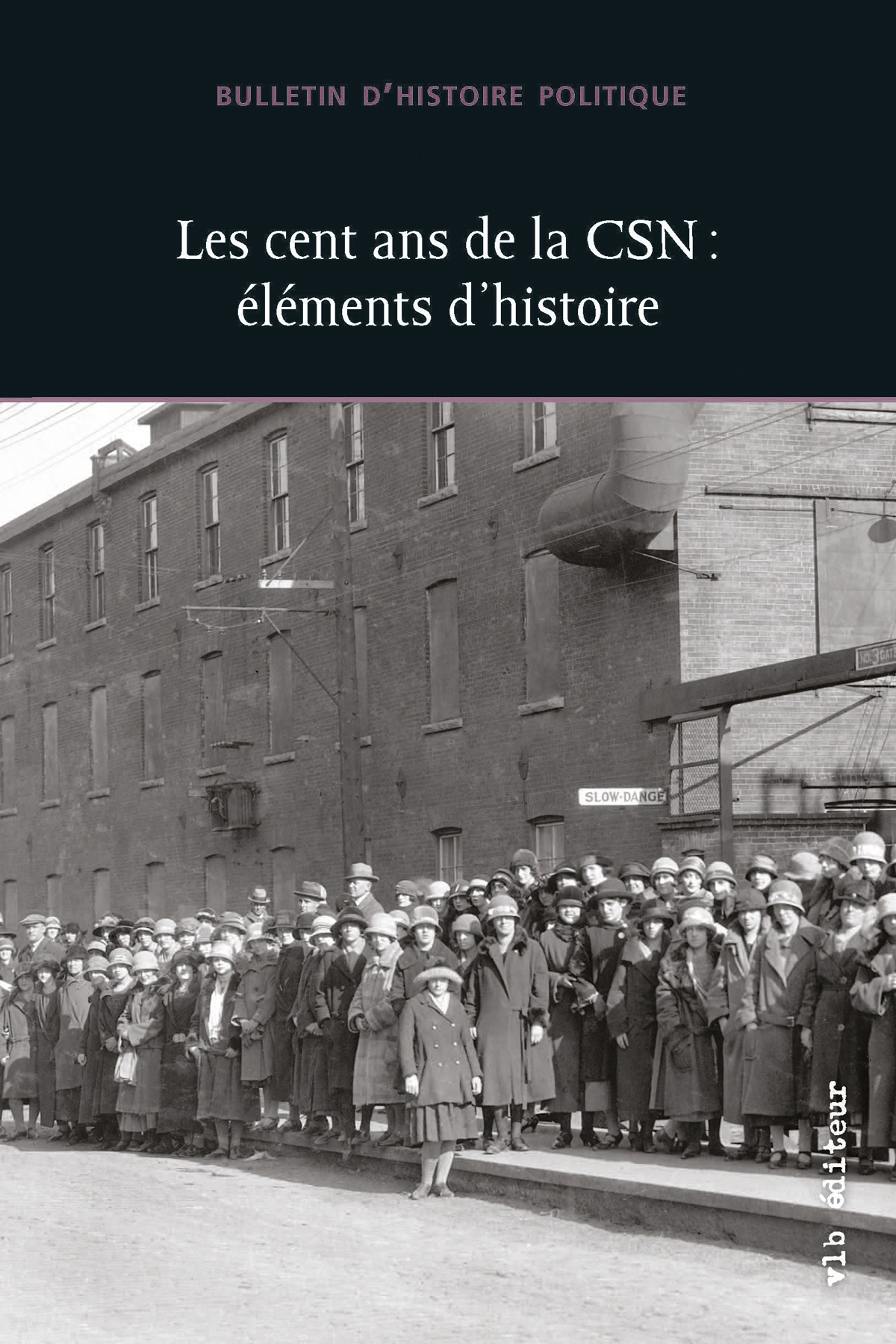Corps de l’article
Quelques mois à peine après avoir remplacé Jean Marchand à la présidence de la CSN, Marcel Pepin publiait, au congrès de 1966, un percutant rapport moral : Une société bâtie pour l’homme. On y préconisait par exemple, pour l’État québécois, un « rôle d’entraîneur de l’économie, ou d’initiateur[1]. » Le virage vers un syndicalisme davantage radical et revendicateur, qui serait la marque du nouveau président, commençait à prendre forme.
Deux ans plus tard, dans un nouveau rapport moral, Pepin ouvrait ce qu’on a appelé le Deuxième front. On y retrouve ce constat :
De plus en plus, l’image la plus répandue et la plus forte que le public se fait de l’injustice, à l’heure actuelle, c’est celle dont est victime la population non dans ses conditions de travail, mais dans ses conditions d’existence. Les conditions de logement, le chômage, la hausse des prix qui ruine les budgets familiaux, l’exploitation criminelle des gens par tant de sociétés de crédit, et combien d’autres choses encore, sont des manifestations de ce désordre profond et qui fait un mal incalculable à la population[2].
Une idée était plantée en terre syndicale. Elle allait germer de diverses façons dans le demi-siècle qui suivra. En témoigne ce que Jacques Létourneau a appelé son « testament syndical » livré en juin 2021 au Conseil confédéral de la CSN. Celui qui quittait son poste de président de la CSN pour se présenter à la mairie de Longueuil a alors inscrit cette décision dans la foulée du rapport de 1968.
Quand Marcel Pepin a lancé l’idée d’un Deuxième front, le message était clair. Les travailleuses et les travailleurs doivent défendre leurs intérêts sur tous les fronts, lutter partout où il y a des inégalités sociales, attaquer les injustices, combattre l’exploitation sur le front de la consommation, s’occuper des municipalités et des commissions scolaires, du logement social, des droits des locataires, du transport en commun, les terrains où peuvent être menées les luttes où des enjeux sociaux sont en cause sont multiples. Il faut les occuper. L’idée du Deuxième front a toujours son sens en 2021.
Quand on a lancé la campagne « Si on avançait », en 1993, c’était en reprenant cette idée d’un Deuxième front. J’avais dit que « dans les milieux de travail, on est sur la défensive et, souvent, on tente surtout de sauver des acquis ». Ce n’est pas évident d’ouvrir le deuxième front dans ce contexte. Mais en période difficile, je suis de ceux qui pensent que l’action sociopolitique est une nécessité.
Le deuxième front est celui des luttes sociales qui font déborder le syndicalisme en dehors des conventions collectives, au bénéfice de l’ensemble de la société : salaire minimum, assurance-maladie, assurance-automobile, régime québécois d’assurance parentale, etc.
C’est celui qui fait prendre conscience aux travailleurs que leurs conventions collectives n’existent pas en vase clos, mais bien dans une société, qui a aussi une emprise sur leurs conditions de vie. Que le rapport de force dans lequels ils sont impliqués peut être un moteur de changement pour tous. Il ne faut jamais perdre de vue qu’un travailleur, c’est aussi un citoyen[3].
Les origines
On a l’habitude de situer le début de la Révolution tranquille à l’arrivée au pouvoir du Parti libéral de Jean Lesage en juin 1960. Mais comme l’ont avancé plusieurs, dont le syndicaliste et essayiste Pierre Vadeboncoeur, cette révolution avait été amorcée depuis quelques années dans les milieux intellectuels, dans certains partis politiques et dans les syndicats, dont la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC), qui, quelques mois après l’élection des libéraux, prit le nom de Confédération des syndicats nationaux (CSN). Dans une préface au recueil de textes de Vadeboncoeur réunis en 1990 dans Souvenirs pour demain, le président de la CSN, Gérald Larose, écrivait que ce dernier « avait expliqué comment le terreau syndical a servi de lieu de culture pour les idées qui ont, par la suite, nourri la révolution qui a transformé la société québécoise[4]. »
Les années qui ont suivi ont vu s’ouvrir les fenêtres et entrer des bouffées d’air frais dans tous les secteurs d’activité. Portés par cet élan d’émancipation, les travailleuses et les travailleurs revendiquent, comme jamais auparavant, de meilleures conditions en même temps que la reconnaissance de la valeur sociale de leur travail. En quelques années, dans les secteurs public et parapublic, la syndicalisation fit des pas de géants : fonctionnaires, professionnels, ingénieurs, employés d’hôpitaux se sont donné des syndicats qui ont osé prendre de front un paternalisme d’État qu’a bien illustré cette phrase de Jean Lesage : « La Reine ne négocie pas avec ses sujets ! »
Dans le secteur privé, on n’était pas en reste. Une audace nouvelle s’était emparée des syndicats et de leurs membres. On ne reculait plus devant les employeurs, anglais et américains en majorité. En plein coeur de ce qu’on a appelé plus tard les Trente glorieuses, des gains impossibles à imaginer jusque-là ont été acquis. Les salaires ont explosé. L’arbitraire patronal a été remis en cause. Les syndicats ont finalement été reconnus comme des interlocuteurs qui ne pouvaient continuer d’être ignorés.
Revenus et dépenses
Mais un piège allait mettre en péril tous ces gains acquis par la négociation de conventions collectives : la consommation ! Longtemps freiné par le manque de ressources financières, le désir d’améliorer son train de vie a rapidement conduit à une consommation que les salaires, même si fortement améliorés, ne pouvaient arriver à satisfaire. C’est ainsi que dans les années soixante, les travailleurs, leurs syndicats et la CSN constataient que les gains obtenus grâce aux négociations de conventions collectives fondaient comme neige au soleil quand ils redevenaient des citoyens/consommateurs. Comme les banques et les Caisses populaires faisaient très peu de prêts personnels, ce sont ce qu’on appelait à l’époque des compagnies de finance et d’ « acceptance » qui attendaient les travailleurs au coin des rues et les finançaient à des taux d’intérêt usuraires.
Les rues principales des petites villes du Québec fourmillaient à l’époque de succursales des compagnies Household Finance, Niagara Finance, Avco, Beneficial Finance, Trans Canada Finance et autres. Constatant les ravages dus à ces opérations dans les rangs des travailleurs, Marcel Pepin, alors secrétaire général de la CSN, confie à un militant de Québec, André Laurin, le mandat d’intervenir à Shawinigan où les travailleurs d’une usine de métallurgie sortaient d’un dur conflit en 1962. Il y avait constaté leur taux extrême d’endettement. Si les augmentations de salaire s’en vont directement dans les coffres des compagnies de finance, on n’est guère avancés, se disait-il.
Les succès furent tels que Laurin fut envoyé par la CSN au Saguenay, quelques années plus tard, pour s’attaquer aux compagnies de finance qui fleurissaient à Chicoutimi, sur la principale artère, la rue Racine. Avec un enthousiasme débordant, Laurin a mené une croisade sans merci contre ces entreprises. Grâce à des campagnes à la radio et à la télévision, toute la population fut alertée. Le samedi soir, tout juste avant la diffusion de la partie de hockey des Canadiens, la CSN finançait une émission de télévision, Tirons ensemble, animée par Laurin. On lui intenta 200 procès, qu’il gagna. En un an, 10 000 familles avaient bénéficié des conseils de l’équipe mise sur pied pour assainir les budgets familiaux. La CSN mit alors sur pied le Service du budget familial dirigé par Laurin. Dans son rapport de 1968, le président en dit « qu’il ne se bornait pas simplement à aider les membres ; il était au surplus, et peut-être surtout, un instrument de combat. La CSN faisait cette fois la lutte contre l’exploitation du peuple en dehors des lieux de travail[5]. »
Plusieurs avocats du Saguenay–Lac-Saint-Jean avaient offert gratuitement un soutien juridique à de nombreuses familles aux prises avec ces compagnies de finance qui les tenaient à la gorge. Dans le rapport de 1968, Pepin s’en était pris à certaines professions libérales, dont le Barreau, qui s’opposait à la mise à disposition de services juridiques gratuits par l’État. Quelques années plus tard, en 1972, une loi créant l’aide juridique était adoptée. On estime à 250 000 le nombre de demandes qui sont traitées chaque année. La bataille de Laurin et de la CSN avait porté ses fruits sur ce front de la défense des droits des consommateurs et des justiciables.
Après les expériences de Shawinigan et du Saguenay, l’idée de défendre les travailleurs partout où leurs droits étaient attaqués avait commencé à prendre forme. En 1965, à l’occasion d’une réunion des permanents de la centrale présidée par le secrétaire général Marcel Pepin — le président Jean Marchand étant membre de la commission Laurendeau-Dunton sur le bilinguisme et le biculturalisme — Pierre Vadeboncoeur fit une intervention qui devait engager l’avenir de la CSN. Conseiller syndical depuis 1950, Vadeboncoeur avait publié en 1963 un essai fort remarqué, La ligne du risque. Il faut retenir que c’est lui qui avait négocié avec le syndicat de Shawinigan en 1962, là où André Laurin était intervenu. Dans son plaidoyer, il avait soutenu que le syndicalisme devait déborder du champ étroit de la convention collective pour mieux défendre la classe ouvrière sur tous les fronts. Son intervention avait été appuyée par un syndicaliste légendaire, Philippe Girard, ancien président du syndicat des chauffeurs de tramway à Montréal, les « p’tits chars ». C’est lui qui avait dirigé les grèves de Sorel, en 1937. Marcel Pepin lui aussi avait appuyé cette idée.
1968
Le président Pepin avait été clair dans son rapport :
Il ne faut pas laisser les choses comme elles sont et nous contenter d’en parler. Il faut mobiliser la misère pour combattre la misère, la pauvreté pour combattre la pauvreté, les endettés pour combattre l’endettement, les trahis pour combattre la trahison, les exploités pour vaincre l’exploitation. Et il nous faut d’abord nous mobiliser nous-mêmes[6].
Le programme était vaste : développer et redresser le système coopératif, multiplier les caisses d’économie, militer dans les caisses populaires, établir des coopératives de consommation, faire la jonction avec le mouvement coopératif, organiser la résistance collective contre la hausse des prix, organiser des groupes de citoyens, de locataires et participer à leurs luttes, lancer des mouvements de contestation et participer aux manifestations, créer des comités d’action politique par comtés et par quartiers, dans les villes et les commissions scolaires, mais en dehors des cadres des partis politiques.
Lucide, Pepin avait fait le constat que « les syndicats se limitent plus ou moins à l’entreprise. Par conséquent, la solidarité aussi. Il en résulte une baisse du militantisme[7]. » Il avait écrit qu’il fallait d’abord « nous mobiliser nous-mêmes[8]. » Chroniqueur syndical dans un quotidien de Québec, j’avais assisté, en 1969, à une rencontre entre la direction de la CSN et ses permanents. Je me souviens très bien avoir entendu Pepin soutenir qu’il fallait que les permanents consacrent au moins une journée par semaine à l’action politique. En dépit des plaidoyers convaincants du directeur du Secrétariat d’action politique, André L’Heureux, et du conseiller Pierre Vadeboncoeur, cette orientation, qui heurtait de front des habitudes bien ancrées depuis des années, ne fut pas reçue dans le plus grand enthousiasme. Dans le Deuxième front, le président avait d’ailleurs prévu que les changements de mentalité ne seraient pas faciles. Il écrit :
Passer aux actes, dans le sens que ce document souligne et avec l’ampleur nécessaire, ce ne sera pas simple. Un grand travail d’évolution dans les conceptions syndicales et sociales des militants sera indispensable. Les changements envisagés ne seront pas possibles à moins que chacun, chaque permanent, chaque militant n’ait le souci de se former aux idées nouvelles[9].
Dans le rapport au congrès de 1970, Un camp de la liberté, le président se livre à quelques observations sur les suites qui ont été données à cette ouverture d’un deuxième front.
Les travailleurs ont plongé avec coeur dans cet effort. Même si les résultats, jusqu’à maintenant, ne sont pas mirobolants, ils ne manquent pas d’impressionner. La fondation d’un grand journal hebdomadaire coopératif, la mise en marché de clubs de consommation, la fondation d’un grand magasin COOPRIX à Montréal et d’un second près de Québec, la formation de nombreuses coopératives de crédit indiquent qu’il y a des ressources et de l’imagination dans le Québec et que nous ne rêvions pas complètement en 1968 lorsque nous avons dit que les travailleurs organisés pouvaient également devenir des consommateurs organisés[10].
Il est vrai que sous certains aspects, les succès ont été mitigés. L’hebdomadaire Québec-Presse a publié sa dernière édition en 1974. Les magasins COOPRIX ont fermé leurs portes. Par contre, il s’est formé des centaines de caisses d’économie en milieu de travail, regroupées aujourd’hui au sein de la Fédération Desjardins sous le vocable de Caisses de groupes. L’un des succès les plus éclatants de ces caisses d’économie est celle fondée en 1971 à Québec par André Laurin sous le nom de la Caisse des travailleurs réunis. Connue aujourd’hui sous le nom de Caisse d’économie solidaire Desjardins, elle est la principale institution financière québécoise spécialisée dans l’économie sociale et l’investissement responsable. En 2019, elle affichait un volume d’affaires de 2,2 milliards $, ce qui la plaçait au 45e rang sur les quelque 213 caisses que compte le Mouvement Desjardins.
Sur d’autres fronts
On l’a vu précédemment, les luttes menées devant les tribunaux pour sortir les travailleurs des griffes des compagnies de finance ont conduit à la mise en place de l’aide juridique, dont bénéficient des milliers de Québécoises et de Québécois chaque année.
C’est grâce au travail acharné du directeur du Secrétariat d’action politique de la CSN, André L’Heureux, et des deux conseilleurs syndicaux du Secrétariat, Pierre Vadeboncoeur et Paul Cliche, que plusieurs outils collectifs à la défense des intérêts populaires ont été produits et que des combats sociaux ont pu être menés à terme. Au moment du décès d’André L’Heureux, en novembre 2003, je lui ai rendu hommage dans Le Devoir :
C’est grâce à son action et à sa ténacité que la société québécoise s’est enrichie d’outils collectifs qui continuent, encore aujourd’hui, d’être de première utilité. Parmi les dossiers pour lesquels il a mis à profit son inépuisable énergie, il faut mentionner la lutte contre les clubs privés de chasse et de pêche, pour l’assurance santé, pour les droits des locataires et contre les privilèges consentis aux grandes entreprises, comme l’Alcan, dans l’utilisation de nos richesses naturelles. Il a aussi mené plusieurs combats pour que la forêt québécoise cesse d’être livrée au pillage des grandes compagnies. Mais c’est sans contredit de sa croisade en faveur d’un régime d’assurance-automobile public que la société québécoise lui est le plus redevable.
Lise Payette, ministre responsable du dossier de l’assurance-automobile, déclarait après l’adoption de la loi créant la société d’État que sans la campagne menée tambour battant par la CSN, cela n’aurait pas été possible. Or le moteur de cette campagne, c’était André L’Heureux, qui, à l’époque, avait vu sur place, en Saskatchewan, les avantages d’une telle législation[11].
Les clubs de chasse et de pêche privés
À la fin des années 1960, la CSN a lancé une campagne pour la démocratisation des clubs privés de chasse et de pêche. Des centaines de lacs et de rivières, parmi les plus poissonneux, étaient réservés à des élites économiques et politiques, souvent américaines, alors que le peuple en était exclu. Lors d’une réunion de chasseurs organisée par la CSN, on met sur pied le Mouvement pour l’abolition des clubs de chasse et de pêche privés sur les terres de la Couronne (MACPTC). D’après Pascal Gagnon, dans un mémoire de maîtrise présenté à l’UQTR en 2002 :
La CSN y va aussi de ses propres initiatives. Elle fait directement pression sur le gouvernement lorsque celui-ci concède à des clubs privés le territoire de deux parcs du domaine public. La centrale syndicale juge ce geste comme étant un recul inacceptable du gouvernement. Elle lui envoie donc une liste de 22 questions « afin que la population sache de façon précise les intentions du gouvernement Bourassa sur la question de la démocratisation des territoires publics de chasse et de pêche ». De plus, ce lien intime de parenté avec la CSN attire l’attention des médias nationaux. Dans les médias écrits, le journal Le Devoir s’occupe de relater les gestes posés par les contestataires[12].
En 1969, un quotidien de Québec, L’Action, a publié un dossier dans lequel était dénoncé cet état de fait d’un peuple dépossédé de son propre territoire : « Chassez ! Pêchez ! Baignez-vous ! … sur la rue Saint-Jean ! »
Ces luttes contre les clubs de chasse et de pêche privés se sont inscrites directement dans une vaste entreprise de libération de son propre territoire. En effet, la situation s’apparentait objectivement à une forme de féodalisme où quelques centaines de possédants pouvaient jouir d’immenses territoires et de richesses auxquels les habitants du lieu n’avaient pas accès. Dans les années cinquante, je demeurais en Gaspésie, à Sainte-Anne-des-Monts. La rivière Sainte-Anne qui se jetait dans le Fleuve était réputée pour sa richesse en saumons. C’est une Américaine qui en était l’unique propriétaire. La rivière et ses rives étaient interdites aux locaux. La propriétaire avait fait installer un système de câbles à partir desquels une nacelle pouvait survoler la rivière. La propriétaire s’y promenait avec une carabine et malheur à qui aurait osé s’aventurer sur SON territoire !
C’est finalement en 1977 que le ministre Yves Duhaime, du Parti Québécois, a fait adopter une loi visant à « décluber » la chasse et la pêche en mettant fin aux baux exclusifs détenus par les privilégiés. On avait recensé plus de 2000 de ces clubs en 1965. Désormais, toutes les citoyennes et tous les citoyens du Québec avaient accès à ces plans d’eau.
L’assurance-maladie : il faut se grouiller
En mars 1970, le Secrétariat du Comité central d’Action politique de la CSN publiait un fascicule intitulé : L’assurance-maladie, il faut se grouiller. Les auteurs, L’Heureux et Vadeboncoeur, y dénonçaient le retard pris par le gouvernement québécois dans l’adoption d’une loi mettant en vigueur une assurance-maladie « universelle, publique et complète ». Pareille loi était prévue pour juillet 1968. La CSN identifiait ceux qui ont retardé cette adoption : « Le trust de l’assurance privée. Le Collège des médecins et autres groupements professionnels de médecins. Les organisations capitalistes, telles que les Chambres de Commerce[13]. »
Il faut se rappeler qu’en octobre 1970, en pleine crise felquiste, les médecins spécialistes ont déclenché une grève pour combattre le projet de loi créant l’assurance-maladie. La loi sera finalement adoptée, non sans que les médecins ne se livrent à un combat d’arrière-garde pour le maintien de leurs privilèges abusifs. À la dernière page de cette brochure, on peut lire dans quel but elle a été produite :
Cette brochure avait pour but d’éclairer, pour le militant, la question très actuelle de l’assurance-maladie. Elle pourra lui servir de guide et d’instrument dans son action. Le militant, à partir de cette brochure, doit faire partager ce qu’il a appris à tous ceux qui sont dans son rayon d’action. Ce ne sont pas les notables, c’est le peuple lui-même qui influencera son propre destin[14].
La dernière phrase est tirée du Deuxième front : « Nous n’avons pas le droit de laisser à d’autres qu’au peuple le soin de faire une société qui est la sienne[15]. »
Cette mobilisation pour l’adoption d’une telle législation était elle aussi inspirée par la nécessité de protéger les gains arrachés de haute lutte lors de la négociation des conventions collectives. À peu près toutes les familles québécoises ont à la mémoire le souvenir de parents qui, faute de ressources financières, n’avaient pu à l’époque recevoir les soins de santé requis. Ou encore, des familles qui avaient dû rembourser durant plusieurs années les frais encourus par l’hospitalisation d’un de leurs membres.
Là aussi, il s’est agi de protéger un pouvoir d’achat mis à mal dès lors que la travailleuse ou le travailleur ne pouvait plus jouir de la protection que lui accordait la convention collective négociée.
L’assurance-automobile : pour une Régie publique
Un mois après la publication de la brochure portant sur l’assurance-maladie, en avril 1970, c’est un vibrant plaidoyer pour la mise en oeuvre d’une assurance-automobile publique qui était contenu dans une brochure qui faisait 174 pages.
« Depuis que l’automobile existe, les compagnies d’assurances ont eu la chance de démontrer ce qu’elles pouvaient faire : la preuve est faite. Elles sont incapables de protéger adéquatement l’ensemble des victimes d’accidents d’automobile au taux le plus bas pour l’assuré, surtout au Québec où les taux ont toujours été les plus élevés au Canada[16] », peut-on y lire. On y faisait la promotion du no fault, qui sera inclus dans la loi adoptée en décembre 1977.
La revendication de la CSN remontait à 1957, le congrès de la centrale réclamant alors que le gouvernement québécois établisse un régime d’assurance-automobile obligatoire sous la Régie de l’État. À compter de 1970, une campagne nationale est lancée pour la création d’un régime public d’assurance-automobile. Avant l’adoption de cette loi, c’est au Québec que les primes étaient les plus élevées. Le tiers des automobilistes n’avaient pas d’assurances.
Il avait fallu vaincre la résistance des avocats et du Barreau, qui voyaient dans les causes d’accidents de voiture une source de gains financiers qui ne leur serait plus accessible en vertu du principe du no fault ; y compris au sein du cabinet Lévesque, où plusieurs ministres avocats s’opposaient aussi au projet de loi. Le chef de cabinet de la ministre, Jacques Desmarais, était un ancien salarié de la CSN qui avait collaboré avec le Secrétariat d’action politique à l’occasion de plusieurs campagnes publiques.
Aujourd’hui, ce régime d’assurance-automobile fait l’envie des provinces canadiennes. La ministre Payette n’avait pas manqué de saluer les efforts de la CSN sans qui, selon elle, cette loi n’aurait pu être adoptée.
Le logement
En décembre 1970, le Secrétariat d’action politique publiait une brochure de près de 200 pages, Le logement au Québec. Une deuxième édition était publiée en août 1972, portant le nombre de brochures distribuées à plus de 6000.
En avant-propos, on y signale que « la crise du logement au Québec s’accentue : rareté de logements familiaux adéquats accessibles au salarié moyen, destruction massive de logements peu coûteux[17]. » À cette époque, des centaines de logements abordables avaient été démolis pour faire place à l’autoroute Ville-Marie et à l’édifice de Radio-Canada, dans ce qu’on appelait le Faubourg à m’lasse. Deux ans plus tôt, au congrès de 1968, le premier rapport du Comité central d’action politique avait vertement dénoncé la spéculation foncière. « Parmi les parasites les plus crasseux, assoiffés et puissants auprès du pouvoir politique, il faut compter les spéculateurs immobiliers. Ceux-ci s’apparentent aux usuriers. La spéculation immobilière est une autre forme, parmi tant d’autres, du vol légalisé, du désordre que maintiennent les profiteurs, ceux qui s’intitulent l’ordre établi[18] », avait écrit le Comité.
En 1969, le Comité du logement du Conseil confédéral de la CSN avait soumis plusieurs rapports au ministère des Affaires municipales du Québec. Dans la brochure de 1971, on constatait que le fond du problème n’avait pas encore été abordé, « les politiques des gouvernements n’ayant pas évolué d’un pouce[19]. »
On s’en prenait à la notion de « logement social » en citant une analyse de la revue française Esprit. « La notion actuelle de logements sociaux n’est-elle pas, comme l’asile ou l’hospice, encore un rejet, par la société, de ses membres gênants ? Une politique de l’habitat, de la santé, de la vieillesse ne devrait-elle pas permettre de remplacer la ségrégation des hospices, des asiles et des logements sociaux par l’intégration de toutes les catégories de la population à l’ensemble de la collectivité[20] ? » Cinquante ans plus tard, on peut constater comment cette intégration est loin d’être atteinte quand on voit les dérives où on peut arriver avec les débats sur ces logements dits « abordables[21] ».
En 1973, c’est l’idée d’un bail type et le remplacement de la Régie des loyers par une Régie du logement qui était lancée par la CSN. Six ans plus tard, une Régie du logement et un bail type étaient mis en place.
Le locataire et ses droits
En janvier 1971, c’est une autre publication du Secrétariat d’action politique de la CSN qui fera du bruit : Le locataire et ses droits[22]. Cette brochure de 190 pages venait compléter une publication antérieure portant sur la question du logement. Jacques Desmarais et Pierre Jauvin y ont collaboré. Rappelant que « le Québec est un pays de locataires[23] » — 81,9 pour cent de la population montréalaise est locataire — la CSN dit intervenir pour que « l’adoption de la loi projetée ne se fasse pas attendre pendant trop d’années encore, nous proposons que les salariés des municipalités entreprennent une campagne auprès du gouvernement. » Le but de cette campagne était d’obtenir que la Régie des loyers devienne le chien de garde des locataires et que sa juridiction soit étendue à tous les locataires de toutes les municipalités du Québec.
D’entrée de jeu, on indique vouloir mettre à la disposition des locataires tous les règlements et lois touchant le logement et les droits des locataires, textes et informations qui sont réservés d’ordinaire aux officines d’avocats. On y trouve aussi des questions que se posent les locataires et les réponses qu’il faut y apporter.
Les salariés à l’action dans les municipalités
La première édition de cette brochure de 248 pages paraît en juillet 1970. L’intention est clairement énoncée : il ne suffit pas de surveiller le pouvoir ; il faut l’exercer ! Le Secrétariat voit grand. « Une armée de militants bien encadrés est en train de se mettre sur pied dans toutes les régions du Québec[24] », affirme-t-on. À la base, on retrouve les militants de chaque syndicat. L’objectif ? « Il faudrait en venir à former au niveau de chaque syndicat ou section de syndicat un noyau de militants qui sensibiliseraient leurs confrères en faisant rapport aux assemblées générales des activités des comités d’Action politique[25]. » On veut créer des comités locaux et régionaux. Un comité national formé de représentants de toutes les régions est aussi mis en place.
Les responsabilités du Secrétariat central d’Action politique sont précisées : il est chargé de former les militants d’Action politique, il va coordonner des manifestations et des campagnes régionales et nationales ayant une incidence politique, il va alimenter les comités en informations et en documentation politiques. On veut aussi que les salariés de la CSN présents dans les Conseils centraux, qui sont les regroupements régionaux des syndicats affiliés, se tiennent en lien avec le Secrétariat.
Force est de constater que ces intentions plutôt optimistes n’ont pas connu les mêmes résultats probants que ceux connus lors des campagnes sur les clubs privés, l’assurance-automobile, l’assurance-maladie ou le logement. Peu avant le congrès de 1974 de la CSN, Paul Cliche s’était livré à une analyse lucide sur les raisons expliquant les insuccès des comités populaires. On retrouve cette réflexion dans le mémoire de maîtrise de l’historien Marc Comby déposé en 2005 :
Il ne faut pas oublier que la plus grosse somme d’énergie que nos militants les plus politisés dépensent présentement à faire de l’action politique n’est pas dépensée au sein des comités populaires, mais dans le cadre du PQ. Il faudrait préciser les limites de ce type d’engagement, qui n’est pas à combattre, mais qui peut conduire à de nouvelles désillusions, car c’est loin d’être la solution à long terme et il ne faudrait pas que nos meilleurs militants mettent tous leurs espoirs dans le PQ parce qu’il présente à court terme des réponses plus concrètes, plus palpables et une action mieux articulée que celles de notre projet politique à long terme[26].
Quatre ans plus tôt, la Crise d’octobre avait complètement déstabilisé le Front d’action politique (FRAP) dirigé par Paul Cliche. Après des luttes intestines, cette formation disparaîtra et le Rassemblement des citoyens de Montréal sera créé. Aux élections de 1974, le RCM fera élire 18 conseillers sur 55 et Paul Cliche obtiendra 57,25 pour cent des voix dans son quartier. Seul le président du Comité exécutif, Lawrence Hanigan, recevra plus de votes. Ce qui avait fait dire au secrétaire général de la FTQ, Fernand Daoust : « Ayant constaté que le Parti civique a perdu le tiers de ses appuis et le tiers de ses sièges au conseil municipal de Montréal, M. Daoust soutient que “c’est là le début de la dégringolade d’un régime autoritaire et anti-social. C’est le début de la démocratie à Montréal”[27]. »
Cinquante ans plus tard
L’idée d’un Deuxième front a conduit à plusieurs résultats probants qui ont profité à toute la population : en particulier l’abolition des clubs privés, l’aide juridique, l’assurance-maladie, l’assurance-automobile, les droits des locataires, le réseau de garderies, l’égalité salariale. Ce sont là des résultats indéniables. On est aujourd’hui conscient que le pouvoir politique et le pouvoir économique sont en mesure de réduire à néant les gains obtenus par la négociation de la convention collective. Les syndicats ont ainsi appris à la dure qu’un article de leur convention, pour utile et nécessaire qu’il soit, ne suffit pas toujours à protéger ce qui a été acquis de haute lutte et qu’en conséquence, il soit impératif d’agir plus largement. Comme l’a souligné l’ex-président de la CSN Jacques Létourneau au moment de son départ de la présidence, le syndiqué est aussi un citoyen et, à ce titre, il doit s’organiser pour que ses droits et ses valeurs soient respectés dans tous les aspects de sa vie en société. C’est ainsi qu’il faut comprendre, par exemple, les mobilisations syndicales qui ont été organisées depuis les années soixante pour la défense et la promotion de la langue française au Québec.
En revanche, sur le front des comités populaires d’action politique, les espoirs du départ ne se sont pas concrétisés. Ce que Paul Cliche appelait « notre projet politique à long terme » n’aura finalement pas vu le jour. Force est de constater que contrairement à ce qui a pu se développer dans d’autres pays, la majorité des organisations syndicales québécoises ont refusé jusqu’à maintenant de s’investir dans l’action politique partisane. Ce qui ne les a pas empêchées de peser de tout leur poids pour influencer les orientations et décisions qui touchent, en tant que citoyens et citoyennes, les travailleuses et les travailleurs syndiqués.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Marcel Pepin, Une société bâtie pour l’homme : Rapport moral du président général de la Confédération des syndicats nationaux, Montréal, CSN, 1966, p. 30.
-
[2]
Marcel Pepin, Le deuxième front : rapport moral de Marcel Pepin, président général, au congrès de la CSN, le 13 octobre 1968, Montréal, CSN, 1968, p. 10.
-
[3]
Jacques Létourneau, « Discours d’ouverture du président de la CSN au Conseil confédéral du 17 juin 2021 ».
-
[4]
Pierre Vadeboncoeur, Souvenirs pour demain, Montréal, CSN, 1990, p. 6.
-
[5]
Marcel Pepin, Le deuxième front…, p. 45.
-
[6]
Ibid., p. 69.
-
[7]
Ibid., p. 41.
-
[8]
Ibid., p. 69.
-
[9]
Ibid., p. 66.
-
[10]
Marcel Pepin, Un camp de la liberté : rapport moral du Président général de la Confédération des syndicats nationaux au congrès général le 6 décembre 1970, Montréal, CSN, 1970, p. 21.
-
[11]
Michel Rioux, « Vivre et mourir debout », Le Devoir, 10 décembre 2003.
-
[12]
Cité dans Pascal Gagnon, La pratique de la chasse dans le comté de Rimouski (1930-1980), mémoire de maîtrise (Études québécoises), UQTR, 2002, p. 68-69.
-
[13]
CSN, Secrétariat du Comité central d’action politique, Assurance-maladie : Il faut se grouiller !, Montréal, CSN, 1970, p. 38.
-
[14]
Ibid., p. 66.
-
[15]
Marcel Pepin, Le deuxième front…, p. 70.
-
[16]
CSN, Secrétariat du Comité central d’action politique, Assurance-automobile : pour une régie publique, Montréal, CSN, 1970, p. 16-17.
-
[17]
CSN, Secrétariat d’action politique, Le logement au Québec, Montréal, CSN, 1972, p. 7.
-
[18]
Ibid., p. 8.
-
[19]
Ibid., p. 128.
-
[20]
Ibid., p. 130.
-
[21]
Ibid., p. 60.
-
[22]
CSN, Secrétariat d’action politique, Le locataire et ses droits, Montréal, CSN, 1971, 190 p.
-
[23]
Ibid., p. 14.
-
[24]
CSN, Secrétariat du Comité central d’action politique, Les salariés à l’action dans les municipalités : Il ne suffit pas de surveiller le pouvoir ; il faut l’exercer, Montréal, CSN, 1970, p. 31.
-
[25]
Ibid., p. 33-34.
-
[26]
Cité dans Marc Comby, Mouvements sociaux, syndicats et action politique à Montréal. L’histoire du FRAP (1970-1974), mémoire de maîtrise (histoire), Université de Montréal, 2005, p. 91.
-
[27]
« FTQ : les travailleurs ont enfin une voix à l’hôtel de ville », Le Devoir, 12 novembre 1974, p. 3.