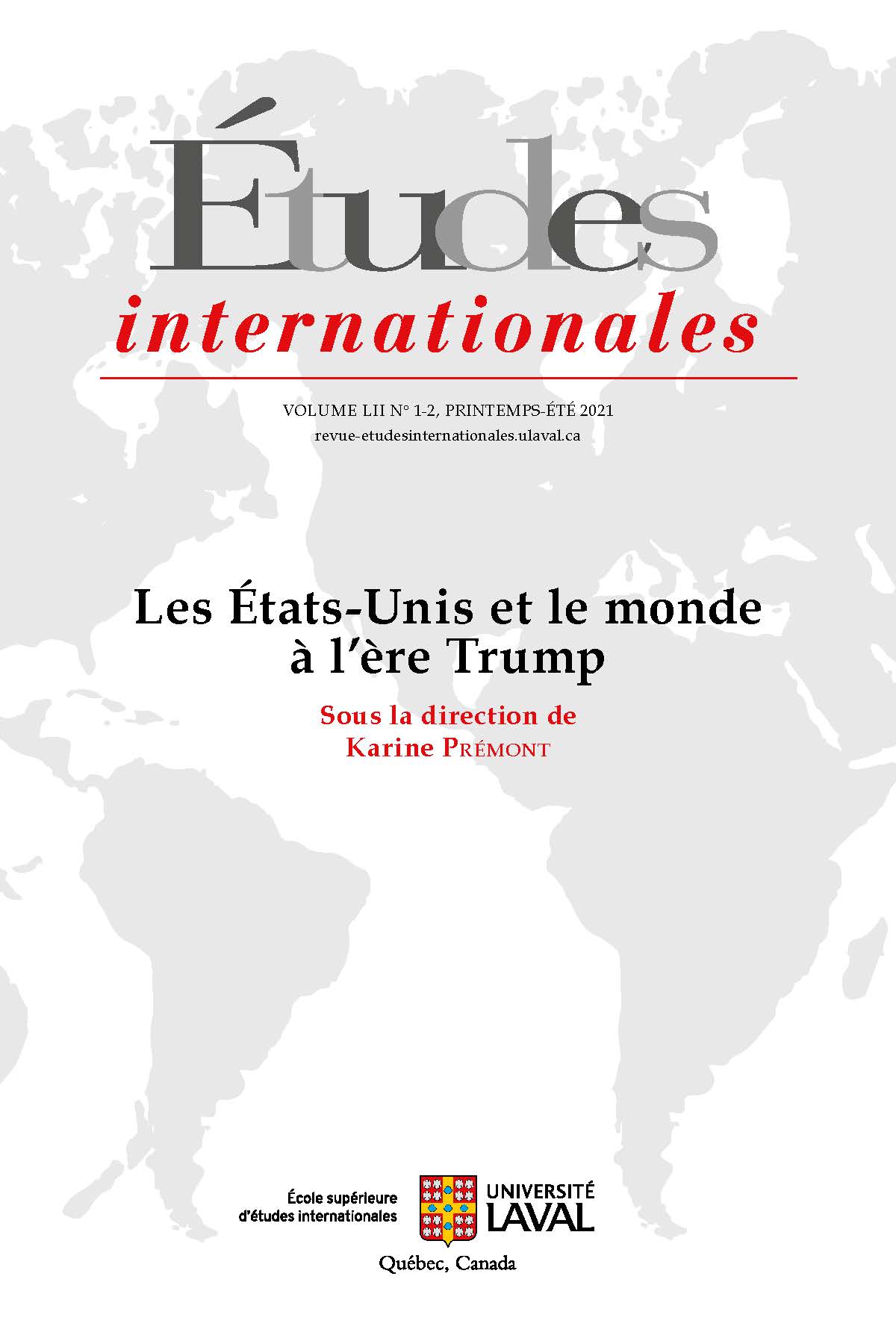Résumés
Résumé
Le système international vient d’entrer dans une nouvelle ère nucléaire que l’on peut qualifier de « désordre multilatéral ». Cette situation est caractérisée par une compétition stratégique accrue entre grandes puissances, en particulier les États-Unis, la Russie et la Chine, l’émergence de technologies déstabilisantes pour la dissuasion, une accélération de la prolifération au niveau régional et l’affaiblissement des normes internationales qui ont favorisé le contrôle des armes nucléaires et freiné leur diffusion. Cet article examine de façon critique chacune de ces tendances et propose quelques pistes de réflexion quant à l’issue de cette situation.
Mots clés:
- armes nucléaires,
- stratégie,
- États-Unis,
- Chine,
- non-prolifération,
- Russie
Abstract
In the past decade, the world has entered a new nuclear age : relations among the major nuclear powers (United States, Russia and China) have grown more competitive, the spread of nuclear weapons to new states has resulted in worrying regional nuclear instabilities, and technological advances are raising new threats, while Arms Control is in a state of near total collapse. A new multilateral nuclear disorder, combining traditional concerns with distinctive new dangers, is here. The perils of this new and still evolving nuclear reality must be understood. The purpose of this article is to present a critical analysis of this reality and offer some thoughts regarding the future of the nuclear (dis)order.
Keywords:
- nuclear weapons,
- strategy,
- Unites-States,
- China,
- non-proliferation,
- Russia
Corps de l’article
Introduction
En janvier 2021, pour la seconde année de suite, l’horloge virtuelle « de la fin du monde », créée en 1947 par The Bulletin of the Atomic Scientists pour signaler le danger d’une confrontation nucléaire, indiquait 100 secondes avant minuit. Après une année et demie de pandémie, accompagnée d’un cortège de catastrophes climatiques, est-il nécessaire d’accentuer les inquiétudes existentielles en rappelant le risque de l’annihilation nucléaire ? Plusieurs raisons pointent dans cette direction.
Un échange nucléaire, d’abord, est-il besoin de le rappeler, serait probablement un événement qui, par ses conséquences, dépasserait de loin les pires catastrophes qui se sont produites durant le dernier siècle. N’oublions pas qu’une seule arme thermonucléaire moderne dépasse d’au moins dix fois la puissance de la bombe d’Hiroshima qui, à elle seule, a fait près de 200 000 victimes. Or, même si les arsenaux nucléaires ont été réduits de plus de 80 % depuis la fin de la guerre froide, ils n’en contiennent pas moins plus de 13 000 armes de ce type, dont plusieurs milliers prêtes à l’emploi en quelques minutes. La perspective d’un conflit nucléaire, même limité à « quelques bombes », aurait donc des conséquences inimaginables. Ajoutons que, même s’il est très réduit, le risque que l’arme atomique soit employée est malgré tout bien réel, au regard du nombre d’États dotés de capacités nucléaires – neuf au dernier décompte – et compte tenu des tensions persistantes entre certains d’entre eux. Vivre avec l’arme nucléaire implique donc que l’on assume ce risque, si infime soit-il.
L’évolution de la conjoncture internationale, depuis près d’une décennie, nous rappelle également que le risque nucléaire post-guerre froide ne fait pas que perdurer, il augmente. Sans vouloir tomber dans l’alarmisme, cinq tendances peuvent être mises en évidence.
Les tensions géopolitiques persistantes entre grandes puissances, notamment les États-Unis, la Russie et la Chine, se répercutent au niveau nucléaire. Toutes trois ont entrepris des programmes ambitieux de modernisation et de renforcement de leurs arsenaux nucléaires, ce qui suggère le début d’une nouvelle compétition stratégique. En outre, de bilatérales qu’elles étaient durant la guerre froide (États-Unis-urss), les relations nucléaires entre très grandes puissances sont devenues trilatérales (États-Unis-Russie-Chine) et, donc, plus complexes à gérer.
Parallèlement, pour beaucoup d’observateurs, l’évolution de certaines technologies de pointe (missiles hypersoniques, armes antisatellites, intelligence artificielle, etc.) est en train de transformer les arsenaux nucléaires et de remettre en question la stabilité de la dissuasion (Chyba 2020). De surcroît, les normes qui ont gouverné les relations nucléaires entre grandes puissances, et notamment la pratique du contrôle des armements, tendent à s’affaiblir en laissant entrevoir la possibilité d’une période de « laisser-faire » presque complet au niveau des armes nucléaires.
Finalement, l’arrivée, depuis 1998, de trois nouvelles puissances nucléaires sur la scène internationale (Inde, Pakistan, Corée du Nord) a changé la donne géopolitique dans l’ensemble de la région qui va du continent indien jusqu’au nord de l’Asie. Le problème de la dissuasion n’affecte donc plus seulement les grandes puissances ; il s’est régionalisé et démultiplié. Compte tenu des inquiétudes concernant le programme nucléaire iranien, la possibilité d’une accélération de la prolifération au Moyen-Orient demeure aussi une réelle possibilité. L’édifice de la non-prolifération est donc en train de se fissurer, et il est difficile de minimiser les conséquences d’un tel phénomène s’il se concrétise.
Les cinq tendances précédentes mettent en évidence la gravité du risque nucléaire aujourd’hui. Elles marquent aussi notre entrée dans l’ère du « désordre nucléaire multilatéral » – comme la qualifie Steve Miller. Cette notion nous fournit d’ailleurs le thème central de cet article. Elle suggère également le questionnement qui va structurer notre argument :
-
Peut-on vraiment parler d’une nouvelle compétition nucléaire entre les États-Unis, la Russie et la Chine ? Et comment interpréter leurs politiques dans ce cadre ?
-
Que penser des nouvelles technologies qui, selon certains, menacent la stabilité de la dissuasion ? Quel est leur rôle dans les politiques nucléaires des grandes puissances ?
-
Faut-il croire ceux qui ont déjà décrété la mort du contrôle des armements et de la non-prolifération ?
-
En définitive, comment peut-on évaluer le risque que fait courir la présence de l’arme nucléaire en Asie et au Moyen-Orient ?
À l’évidence, nous ne pourrons approfondir chacune des questions précédentes autant qu’elle le mériterait, mais notre objectif ici est d’offrir un tableau d’ensemble des défis auxquels nous faisons face dans le domaine des armes nucléaires et de suggérer quelques pistes de réflexion en ce qui a trait à la façon dont la communauté internationale pourrait relever ces défis.
I – Les arsenaux russes et américains entre modernisation et compétition stratégique
Nous ne reviendrons pas ici sur le retour des tensions entre Washington et Moscou depuis l’invasion de la Crimée en 2014. Il est important, en revanche, de souligner les répercussions de ces tensions au niveau nucléaire. Certains observateurs avancent, en effet, que la Russie cherche à nouveau à affirmer sa supériorité dans la compétition nucléaire avec les États-Unis. Sa stratégie serait devenue également plus agressive, menaçant de recourir en premier à l’arme nucléaire afin d’intimider un adversaire éventuel. Ses forces conventionnelles et nucléaires seraient à présent intégrées, suggérant que les Russes envisagent de mener, le cas échéant, une guerre nucléaire contre l’Alliance atlantique (Geller et Brookes 2021).
Un examen rapide de ces affirmations révèle cependant une situation beaucoup plus nuancée. S’il est vrai que l’arme nucléaire a pris une place plus importante dans la politique de sécurité russe depuis deux décennies, ceci révèle plus le profond sentiment d’insécurité des stratèges du Kremlin en ce qui concerne la situation de leurs forces militaires et leur capacité de dissuasion qu’une agressivité croissante à l’égard des États-Unis. On a tendance à oublier qu’avec l’éclatement de l’urss en quinze États, la Russie a littéralement perdu 58 % de ses missiles intercontinentaux, 39 % de ses bombardiers stratégiques et 80 % de ses sous-marins lance-engins qui se sont retrouvés dans des pays voisins comme l’Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan. Pour l’essentiel, ces composantes de l’arsenal soviétique ont été détruites ou rapatriées dans le cadre du programme de coopération ctr[1], mais durant la décennie 1991-2001, les forces stratégiques russes n’ont pas été modernisées et ont subi de graves problèmes d’entretien, en partie en raison de la situation financière catastrophique de la Fédération. En sont témoins plusieurs accidents qui ont affecté leur flotte de sous-marins stratégiques. Le système d’alerte des forces stratégiques russes était, semble-t-il, à peine fonctionnel au début des années 2000 (Lieber et Press 2006). En un mot, la Russie, en 2005, était pour ainsi dire stratégiquement désarmée face aux États-Unis. Si on se remet dans le contexte, la Fédération russe avait vu avec inquiétude l’Alliance atlantique s’étendre durant les années 1990, incluant progressivement la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, puis les pays baltes. L’Ukraine et la Géorgie allaient-elles suivre ? C’était certainement envisageable du point de vue du Kremlin.
On comprend sans doute mieux, dans cette situation, qu’une des priorités du gouvernement russe, à partir de 2006-2007, a été de rétablir les bases de la dissuasion nucléaire face à ce qui pouvait être perçu, de Moscou, comme un insidieux travail de sape et d’encerclement de la part des démocraties occidentales. L’effort de modernisation de l’arsenal nucléaire russe entrepris à partir de là, ainsi que le rétablissement d’une force militaire imposante, sont donc motivés essentiellement par le sentiment d’insécurité invoqué par les autorités russes au terme de plus d’une décennie de désarmement unilatéral. Soulignons, par ailleurs, que pour la Russie, avec un pnb qui représente moins du quart de celui des États-Unis et un budget de Défense qui s’élève à 8 % de celui du Pentagone, la tâche ne semble pas évidente. Ne nous y trompons pas toutefois, les forces stratégiques russes demeurent quantitativement importantes. Elles comptent aujourd’hui, en effet, 4500 têtes nucléaires, dont 1600 sont déployées sur les trois composantes d’une triade stratégique comprenant missiles intercontinentaux (icbm), sous-marins (slbm) et bombardiers (Kristensen et Korda 2021). D’après les informations les plus récentes dont on dispose, 86 % de ces forces sont maintenant modernisées, au terme d’un programme de rénovation accéléré de plus de dix ans. Il ne fait donc aucun doute qu’en 2021, la Russie présente une force de dissuasion significative. La modernisation des forces militaires conventionnelles russes a également suivi son cours, diminuant ainsi, sans doute, l’accent qui avait été mis sur les forces nucléaires jusqu’à présent (Akimenko 2021).
Mais qu’en est-il des déclarations officielles de Moscou en ce qui concerne la dissuasion nucléaire ? Celles-ci relèvent-elles d’une nouvelle agressivité, assimilable à celle d’un Khrouchtchev à la fin des années 1950 ? Si l’on se réfère aux principes de la dissuasion nucléaire publiés en 2020 par le gouvernement russe (Roberts 2020), l’arme nucléaire ne serait employée que lorsqu’un adversaire utiliserait lui-même ce type d’arme contre les forces russes ou lorsque la survie de l’État serait en jeu. Pour les autorités du Kremlin, l’arme nucléaire apparaît donc comme une option de dernier recours. Les déclarations de Vladimir Poutine lui-même soulignent que le président russe se rend bien compte que l’usage de l’arme nucléaire serait une catastrophe globale qui signerait probablement la fin de notre civilisation (Loukanova et Oliker 2020). Il porte aussi un intérêt certain au contrôle de la compétition nucléaire entre Washington et Moscou, vu la rapidité avec laquelle il a accepté de proroger, cette année, le traité New Start jusqu’en 2026. La porte demeure donc ouverte à un renouvellement du dialogue stratégique, dans la mesure où les États-Unis tiendraient compte des insécurités géopolitiques de la Russie et lui manifesteraient le respect revendiqué par celle-ci au titre de son statut d’ancienne grande puissance, fusse-t-elle diminuée.
Si nous nous tournons vers les États-Unis, maintenant, que penser de leurs choix dans le domaine nucléaire, et comment percevoir l’évolution de leur arsenal stratégique durant les dernières décennies ? Un fait doit être immédiatement souligné : l’arsenal nucléaire américain, comme sa contrepartie russe, a vécu une crise de vieillissement au début des années 2000. Bien que moins profonde et moins radicale que celle de la Russie, elle n’en est pas moins importante et affecte toutes les composantes de la triade, ainsi que le système de commandement et de contrôle stratégique, et l’infrastructure industrielle de la force de dissuasion américaine. La perte de statut du commandement stratégique (stratcom) dans le sillage de la période post-guerre froide a également affecté le moral des officiers et des civils employés dans le domaine, ce qui a eu un impact négatif sur le niveau de professionnalisme de l’organisation.
Dans l’ensemble, tous les éléments de la triade sont au bord de la retraite. Les bombardiers B-52 datent de la fin des années 1950. Les missiles Minuteman ont commencé à être déployés dans les années 1960. Les sous-marins nucléaires Ohio, quant à eux, avaient entrepris leurs patrouilles au début des années 1970. Comme l’a remarqué un commentateur, « les armes nucléaires américaines étaient peut-être des merveilles technologiques il y a cinquante ans, mais aujourd’hui, on pourrait les comparer à un parc de Chevrolet 1957 » (Bond 2009).
L’état de délabrement des infrastructures industrielles dont la vocation est l’entretien des armes nucléaires est un problème particulièrement grave, qui affecte la viabilité de l’ensemble des forces stratégiques américaines (Gramer 2017). Or les énormes dépenses nécessaires à une modernisation complète de l’arsenal nucléaire ont été repoussées, d’abord par l’administration Clinton dans les années 1990, puis par l’administration Bush qui s’est lancée dans deux guerres extrêmement coûteuses en Irak et en Afghanistan. La part du nucléaire, dans le budget du Pentagone, est donc passée de 13 % dans les années 1980 à 6 % environ dans les années 2000. L’ironie est, évidemment, que la décision d’entreprendre finalement la remise à niveau des forces stratégiques américaines allait reposer sur les épaules du président qui, en 2009, à Prague, avait évoqué l’éventualité d’un monde libre d’armes nucléaires. Pour assurer la ratification du traité New Start qui réduisait les forces russes et américaines à 1550 armes nucléaires, Barack Obama a, en effet, conclu en 2010, avec le whip du Sénat, Jon Kyl (républicain de l’Arizona), un pacte faustien : les Républicains ne s’opposeraient pas à la ratification du traité start, mais en contrepartie, le président accepterait d’entamer, finalement, la modernisation complète des forces nucléaires américaines (Kaplan 2020 : 494). Ce programme s’étalerait sur trois décennies et couvrirait l’ensemble des forces de la triade, ainsi que la base industrielle du complexe nucléaire. L’estimation des coûts de cette énorme entreprise, qui se poursuivra jusqu’en 2046, est d’environ 1,5 billion de dollars ou, si l’on préfère, 1500 milliards (Reif 2020).
La modernisation des forces stratégiques américaines ne s’effectue donc pas en fonction de la croissance des menaces externes auxquelles feraient face les États-Unis. Elle répond d’abord à son vieillissement, et parallèlement, il faut aussi le dire, aux intérêts industriels qui tireront profit d’un tel programme. Mais il est certain que cette entreprise, par ses dimensions, aura un impact important sur les perceptions et les choix de la Russie et de la Chine, toutes deux sensibles aux évolutions mises en oeuvre par Washington. Pour autant, la modernisation des forces stratégiques, autant en Russie qu’aux États-Unis ou en Chine, ne semble pas pouvoir se faire en maintenant le dialogue entre puissances nucléaires afin d’éviter que ces grands programmes aient pour effet de stimuler entre eux une compétition en fin de compte coûteuse et inutile.
Un mot de conclusion s’impose en ce qui concerne les stratégies nucléaires américaines proposées durant cette période. Contrairement à la Russie, qui a admis clairement le caractère suicidaire de tout échange nucléaire, les experts et les professionnels américains de la dissuasion peinent à formuler l’idée que les armes nucléaires ne servent qu’à dissuader un adversaire. Depuis les débuts de l’ère nucléaire, ils persistent à vouloir élaborer des options « limitées » qui éviteraient la « fin du monde ». Au terme de la guerre froide, le président Reagan et son homologue russe avaient finalement admis qu’une guerre nucléaire ne pouvait être gagnée et qu’elle ne devrait jamais être entamée ; mais la tentation d’une guerre nucléaire limitée est de retour depuis quelques années, spécifiquement dans le vocabulaire des experts américains (Larsen et Kartchener 2014 ; Roberts 2015). Certains s’imaginent-ils encore qu’une guerre nucléaire pourrait être « remportée » ? Si tel est le cas, nous sommes entrés dans une période réellement plus dangereuse.
II – L’évolution des forces nucléaires chinoises : un nouveau joueur sur l’échiquier stratégique
Jusqu’aux années 2000, la Chine est restée la grande absente de la compétition nucléaire entre grandes puissances. Après son premier essai nucléaire, en 1964, Pékin avait en effet adopté une approche minimaliste de la dissuasion, ne déployant qu’un nombre restreint de vecteurs nucléaires, tout juste perçus comme suffisants pour assurer des représailles limitées en cas d’attaque nucléaire. À l’aube des années 2000, cette force se résumait à une poignée de missiles intercontinentaux – une vingtaine environ – à carburant liquide, demandant donc plusieurs heures de préparation avant un lancement. À ceci s’ajoutait un peu plus d’une centaine de missiles non stratégiques, à courte et moyenne portées, assurant ce que l’on pourrait appeler une mission de dissuasion régionale. Les forces chinoises ne disposaient, soulignons-le, ni de sous-marins lance-engins, ni de bombardiers stratégiques comme la Russie et les États-Unis. Par ailleurs, les armes nucléaires chinoises, séparées de leurs vecteurs, demeuraient sous l’autorité civile jusqu’à la décision de les employer. Pékin adhérait par ailleurs, comme l’urss, à la doctrine du non-recours en premier à l’arme nucléaire (Pomper et Santoro 2020).
Durant les deux dernières décennies, marquées à la fois par la montée en puissance de la Chine, mais également par la croissance des tensions entre Pékin et Washington, les forces nucléaires chinoises ont commencé à évoluer. Leur stock d’armes a augmenté de façon modeste, une portion de leurs missiles est devenue mobile, et donc moins vulnérable. Les autorités chinoises ont également diversifié leurs vecteurs avec la construction de leurs premiers sous-marins stratégiques. Elles ont aussi développé la technologie des missiles à têtes multiples (mirv), accroissant d’autant leur force de frappe. Depuis l’accession au pouvoir du président Xi Jinping, l’effort de modernisation des forces nucléaires chinoises s’est accéléré. En 2021, la Chine déploie ainsi une demi-douzaine de sous-marins lance-engins qui transportent, au total, 72 missiles à portée intermédiaire. Une nouvelle mission nucléaire a aussi été assignée à ses bombardiers H-6. En outre, le nombre de brigades de missiles mobiles a augmenté, passant de 29 à 40, et leur niveau d’alerte s’est accru (Brown 2021). Finalement, au début de l’été 2021, des photos de satellite ont révélé que Pékin avait commencé à construire deux nouveaux champs de silos de missiles intercontinentaux, l’un dans la province de Gansu, l’autre à l’est du Xinjiang (Lewis 2021). Chacun pourrait permettre le déploiement d’environ 120 missiles intercontinentaux et donc tripler l’arsenal nucléaire chinois qui, en septembre 2021, était évalué à une centaine de vecteurs icbm. Les autorités chinoises, qui sont extrêmement réticentes pour tout ce qui touche au nucléaire, n’ont pas confirmé cette information, mais les données diffusées par les médias et les experts ne laissent aucun doute à ce sujet.
L’arsenal nucléaire chinois est encore très modeste par rapport à ceux de la Russie et des États-Unis. Il n’en demeure pas moins qu’il évolue qualitativement, se diversifie et augmente de façon significative. La grande question, compte tenu de l’opacité des autorités chinoises à ce sujet, est cependant de connaître les motivations de Pékin. Comme l’avancent Kristensen et Korda, la Chine entend-elle passer de la capacité de dissuasion minimale à une capacité de dissuasion assurée ? Après tout, si l’Empire du milieu est déjà une superpuissance économique, pourquoi n’acquerrait-elle pas le statut de puissance nucléaire moyenne ? Dans cette optique, les autorités chinoises souhaiteraient simplement assurer leur capacité de dissuasion face à leur concurrent géopolitique américain, dans ce qu’ils considèrent comme leur zone d’influence régionale.
Dans une perspective plus inquiétante, la Chine se préparerait à l’éventualité d’un conflit régional en tablant sur le fait que les États-Unis n’interviendraient pas dans ce cadre, par crainte d’une escalade. Le renforcement de sa capacité nucléaire, dans ce cas, aurait pour but de garantir sa supériorité militaire au niveau régional. Comme l’a souligné un stratège chinois, « les États tendent à devenir très prudents lorsqu’ils sont confrontés à une puissance nucléaire » (Brown 2021). Mais n’est-ce pas un pari extrêmement risqué que d’évoquer, d’emblée, le risque nucléaire dans le cadre d’une confrontation conventionnelle ? Il s’agit de facto d’une version coercitive, et non plus défensive, de la dissuasion, loin du non-recours en premier à l’arme nucléaire.
Certains commentateurs chinois avancent de surcroît que, dans le contexte actuel de confrontation avec les pays occidentaux, la Chine n’a pas d’autre choix que d’affirmer sa force et sa détermination. Selon Hu Xijin, rédacteur en chef d’une publication semi-officielle très populaire, il est essentiel pour la Chine d’accroître le plus possible son arsenal nucléaire afin que les Occidentaux lui manifestent le respect qui lui est dû (Zhao 2021). Le président Xi Jinping a d’ailleurs fait écho à ce sentiment en recommandant, au printemps 2021, « d’accélérer la construction d’une force de dissuasion moderne », qu’il considère comme un « pilier essentiel du statut de grande puissance de la Chine ». N’a-t-il pas, dès 2017, annoncé que la Chine devrait être dans « une position dominante » dès 2049 ?
Le fossé qui sépare les spéculations optimistes des prévisions les plus pessimistes, en ce qui concerne les intentions stratégiques chinoises, souligne le peu de données précises dont disposent les experts à ce sujet, mais aussi, évidemment, le manque de transparence des autorités de Pékin dans le domaine des armes nucléaires et de leur emploi éventuel. Une compréhension plus approfondie des politiques chinoises et de leur stratégie est donc une priorité dans le contexte actuel. La stabilisation de la situation stratégique est à ce prix. Américains et Chinois pourraient apprendre à échanger, au profit d’une plus grande prévisibilité, comme les Soviétiques et les Américains ont pu le faire à partir des années 1960, dans le cadre du processus de maîtrise des armements. Certains ont suggéré que Pékin et Washington se trouvent en ce moment dans la situation où se trouvaient les États-Unis et l’urss à la fin des années 1950. La prise de conscience nécessaire à l’ouverture d’un tel dialogue n’avait néanmoins émergé qu’à l’issue du choc de la crise de Cuba, en octobre 1962.
III – Nouvelles technologies et dissuasion : évolution ou révolution ?
Depuis quelque temps, le thème des innovations technologiques est de retour dans le débat nucléaire. À titre d’exemple, les missiles hypersoniques, présentés en grande pompe par Vladimir Poutine en 2018, sont devenus de nouveaux symboles de puissance militaire (Rotenberg et Popov 2018). Américains et Chinois ont immédiatement annoncé qu’ils développaient ou détenaient déjà de tels systèmes. Ajoutés à un buffet garni de toutes sortes de nouveautés, telles que des torpilles nucléaires sous-marines à longue portée, des missiles lourds intercontinentaux et des systèmes de combat laser, le président russe semblait annoncer le premier acte d’une nouvelle course qualitative aux armements, semblable à celle que le monde a vécue dans les années 1980 (Barluet 2019). Les revues spécialisées occidentales, de leur côté, ont évoqué sombrement les menaces cybernétiques et leur impact potentiel sur la dissuasion (Bommakanti 2018). Doit-on, par exemple, craindre que des pirates informatiques puissent interférer avec le fonctionnement des armes stratégiques ? Même des technologies d’appoint, comme l’intelligence artificielle – à savoir des systèmes ou des machines qui imitent l’intelligence humaine – semblent représenter un défi pour la stabilité nucléaire (Loss et Johnson 2019). Certains ont même suggéré que des ordinateurs superpuissants pourraient se voir confier la tâche de gérer une frappe nucléaire.
Mais en quoi toutes ces nouvelles technologies changent-elles la donne stratégique ? Depuis approximativement 70 ans, l’équilibre nucléaire, et donc la dissuasion, reposait sur la certitude que toute attaque contre un pays équipé de l’arme nucléaire serait suivie par des représailles qui laisseraient l’agresseur en ruine. C’est ce que l’on appelle la destruction mutuelle assurée. Sommes-nous dans une situation où l’évolution technologique remet cet état de choses en question ?
Pour certains observateurs, nous serions peut-être arrivés à ce stade. D’après Keir Lieber et Daryl Press (2006), en particulier, les nouvelles technologies en matière de reconnaissance et de renseignement mises au point depuis une trentaine d’années, ainsi qu’une capacité accrue de traitement des données, permettraient aujourd’hui de localiser avec précision les vecteurs nucléaires d’une puissance comme la Corée du Nord. Compte tenu de la précision croissante des missiles balistiques, un pays comme les États-Unis serait même en mesure de neutraliser les forces nucléaires d’un adversaire en employant exclusivement des armes conventionnelles. Si, par hasard, l’État attaqué tentait de répliquer avec les forces qui lui restent, les défenses antimissiles se chargeraient de les neutraliser. Un tel scénario est-il crédible ? On peut en douter. En effet, la situation que nous venons d’évoquer implique que tous les systèmes concernés, depuis les instruments de reconnaissance jusqu’aux missiles d’interception, fonctionnent à la perfection. Une seule erreur, et un vecteur ennemi peut détruire un centre urbain et faire plusieurs centaines de milliers de victimes. Lieber et Press ignorent complètement ce que les stratèges appellent « la friction », à savoir le fait que, dans le cadre d’une guerre réelle, les choses ne se passent jamais comme on l’avait prévu (Lieber et Press 2006 ; voir aussi Zaloga 2002 : 220-229). En outre, il est un peu naïf de penser que les concurrents stratégiques des États-Unis resteraient sans réaction face à l’émergence de technologies qui menacent potentiellement leur capacité de représailles.
La Chine et la Russie ont, de ce point de vue, clairement perçu comme une menace importante le retrait unilatéral de Washington du traité abm sur les armements stratégiques défensifs, en 2001, et l’effort subséquent entrepris par l’administration Bush pour mettre au point et déployer des défenses antimissiles soi-disant dirigées contre la Corée du Nord et l’Iran. Le projet de développer un système de frappe conventionnelle rapide à longue portée (Prompt Global Strike) a également été interprété comme un signe que le Pentagone visait à concrétiser la supériorité américaine dans les domaines stratégiques et nucléaires. Dans une large mesure, les déclarations publiques du Kremlin concernant les armes dont disposera prochainement la Russie sont destinées à envoyer un message clair à Washington : « [q]uoi que vous fassiez, vous ne remettrez pas en question nos capacités de représailles ». L’effort de modernisation de l’arsenal chinois peut également être interprété de cette façon. Dans le cadre des tensions croissantes entre forces chinoises et américaines dans la région, Pékin met Washington en garde : en cas d’attaque directe sur la Chine, celle-ci demeurera capable de répliquer de façon décisive.
Les nouvelles technologies, souvent évoquées dans le contexte actuel, sont donc, d’abord, ce que l’on peut appeler des contre-mesures destinées à assurer que, quoiqu’il arrive, en cas d’attaque préemptive, des représailles auraient lieu. C’est la vocation, en particulier, des missiles hypersoniques, des torpilles nucléaires géantes, ainsi que des armes antisatellites qui auraient pour mission d’aveugler les moyens de reconnaissance et de communication d’un attaquant. La multiplication des cibles potentielles, dans le cas de la Chine, a aussi pour but de compliquer la tâche éventuelle d’un assaillant qui envisagerait une attaque surprise.
Il est ironique de penser que l’illusion de la supériorité technologique américaine, née durant la période dite d’unipolarité, au début des années 2000, a déclenché un nouveau cycle de compétition technologique dont nous voyons les effets maintenant au niveau des arsenaux nucléaires. L’ère de la paranoïa stratégique, visiblement, est de retour… Est-il possible de mettre un terme à ce phénomène coûteux et dangereux ? Cette interrogation soulève naturellement la question de la maîtrise des armements.
IV – La mort annoncée du contrôle des armements stratégiques
Il est sans doute inutile d’épiloguer sur la crise des négociations et des accords de contrôle des armements depuis la fin des années 1990. Qu’il suffise de rappeler ici que quatre accords stratégiques significatifs sont devenus obsolètes, soit du fait de la Russie, soit de celui des États-Unis, depuis 2001 (le Traité abm en 2002, le Traité sur les Forces nucléaires intermédiaires en 2018, l’Accord nucléaire conjoint avec l’Iran en 2017, le traité « Ciel Ouvert » en 2020). Le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, quant à lui, est toujours dans les limbes, et les négociations sur le prochain sommet de la sécurité nucléaire sont au point mort. Le régime de non-prolifération, finalement, a été durement secoué par la nucléarisation de la Corée du Nord et le délitement des accords nucléaires multilatéraux avec l’Iran.
Peut-on dire, pour autant, que la pratique de la maîtrise des armements stratégiques est obsolète et que toute tentative pour freiner ou arrêter la reprise de la course aux armements est vouée à l’échec ? Qu’il soit permis d’avancer ici qu’une telle annonce serait prématurée. En premier lieu, le Traité New Start a été prorogé jusqu’en 2026, ce qui est certainement une excellente nouvelle. Les arsenaux russes et américains se voient donc toujours plafonnés à 1550 armes nucléaires chacun. Les deux États ont aussi entamé, en juillet 2021, un « dialogue stratégique » qui devrait permettre d’explorer de nouvelles avenues afin de préparer éventuellement un successeur au traité de 2010. Diplomates russes et américains se sont retrouvés en septembre 2021, à Genève, en vue de tenter de stabiliser les relations bilatérales très dégradées des deux pays. Notons, d’ailleurs, que le président russe a plusieurs fois manifesté de l’intérêt pour reprendre des pourparlers de ce type avec Washington. La grande inconnue, évidemment, se situe au niveau de la politique intérieure américaine. Quelle sera la marge de manoeuvre du président Biden, alors qu’il fait face à un ordre du jour très chargé et une opposition républicaine plus hargneuse que jamais ? Aura-t-il même la possibilité de lancer une initiative importante dans le domaine du désarmement, alors que les crises politiques se multiplient autant dans le domaine de la santé, de l’économie que de celui des « guerres culturelles » ? Il est certain que l’administration démocrate souhaiterait suivre la voie qu’a tracée le président Obama, de 2009 à 2016, en matière de désarmement, mais les conditions, à l’évidence, ne sont pas optimales.
Pour un observateur intéressé aux questions de maîtrise des armements, l’occasion que représente la réouverture du dialogue stratégique entre Russes et Américains offre cependant des perspectives prometteuses. Quelles priorités, quels thèmes pourrait-on souhaiter voir apparaître à l’agenda de ce dialogue ? N’oublions pas, en effet, que la maîtrise des armements ne se limite pas à des accords formels, juridiquement contraignants et souvent longs à négocier. Comme nous le rappellent Linton Brooks (2020) et Nina Tannenwald (2020), au-delà des traités, les États disposent d’un ensemble de méthodes moins contraignantes s’ils souhaitent coopérer en matière de stabilité stratégique. Celles-ci vont des déclarations conjointes à des accords politiques, en passant par des mesures unilatérales.
D’entrée de jeu, le fait que les chefs d’État russe et américain, lors de leur rencontre du 16 juin 2021, se soient entendus pour émettre une déclaration conjointe à l’effet qu’une guerre nucléaire ne devrait jamais être entreprise et ne pourrait être gagnée, est un excellent début. Cette affirmation fait, en effet, écho aux propos similaires du président Reagan et de Mikhaïl Gorbatchev en 1985, propos qui ont annoncé le dégel des relations russo-américaines et le déblocage des négociations start et fni. Ne pourrait-on imaginer que d’autres États concernés, dont la Chine, pourraient se joindre aujourd’hui à cette déclaration qui, formellement, amènerait les grandes puissances à renoncer à l’idée d’une guerre nucléaire « limitée » et reconnaîtrait clairement le caractère suicidaire de tout conflit nucléaire (Kinninont 2021) ?
Partant de ce consensus, Russes, Américains et, à terme, Chinois font face à trois tâches prioritaires :
-
contrôler et arriver à neutraliser les technologies qui peuvent mettre en danger les capacités de représailles des puissances nucléaires ; ceci concerne, en particulier, les défenses antimissiles américaines, ainsi que le système de frappe conventionnelle rapide à longue portée (Prompt Global Strike) planifié par le Pentagone. Les missiles hypersoniques et les armes antisatellites font également partie de ces technologies que l’on peut décrire comme « déstabilisantes » ;
-
il est aussi impératif de limiter le déploiement des systèmes à moyenne et à courte portées, qui accroissent le risque d’emploi de l’arme nucléaire dans des situations de tensions régionales. Le cas de l’Europe, mais aussi de l’Asie, vient, à l’esprit ;
-
enfin, ces dernières années ont vu une recrudescence d’incidents et de frictions entre unités militaires américaines, européennes, russes et chinoises. De 2013 à 2020, près de 3000 incidents se sont produits entre les forces russes et celles de l’otan (Clem et Finch 2021). Les incidents impliquant les forces navales américaines et chinoises sont également de plus en plus fréquents. Il est essentiel, dans ce contexte, de renouer avec l’expérience russo-américaine de la guerre froide et de se remémorer les leçons apprises durant cette période afin d’éviter les crises qui pourraient résulter de ces incidents.
Compte tenu de ces priorités, quelles sont les mesures qui pourraient être assez rapidement adoptées, tout en laissant le temps aux diplomates et aux experts de négocier des accords à plus long terme ?
Dans le domaine des technologies déstabilisantes, par exemple, le moratoire pourrait représenter une approche fructueuse dans la mesure où plusieurs des technologies en question en sont encore au stade du développement. C’est le cas de plusieurs des missiles hypersoniques, par exemple ; c’est aussi le cas des systèmes de frappe conventionnelle à longue portée (Conventional Global Strike). La mise en oeuvre des armes antisatellites n’a pas non plus été décidée. Ainsi pourrait-on envisager un moratoire de dix ans environ sur le déploiement ou même le développement de ces systèmes. En ce qui concerne les systèmes de défense antimissiles, les autorités américaines pourraient faire preuve de plus de transparence quant aux caractéristiques et aux plans de développement de ces systèmes. Cet effort permettrait de rassurer Moscou et Pékin à l’égard des intentions américaines. Finalement, un code de conduite pourrait être envisagé concernant les activités militaires dans l’espace visant à garantir l’intégrité des systèmes de reconnaissance et d’alerte stratégiques.
Il est certain qu’en ce qui a trait aux armes hypersoniques et aux vecteurs conventionnels à longue portée, des mesures plus formelles devront être envisagées dans le cadre d’un successeur au Traité New start. Certaines de ces armes devront, le cas échéant, être incluses dans le nombre des vecteurs comptabilisés. Mais les mesures moins contraignantes, comme un moratoire et ce qu’on appelle des mesures de confiance et de transparence, pourront à la fois modérer la compétition stratégique et laisser le temps aux négociateurs de conclure un accord plus contraignant et plus détaillé.
En ce qui concerne les armes tactiques ou à portée intermédiaire, une démarche comparable peut être tentée, du moins dans le cadre européen. Il n’est en effet ni dans l’intérêt des États-Unis, ni dans celui de la Russie de revenir à une crise des missiles semblable à celle des années 1980. Annoncer le redéploiement de missiles nucléaires dans la zone otan est simplement impensable, même dans les scénarios les plus pessimistes. Or, dans ce cas, pourquoi ne pas annoncer publiquement, lors du prochain sommet Biden-Poutine, que la Russie et les États-Unis s’engagent à respecter les termes de l’accord fni de 1987 en ce qui concerne l’Europe ? L’aire géographique pourrait être précisée dans la déclaration. Ceci garantirait qu’aucun missile nucléaire, d’une portée de 500 à 5000 km, ne serait déployé sur le continent. Il est même envisageable que les Russes puissent s’engager à ramener leurs armes nucléaires tactiques dans un certain nombre de dépôts désignés, en retrait de la zone affectée. Les bombes nucléaires tactiques américaines, en nombre très réduit (une centaine environ), sont déjà rassemblées dans six dépôts connus et localisés.
La question des forces nucléaires non stratégiques en Asie est tout à fait différente. Les États-Unis ont, en effet, retiré leurs armes nucléaires tactiques de la région au début des années 1990. Ils ne disposent pas, par ailleurs, de forces nucléaires à portée intermédiaire dans cette zone. Le gros des forces nucléaires chinoises, par contre, entre dans cette catégorie. Pékin dispose d’un arsenal de près de 2000 missiles à courte et à moyenne portées, de type conventionnel, souvent déployés aux endroits mêmes où se trouvent leurs forces nucléaires. La situation est donc à la fois asymétrique, dangereuse et complexe. Toutefois, le principal problème réside dans le fait que la Chine refuse de discuter de son arsenal nucléaire avec Washington, prétextant que ses forces nucléaires sont trop modestes pour faire l’objet de réductions ou de limitations supplémentaires. La priorité est donc d’ouvrir, au moins, la porte à un dialogue semblable à celui que Russes et Américains ont entamé cet été. La clé d’un tel dialogue serait, pour les États-Unis, de trouver un appât ou une monnaie d’échange qui puisse intéresser la Chine. Pour l’instant, le pronostic ne peut être que pessimiste à cet égard.
En ce qui concerne la question des incidents impliquant différentes forces militaires, la pratique de la maîtrise des armements offre quelques outils utiles, dont l’usage pourrait être aisément transposé au cadre européen ou asiatique aujourd’hui. Russes et Américains ont en effet conclu, dès 1972, un accord destiné à prévenir les incidents en haute mer. En 1989, un accord complémentaire a été conclu entre Washington et Moscou « sur la prévention des activités militaires dangereuses ». Dans le domaine des forces terrestres, l’Organisation de la sécurité et de la coopération européenne (osce) a également mis au point une liste de mesures destinées à prévenir les incidents militaires et à promouvoir la confiance entre les 56 membres de l’osce : le Document de Vienne de 1999. Les outils ne manquent donc pas pour réfléchir aux moyens d’éviter les crises qui pourraient dégénérer entre puissances nucléaires. Le problème, pour l’instant, est que la Russie et la Chine préfèrent utiliser leurs forces militaires, leurs déploiements et leurs manoeuvres pour intimider leurs adversaires plutôt que pour créer et promouvoir la confiance (Caryl 2021). Il semble même difficile d’établir des canaux de communication directs en cas de crise avec les autorités chinoises (Campbell 2021). Une voie intéressante et accessible pour éviter les crises et les dérapages semble donc fermée pour l’instant.
Dans l’ensemble, la perspective d’une relance de la maîtrise des armements semble possible, dans le cadre du dialogue stratégique russo-américain. Le président Biden a effectivement la possibilité de faire sa marque, si la politique intérieure américaine lui laisse les mains libres. Le grand absent, dans ce cadre, reste la Chine et il faudra, tôt ou tard, qu’elle soit impliquée dans des discussions nucléaires, soit au niveau bilatéral, soit au niveau trilatéral. La stabilité stratégique globale est à ce prix. Et l’avenir du régime de non-prolifération dépend aussi probablement de ce qui va se passer au sein du nouveau triangle stratégique que forment maintenant les États-Unis, la Russie et la Chine.
V – Empêcher la prolifération ou la gérer ?
Jusqu’à la fin des années 1990, la non-prolifération pouvait être présentée comme le grand succès de l’entreprise du contrôle des armements nucléaires depuis la fin des années 1960. Le Traité de non-prolifération (tnp) ne venait-il pas d’être reconduit pour une durée indéterminée en 1995 ? La communauté internationale avait présidé, parallèlement, à la dénucléarisation de l’Afrique du Sud et de quatre pays successeurs de l’urss, dont l’Ukraine. Au début des années 2000, le tnp réunissait ainsi plus de 185 membres, reflétant un consensus unique parmi l’ensemble des pays de l’onu.
La situation s’est dégradée, depuis, du point de vue de l’encadrement international des activités nucléaires. En mai 1998, l’Inde et le Pakistan – deux non-signataires du traité – effectuaient tous deux une série d’essais nucléaires et forçaient l’entrée du club des cinq grandes puissances reconnues par le tnp. En 2003, la Corée du Nord, signataire depuis 1985, annonçait qu’elle quittait l’accord. À partir de 2006, par ailleurs, Pyongyang entamait une série d’essais nucléaires dont le dernier, en septembre 2017, semble avoir été une bombe thermonucléaire d’une puissance estimée entre 70 et 200 kt. En août 2002, une autre révélation allait choquer les observateurs. L’Iran avait apparemment caché un programme d’enrichissement de l’uranium, ainsi que la construction d’un réacteur à eau lourde destiné à la production du plutonium. Dans ce cas, l’Iran s’est défendu d’avoir l’intention de se doter d’armes nucléaires et a prétexté de ses besoins en énergie pour justifier sa production d’uranium enrichi. Téhéran fait, d’ailleurs, de sa liberté de choix dans le domaine nucléaire une question de souveraineté nationale. Comme on le sait, de longues négociations ont mené l’Iran à accepter un certain nombre de restrictions en ce qui a trait à son programme d’enrichissement, en contrepartie d’une levée des sanctions économiques sur ses échanges commerciaux et ses transactions financières. C’est l’objet de l’accord nucléaire de 2015 (Joint Comprehensive Plan of Action [jcpoa] ou Plan d’action global commun) entre l’Iran et le groupe des 6+1. Cet accord devait mettre un terme provisoire aux activités d’enrichissement et de production de plutonium de l’Iran à l’horizon de 2030. L’accord de 2015 a toutefois été remis en question par le successeur du président Obama, en 2018, ce qui a amené la réimposition des sanctions envers l’Iran et, en représailles, plusieurs violations des clauses du jcpoa par Téhéran. À l’automne 2021, malgré l’arrivée au pouvoir d’un président démocrate à la Maison-Blanche, aucune nouvelle entente n’était intervenue, et l’élection d’un conservateur militant à la présidence iranienne n’augure rien de bon dans le dossier du nucléaire (Fassihi, Kwai et Hubbard 2021).
L’émergence de trois nouvelles puissances nucléaires depuis 1998, ce à quoi s’ajoute l’inconnue iranienne, soulève plusieurs questions cruciales en ce qui concerne non seulement le régime de la non-prolifération, mais également la stabilité stratégique au sens le plus large. En priorité, la stabilité nucléaire est-elle possible autour du sous-continent indien et en Asie du Nord ? Assiste-t-on à la mise en place de relations de dissuasion « stables » entre l’Inde, le Pakistan et la Chine ? Ou entre la Corée du Nord, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ? En second lieu, faut-il craindre de nouvelles défections du régime de non-prolifération dans le sillage de ce qui s’est produit depuis 1998 ? Enfin, peut-on envisager une troisième voie, plus coopérative, pour les nouvelles puissances nucléaires ? Serait-il possible de les associer à une démarche de contrôle des armements, semblable à celle des grandes puissances durant les années 1960 à 1990 ?
Concernant la première question, le cas indo-pakistanais offre un exemple intéressant. Les deux États ont en effet constitué, en vingt ans, des arsenaux très complets qui comprennent – au moins en embryon – des triades traditionnelles (avions, missiles, sous-marins lance-engins) et un stock d’armes nucléaires assez important (environ une centaine chacun). Tous deux sont, d’ailleurs, en pleine modernisation et vont continuer à perfectionner leurs forces de frappe respectives. Ont-ils développé une relation de dissuasion que l’on peut qualifier de stable ? La réponse ne peut qu’être nuancée. D’un côté, tous deux reconnaissent le fait que l’arme nucléaire est une arme « de dernier recours », mais, si l’Inde peut se permettre de dire qu’elle ne l’utiliserait pas en premier, le Pakistan, dont les forces conventionnelles ne font pas le poids face à l’armée indienne, menace d’utiliser ses armes nucléaires « tactiques » au cas où son territoire serait envahi. Le risque qu’un incident militaire dégénère est donc présent. N’oublions pas que les deux pays ont été en guerre à trois reprises depuis 1948, et que, depuis 1999, ils ont connu six crises graves – la dernière en 2019 – au cours desquelles la menace nucléaire a clairement été évoquée. En revanche, depuis les années 1980, les deux États se sont dotés de nombreux moyens afin de pouvoir communiquer, aux niveaux politique et militaire, en cas de crise. Ils ont également adopté un ensemble de mesures, dites « de confiance », afin de pouvoir éviter les malentendus (Mohammad Khan 2018). Malgré les tensions, dues en grande partie à la situation du Cachemire, New Dehli et Islamabad maintiennent des relations diplomatiques et commerciales. La situation entre les deux pays demeure cependant tendue, et l’arrivée des talibans au pouvoir en Afghanistan risque de créer un nouveau foyer de djihadisme qui pourrait affecter la crise persistante au Cachemire. Notons également que l’arsenal nucléaire de New Dehli a aussi pour vocation de dissuader la Chine, avec laquelle l’Inde a encore des problèmes de frontières au nord du Bhoutan. Ceci donne évidemment un excellent argument aux stratèges indiens pour accroître d’autant leur arsenal nucléaire. Mais l’influence d’une telle politique sur les choix du Pakistan (et de la Chine) ne peut que créer les conditions d’un dilemme de sécurité, ou si l’on préfère plus simplement, d’une course aux armements entre les protagonistes de ce triangle nucléaire régional.
Si la relation qui prévaut entre le Pakistan et l’Inde peut, au moins partiellement, rassurer du fait de sa résilience et des éléments coopératifs qui la sous-tendent, tel n’est pas le cas de la situation dans la péninsule coréenne. Comme l’a noté Viping Narang, « [l]a Corée du Nord semble prête à danser au bord du précipice nucléaire, à la fois en temps de paix ou de tension. La stratégie de Kim Jong-un est un exemple type de ce que signifie une “diplomatie au bord du gouffre” (brinkmanship) » (Narang et Panda 2020 : 49). On se rappellera que, dans les années 1950, la notion de brinkmanship signifiait, pour les États-Unis, qu’en cas de crise ou de confrontation avec l’urss, il ne fallait pas hésiter à aller « jusqu’au bout », afin de montrer sa détermination face à l’ennemi. Les « gesticulations » nucléaires du dictateur nord-coréen semblent donc destinées, en priorité, à démontrer qu’il n’hésiterait pas à utiliser l’arme nucléaire si son régime était menacé. Le risque est évidemment qu’un incident imprévu ou un geste mal interprété déclenche une escalade que personne n’aurait voulue. La question, pour les États-Unis, comme pour leurs alliés japonais et sud-coréens, est de savoir s’il faut accommoder Pyongyang et laisser à Kim Jong-un une plus grande latitude en évitant de le provoquer ou, au contraire, communiquer clairement qu’au cas où certaines limites seraient dépassées, lui et son régime ne survivraient pas. La situation très tendue dans la péninsule a, certes, un impact direct sur le climat politique à Séoul. La question de la renucléarisation de la Corée du Sud est de nouveau à l’ordre du jour au point qu’un Sud-Coréen sur deux soutient l’idée que son gouvernement devrait développer l’arme nucléaire pour faire face à la menace du Nord (Larsen 2021).
Le réalisme nucléaire s’impose donc dans la péninsule coréenne, et l’espoir d’un retour à la situation antérieure à 2003 s’estompe avec lui. Cela ne signifie pas que l’issue soit irrémédiable. Mais pour influer sur la situation, autant dans le sous-continent indien qu’en Corée, il faut un leader qui puisse proposer des initiatives et cristalliser un consensus. Or l’administration américaine, en dépit des bonnes intentions affichées par ses dirigeants, s’est montrée étrangement inactive dans le domaine de la non-prolifération, autant dans le dossier de la Corée du Nord que dans celui de l’Iran (Jackson 2021). Et au regard de la situation politique intérieure aux États-Unis, on risque d’attendre longtemps un président dont la devise serait à nouveau : yes we can!
Faisons-nous face à un moment charnière en ce qui concerne la prolifération ? C’est apparemment le cas, si nous nous tournons maintenant vers le cas iranien. Pour la plupart des observateurs, l’accord de 2015 apportait une solution satisfaisante au problème du programme nucléaire iranien. Même s’il s’agissait d’un accord de transition dont les effets s’éteignaient en 2030, les Européens, en particulier, étaient persuadés que d’ici là il serait possible d’assurer la démilitarisation complète du programme nucléaire iranien et la normalisation des relations entre Téhéran et la communauté internationale. La revitalisation de l’accord, dès le départ du président Trump, était donc perçue comme le coup de baguette magique qui remettrait les choses sur le bon chemin. Il est possible qu’une politique plus déterminée serait arrivée à débloquer le dossier avant l’élection d’un religieux, ultra-conservateur, Ebrahim Raïssi, à la présidence en août 2021, mais il est sans doute inutile de spéculer à ce sujet (Sanger, Jakes et Fassihi 2021).
Dans les faits, les autorités iraniennes ont, pour l’instant, choisi de relancer leur programme d’enrichissement, et le parlement (le Madjles) a voté une loi annonçant la reprise de la production d’uranium enrichi, la mise en place de nouvelles cascades de centrifugeuses destinées à l’enrichissement et la relance du projet de construction d’une centrale nucléaire destinée à la production de plutonium.
L’information la plus préoccupante, cependant, trouve sa source dans un fait qui date déjà de deux ans, mais que beaucoup observateurs ont négligé, faute d’un examen plus approfondi des données disponibles. En janvier 2018, les services secrets israéliens ont en effet réussi à mettre la main sur les archives historiques secrètes du projet nucléaire iranien dans un hangar de la banlieue de Téhéran. Plus de 55 000 pages de documents et environ 200 disques compacts ont été pris et ramenés en Israël. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a révélé l’existence de ces archives le 30 janvier 2018, mais comme celles-ci concernaient surtout une période antérieure à 2003-2004, la nouvelle n’a pas eu l’impact souhaité. Après tout, les autorités iraniennes n’avaient-elles pas accepté, en 2015, de mettre un terme à leur programme d’enrichissement de l’uranium ? Pourquoi donc revenir sur le passé ? Il faut également ajouter que peu de journalistes ou de spécialistes se sont vu accorder un accès direct aux documents originaux pris par les Israéliens. Ce n’est, en fait, que depuis quelques mois que des experts occidentaux ont pu se plonger dans les archives nucléaires iraniennes et présenter leurs conclusions. Celles-ci apportent des révélations majeures. Contrairement à ce qu’ont prétendu les autorités iraniennes depuis 2002, la décision de lancer un programme de développement de l’arme nucléaire a été prise dès 1984, au plus haut niveau de l’État, par l’ayatollah Ali Khamenei, encore aujourd’hui Guide suprême de la révolution. Dans ses propres termes, et contrairement à ses déclarations décrivant l’arme nucléaire comme non conforme aux enseignements du Coran, « [u]n arsenal nucléaire servirait de force de dissuasion aux mains des soldats de Dieu » (Albright et Burkhard 2021 : 17). D’après les documents, il faudrait cependant attendre la fin des années 1990 pour que l’Iran décide formellement de lancer un programme accéléré, destiné à la fabrication d’un arsenal nucléaire d’au moins cinq bombes. C’est le Plan Amad qu’interrompront les révélations de 2002. À cette date, les efforts iraniens avaient déjà porté fruit, grâce à l’aide technique du Pakistan ainsi que l’assistance de scientifiques russes. Les données disponibles prouvent ainsi, sans l’ombre d’un doute, que les experts iraniens maîtrisent d’ores et déjà les techniques de fabrication d’une tête nucléaire. Que conclure de ces faits ? Si l’on considère qu’un programme nucléaire militaire repose sur trois piliers – la capacité de produire la matière fissile, l’expertise nécessaire à la fabrication d’une bombe et la possession de vecteurs destinés à lancer l’arme nucléaire –, l’Iran maîtrise sans conteste deux de ces capacités et est en très bonne position pour produire l’uranium enrichi nécessaire pour plusieurs bombes, dans un délai assez court. En fait, on peut considérer que l’Iran est, d’ores et déjà, un pays capable de produire des armes nucléaires « sur demande », dès que les autorités politiques le décideront. La seule question est de savoir si cela se produira, et quand cela aura lieu. En d’autres termes, l’accord de 2015 n’est tout simplement plus d’actualité et, dans le cas où l’Iran officialiserait son programme nucléaire militaire, il faudra se préparer à l’éventualité d’une accélération de la prolifération au Moyen-Orient, phénomène dont on ne peut minimiser la gravité. Le seul espoir, dans cette perspective, est que les autorités iraniennes demeurent extrêmement discrètes quant à leur capacité nucléaire. Après tout, ce ne serait pas le seul État de la région à rester « opaque » dans ce domaine. Mais combien de temps cette pauvre feuille de vigne remplira-t-elle son office ? La réponse est dans la question.
Le mot de la fin
Les conclusions que l’on tirera de ce survol ne peuvent qu’ajouter au pessimisme ambiant. La maîtrise des armements n’est pas « morte », comme certains le prétendent, mais la possibilité modeste, mais réelle, d’un nouvel accord stratégique entre Moscou et Washington ne fait que souligner l’absence de la Chine de toute discussion portant sur les armes nucléaires. La réalisation d’un équilibre de la dissuasion, au niveau global, exigera la présence de Pékin dans les pourparlers stratégiques entre grandes puissances. C’est incontournable. Mais rien, comme nous l’avons dit, ne laisse penser que nous sommes à la veille de voir la Chine s’engager dans cette voie.
En ce qui concerne la prolifération, il est certain que nous assistons, en plus de l’émergence d’une problématique nucléaire triangulaire au niveau des grandes puissances, à une diversification des relations de dissuasion au niveau régional. Chacune présente des risques particuliers que les acteurs locaux devront apprendre à gérer, avec ou sans aide extérieure, et il est difficile, pour l’instant, de qualifier ces situations de « stables ». En outre, le risque de voir d’autres régions se nucléariser est très présent, en particulier au Moyen-Orient. Le régime de non-prolifération peut-il survivre à ces tensions ? On peut en douter. Le « désordre nucléaire multilatéral » décrit donc bien la situation que nous vivons actuellement.
En dépit de ce tableau, la majorité des États de la planète restent en faveur de la prohibition complète des armes nucléaires, même si ce souhait paraît irréalisable. Cent vingt-deux pays ont voté, en 2017, en faveur d’un Traité sur l’interdiction des armes nucléaires, malgré l’opposition des grandes puissances, et l’accord est entré en vigueur en 2021. En l’absence de ces dernières, ledit traité ne peut qu’avoir une portée limitée, mais il symbolise néanmoins clairement le sentiment d’impatience et de frustration de centaines de millions d’êtres humains, excédés de voir une poignée d’États menacer le monde d’un conflit nucléaire (Meyer et Sauer 2018). Peut-on imaginer une grande mobilisation planétaire en faveur du désarmement comme celle qui a forcé la main aux puissances nucléaires dans le passé ? Ce n’est pas impossible. L’alternative est de voir l’horloge de l’apocalypse se rapprocher encore de minuit.
Parties annexes
Note biographique
Michel Fortmann
Professeur honoraire, Département de science politique, Université de Montréal.
Note
-
[1]
Cooperative Threat Reduction (ctr) : il s’agissait d’un programme d’urgence financé par les États-Unis pour aider les pays issus de l’éclatement de l’urss à démanteler les milliers d’armes nucléaires de l’État soviétique.
Références
- Acton James, 2020, « Cyberwarfare and inadvertent Escalation », dans Robert Legvold et Christopher F. Chyba (dir.), numéro thématique Daedalus, « Meeting the Challenges of a New Nuclear Age », vol. 149, no 2 : 133-149.
- Akimenko Valeriy, 2021, « Russia and Non-Nuclear Deterrence », Chatham House, 29 juillet 2021, consulté sur Internet en août 2021, (https://www.chathamhouse.org/2021/07/russia-and-strategic-non-nuclear-deterrence/russias-non-nuclear-deterrent-uncertainty-and).
- Albright David et Sarah Burkhard, 2021, Sarah Burkhard, Iran’s Perilous Pursuit of Nuclear Weapons, Washington, Institute for Science and International Security Press.
- Auslin Michael, 2014, « The Dangerous Degradation of the us Nuclear Arsenal », Forbes, 27 février.
- Barluet Alain, 2019, « Faut-il craindre les supermissiles de Vladimir Poutine ? » Le Figaro, 15 septembre.
- Bommakanti Kartic, 2018, « The Impact of cyber warfare on nuclear deterrence: A conceptual and empirical overview », orf (Observer Research Foundation) Issue Brief no 266, 1er novembre.
- Bond Allison, 2009, « Battling Over Aging Nuclear Warheads », Popular Science, 15 avril 2009, consulté sur Internet en août 2021, (https://www.popsci.com/military-aviation-amp-space/article/2009-04/battling-over-aging-nuclear-warheads/).
- Brooks Linton E., 2020, « The end of arms control », dans Robert Legvold et Christopher F. Chyba (dir.), numéro thématique Daedalus, « Meeting the Challenges of a New Nuclear Age », vol. 149, no 2 : 84-101.
- Brown Gerald C., 2021, « Understanding the Risks and Realities of China’s Nuclear Forces », Arms Control Association – Arms Control Today, juin : 6-13.
- Campbell Kurt, 2021, « Hotlines “ring out”: China’s military crisis strategy needs rethink, says Biden Asia chief », The Guardian, 6 mai 2021, consulté sur Internet en août 2021, (https://www.theguardian.com/world/2021/may/06/hotlines-ring-out-chinas-military-crisis-strategy-needs-rethink-says-biden-asia-chief-kurt-campbell).
- Caryl Christian, 2021, « Vladimir Putin, agent of chaos, is using a huge military exercise to keep the West on edge », Washington Post, 9 septembre 2021, consulté sur Internet en août 2021, (https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/09/09/russia-zapad-2021-belarus-military/).
- Chyba Christopher F., 2020, « New Technologies and Strategic Stability », dans Robert Legvold et Christopher F. Chyba (dir.), numéro thématique Daedalus, « Meeting the Challenges of a New Nuclear Age », vol. 149, no 2 : 150-170.
- Clem Ralph et Ray Finch, 2021, « Crowded Skies and Turbulent seas : Assessing the Full Scope of nato-Russian Military Incidents », War on the Rocks, 19 août 2021, consulté sur Internet en août 2021, (https://warontherocks.com/2021/08/crowded-skies-and-turbulent-seas-assessing-the-full-scope-of-nato-russian-military-incidents/).
- Fassihi Farnaz, Isabella Kwai et Ben Hubbard, 2021, « Iran incoming president vows tough line on missiles and militias », New York Times, 21 juin.
- Geller Patty-Jane et Peter Brookes, 2021, « The Increasing Russian Nuclear Threat », The Heritage Foundation, 6 avril 2021, consulté sur Internet en août 2021, (https://www.heritage.org/defense/report/the-increasing-russian-nuclear-threat).
- Gramer Robbie, 2017, « America’s nuclear weapons infrastructure is Crumbling », Foreign Policy, 17 mars 2021, consulté sur Internet en août 2021, (https://foreignpolicy.com/2017/03/17/americas-nuclear-weapons-infrastructure-is-crumbling-national-nuclear-security-administration-deterrence-aging-congressional-oversight/).
- Jackson Van, 2021, « Biden dangerous, risk averse inaction on North Korea », World Politics Review, 25 mai.
- Kaplan Fred, 2020, The Bomb : Presidents, Generals, and the Secret History of Nuclear War, New York, Simon & Schuster.
- Kinninmont Jane, 2021, « Why can’t world leaders agree that a nuclear war should never be fought ? » The Guardian, 21 juin 2021, consulté sur Internet en août 2021, (https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jun/21/world-leaders-biden-putin-nuclear-war?CMP=Share_iOSApp_Other).
- Kristensen Hans M. et Matt Korda, 2021, « Russian Nuclear Weapons », Bulletin of Atomic Scientists, vol. 77, no 2 : 90-108.
- Kristensen Hans et Matt Korda, 2021, « China’s nuclear missile silo expansion : From minimum deterrence to medium deterrence », Bulletin of the Atomic Scientists, 1er septembre, consulté sur Internet en août 2021, (https://thebulletin.org/2021/09/chinas-nuclear-missile-silo-expansion-from-minimum-deterrence-to-medium-deterrence/).
- Larsen Jeffrey A. et Kerry M. Kartchner, 2014, On Limited Nuclear War in the 21st Century, Stanford, Stanford University Press.
- Larsen Morten Soendergaard, 2021, « Talk of a Nuclear Deterrent in South Korea », Foreign Policy, 9 septembre, consulté sur Internet en août 2021, (https://foreignpolicy.com/2021/09/09/south-korea-nuclear-deterrent-north-korea/).
- Lieber Keir A. et Daryl G. Press, 2006, « The End of mad : The Nuclear Dimension of u.s. Primacy », International Security, vol. 30, no 4 : 7-44.
- Lieber Keir A. et Daryl G. Press, 2017, « The New Era of Counterforce: Technological Change and the Future of Nuclear Deterrence », International Security, vol. 41, no 4 : 9-49.
- Loss Rafael et Joseph Johnson, 2019, « Will Artificial Intelligence Imperil Nuclear Deterrence », War on the Rocks, 19 septembre, consulté sur Internet en août 2021, (https://warontherocks.com/2019/09/will-artificial-intelligence-imperil-nuclear-deterrence/).
- Lewis Jeffrey, 2021, « China Is Radically Expanding Its Nuclear Missile Silos: With more weapons likely, it’s time to go back to arms talks », Foreign Policy, 30 juin, consulté sur Internet (https://foreignpolicy.com/2021/06/30/china-nuclear-weapons-silos-arms-control/).
- Loukanova Anya et Olga Oliker, 2020, « Russia’s Nuclear Weapons in a Multipolar World : Guarantors of Sovereignty, Great Power Status and More », dans Robert Legvold et Christopher F. Chyba (dir.), numéro thématique Daedalus, « Meeting the Challenges of a New Nuclear Age », vol. 149, no 2 : 37-55.
- Meyer Paul et Tom Sauer, 2018, « The Nuclear Ban Treaty: A Sign of Global Impatience », Survival, vol. 60, no2 : 61-72.
- Miller Steven, 2020, « A Nuclear World Transformed: The Rise of Multilateral Disorder », dans Robert Legvold et Christopher F. Chyba (dir.), numéro thématique Daedalus, « Meeting the Challenges of a New Nuclear Age », vol. 149, no 2 : 17-37.
- Mohammad Khan Riaz, 2018, « Conflict Resolution and Crisis Management: Challenges in Pakistan-India Relations: Investigating Crises », dans Sameer Lalwani et Hannah Haegeland (dir.), Investigating Crises: South Asia’s Lessons, Evolving Dynamics, and Trajectories, Washington, Stimson Center: 75-95.
- Narang Vipin et Ankit Panda, 2020, « North Korea : Risks of Escalation », Survival, vol. 62, no1 : 47-54.
- Nia Council, 2020, « Iranian Parliament Bill on Nuclear Program », nia Council, 3 décembre 2020, consulté sur Internet en août 2021, (https://www.niacouncil.org/publications/iranian-parliament-bill-on-nuclear-program-full-text-in-english/?locale=en).
- Pomper Miles et David Santoro, 2021, « China’s Nuclear Weapons Build-Up Could Make for a More Dangerous Future », World Politics Review, 30 août 2021, consulté sur Internet en août 2021, (https://www.worldpoliticsreview.com/articles/29926/china-s-nuclear-weapons-build-up-could-make-for-a-more-dangerous-future).
- Reif Kingston, 2020, « Surging u.s. Nuclear Weapons Budget a Growing Danger », Arms Control Association, vol. 12, no 3, consulté sur Internet en août 2021, (https://www.armscontrol.org/issue-briefs/2020-03/surging-us-nuclear-weapons-budget-growing-danger).
- Roberts Brad, 2015, The Case for u.s. Nuclear Weapons in the 21st Century, Stanford, Stanford University Press.
- Roberts Cynthia, 2020, « Revelations about Russia’s Nuclear Deterrence Policy », War on the Rocks, 19 juin 2020, consulté sur Internet en août 2021, (https://warontherocks.com/2020/06/revelations-about-russias-nuclear-deterrence-policy/).
- Rotenberg Olga et Maxime Popov, 2018, « Poutine dévoile avec fierté les nouvelles armes russes », La Presse, 1er mars.
- Sanger David E., Lara Jakes et Farnaz Fassihi, 2021, « Biden promised to restore the nuclear deal: Now it risks derailment », New York Times, 31 juillet.
- Tannenwald Nina, 2020, « Life beyond Arms Control : Moving toward a Global Regime of Nuclear Restraint and Responsibility », dans Robert Legvold et Christopher F. Chyba (dir.), numéro thématique Daedalus, « Meeting the Challenges of a New Nuclear Age », vol. 149, no 2 : 205-222.
- The Economist, 2021, « Can America and Iran revive the Nuclear Deal? » The Economist, 5 juillet.
- Vartabedian Ralph et W.J. Hennigan, 2014, « New nuclear weapons needed, many experts say, pointing to aged arsenal », Los Angeles Times, 29 novembre 2014, consulté sur Internet en août 2021, (https://www.latimes.com/nation/la-na-new-nukes-20141130-story.html).
- Wilkening Dean, 2019, « Hypersonic Weapons and Strategic Stability », Survival, vol. 61, no 5 : 129-148.
- Xinhua Net, 2017, Full text of Xi Jinping’s report at 19th CPC National Congress, 3 novembre 2017, consulté sur Internet en août 2021, (http://www.xinhuanet.com/english/special/2017-11/03/c_136725942.htm).
- Zaloga Steven, 2002, The Kremlin’s Nuclear Sword : The Rise and Fall of Russia’s Strategic Nuclear Forces, 1945-2000, Washington, Smithsonian Institution and Press.
- Zhao Tong, 2021, « What’s driving China nuclear buildup », Commentary, Carnegie Endowment for International Peace, 5 août 2021, consulté sur Internet en août 2021, (https://carnegieendowment.org/2021/08/05/what-s-driving-china-s-nuclear-buildup-pub-85106).