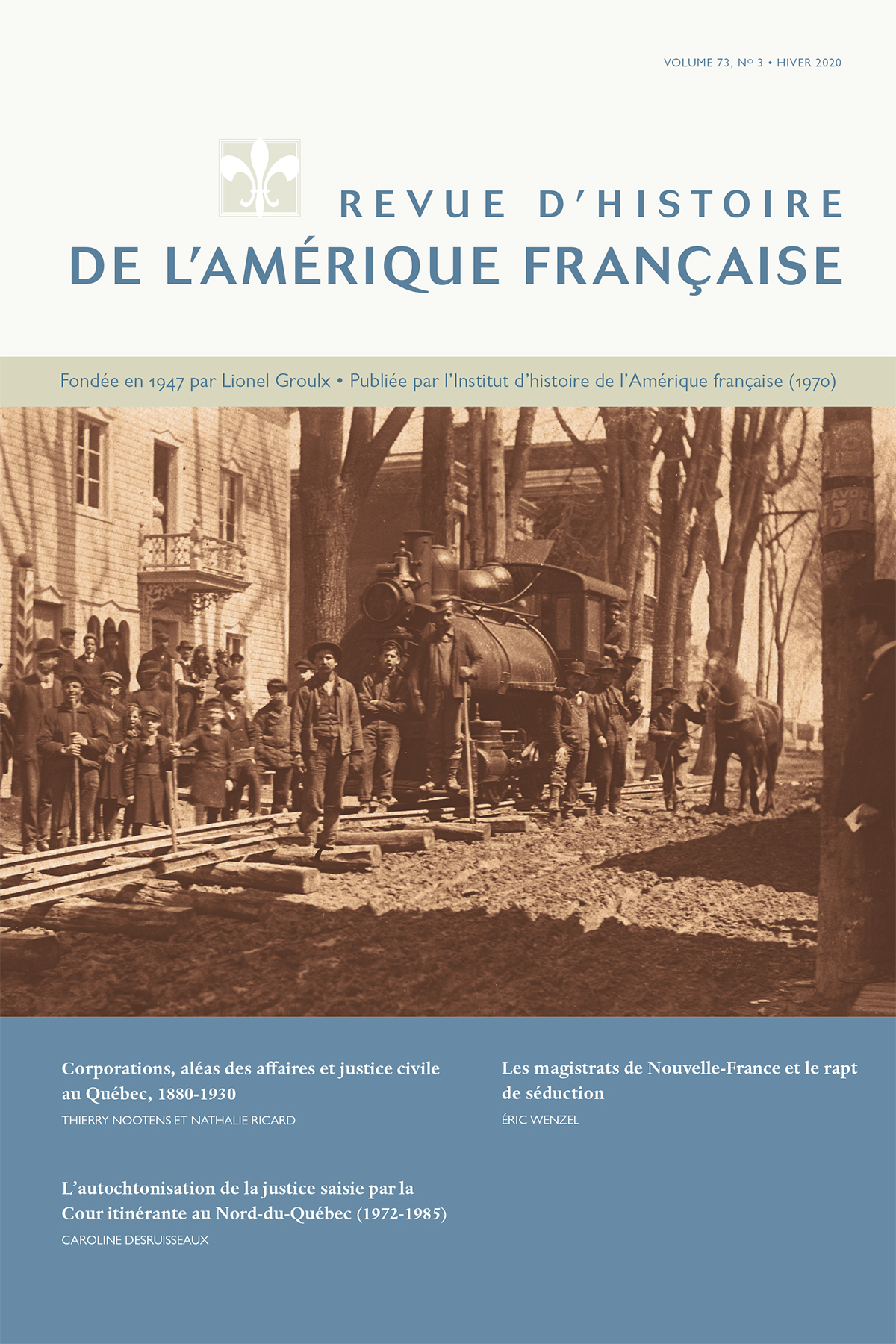Corps de l’article
À priori, le sujet du livre récent d’Hugues Théorêt, La presse canadienne-française et l’extrême droite européenne (1918-1945) semble avoir été amplement couvert. Combien d’études n’ont-elles pas déjà été consacrées aux liens putatifs entre Lionel Groulx et L’Action française devenue nationale (de Montréal) et Charles Maurras et L’Action française (de Paris) ? N’a-t-on pas examiné sous toutes ses coutures l’antisémitisme du Devoir des années 1930 ? D’autres aspects sont connus grâce, entre autres, aux bons travaux de Caroline Désy sur la Guerre civile espagnole ou d’Éric Amyot sur un Québec tiraillé entre Vichy et la France Libre. Mais l’étude de Théorêt émerge du lot. Elle embrasse le quart de siècle allant de l’Armistice de 1918 à la reddition des Nazis, couvre l’ensemble des régimes d’extrême droite (Italie, Portugal, Allemagne, Espagne, France pétainiste), et surtout – on a envie de dire : enfin ! – elle ne se contente pas de scruter le seul Devoir. On propose ici un panorama de la presse canadienne-française allant de Clarté (communiste) aux journaux fascistes d’Adrien Arcand, en passant bien sûr par Le Devoir, L’Action catholique et Le Droit, mais aussi par les organes libéraux et grand public que sont Le Soleil et La Presse, d’autres journaux libéraux mais plus intellectuels comme Le Canada et Le Jour, sans oublier quelques revues comme La Relève et Vivre.
Ce caractère synthétique est le plus grand mérite de l’ouvrage. Il permet une perspective plus juste, moins braquée sur tel ou tel thème. Moins téléologique aussi : Théorêt ne cherche ni à faire le procès du clérico-nationalisme ni à louanger la prescience antifasciste des journaux libéraux, pas plus qu’à réhabiliter ou à débusquer des mythes chez les uns ou les autres. Il se contente simplement, mais pleinement, de suivre et de respecter la chronologie – le Mussolini de 1922 n’est pas celui de 1938, le Pétain de l’été 1940 n’est pas celui de la fin de la guerre – et de donner la parole à une panoplie d’éditorialistes et de chroniqueurs. Il recourt assez peu à l’historiographie préexistante. Certes, les travaux sur l’extrême droite et sur la presse du temps lui sont connus et il s’y réfère à l’occasion, mais le but manifeste de l’auteur n’est pas tant de se positionner au sein d’une école de pensée que de laisser parler les textes, sans déterminisme, dans une approche descriptive et empirique.
De cette fresque de plus de vingt-cinq ans, couvrant plusieurs pays d’Europe et une infinité d’événements et de crises, qu’apprend-on ? En quelques mots : que des sympathies se sont souvent manifestées pour les dictatures de droite, à des degrés variables selon les journaux et selon les régimes, sympathies reposant sur l’anticommunisme et les professions de foi corporatistes de ces régimes, mais que rares furent les cas d’appui franc. Plus qu’une adhésion doctrinale ou viscérale au libéralisme ou à la démocratie, c’est le catholicisme professé par la quasi-totalité des organes de presse (sauf Clarté) qui constitue la première grille d’analyse des Canadiens français et explique que presque personne n’appuie inconditionnellement l’un ou l’autre de ces régimes.
Ainsi, le Mussolini du début des années 1920 suscite un appui d’ensemble, appui qui se dérobe cependant chaque fois que le gouvernement fasciste entend enrégimenter les diverses organisations catholiques. Les protestations du Vatican sont appuyées par l’ensemble des médias. Certes, les accords du Latran, en 1929, recueillent l’enthousiasme : enfin, la question romaine est réglée, le pape n’est plus prisonnier à Rome. La concrétisation de la statolâtrie mussolinienne inquiète la presse dès le début des années 1930, et l’encyclique Non abbiamo bisogno (« Nous n’avons pas besoin », 1931) la place encore une fois dans le camp anti-Mussolini. Le capital de sympathie ne se dissipe pas pour autant. Tout en réprouvant maintes méthodes, décisions et approches du Duce, on continue souvent à voir en lui un « chef » anticommuniste ayant revivifié l’instinct national des Italiens. Cela bascule fortement après l’invasion de l’Éthiopie en 1935, le raffermissement de l’axe Berlin-Rome, et plus encore après l’invasion traîtresse de la France.
Les deux dictateurs que sont Salazar et Franco recueillent une sympathie générale. Le Portugais suscite peu d’intérêt, mais on apprécie ce dirigeant censément apolitique, son corporatisme à visage humain, sa foi catholique et son non-interventionnisme dans les affaires internationales. Pour l’Espagnol, l’appui vient de la révulsion éprouvée par presque toute la presse pour les exactions anticatholiques perpétrées – ou non réprimées – par le régime républicain et surtout le Frente Popular depuis février 1936. L’anticommunisme de Franco, son catholicisme indubitable plaisent à l’Église et à la presse d’ici, même au Soleil et à La Presse, mais non au Canada qui ne peut avaliser une dictature, pas plus qu’au Jour ni à Clarté. Franco conservera la bienveillance de la majorité de l’opinion journalistique après 1939 à cause de sa neutralité pendant la Seconde Guerre.
Avant l’antisémitisme, chronologiquement parlant, c’est l’anticatholicisme du régime hitlérien qui révulse la quasi-totalité de la presse à l’exception, les premières années, des organes d’Adrien Arcand qui tentent de le gommer. L’assassinat du chancelier autrichien Dollfuss, en 1934, dissipe toute équivoque possible. Le rétablissement illégal du service militaire obligatoire, en 1935, confirme que les velléités pacifiques du chancelier ne sont qu’un leurre. L’encyclique Mit brennender Sorge (« Avec une brûlante inquiétude ») de Pie XI enfonce le clou en 1937.
L’avènement de l’« État français » du maréchal Pétain, dans la foulée de la défaite de juin 1940, suscite un bon accueil, même auprès de titres comme Le Soleil. On voit en Pétain un homme d’honneur qui servira de bouclier pour les Français et restaurera des bonnes valeurs négligées par la IIIe République. On n’en condamne pas pour autant de Gaulle qu’on voit comme représentant de l’honneur français. Le maréchalisme s’étiole avec le raffermissement de la Collaboration, sans disparaître cependant : chez les organes nationalistes et catholiques, son soutien affiché pour l’Église, son anticommunisme et son passé glorieux jouent dans la balance. Les politiques anti-juives de Vichy semblent peu évoquées.
Presque toute la presse – sauf Le Jour de Jean-Charles Harvey – est soulagée par les accords de Munich en 1938, non par connivence avec Hitler, mais parce que le spectre d’une guerre générale semble reculer. On n’en pense et dit pas moins que la Tchécoslovaquie a été sacrifiée. Théorêt rappelle que la quasi-totalité des journaux, incluant Le Soleil, La Presse et Le Canada s’érigent contre tout engagement du Canada dans un conflit qu’on estime européen. Après le début de la Seconde Guerre en 1939, personne ne soutient l’Axe et chacun souhaite la victoire des alliés franco-britanniques, même si l’opinion canadienne-française reste divisée sur l’opportunité d’une participation du Canada, s’arc-boute contre la conscription et voit avec suspicion l’alliance avec l’Union soviétique après 1941.
L’étude d’Hugues Théorêt permet un regard complet et documenté sur ces lourdes années. Deux réflexions en guise de post-scriptum ? On aurait aimé que l’auteur se penchât sur un journal de la diaspora canadienne-française, en plus du Droit qui est à demi québécois. Se pourrait-il que L’Évangéline (Moncton), La Liberté (Winnipeg), voire Le Travailleur (Worcester) se soient positionnés différemment, en raison de leur insertion dans un milieu très anglophone ? On aurait souhaité aussi qu’on nous proposât des parallèles avec la presse canadienne-anglaise d’alors. Instinctivement, la parenté intellectuelle et linguistique avec l’Anglosphère des deux continents laisserait croire à une opposition résolue du « ROC » contre les dictatures de droite. Fut-ce le cas ? La thèse des deux solitudes se vérifie-t-elle ici encore, ou les choses sont-elles plus complexes, comme le montrerait par exemple la naïveté par laquelle le premier ministre Mackenzie King a longtemps accueilli le soi-disant pacifisme d’Hitler ? C’est le propre des bons livres d’histoire que d’inciter leurs lecteurs à se poser des questions. Merci à l’auteur de les faire germer.