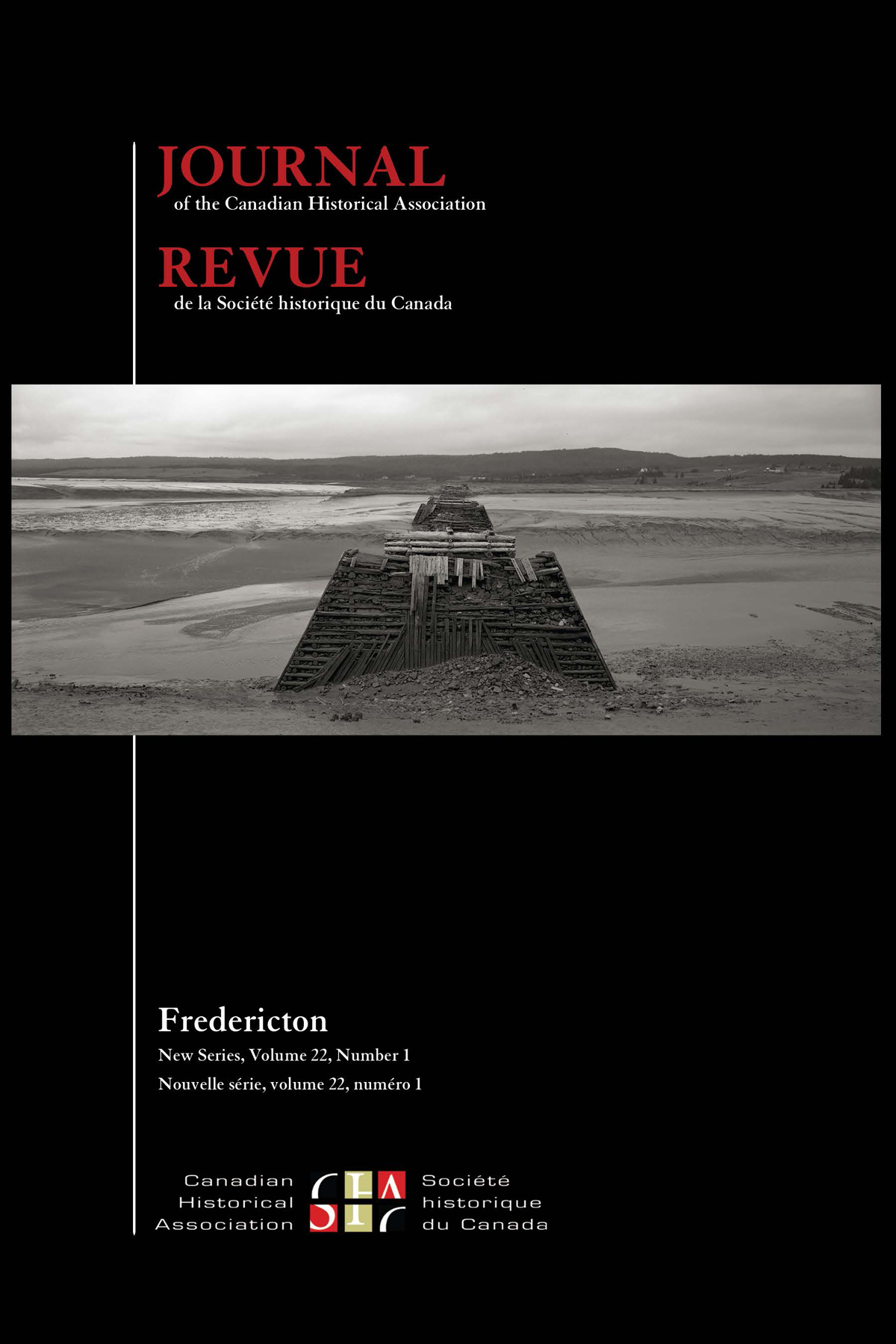Résumés
Abstract
Using her own experience as a window into the experiences of many historians, and especially women historians, who entered the profession in the 1960s, Mary Lynn spotlighted four barriers this generation crossed. First, many who came from working-class families benefitted from the expansion of university studies and financial support to take degrees, especially in the liberal arts as opposed to more practical diplomas that our parents and families preferred. They brought with them an interest in those who had been left out of conventional histories, thereby developing the fields of labour, social, and women’s history. Second, many participated in the political and social protests of the 1960s and learned from this much about the operations of power and memory that would apply in historical research and analyses. Third, women and men who were involved in the women’s movement in the 1960s and 1970s opened up the field of women’s history and subsequently gender history. Fourth, they did more local, regional and, more recently, transnational historical studies and within history departments, pressed for more inclusive and representative faculty members to teach the more expansive kind of history that has emerged.
Résumé
Présentant sa propre expérience comme représentative de celle de beaucoup d’historiens, et en particulier de beaucoup d’historiennes, qui ont fait leur entrée dans la profession dans les années 1960, Mary Lynn Stewart met en lumière quatre caractéristiques de l’expérience de sa génération. Premièrement, plusieurs étudiantes et étudiants issus de familles ouvrières ont bénéficié d’une plus grande accessibilité aux études universitaires et d’un soutien financier accru, ce qui leur a permis de s’inscrire dans des programmes offerts par les facultés des arts plutôt que dans ceux offerts par d’autres facultés, davantage favorisés par leurs parents et leurs familles. Ils se sont alors intéressés aux groupes et aux gens qui avaient été laissés pour compte dans les histoires traditionnelles, développant ainsi la recherche dans les domaines de l’histoire du travail, de l’histoire sociale et de l’histoire des femmes. Deuxièmement, bon nombre de ces historiennes et historiens ont participé aux manifestations politiques et sociales des années 1960, ce qui leur en a appris beaucoup sur l’exercice du pouvoir et sur l’articulation de la mémoire. Ils ont ensuite appliqué ce qu’ils avaient appris à la recherche et à l’analyse historiques. Troisièmement, les femmes et les hommes qui se sont engagés dans le mouvement féministe dans les années 1960 et 1970 ont par la suite ouvert de nouveaux champs de recherche en histoire des femmes et du genre. Quatrièmement, ces historiennes et ces historiens ont fait plus de recherche sur l’histoire locale, régionale et, plus récemment, transnationale que leurs prédécesseurs. Ils ont aussi lutté au sein de leur département pour que le corps professoral devienne plus inclusif et représentatif des nouveaux champs de recherche afin que ceux-ci soient enseignés.
Corps de l’article
When I let my name stand for President of the Canadian Historical Asociation/ Société historique du Canada, I knew that I had to give a presidential talk. After reading and thinking about that genre of talk, I decided that a theoretical or methodological address, full of references to French and gender theorists, might be demanding for a late afternoon talk in the middle of a conference. And I am not interested in defining the state of the discipline, which is too often an exercise in boundary maintenance.[1] On the contrary, I freely cross over disciplinary boundaries, much as Doctors without Borders operate with modest regard for political borders.
Taking my cue from Carol Steedman’s book, Landscape for a Good Woman (1986), which used the author’s autobiography and the life of her mother to challenge some of the received wisdom of British social history, I am going to use some of my life in history as a window into my generation’s practice of history and experience of political and cultural changes. By my generation, I mean those who began their careers in History in the long sixties and who continue to do historical research today. I follow Bryan Palmer, in his masterful history of the sixties in Canada, in defining the long sixties as the early 1960s through the mid 1970s.[2] In this talk, I contend that my generation has been very open to changing methods and interpretations. In this sense, we have been “Historians without Borders.”
I begin with a personal story about disregarding class and gender barriers: my decision to go to university, as a working-class girl from an extended family in Western Canada that had only sent one member — an eldest son — to university. Although the extended family approved my initial choice to pursue the gender-appropriate and upwardly-mobile goal of an Education degree, they disapproved of my decision to switch into an Honours BA in History, which they considered impractical. Happily, I persuaded my parents that I should follow my heart. I have met other faculty women with working class origins whose families reacted in the same way to their decisions to major in the Arts. Although our families had little knowledge of the hiring situation in universities, they were right about how few women these departments hired in the early sixties. That has changed dramatically in the intervening decades.[3] Because we ignored class and gender barriers, we brought changes to history and other departments, not least by being willing to hire women and other former outsiders.
I am grateful that I had parents who admired education and did not have sons to send to university. Happily, the financial hurdles of going to university had been lowered, in so far as support for university education was expanding in the 1960s. When I entered what was then the University of Alberta, Calgary, in 1963, about 11 % of Canadian high school graduates went on to university, and of these, about one quarter were women.[4] None of the girls and few of the boys I knew in high school went to university. I had small scholarships throughout my undergraduate studies, which only sufficed because I lived at home. Scholars studying how students from modest backgrounds make it through university, find that they have similar financial support and housing.[5] Like most of my contemporaries, I only worked summers in my four undergraduate years. We seem fortunate by comparison to today’s students, many of whom work year round and take large student loans in order to get their degrees. I believe that our location in the borderlands, to extend my metaphor, or, if you prefer, our peripheral stand-point on history, made us receptive to new methods and subject matter. Our relative freedom from paid work and loan repayments let us approach history critically and engage in the protests of the long sixties.
By the time I graduated from the renamed University of Calgary in 1967, the gender ratio was closer to two boys for every girl, almost the opposite of today. I recall only one woman faculty member in the History Department, an American historian whose courses I did not take. I was curiously impervious to the not-so-hidden message in the gender composition of the faculty complement. But I was mentored by someone who did not dismiss me on the basis of gender or class. Because my senior supervisor in the Honours Programme encouraged me, I realized that I could go to graduate school. His assurances that I would get a scholarship overcame my parents’ worries about financing graduate education — and a four-year Faculty Fellowship at Columbia University in New York City made a graduate education possible. Like other faculty from underprivileged backgrounds, I am grateful for open-minded mentoring and try to do the same for my students. I consider this paying backward and forward at the same time.
To go to Columbia University, I crossed more than a national border. I moved from a conservative and homogeneous mid-sized Prairie city to the Upper West Side of Manhattan, a relatively radical and culturally-diverse neighbourhood. I chose Columbia because it offered a four-year fellowship and a great location. I applied to Canadian universities but only the University of Calgary offered more than one year’s financial support, and I was advised not to get three degrees from one institution. Other Canadians who had to have scholarships to go to grad school tell similar stories about getting more support outside Canada. To this day, I advise students, especially those who have lived all their lives in the Lower Mainland of BC, to go away for graduate school. Fortunately, there are more opportunities for financial support at Canadian universities today.
My decision to specialize in French history was another way of ignoring national borders. I give academic credit for my fascination with French history to Honours Supervisor, Harvey Mitchell, who made French history engaging and contentious, filled as it was with revolutions yet stubbornly persistent economic and social structures. To this day, much of my work grapples with the coexistence of change and continuity.
At Calgary, I read what was not yet called “history from below,” the history of the ordinary people who were left out of the diplomatic and political history that dominated departments of History in the early 1960s.[6] Harvey introduced me to the works of the British Neo-Marxist historians, notably Edward P. Thompson’s The Making of the English Working Class. Note that Neo-Marxists like Thompson went beyond any simple “economic determinism” or base/ superstructure hierarchy by paying attention to working class cultures, including ritual, songs, and sociability. I remember vividly feeling that my generation was entering a new frontier of historical research, acknowledging agency in the working class crowd and developing the idea of working class culture. I was fascinated by the oppositional history of the French working class during graduate school and published my first monograph on an aspect of the topic in 1981.
For more than a decade, class was the main tool in my intellectual tool box. It remains important, but has been joined by other analytical constructs, many of them drawn from cultural studies. I see similar accumulation of analytical constructs in the work of my peers, as they too go beyond their initial intellectual paradigms.
Neither the historiography course nor our advisors at Columbia defended the ramparts of historical research. Instead, they suggested taking courses in the social sciences and adopting some of their methods. One result was that many dissertations and first books were micro-histories. Many still are, though the more recent ones, at least in my field, situate their material in the growing body of knowledge generated by previous micro-histories, a process that begins to coalesce into a more variegated version of history. These micro-histories undermined national narratives that had prevailed since the late nineteenth century — and in the case of France, were selected and implemented by a centralized education system. As these micro-histories accumulate and interact with one another, they assuage fears about the fragmentation of historical studies.
I did my dissertation on the silk workers of Lyon between their insurrection of 1834 and the fall of the Second French Republic in 1852. With other grad students, I participated in a study group on demography and learned Fortran to use the computer, in my case to analyze the occupations, addresses, arrest records, and charges of nearly twelve hundred silk workers arrested for protests in Lyon between 1834 and 1852. But I never abandoned my search for the thoughts, feelings, and personal lives of these workers. I analyzed their poetry, pamphlets, and newspapers and researched their families, neighbourhoods, and workplaces. Over the decades, like most of my cohort, I have done less quantitative history, but I see no reason not to combine quantitative and qualitative data, as long as both words and figures are subjected to critical scrutiny.
E.P. Thompson’s legacy played a role in this bifurcated approach,[7] as did the example of the Annales School, with its goal of universal history. I was particularly influenced by Fernand Braudel’s Capitalism and Material life, 1400-1800, with its attention to the relationships between capitalism, consumption and material history.
Being interested in French history meant an early introduction to Foucault in study groups for ten years after graduate school. In the late 1980s, the French theorist du jour changed. First in line, and still foremost for me, was Pierre Bourdieu, with his grounded notions of social and cultural capital, which helped me understand the importance of taste, whether in personal appearance or household decor, for bourgeois women. This was essential for my latest monograph, on French fashion. But I’ll stop listing French theorists now, having promised not to go on about them. The point is that much of our theoretical education was the result of extra-curricular study. We did not confine ourselves to education within the halls of academe.
I fully acknowledge the connection between my interests in historical research and my anti-war and free speech activism in the long sixties. Although left-wing activism at the University of Alberta, Calgary, rarely makes it into the history books, I want to record that I began four decades of marching in demonstrations at that very university, first in a small protest against the Vietnam war and then in a larger protest against the University and other local venues that refused to host the San Francisco Mime Troop, an irreverent troop of Afro-American actors. At Columbia, I continued my involvement in the Vietnam War demonstrations and joined the student occupation of Columbia University in 1968 over the University’s involvement in the Vietnam War. As a participant-observer of the reaction of New York City policemen to student occupiers — a police riot — I recognized the class basis of policemen’s anger at privileged youth. I was on the other side of a barricade, but the barricade did not fit my idea of the barricades in French revolutions. I rethought my naive assumptions that barricades are necessarily material barriers erected by left-wing radicals.
After the student occupation, I participated in organizing efforts among caretakers at Columbia University and nearby St Paul’s hospital. Reading the media coverage of the student occupation of the buildings at Columbia, which said little about a police riot, and noting their utter indifference to efforts to organize caretaking staff, we had another learning moment, this time about the selectivity of the media’s definition of “all the news fit to print.” This insight reinforced my historiography course, with its instructions not to rely heavily upon printed sources and to scrutinize all sources for bias.
My participation in anti-war and peace demonstrations, as well as my support for striking workers at Simon Fraser University, where I taught from 1977, continued through the 1980s. I think this activism informed and improved the quality of the scholarship I produced, notably my 1983 book on gendered labour legislation in France. Colleagues report similar benefits.
In Canada, the Student Union for Peace Action was active in the years leading up to 1968, both in anti-war protests and community organizing, and students for a Democratic University were occupying universities in 1969. For those who became historians, I suggest that these generational experiences may have had a similar impact on their practice of history. Of greater import, for women like me, was the publication of Maggie Benston’s “Political Economy of Women’s Liberation.” I was delighted to join the Women’s Studies program at Simon Fraser University in 1977, because Maggie was there. But I did not follow up her insights about women’s unpaid labour in my research until my present research project, which includes a content analysis of columns and letters to the editors of the woman’s pages of French newspapers.
The tipping point in my conversion to women’s history occurred in New York, in a non-credit, off-campus graduate seminar in history conducted by pioneers of women’s history like Gerda Lerner and Joan Kelly Gadol. This was the most demanding and rewarding course I ever took, because we all devoted a lot of time to finding elusive reading material and came to each session prepared to debate our interpretations of what was very fresh material. To those who dismiss this period of women’s history as mere recovery history, without any theory, I agree that we searched high and low for documents and secondary sources, but I disagree about not using theory. In my case, I drew heavily on Simone de Beauvoir’s Second Sex, with her useful notions of women’s situation and historical contingency.
We were explorers in nearly uncharted territory. I say nearly uncharted because we quickly uncovered an earlier generation of historians whose superb scholarship on women had escaped our notice, since these works had not been assigned in any course or been included on any comprehensive exam bibliography. I understand that other historians excavating what they thought were untapped lodes of historical data, have also discovered predecessors who have been excised from the historiographical record.
In marathon negotiations with the departmental curriculum committee at Columbia, we concentrated on including women in Western Civilization courses. The progressive narrative that was history considered women ahistorical, so women barely played a cameo role in history courses. When they entered the scene, they were identified as exceptional women; on the rare occasion that anyone alluded to femininity, it was eternal, or the negation of history as progress. Most of us refused to focus on “exceptional” women or accept the notion of an eternal feminine.[8] We were grappling with essentialism, but did not have that language to talk about it. Here again we bumped up against the issue of continuity and change, now articulated as a problem of patriarchal structure versus women’s agency.[9] It would take several years to develop the concepts of patriarchy as flexible, patriarchies in the plural and structured choice, an articulation of ideas about the coexistence of structures and limited agency.
We grappled with the need for multiple histories, not just a single narrative. (We did not have the term master narratives). We ran into the “fear of plurality” that still informs efforts to be more inclusive, fears that still lead to the near exclusion of women in, for instance, the recently imposed national historical canon in Holland.[10] Other excluded groups have encountered resistance when they argued for a more representative history. To me, expanding historical coverage is a positive development, though the notion of multiple histories does raise concerns about the fragmentation of historical knowledge. A curriculum that includes diversity in the survey courses, and sets requirements to explore alternative histories in the course of a history degree, addresses some of these concerns.
This extracurricular women’s history course was the only occasion I had as a student to observe women as professors of history. Their enthusiasm and intellectual rigour inspire me to this day. Many in that seminar continue to teach women’s history or women’s studies. I spent twenty-eight years in a joint appointment with Women’s Studies and am now full time in the recently renamed Department of Gender, Sexuality and Women’s Studies at Simon Fraser University. In my thirty-eight years teaching career, I have tried to recreate the unadulterated pleasure in learning that I felt in that seminar. As the boundaries of historical inquiry opened to include other previously-unrecognized subjects, such as people of colour, disabled people, gays and lesbians, and most recently transgendered people, some of my students have experienced that joy of discovery.
The other impetus for my interest in women’s history was the women’s movement. During the campaign for abortion in New York State, I began attending what would later be called consciousness-raising sessions at Columbia. However, our large group of university students, including such feminist luminaries as Kate Millet and Ti-Grace Atkinson, focused on practical issues like acquiring more women’s washrooms (and liberating men’s rooms, when we got no results), getting access to birth control pills (and occupying the student health centre when we were ignored), and lobbying for what became the first special police unit for sex crimes.
When I began teaching, I was further drawn to women’s history, because I was realizing that history itself was gendered and that this was causally linked to the predominance of men in history departments. When I was first hired in a department of history at a women’s college, Smith College in Northampton, Massachusetts, I was impressed by the fact that the department employed three women and eleven men. I soon realized that there were informal gender barriers that I had not imagined. The most ironic and frustrating one was opposition to teaching women’s history at a women’s college — until influential alumni (or large donors) urged the department at least to offer a course during the centennial of the College in 1975. After I joined the History Department at Simon Fraser University in 1977, it was acceptable to teach women’s history, because the first two tenure-track women — the other one was an earlier President of the CHA, Nikki Strong-Boag — were jointly-appointed with Women’s Studies. For fifteen years, I was one of only two women in a department of twenty-eight tenure-line faculty members. At SFU, I bumped into the attitude that two tenured women were quite enough for a department, an opinion expressed in hiring battles when Nikki and I tried to persuade the department to hire promising women. Even after the walls of history departments had been breached, some tried to defend the perimeters from outsiders. These battles and attitudes prevailed until the early nineties, when a few more women were hired. Not incidentally, many more have been added since then.
Meanwhile, I benefitted from the inter-disciplinarity of Women’s Studies, notably when I conceived of a book on the history of modern women’s clothing that used symbolic anthropology to uncover the meaning of fashion along with a political economy of the couture business in interwar France. In the late 1980s, I helped form Academic Women at SFU to organize other faculty women, many of whom felt very isolated in their departments. Although we lobbied for and got an employment equity officer and a pay equity review, we also attended each others’ talks. These talks expanded our horizons and enriched our scholarship. To belabour the metaphor, we benefitted from traversing disciplinary borders. Other multi-disciplinary societies serve the same purpose.
The title of my talk also reflects my current research project on the gender of newspaper journalism in Interwar France, a gender history combing a sociological approach to the careers of journalists with a linguistic approach to the style of French journalism. Like most gender history, it is both a social and a cultural history, whatever polemicists for both camps claimed about their incompatibility in the 1980s and 1990s.[11] After over a decade of controversy over theory and methods, I, like many in my generation, am flexible about methods.
In the current project, I am comparing the writing style and careers of two of the seven women who reached the pinnacle of national newspaper reporting, to the writing style and careers of two of their forty-some male peers. I am testing claims by historians who study women in American newspaper journalism that women penetrated the first page because their feminine style — a melange of personal reporting, sensationalism, and sentiment — suited a mass readership.[12] My hypotheses were that Frenchwomen writing on the front page wrote in much the same way as their male peers and that both sets of reporters regularly inserted their own opinions and exploited sensational topics. Ongoing research has confirmed these hypotheses.
For the moment, the question is: How did this project give rise to the title “Historians without Borders”? Clearly, the boundaries between genders, or at least the notion of gendered styles, will be breached in my research. I am drawing upon recent trends in Gender Studies, treating gender as a question, not a category, of historical analysis.[13]
Because my subjects investigated and wrote about different countries and continents, I am becoming a “Historian without National Borders.” All of my subjects wrote series of articles and books about French colonies, which has led me to study interpretations of the same colonies by their contemporaries and recent scholars and to delve into post-colonial theories to see if they can be applied to reporting on these colonies. My research agenda includes inquiring whether their variant of racism correlates with their gendered experiences of their occupation. In doing so, I am engaging in intersectional analysis, examining the intersections between gender, race and class,[14] a method many historians have borrowed from Women’s and Gender Studies.
In addition, one of my subjects, Andrée Viollis, produced two newspaper series and three books about China and Japan. Her excursions in the East have been linked to her second husband’s career as a curator of Chinese art, and her different responses to the two Asian countries have been interpreted as manifestations of Western fear of Japanese imperialism. Neither interpretation is an adequate explanation. To understand Viollis’ polemical response to militaristic authoritarianism in Japan — she labelled it fascist — I am not only examining her reporting on Nazi Germany, but rereading germinal works on Orientalism and immersing myself in the war-torn history of Chinese-Japanese relations in the clearly misnamed interwar period. Accordingly, I am hurdling over intra-disciplinary fences and querying the utility of Eurocentric periodization. Like other members of my cohort, I am following the lead of a younger generation of historians.
One might expect European historians to destabilize national history narratives more directly than through the proliferation of village and regional histories. Nationalism, which has often aligned with racism and warfare in Europe, has a bad track record. However, with the exception of economic historians and specialists in international relations, few historians have written European history. Genuinely transnational histories of Europe are rare, and are fraught with internal difficulties such as differences in periodization (e.g. contemporary history starts with the Great Revolution in France in Western European countries, but with the First World War in Eastern European countries). Those who are seeking a method, begin by rejecting essentialist narratives, such as the shared heritage of the Enlightenment, and look to a truly transnational history, with the emphasis on interdependency and transfers between nations and other entities. The best insist upon a plurality of histories and what the French call histoire croisée, meaning that transfers must be seen as multi-directional.[15]
Of course, some European historians have written transnational historical works. The stellar example is Natalie Zemon Davis, the 2010 winner of the Holberg International Prize for outstanding work in the arts and humanities. Although I cannot forebear mentioning that she began as a French historian, she has not been confined in national or disciplinary traditions. As she described her work in the Holberg interview, her “historical inquiry has ranged in space from early modern France and Western Europe to North Africa and the Caribbean and in theme from social and religious conflict to gift-giving, storytelling and festivity. But throughout I’ve especially sought the history of working people — artisans, peasants, and now slaves — and the history of women along with the men. I’ve tried to recapture their voices and visions of the world, and seen them not as mere victims of oppression, but as actors finding ways to survive, improvise, and even resist. I’ve tried to write decentred history, where what happens in a woman’s workshop or a villager’s hut or at a printer’s press can count as much as decisions at a king’s council or a meeting of a Faculty of Theology. I’ve tried to write a pluralistic history, where the poor are present along with the rich, and Jews and Muslims along with Catholics, Protestants, and other Christians.”[16] Few among us can hope to match her breadth, but her example of seeing links between local histories and the wider world, between everyday people and world-historical events, is manageable.
I wish to conclude with a few remarks on what this all has to do with Canadian history and the CHA/SHC?
I think that historians of Canada write exemplary history without borders. Consider two recent prize winning books. The 2010 MacDonald Prize went to Beatrice Craig’s Backwoods Consumers and Homespun Capitalists. The Rise of a Market Culture in Eastern Canada,[17] a micro-history of an isolated region that identifies links between local and international markets and queries conventional wisdom about capitalism in rural areas. Or the winner of the 2010 Harold Adams Innis Prize for Best English-Language work in the social sciences, Makuk, A New History of Aboriginal-White Relations, by John Lutz, a Council member. This is another micro-history, in this case of two indigenous peoples, the Tsilhqot’in and the Straits Salish, in British Columbia, the different ways they responded to European colonialism, and how they were affected by the Euro-American construction of the “lazy Indian” and “vanishing” Indians.[18]
I also base my conclusion on my continuing reading in Canadian women’s history and sporadic efforts to keep up with Canadian labour history. Not being able to keep track of all the scholarship in Canadian history, I asked colleagues in fields like environmental, aboriginal and western Canadian history to suggest recent surveys of the fields, and I thank all who responded. I also consulted the programs and papers of recent annual meetings and attended as many sessions at the last four meetings as I could.
There are many reasons to consider historians of Canada well positioned in the new and more interdisciplinary and international practice of history. The absence of a national history canon is an advantage: historians do not have to put so much effort into destabilizing a powerful and entrenched national narrative or, this being Canada, narratives. Second, scholarship about Canadian history flourished since the long 1960s and accordingly benefits from the trend to adapt methods from other disciplines. Third, most Canadians are immigrants or the heirs of settlers, which means that part of the fabric of Canadian history is knowing where people came from and what they brought with them. Given the variety of Canadian backgrounds, Canadian history must address many different cultural heritages and how they mingle with, are altered by, and enhance the Canadian social landscape.
Finally, the CHA/SHC has a mandate to represent all historians in Canada. This mandate has meant conscious efforts to draw in historians who are not Canadian specialists, whether in the form of comparative sessions at the annual meetings, inclusion of promising papers in the Journal of the Canadian Historical Association, and by electing presidents whose specializations are not Canadian. I have found being on Council, and attending the annual meetings, stimulating and inspiring. I hope to be able to attend more sessions and join the new media history group in the future. I hope that I will see you at these sessions.
En acceptant de me présenter au poste de présidente de la Société historique du Canada, je savais que je serais un jour appelée à présenter le discours de la présidente. Après avoir lu et réfléchi sur ce genre de présentation, j’en suis venue à la conclusion qu’un discours théorique et méthodologique, truffé de références à la France, aux théoriciens français et à ceux du genre, pourrait être indigeste pour une fin d’après-midi, au milieu d’un congrès. De plus, je n’avais pas envie de définir l’état de la discipline, ce qui revient trop souvent à délimiter le champ de la pratique historienne[1]. Au contraire, j’ai choisi de traverser librement les frontières disciplinaires, un peu comme les Médecins sans frontières pratiquent leur profession sans trop tenir compte des frontières politiques.
Inspirée par l’ouvrage de Carol Steedman intitulé Landscape for a Good Woman (1986), dans lequel l’auteure s’inspire de sa vie et de celle de sa mère pour remettre en question certaines des idées les plus répandues concernant l’histoire sociale britannique, je vais puiser dans ma propre expérience pour jeter un regard sur la manière dont ma génération a pratiqué l’histoire et vécu les changements politiques et culturels qui l’ont marquée. Quand je dis « ma génération », je fais référence à ceux et celles qui ont commencé leur carrière d’historiens au cours des long sixties et qui s’adonnent toujours à la recherche historique aujourd’hui. Comme le fait Bryan Palmer dans sa remarquable histoire des années 1960 au Canada, je définis les long sixties comme étant la période allant du début des années 1960 au milieu des années 1970[2]. Dans le présent discours, je soutiens que ma génération a été très réceptive aux nouvelles méthodes et interprétations; en ce sens, nous avons été des « historiennes et historiens sans frontières ».
Je vous raconterai d’abord l’histoire de mon entrée à l’université, laquelle n’a pas été influencée par des questions de classes et de genre. J’étais alors une jeune fille issue de la classe ouvrière et j’appartenais à une famille élargie de l’Ouest canadien qui n’avait envoyé jusqu’alors qu’un de ses membres (un aîné) dans un tel établissement. Si ma famille a d’abord approuvé mon choix de faire des études en éducation, choix approprié pour une jeune femme et pouvant permettre une certaine ascension sociale, elle ne s’est pas montrée favorable à ma décision de changer de programme d’études et de m’inscrire au baccalauréat spécialisé en histoire, décision qu’elle considérait comme dénuée de sens pratique. J’ai heureusement réussi à convaincre mes parents de l’importance de suivre ma voie. J’ai depuis rencontré nombre de professeures provenant de la classe ouvrière et dont les familles avaient réagi de façon similaire face à leur choix de s’inscrire dans un programme d’études offert par la faculté des arts. Bien que nos familles n’aient pas eu vent de la situation quant aux embauches dans les universités, elles avaient raison sur un point : les départements spécialisés dans ces domaines embauchaient peu de femmes au début des années 1960. Cela a énormément changé au cours des dernières décennies[3]. En ignorant les considérations de classe et de genre et en recrutant des femmes et des personnes jusqu’alors marginalisées, nous avons transformé ces départements, incluant ceux d’histoire.
Je suis reconnaissante à mes parents pour avoir compris l’importance de l’éducation et aussi, de manière plus ironique, pour ne pas avoir eu de fils à envoyer à l’université. Heureusement, les obstacles financiers associés aux études universitaires s’étaient aussi quelque peu aplanis dans les années 1960, grâce au soutien accru octroyé à l’éducation postsecondaire. En 1963, lorsque je suis entrée à ce qui était alors la University of Alberta à Calgary, environ 11 % des diplômés du secondaire poursuivaient des études universitaires. De ce nombre, à peu près un quart était des femmes[4]. De mes compagnons et compagnes de classe du secondaire, seuls quelques garçons sont allés à l’université, aucune fille. Si les petites bourses que j’ai obtenues tout au long de mes études de premier cycle ont été suffisantes à la poursuite de celles-ci, c’est uniquement parce que j’habitais encore chez mes parents. Les chercheurs qui se sont penchés sur la façon dont les étudiantes et étudiants provenant de milieux modestes arrivent à fréquenter l’université ont démontré qu’ils bénéficient généralement d’un soutien financier et d’un hébergement similaires[5]. Comme la plupart de mes collègues d’alors, je ne travaillais que pendant l’été durant mes études de premier cycle. Nous avons été fort chanceux, surtout en comparaison avec les étudiantes et les étudiants d’aujourd’hui qui doivent souvent travailler toute l’année et contracter d’importantes dettes étudiantes pour arriver à obtenir leur(s) diplôme(s). M’inspirant de ma métaphore initiale, je dirais que la région limitrophe où nous habitions ou, si vous préférez, la position périphérique à partir de laquelle nous observions l’histoire nous a permis d’être réceptifs aux nouvelles méthodes de recherche et ouverts aux nouveaux sujets. Grâce à la possibilité que nous avions de ne pas travailler durant l’année et à la chance que nous avons eue de ne pas avoir à nous endetter pour étudier, nous avons pu aborder l’histoire de façon critique et participer aux mouvements de protestation caractéristiques des années 1960.
Au moment où j’ai terminé mes études en 1967, à ce qui s’appelait alors la University of Calgary, la proportion d’étudiants et d’étudiantes était presque de deux pour une, soit pratiquement l’inverse de la situation actuelle. Je ne me souviens que d’une seule professeure au département d’histoire. Il s’agissait d’une historienne des États-Unis, dont je n’ai pas suivi les cours. Curieusement, je n’étais guère touchée par la question de la composition essentiellement masculine du corps professoral. Par contre, mon directeur de mémoire de spécialisation n’a jamais tenu compte de mon origine ouvrière ou du fait que j’aie été une femme. Plus encore, ce sont ses encouragements qui m’ont fait comprendre que je pouvais poursuivre mes études aux cycles supérieurs. Sa confiance dans ma capacité à obtenir une bourse a fini par triompher des inquiétudes de mes parents au regard du financement de mes études. L’obtention d’une bourse de recherche de quatre ans de la Columbia University de New York a finalement rendu possible la poursuite de mes études. À l’instar d’autres collègues provenant de milieux défavorisés, je suis reconnaissante d’avoir été formée par des professeurs à l’esprit ouvert. J’essaie aujourd’hui de donner à mes étudiantes et à mes étudiants cette même chance. En agissant de la sorte, je redonne ce que j’ai reçu tout en investissant dans l’avenir.
En allant à Columbia, j’ai traversé bien plus qu’une frontière nationale. Je suis partie d’une ville de taille moyenne, conservatrice et homogène des Prairies, pour me rendre dans le Upper West Side de Manhattan, un quartier relativement radical et culturellement diversifié. J’ai choisi de poursuivre mes études à Columbia à cause de la bourse de quatre ans qui m’avait été offerte ainsi que de son excellent emplacement. J’avais fait des demandes d’admission dans des universités canadiennes, mais seule la University of Calgary m’a offert un soutien financier de plus d’un an. Or, on m’avait conseillé de ne pas obtenir trois diplômes d’une même institution. D’autres étudiants canadiens en mal de bourses racontent également avoir eu plus de soutien à l’extérieur du pays. Encore aujourd’hui, je recommande à mes étudiants, particulièrement ceux qui ont toujours habité dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique, d’aller poursuivre leurs études dans une autre université. Heureusement, le soutien financier offert aux étudiants actuels est bien plus généreux.
Ma décision de me spécialiser en histoire française constituait une autre façon de franchir les frontières nationales. Je dois une bonne partie de ma fascination pour l’histoire française à Harvey Mitchell, mon directeur de mémoire de spécialisation. Il a su faire de l’histoire française un récit captivant et controversé, marqué aussi bien par les révolutions que par la persistance des structures économiques et sociales. Jusqu’à présent, une bonne partie de mes recherches ont porté sur la coexistence du changement et de la continuité dans l’histoire française.
À Calgary, j’ai pris connaissance de ce qui ne s’appelait pas encore « l’histoire par le bas » (history from below), soit l’histoire des gens ordinaires exclus de l’histoire diplomatique et politique qui dominait les départements au début des années 1960[6]. Mitchell m’a fait découvrir le travail des historiens néo-marxistes britanniques, notamment The Making of the English Working Class d’Edward P. Thompson. Soulignons que les néo-marxistes tels que Thompson sont allés au-delà du simple déterminisme économique ou du concept de superstructure en portant une attention particulière à la culture de la classe ouvrière, y compris à ses rituels, à ses chants et à sa sociabilité. Je me souviens clairement d’avoir eu l’impression que ma génération franchissait une nouvelle frontière en reconnaissant l’agentivité de la classe ouvrière et en développant l’idée de la culture ouvrière. J’ai été fascinée tout au long de mes études supérieures par l’histoire conflictuelle de la classe ouvrière française. Mon premier ouvrage, publié en 1981, portait d’ailleurs sur un aspect de cette question.
Durant plus d’une décennie, la classe sociale a été ma principale catégorie d’analyse. Bien qu’elle demeure encore importante aujourd’hui, elle est maintenant complétée par d’autres catégories ou cadres d’analyse, dont plusieurs proviennent des études culturelles. Je remarque que mes pairs juxtaposent également différents cadres d’analyse dans leurs travaux, transcendant ainsi leur paradigme initial.
Ni le cours d’historiographie ni les directeurs de thèse à Columbia ne défendaient les remparts de la discipline historique. On nous suggérait plutôt de nous inspirer de ce qui se faisait dans les sciences sociales et d’adopter certaines de leurs méthodes. Par conséquent, plusieurs thèses et premiers livres publiés à cette époque constituaient des micro-histoires. C’est encore souvent le cas, bien que les auteurs des travaux les plus récents, du moins dans mon domaine, inscrivent leurs conclusions dans le cadre d’une riche historiographie nourrie par les micro-histoires antérieures, ce qui donne forme à une version plus variée de l’histoire. Ces micro-histoires sont venues miner les discours nationaux qui prévalaient depuis la fin du 19e siècle et qui avaient même été promus en France par le système d’éducation centralisé. Leur accumulation et leur interaction peuvent nous rassurer quant à la menace d’une trop grande fragmentation de la discipline.
Ma thèse doctorale portait sur les travailleurs de la soie de Lyon entre leur insurrection de 1834 et la chute de la Seconde République française en 1852. J’ai pris part à un groupe d’études sur la démographie avec d’autres étudiants. J’ai aussi appris le langage informatique FORTRAN afin de pouvoir utiliser l’ordinateur pour analyser les emplois, les adresses, les rapports d’arrestation et les accusations portées contre près de mille deux cents travailleurs de la soie arrêtés pour avoir participé à des manifestations à Lyon durant cette période. Je n’ai toutefois jamais cessé de travailler parallèlement à mieux connaître les pensées, les sentiments et la vie personnelle de ces travailleurs. J’ai analysé leurs brochures, journaux et poésie. J’ai étudié leur famille, leur voisinage et leur lieu de travail. Au fil des décennies, j’ai quelque peu délaissé l’histoire quantitative, comme la majorité de mes collègues. Je ne vois cependant aucune raison de ne pas combiner les données quantitatives et qualitatives, en autant que les mots et les nombres soient soumis à une critique rigoureuse.
L’héritage de E.P. Thompson a joué un rôle essentiel dans l’élaboration de cette approche[7], tout comme celui de l’École des Annales, qui avait pour idéal l’histoire totale. J’ai été particulièrement influencée par l’ouvrage de Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe – XVIIIe siècle, qui étudie les relations entre le capitalisme, la consommation et l’histoire de la culture matérielle.
Intéressée par l’histoire française, j’ai fréquenté très tôt les écrits de Michel Foucault au sein de cercles d’études, et ce pendant les dix années qui ont suivi l’obtention de mon doctorat. À la fin des années 1980, le théoricien français du jour a été délogé par Pierre Bourdieu, qui développait alors ses théories par rapport au capital social et culturel. Bourdieu demeure encore le théoricien le plus important pour moi. Ses théories m’ont permis de mieux comprendre l’importance du goût chez les femmes bourgeoises, aussi bien en ce qui a trait à leur apparence personnelle qu’à la décoration intérieure de leur demeure. Elles m’ont été essentielles dans la réalisation de ma dernière monographie qui porte sur la mode française. Mais en voilà assez en ce qui concerne les théoriciens français, puisque j’ai promis ne pas trop en parler. Je tiens seulement à souligner qu’une bonne partie de notre formation théorique nous est venue d’activités parascolaires. Disons que nous ne nous sommes pas limités à étudier entre les murs du monde universitaire.
Je reconnais tout à fait le lien entre mes intérêts de recherche et mon militantisme anti-militariste et pro-liberté d’expression qui m’animait durant les long sixties. On a rarement parlé de l’activisme de gauche présent à la University of Alberta à Calgary dans les livres d’histoire. J’aimerais toutefois rappeler que c’est précisément là où j’ai commencé à prendre part à des manifestations – une activité que j’ai poursuivie pendant quarante ans. J’ai d’abord participé à une petite manifestation contre la guerre du Vietnam, puis à une plus grande contre l’université et d’autres établissements locaux qui avaient refusé d’accueillir la San Francisco Mime Troupe, une troupe de comédiens afro-américains jugée subversive. À Columbia, j’ai continué à manifester publiquement contre la guerre du Vietnam. J’étais parmi les étudiantes et les étudiants qui ont occupé Columbia en 1968 pour décrier son engagement dans la guerre. C’est en observant la réaction de la police de New York face aux manifestants, qui a tourné en une émeute policière, que j’ai compris la place centrale occupée par la classe sociale dans la rage des policiers envers la jeunesse privilégiée. Je me trouvais derrière une barricade, mais cette dernière ne correspondait pas à l’image que j’avais de celles des révolutions françaises. J’ai dû repenser mes naïves hypothèses selon lesquelles une barricade est nécessairement une barrière matérielle érigée par des radicaux de gauche.
Après l’occupation étudiante, j’ai aidé à concerter les efforts des responsables de l’entretien à Columbia ainsi qu’à l’hôpital voisin, St. Paul. En prenant connaissance de la couverture médiatique de l’occupation de l’université, qui en disait peu au sujet de l’émeute policière et qui ne faisait guère référence aux efforts déployés par les étudiants pour aider les employés de soutien à s’organiser, j’ai mieux saisi les limites inhérentes à l’idée voulant que « All the news fit to print » (Toutes les nouvelles méritent d’être imprimées). Cette leçon m’a été fort utile par la suite. Je dis toujours à mes étudiantes et mes étudiants dans mon cours d’historiographie de ne pas trop se fier aux sources imprimées et de soigneusement critiquer toutes les sources pour repérer les préconceptions des auteurs et leurs partis pris.
Tout au long des années 1980, j’ai continué à participer à des manifestations anti-militaristes et pacifistes ainsi qu’à soutenir les grévistes à Simon Fraser University, où j’ai commencé à enseigner en 1977. Je crois que ce militantisme a contribué à façonner et à améliorer mes travaux, en particulier le livre que j’ai publié en1983 sur la législation du travail selon le genre en France. Certains de mes collègues déclarent avoir également tiré profit de leur engagement politique et social.
Au Canada, durant les années qui ont précédé 1968, l’Union des étudiants pour la paix a activement participé aux manifestations anti-militaristes et à l’organisation communautaire. Les Students for a Democratic University ont, quant à eux, occupé des universités en 1969. Je serais portée à croire que ces expériences générationnelles ont, elles aussi, eu une influence sur la pratique de ceux qui sont devenus historiens. Pour des femmes comme moi, la publication de Political Economy of Women’s Liberation de Maggie Benston a été d’une grande importance. J’ai d’ailleurs été ravie de joindre le programme d’études féministes de Simon Fraser University en 1977, puisque Maggie y était. Ce n’est toutefois que dans le cadre de mon projet de recherche actuel, qui comprend une analyse du contenu des chroniques et des lettres aux éditeurs publiées dans les pages réservées aux femmes des journaux français, que j’ai commencé à tirer profit de ses idées au sujet du travail non rémunéré des femmes.
C’est un séminaire d’études supérieures en histoire, hors campus et non crédité, qui a entraîné ma conversion à l’histoire des femmes. Donné à New York et dirigé par des pionnières de l’histoire des femmes telles que Gerda Lerner et Joan Kelly Gadol, ce cours a été le plus exigeant et le plus gratifiant de ceux auxquels j’ai participé. En effet, nous devions toutes consacrer beaucoup de temps à la recherche de documents difficilement accessibles et nous présenter à chaque séance prêtes à débattre nos interprétations par rapport à nos dernières trouvailles. À ceux qui dénigrent cette période dans le développement de l’histoire des femmes et la considèrent comme ayant été marquée par un simple rattrapage sans fondement théorique, je répondrai que s’il est vrai que nous cherchions partout pour trouver des documents et des sources secondaires, il est faux de dire que nous n’utilisions pas d’ouvrages théoriques. Pour ma part, j’ai grandement puisé dans le Deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui présente des notions utiles au sujet de la situation des femmes et de la contingence historique.
Nous explorions un domaine pratiquement inconnu. Je dis pratiquement inconnu, car nous avons vite fait de découvrir qu’une génération d’historiennes nous avait précédées et qu’elle avait produit d’excellentes études sur les femmes qui nous avaient échappé. Leurs travaux n’avaient été référés en effet dans aucun cours et n’avaient été intégrés dans aucune bibliographie destinée aux examens de synthèse. Je sais que d’autres historiens intéressés par des sujets novateurs, qu’ils croyaient non étudiés, ont aussi découvert des prédécesseurs exclus de l’historiographie.
Lors des négociations marathon avec le comité du programme d’études du département d’histoire à Columbia, nous avons lutté pour obtenir l’inclusion des femmes dans les cours de civilisation occidentale. Bien que les historiens aient alors tenu un discours progressiste, ils situaient encore les femmes hors de l’histoire. Par conséquent, ces dernières jouaient à peine un rôle de figurantes dans les cours d’histoire. Celles qui y apparaissaient étaient considérées comme exceptionnelles. Quant aux rares allusions à la féminité, elles renvoyaient à quelque chose d’éternel ou niaient l’idée de progrès en histoire. La plupart d’entre nous refusaient de mettre l’accent sur les femmes « exceptionnelles » ou d’accepter la notion de l’éternel féminin[8]. Nous traitions de l’essentialisme, sans en avoir le vocabulaire. Nous nous heurtions à nouveau à la question de la continuité et du changement, traduite cette fois par un conflit entre la structure patriarcale et l’autonomie des femmes[9]. Des années ont été nécessaires au développement d’une compréhension plus souple du patriarcat, ou plutôt des différents concepts de patriarcat, compris comme un agencement d’idées sur la coexistence de certaines structures et d’une certaine agentivité.
Nous cherchions à combler le besoin de développer plusieurs histoires. Une seule ne suffisait pas. (Nous ne connaissions pas encore le terme « master narrative »). Nous avons connu la peur de la pluralité qui, encore aujourd’hui, limite notre capacité à construire une histoire plus inclusive, une peur qui a pratiquement mené à l’exclusion des femmes dans le grand récit national récemment imposé aux Pays-Bas[10]. D’autres groupes exclus ont eux aussi rencontré une résistance lorsqu’ils ont réclamé une histoire plus représentative. Couvrir l’histoire plus largement est à mon sens un développement positif, même si l’existence de multiples histoires soulève des inquiétudes quant à la fragmentation de la connaissance historique. En incluant la diversité dans les cours d’introduction et en exigeant que soient explorées différentes formes d’histoire dans le cadre d’un baccalauréat en histoire, les programmes d’études répondent à certaines de ces préoccupations.
Comme étudiante, j’ai eu la chance de côtoyer des femmes professeures d’histoire dans le cadre d’un cours d’histoire des femmes hors programme. Leur enthousiasme et leur rigueur intellectuelle m’inspirent encore aujourd’hui. Plusieurs d’entre elles enseignent toujours l’histoire des femmes ou les études féministes. Pendant vingt-huit ans, j’ai détenu une nomination conjointe en histoire et en études féministes. Je travaille présentement à temps plein au département qui s’appelle depuis peu Department of Gender, Sexuality and Women’s Studies (département d’études des femmes, du genre et de la sexualité) à Simon Fraser University. Au cours de mes trente-huit années d’enseignement, j’ai essayé de recréer le pur plaisir d’apprendre que j’avais connu dans ce séminaire. Et certains de mes étudiantes et étudiants ont expérimenté cette joie de la découverte lorsque les frontières de la recherche historique se sont ouvertes devant eux sur des sujets qui leur étaient inconnus auparavant, tels que les gens de couleurs, les personnes handicapées, les gais et les lesbiennes, puis la communauté transgenre.
Le mouvement féministe a également attisé mon intérêt pour l’histoire des femmes. Lors de la campagne sur l’avortement dans l’État de New York, j’ai commencé à assister, à Columbia, à ce qui allait s’appeler des séances de conscientisation. L’important groupe d’universitaires que nous formions, et qui incluait des sommités féministes comme Kate Millet et Ti-Grace Atkinson, se concentrait toutefois essentiellement sur des questions pratiques. Par exemple, nous voulions disposer de plus de toilettes pour femmes (ou, lorsque nous n’y arrivions pas, libérer celles des hommes), pouvoir se procurer des contraceptifs oraux (et prendre d’assaut le centre de santé des étudiants quand nous n’étions pas entendues), et obtenir ce qui est devenu la première unité spéciale de la police pour les crimes sexuels.
Mon intérêt pour l’histoire des femmes s’est encore davantage accru quand j’ai commencé à enseigner. Je me suis rendu compte que l’histoire, comme discipline, était grandement influencée par le genre. Si tel était le cas, c’était à cause de la prédominance des hommes dans les départements d’histoire. J’ai obtenu mon premier emploi à Smith College, à Northampton au Massachusetts. Il s’agissait d’un collège pour femmes. J’ai été heureuse de constater à mon arrivée au département d’histoire que nous étions trois femmes pour onze hommes. J’ai toutefois vite compris qu’il y avait des barrières informelles entre les hommes et les femmes que je n’avais pas imaginées. La plus ironique et la plus frustrante de toutes était certainement l’opposition de mes collègues à l’enseignement de l’histoire des femmes, dans un collège pour femmes. Heureusement, d’anciennes étudiantes influentes (ou de généreuses donatrices) ont fait pression pour que le département offre au moins un cours en histoire des femmes dans le cadre du centenaire du collège en 1975. À mon arrivée au département d’histoire à Simon Fraser en 1977, il était devenu acceptable d’enseigner l’histoire des femmes. Il est intéressant de noter que les deux premières femmes occupant des postes menant à la permanence – la seconde étant Nikki Strong-Boag, qui a déjà été présidente de la SHC – détenaient des nominations conjointes en histoire et en études féministes. Pendant quinze ans, j’ai été l’une des deux seules femmes d’un département comptant vingt-huit professeurs permanents ou en voie de l’être. Pour plusieurs de mes collègues, la présence de deux femmes au sein du corps professoral au département d’histoire suffisait amplement, comme l’a révélé la résistance à laquelle nous nous sommes heurtées lorsque nous avons essayé de convaincre le département d’embaucher d’autres femmes prometteuses. Certains ont cherché à empêcher l’embauche de femmes, même une fois la brèche faite. Ces attitudes et ces luttes ont persisté jusqu’au début des années 1990, au moment où quelques femmes ont été recrutées. Il n’y a eu rien de naturel dans l’embauche de plusieurs autres femmes par la suite.
Entre-temps, j’ai tiré avantage du caractère interdisciplinaire des études féministes, notamment lorsque j’ai écrit mon livre sur l’histoire des vêtements féminins modernes. J’ai alors eu recours à l’anthropologie symbolique pour révéler le sens de la mode ainsi que pour éclairer l’économie politique de l’industrie de la couture durant l’entre-deux-guerres en France. À la fin des années 1980, j’ai participé à la création de l’Academic Women, à SFU, un organisme visant à regrouper les femmes membres du corps professoral, dont plusieurs se sentaient isolées dans leur département respectif. Nous avons fait pression et réussi à obtenir l’embauche d’un agent en matière d’équité en emploi. Nous avons aussi obtenu l’examen de la question de l’équité salariale. Nous avons assisté à nos présentations respectives, ce qui a ouvert nos horizons et enrichi nos travaux. Pour reprendre la métaphore du début, nous avons tiré profit de la possibilité de traverser les frontières entre les disciplines. D’autres institutions multidisciplinaires visent le même objectif.
Le titre de mon discours, « Historiennes et historiens sans frontières », reflète aussi mon projet de recherche actuel sur le rôle du genre dans le journalisme de l’entre-deux-guerres en France, une histoire qui combine une approche sociologique de la carrière de journaliste à une approche linguistique du style journalistique français. Comme c’est souvent le cas avec l’histoire du genre, il s’agit d’une histoire à la fois sociale et culturelle, quoi qu’en aient pensé les polémistes des deux camps qui soutenaient l’incompatibilité entre les deux approches dans les années 1980 et 1990[11]. Après une controverse qui a duré plus d’une décennie au sujet de la théorie et des méthodes en histoire, je suis devenue, à l’instar de plusieurs de mes contemporains, plus souple à leur égard.
Dans ce projet, je compare le style d’écriture et la carrière de deux des sept femmes qui ont atteint le sommet du journalisme national à ceux de deux de leurs collègues masculins, sur une quarantaine possible. J’entends vérifier l’affirmation des historiens qui ont étudié les femmes et le journalisme américain et qui ont prétendu que les femmes ont réussi à faire la première page parce que leur style féminin, c’est-à-dire à la fois personnel, sensationnaliste et sentimental, convenait à un lectorat de masse[12]. Selon mes hypothèses, le style d’écriture des femmes françaises, dont les textes étaient publiés à la une, était très semblable à celui des hommes : tous les journalistes, qu’ils aient été hommes ou femmes, inséraient leurs propres opinions dans leurs articles et exploitaient régulièrement des sujets sensationnels. D’autres recherches récentes tendent à confirmer ces hypothèses.
La question pour l’instant est la suivante : Comment ce projet a-t-il pu engendrer le titre « Historiennes et historiens sans frontières »? Il est clair que mes recherches actuelles démantèleront les frontières supposées entre les hommes et les femmes ou, du moins, mineront l’idée voulant que leur style d’écriture ait varié selon le fait qu’ils aient été hommes ou femmes. Je m’inspire en cela des récentes tendances en études du genre, en traitant le genre comme une question, non pas comme une catégorie, de l’analyse historique[13].
Puisque les journalistes que j’étudie ont examiné et écrit sur différents pays et continents, je suis en train de devenir une « historienne sans frontières nationales ». Comme tous ces journalistes ont écrit des séries d’articles et des livres sur les colonies françaises, j’ai été amenée à étudier leurs interprétations par rapport à ces colonies, celles de leurs contemporains et celles des historiens, ainsi qu’à examiner à fond les théories postcoloniales afin de voir s’il était possible de les appliquer aux reportages concernant ces colonies. Dans le cadre de mes recherches, j’essaie de découvrir si le racisme de mes journalistes était lié à leur expérience professionnelle comme hommes et femmes. En procédant de la sorte, je m’engage dans une analyse croisée qui examine les chevauchements entre le genre, la race et la classe[14], une méthode que plusieurs historiens ont empruntée aux études féministes et aux études du genre.
En outre, Andrée Viollis, une de mes journalistes, a réalisé deux séries d’articles et trois livres sur la Chine et le Japon. Ses voyages en Asie s’expliquent par la carrière de conservateur d’art chinois de son deuxième mari. Ses différentes réactions face aux deux pays ont été interprétées comme des manifestations de la peur occidentale face à l’impérialisme japonais. Or, cette explication n’est pas adéquate. Afin de comprendre la réaction de Viollis face à l’autoritarisme militariste au Japon, qu’elle a présenté comme fasciste, je dois non seulement analyser ses reportages, mais aussi ses écrits sur l’Allemagne nazie. Je dois également relire les travaux embryonnaires sur l’orientalisme et me plonger dans l’histoire conflictuelle des relations sino-japonaises durant ce qu’on appelle, de toute évidence à tort, l’entre-deux-guerres. En conséquence, je saute par-dessus les barrières intra-disciplinaires et je mets en doute l’utilité de la périodisation eurocentrique. Comme d’autres membres de ma génération, je me suis ralliée à la position de la nouvelle génération d’historiennes et d’historiens.
On aurait pu s’attendre à ce que les historiens européens déstabilisent plus directement les grands récits d’histoire nationale, plutôt que de le faire grâce à la prolifération d’études de villages et de régions particulières. D’autant plus que le bilan du nationalisme, souvent associé au racisme et à la guerre en Europe, est triste. Toutefois, hormis les historiens économiques et les spécialistes en relations internationales, peu d’historiens ont écrit des histoires véritablement européennes. Les histoires transnationales de l’Europe sont non seulement rares, mais leur réalisation est difficile étant donné, par exemple, les écarts dans la périodisation (par exemple, l’histoire contemporaine débute au moment de la Révolution française dans les pays de l’Europe de l’Ouest, mais avec la Première Guerre mondiale dans ceux de l’Europe de l’Est). Ceux qui sont à la recherche d’une méthode rejettent dans un premier temps les discours essentialistes, pensons par exemple à l’idée d’un patrimoine commun issu des Lumières, et se tournent vers une véritable histoire transnationale, qui met l’accent sur l’interdépendance et les transferts entre les nations et d’autres entités. Les meilleurs insistent sur l’existence de plusieurs histoires et sur ce que les Français appellent l’histoire croisée, c’est-à-dire sur l’étude des échanges et des transferts dans une perspective multidirectionnelle[15].
Certains historiens européens ont évidemment produit des travaux d’histoire transnationale. Natalie Zemon Davis, qui a remporté le prix international Holberg 2010 pour son travail exceptionnel en arts et sciences humaines, en est un excellent exemple. Je ne peux m’abstenir de mentionner que, même si elle a commencé sa carrière comme historienne française, elle ne s’est pas limitée aux traditions nationales ou aux pratiques disciplinaires conventionnelles. Comme elle l’a expliqué au cours de l’entrevue entourant le prix Holberg, ses « recherches s’étendent de la France moderne et de l’Europe de l’Ouest à l’Afrique du Nord et aux Caraïbes et couvrent aussi bien les conflits sociaux et religieux que les échanges de cadeaux, la narration et les festivités. Mais tout au long de mon travail, je me suis surtout penchée sur l’histoire des travailleurs – artisans, paysans, et maintenant esclaves – ainsi que sur l’histoire des femmes en plus de celle des hommes. J’ai essayé de retrouver leurs voix et leurs visions du monde et de les considérer non pas comme de simples victimes de l’oppression, mais bien comme des agents trouvant des façons de survivre, d’improviser, et même de résister. J’ai tenté d’écrire une histoire décentrée où ce qui arrive dans un atelier de femmes, dans la hutte d’un villageois ou chez un imprimeur a autant d’importance que les décisions prises au Conseil du roi ou lors d’une réunion de la Faculté de théologie. J’ai cherché à écrire une histoire pluraliste, où les pauvres sont présents comme les riches, où les juifs et les musulmans ont leur place aux côtés des catholiques, des protestants et d’autres chrétiens »[16]. Peu parmi nous peuvent aspirer à couvrir un éventail aussi large de sujets, mais nous pouvons nous inspirer de son exemple et de sa façon de voir des liens entre les histoires locales et le reste du monde, entre les gens ordinaires et les événements historiques.
Pour conclure, j’aimerais expliquer un peu la relation entre ce que je viens d’exposer, l’histoire du Canada et la SHC.
Je crois que les historiennes et les historiens du Canada écrivent une histoire sans frontières de façon exemplaire. Deux prix décernés récemment pour des livres en histoire canadienne le montrent bien. Béatrice Craig a remporté le prix Sir John A. Macdonald 2010 pour son ouvrage Backwoods Consumers and Homespun Capitalists: The Rise of a Market Culture in Eastern Canada[17], une micro-histoire d’une région isolée qui établit des rapports entre les marchés local et international et remet en question les idées reçues sur le capitalisme dans les régions rurales. John Lutz, un membre du conseil de la Société historique du Canada, est pour sa part lauréat du prix Harold Adams Innis 2010 pour le meilleur ouvrage en langue anglaise dans le domaine des sciences sociales, soit Makuk: A New History of Aboriginal-White Relations. Il s’agit également d’une micro-histoire mais qui, cette fois, porte sur deux peuples autochtones, les Tsilhqot’in et les Straits Salish de la Colombie-Britannique, les différentes façons dont ils ont réagi face au colonialisme européen et l’effet qu’a eu sur eux la construction euro-américaine de l’Indien « paresseux » et qui « disparaît »[18].
Avant de terminer, j’aimerais aussi mentionner mes lectures continues sur l’histoire des femmes au Canada et mes efforts sporadiques pour me maintenir à jour en histoire du travail au Canada. Comme je n’arrive pas à suivre tout ce qui se fait en recherche sur l’histoire canadienne, je demande souvent à des collègues spécialistes en histoire environnementale, autochtone et de l’Ouest canadien, de me suggérer des études récentes. Je remercie tous ceux qui ont répondu à l’appel jusqu’à maintenant. J’ai également consulté les programmes des dernières réunions annuelles ainsi que les articles qui en sont issus et j’ai assisté à autant de séances que possible au cours des quatre dernières réunions.
Les historiennes et les historiens canadiens sont bien positionnés au sein de la profession historique, transformée et désormais plus interdisciplinaire et internationale, pour plusieurs raisons. Premièrement, l’absence d’un grand récit propre à l’histoire nationale constitue un avantage. Les historiens n’ont pas à investir trop d’énergie pour déstabiliser un récit national ou devrais-je dire, puisque nous sommes au Canada, plusieurs récits nationaux forts et bien enracinés. Deuxièmement, la recherche en histoire canadienne a prospéré depuis les long sixties. Elle a su tirer profit des méthodes issues d’autres disciplines. Troisièmement, la plupart des Canadiens étant des immigrants ou des descendants de colonisateurs, une partie de la recherche historique au Canada consiste à étudier la provenance des gens et ce qu’ils ont apporté avec eux. Étant donné la diversité qui caractérise le pays, l’histoire canadienne doit explorer différents héritages culturels ainsi que la façon dont ils se mêlent au paysage culturel, se laissent transformer par lui et l’enrichissent.
Finalement, la SHC a le mandat de représenter toutes les historiennes et les historiens du pays. Pour atteindre cet objectif, elle doit travailler consciencieusement à rejoindre et à inclure celles et ceux qui ne sont pas des spécialistes du Canada. Elle organise donc des séances comparatives lors des réunions annuelles, inclut des articles prometteurs dans la Revue de la Société historique du Canada et élit des présidents dont la spécialisation n’est pas le Canada. Ma participation au conseil et aux réunions annuelles a été très inspirante. J’espère avoir la chance d’assister à plus de séances et de me joindre au groupe d’histoire des nouveaux médias à l’avenir. J’espère également que vous serez présents à ces séances.
Parties annexes
Biographical note
MARY LYNN STEWART is a professor in the Department of Gender, Sexuality, and Women’s Studies at Simon Fraser University. She is the author of Dressing Modern Frenchwomen: Marketing Haute Couture, 1919-1939 and For Health and Beauty: Physical Culture for Frenchwomen, 1880’s- 1930’s.
Notes
-
[1]
Joan Wallach Scott, “History in Crisis: The Other Side of the Story,” The American Historical Review, 94, 3 (1989).
-
[2]
Brian D. Palmer, Canada’s 1960s. The Ironies of Identity in a Rebellious Era (Toronto: University of Toronto Press, 2009)
-
[3]
Table 2 University enrolments by field of study and gender, University Enrolment, The Daily, Statistics Canada, July 14th, 2010. http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/100714/dq100714a-eng.htm, and Table 2, Percentage of women and rate of change in the percentage of women and total number of faculty by principal subject taught by year, in Michael Ornstein, P. Stewart and J. Drakich, “The Status of Women Faculty in Canadian Universities,” Education Quarterly Review, 1998.
-
[4]
Lesley Andres and Mari Adamuti-Trache, “You’ve Come a Long Way, Baby? Persistent Gender Inequality in University Enrolment and Completion in Canada, 1979–2004,” Canadian Public Policy, 33, 1 (March 2007).
-
[5]
Marc Frenette, Why Are Youth from Lower-income Families Less Likely to Attend University? Evidence from Academic Abilities, Parental Influences, and Financial Constraints (Statistics Canada, Business and Labour Market Analysis, 2007) puts more emphasis on familial attitudes toward education and practical matters such as distance from universities, than on financial limits per se. He did not study the influence of gender.
-
[6]
History from below. Studies in popular protest and popular ideology. Ed. Frederick Krantz. (Oxford: Basil Blackwell, c1988).
-
[7]
W.H. Sewell, Logics of History : Social Theory and Social Transformation (Chicago: University of Chicago Press, 2005) p. 31.
-
[8]
Sylvia Paletschek, “Opening up Narrow Boundaries: Memory Culture, Historiography and Excluded Histories from a Gendered Perspective,” in Gendering Historiography. Beyond National Canons, ed. Angelika Epple, Angelika Schaser (Frankfurt: Campus Verlag, 2009), p. 168.
-
[9]
Judith M. Bennett, History Matters. Patriarchy and the Challenge of Feminism (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006) pp. 68 and 129.
-
[10]
“Introduction. Multiple Histories? Changing Perspectives on Modern Historiography,” and Maria Grever, “Fear of Plurality: Historical Culture and Historiographical Canonization in Western Europe,” in Epple and Schaser.
-
[11]
Laura Lee Downs, Writing Gender History (London: Hodder Arnold, 2004).
-
[12]
Jean M. Lutes, Front-page girls: Women journalists in American culture and fiction, 1880-1930 (Ithaca: Cornell University Press, 2006).
-
[13]
Jean Boydston, “Gender as a Question of Historical Analysis,” Gender and History, 20, 3 (November 2008), but see also Joan Wallach Scott, ‘Gender: A Useful Category of Historical Analysis’, American Historical Review 91 (1986), and “Gender: Still a Useful Category of Analysis?” Diogenes, 57, 1 (2010).
-
[14]
Chandra Talpede Mohanty “Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses,” Feminist Review, 30 (1988), pp. 61–88.
-
[15]
Conflicted Memories. Europeanizing Contemporary Histories, edited by Konrad H. Jarausch and Thomas Lindenberger in collaboration with Annelie Ramsbrock (New York/Oxford: Berghahn Books, 2007).
- [16]
-
[17]
Beatrice Craig, Backwoods Consumers and Homespun Capitalists. The Rise of a Market Culture in Eastern Canada (Toronto: University of Toronto Press, 2009)
-
[18]
John Lutz, Makuk, A New History of Aboriginal-White Relations (Vancouver: UBC Press, 2008)
Parties annexes
Note biographique
MARY LYNN STEWART est professeure au département Gender, Sexuality, and Women’s Studies de Simon Fraser University. Elle est l’auteure de Dressing Modern Frenchwomen: Marketing Haute Couture, 1919-1939 et For Health and Beauty: Physical Culture for Frenchwomen, 1880’s- 1930 ‘s.
Notes
-
[1]
Joan Wallach Scott. « History in Crisis: The Others’ Side of the Story », American Historical Review, vol. 94, no 3 (1989): 680-692.
-
[2]
Brian D. Palmer, Canada’s 1960s: The Ironies of Identity in a Rebellious Era, Toronto, University of Toronto Press, 2009.
-
[3]
Tableau 2, Effectifs universitaires selon le domaine d’études et le sexe, Effectifs universitaires, Le Quotidien, Statistique Canada, 14 juillet 2010, http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/100714/dq100714a-fra.htm, et Tableau 2, Pourcentage de femmes et taux de variation du pourcentage de femmes et nombre total d’enseignants selon la principale matière enseignée et selon l’année, dans Michael Ornstein, P. Stewart et J. Drakich, « Situation du corps professoral féminin dans les universités canadiennes », Revue trimestrielle de l’éducation, vol. 5, no 2 (1998) : 9-29.
-
[4]
Lesley Andres et Mari Adamuti-Trache, « You’ve Come a Long Way, Baby? Persistent Gender Inequality in University Enrolment and Completion in Canada, 1979–2004 », Canadian Public Policy, vol. 33, no 1 (mars 2007).
-
[5]
Marc Frenette, Pourquoi les jeunes provenant de familles à plus faible revenu sont-ils moins susceptibles de fréquenter l’université? Analyse fondée sur les aptitudes aux études, l’influence des parents et les contraintes financières, Statistique Canada, Division de l’analyse des entreprises et du marché du travail, 2007. L’auteur met davantage l’accent sur l’attitude des familles envers l’éducation et sur les aspects pratiques comme la distance des universités que sur les limites financières en soi. Il n’a pas étudié l’influence du genre.
-
[6]
Frederick Krantz, ed., History from Below: Studies in Popular Protest and Popular Ideology, Oxford, Basil Blackwell, 1988.
-
[7]
W.H. Sewell, Logics of History: Social Theory and Social Transformation, Chicago, University of Chicago Press, 2005, p. 31.
-
[8]
Sylvia Paletschek, « Opening up Narrow Boundaries: Memory Culture, Historiography and Excluded Histories from a Gendered Perspective », dans Angelika Epple et Angelika Schaser, dir., Gendering Historiography: Beyond National Canons, Frankfurt, Campus Verlag, 2009, p. 168.
-
[9]
Judith M. Bennett, History Matters: Patriarchy and the Challenge of Feminism, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2006, p. 68 et 129.
-
[10]
Angelika Epple et Angelika Schaser « Introduction: Multiple Histories? Changing Perspectives on Modern Historiography » et Maria Grever, « Fear of Plurality: Historical Culture and Historiographical Canonization in Western Europe », dans Epple et Schaser, Gendering Historiography.
-
[11]
Laura Lee Downs, Writing Gender History, London, Hodder Arnold, 2004.
-
[12]
Jean M. Lutes, Front-Page Girls: Women Journalists in American Culture and Fiction, 1880-1930, Ithaca, Cornell University Press, 2006.
-
[13]
Jeanne Boydston, « Gender as a Question of Historical Analysis », Gender and History, vol. 20, no 3 (novembre 2008): 558-583. Voir aussi Joan Wallach Scott, « Gender: A Useful Category of Historical Analysis », American Historical Review, vol. 91, no 5 (1986): 1053-1075, et « Gender: Still a Useful Category of Analysis? », Diogenes, vol. 57, no 1 (2010): 7-14.
-
[14]
Chandra Talpede Mohanty, « Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses », Feminist Review, vol. 30 (1988): 61–88.
-
[15]
Konrad H. Jarausch et Thomas Lindenberger, dir., avec la collaboration de Annelie Ramsbrock, Conflicted Memories. Europeanizing Contemporary Histories, New York/Oxford, Berghahn Books, 2007.
- [16]
-
[17]
Béatrice Craig, Backwoods Consumers and Homespun Capitalists: The Rise of a Market Culture in Eastern Canada, Toronto, University of Toronto Press, 2009.
-
[18]
John Lutz, Makuk: A New History of Aboriginal-White Relations, Vancouver, UBC Press, 2008.