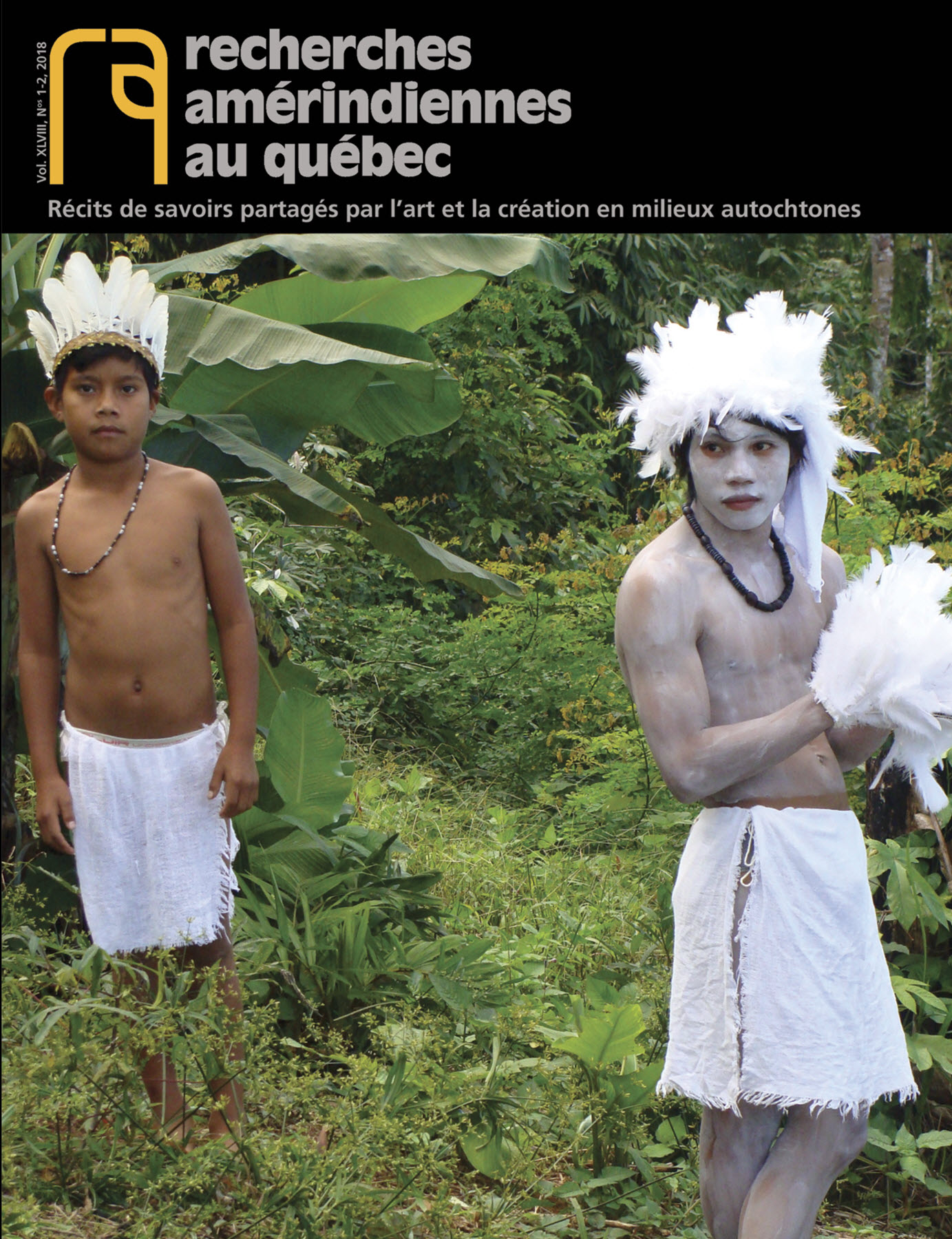Corps de l’article
À l’occasion de l’ouverture de l’exposition Lignes de vie. Art contemporain des autochtones d’Australie (21 octobre 2015 au 5 septembre 2016), le Musée de la civilisation de Québec, sous l’initiative de Jean Tanguay et de Françoise Dussart[1], a organisé les 19 et 22 octobre 2015 un séminaire ayant pour titre Créativité et muséologie autochtone. Dialogue entre conservateurs-artistes[2] autochtones d’Australie et du Québec. Cette activité visait à susciter un échange entre autochtones québécois et australiens sur le rôle des conservateurs autochtones et le contexte dans lequel ils évoluent.
Il existe très peu d’écrits sur la réalité de ces conservateurs et il nous semblait opportun d’organiser cette rencontre dans le but de permettre les échanges, les partages d’expériences et d’éventuels réseautages autour de projets communs. Ce séminaire offrait également une occasion de développement professionnel en plus de favoriser l’ouverture aux autres dans un contexte de mondialisation. Les participants ont pu partager et comparer leurs expériences pratiques en muséologie, soit en contexte de musées nationaux ou encore de centres culturels autochtones. Plus largement, cette rencontre a été l’occasion de poser un regard sur le rapport actuel entre la muséologie et les peuples autochtones.
Il est intéressant de souligner que ce séminaire s’est déroulé plus de vingt-cinq ans après la rencontre « Préserver notre héritage : une conférence de travail entre les Musées et les Premières Nations » (1988) qui, de nos jours, est considérée comme un événement phare associé au développement de la muséologie autochtone canadienne car elle allait permettre à des participants autochtones et à des muséologues de définir ensemble ce qui favoriserait un véritable partenariat entre les Musées et les Premières Nations. C’est au terme de cette rencontre que fut créé le groupe de travail sur les Musées et les Premières Nations, composé de vingt-cinq individus, incluant plusieurs aînés autochtones. L’exercice comportait des consultations régionales, de même que la réception de nombreuses recommandations d’organismes et individus et des échanges menés lors de quatre réunions nationales du groupe de travail. Le rapport Tourner la page : Forger de nouveaux partenariats entre les Musées et les Premières Nations[3] qui en résulta expose les enjeux et recommandations issus de cet exercice. Aux fins de ce compte rendu, retenons les éléments suivants :
1) une participation accrue des Premières Nations au travail des Musées est essentielle pour améliorer la représentation et l’interprétation de leur histoire et de leur culture ;
2) l’incorporation des Premières Nations aux équipes des musées aiderait à éduquer et à sensibiliser le personnel aux perspectives et aux philosophies autochtones aussi bien qu’aux intérêts des communautés autochtones.
Aux cours des années qui suivirent le dépôt du rapport, les recommandations incitèrent effectivement beaucoup d’institutions muséales à tourner la page et à laisser place à une participation plus grande des autochtones à leurs projets. Un certain nombre d’entre eux furent engagés comme employés au sein de ces institutions. Une nouvelle approche participative allait ainsi mener à quelques initiatives notables au Canada et en d’autres lieux à travers la planète. Pensons aux processus collaboratifs qui ont mené à la réalisation d’expositions à thématiques autochtones telles que Niitsitapiisini: Our Way of Life au Glenbow Museum de Calgary (2001), Native voice au National Museum of the American Indian à Washington (2004), First Peoples au Bunjilaka Gallery, Melbourne Museum (2013), Porter son identité – La collection Premiers Peuples au Musée McCord de Montréal (2012) ou, récemment, C’est notre histoire : Premières Nations et Inuit au xxie siècle au Musée de la civilisation de Québec (2013).
Au regard de ces initiatives, qu’en est-il aujourd’hui de la muséologie autochtone ? Avons-nous réussi à créer une véritable muséologie collaborative qui soit émancipatrice pour les Premiers Peuples ? Le présent compte rendu rapporte les propos tenus autour de ces questions par les conservateurs et artistes autochtones oeuvrant dans le contexte muséal. Il ne s’agit pas de faire ici une analyse exhaustive de l’état de la question en matière de muséologie autochtone mais de tenter de cerner où en sont ceux qui travaillent aujourd’hui dans ce domaine et quels sont leurs souhaits pour l’avenir.
Pendant les deux jours qu’a duré le séminaire, les participants ont pu débattre des questions suivantes. Comment conçoivent-ils leurs rôles en tant que conservateurs autochtones ? Comment conçoivent-ils l’intégration des arts des Premiers Peuples dans les musées ? Quelles devraient être les orientations prioritaires en muséologie quant à la mise en valeur du patrimoine artistique et culturel des Autochtones ? Nous terminerons ce compte rendu par le profil de l’avenir souhaité qui s’est construit au fil des discussions de ces conservateurs autochtones. Les trois sections suivantes rapportent, soit par des citations ou des résumés, les propos tenus par les participants autour de ces trois questions.
Comment percevez-vous votre rôle en tant que conservateur autochtone ?
Glenn Iseger-Pilkington (ci-après GIP) mentionne qu’il y a peu d’autochtones au sein des grandes institutions muséales et que c’est difficile pour lui de ne pas en faire une affaire personnelle. Depuis dix ans, il travaille dans des musées et galeries d’art et il a rencontré plusieurs défis et problèmes. Le grand musée australien dans lequel il évolue depuis quelques années repense présentement ses collections liées au Premiers Peuples. Il est le seul autochtone au sein de l’équipe de vingt-cinq personnes ayant ce mandat. Une des difficultés auxquelles il doit faire face est d’être un jeune homme et non un aîné, ce qui fait qu’il n’a aucune autorité au regard des autochtones australiens et qu’on lui remet tout de même cette responsabilité entre les mains. Sa situation s’avère d’autant plus délicate qu’il y a beaucoup d’aînés qui décèdent et que les institutions muséales sollicitent des représentants culturels plus jeunes qui ne se sentent pas légitimés de prendre position au nom de leur nation. Les connaissances sont ainsi non transmises, tenues dans le secret. Glenn essaie donc de rendre cette autorité aux bonnes personnes dans les communautés. Mais il doit tout de même répondre rapidement à ce besoin « d’expertise autochtone », puisque c’est souvent requis.
GIP soutient qu’un autre défi actuel est que les Musées reconnaissent que les autochtones ne soient plus uniquement représentés par les seuls objets des collections, mais soient aussi un « public cible » ; les Musées doivent dorénavant tenir compte de cet objectif dans leur mandat d’interprétation et de mise en valeur. Il a dû réfléchir sur la façon de travailler avec les nombreuses communautés autochtones. Dans le futur, un travail de réflexion avec l’équipe interne du musée, prévu sur une durée de six ans, devrait faire en sorte que les discours disciplinaires en regard des questions autochtones soient complémentaires et non dichotomiques entre vision autochtone et vision allochtone. Selon GIP, il est essentiel de démontrer la valeur des savoirs autochtones et faire en sorte que la présence de ce regard subsiste jusque dans les expositions ; que tous (incluant les équipes de production) y croient et aient à coeur cet objectif.
À la question « Votre institution vous donne-t-elle le pouvoir de parvenir à vos fins ? » GIP répond : « Beaucoup plus qu’avant, mais quand on travaille dans un milieu non autochtone, quand on nous donne du pouvoir, ce n’est jamais gratuit. Je crois que c’est la réalité pour tous les autochtones qui travaillent en situation minoritaire dans un milieu allochtone. » À son avis, le rôle du conservateur ne lui confère aucune autorité ; il amène les idées de la communauté au musée qui les considère. L’institution muséale ne devrait pas avoir d’ego et il en va de même du conservateur. Il doit agir en respect avec d’autres identités. À chaque tâche qu’il accomplit, le conservateur autochtone essaie d’être plus attentif à identifier ce qu’il veut réaliser et de tout faire afin d’y parvenir. Selon GIP cela est difficile dans de grandes institutions puisque les nouveaux conservateurs se voient rapidement confier de grandes responsabilités ; il suggère qu’on devrait plutôt y aller progressivement, pour permettre une meilleure adaptation. C’est un cercle vicieux pour les autochtones en milieu muséal : ils vivent un échec à un moment donné et n’ont pas eu le temps de s’outiller pour y faire face. Il n’y a pas de mode d’emploi, finalement. Cela amène des gens à être sévères envers eux-mêmes. Il n’y a pas d’espace pour développer un leadership, pour assurer des transitions, une continuité. Dans un milieu muséal, il n’y a pas de code éthique de travail avec les autochtones, à la longue il est difficile d’exister dans ce genre d’institution. Des contractuels autochtones peuvent graviter autour sans être dans l’institution, mais il faut aussi une présence permanente à l’interne. Dans la région où GIP travaille, grande comme l’Inde, il y a approximativement 90 dialectes et, en Australie, 600 différents groupes appartenant à six grands blocs culturels. Il croit qu’une des façons d’éviter les conflits entre ces groupes est de travailler à identifier les points de rencontre plutôt que de divergence. Il explique : « Il y a des histoires de création qui s’entrecoupent, d’autres qui se contredisent mais ont aussi des points communs. Quand je fais ma recherche, je me concentre sur les éléments communs et non distinctifs. »
Margot Neal (MN) croit pour sa part qu’elle a du pouvoir. Il y a trois ans, elle n’aurait pas pu en dire autant, en raison de l’administration en place dans son musée. Mais dix ans auparavant et plus récemment, elle a occupé des fonctions qui lui ont permis d’influencer les décisions ; elle ne se sent plus marginalisée. Au début, dix-sept personnes d’origine autochtone travaillaient dans son musée, puis ce nombre a baissé progressivement jusqu’à trois individus. MN précise que lors d’une consultation sur les orientations muséales, ils ont dû se mobiliser pour revendiquer une plus juste représentativité. Aujourd’hui, il y a treize autochtones au sein de son institution. Au départ, ces gens se voyaient octroyer des positions sans trop de pouvoir ; aujourd’hui il y en a à tous les niveaux : services éducatifs, conservation, administration, sécurité, etc.
Après ce témoignage, MN mentionne qu’aujourd’hui elle travaille dans le premier musée en Australie qui a pour vocation de montrer l’art des autochtones vu par les autochtones. Cela ne s’est pas fait sans difficulté puisque l’interprétation de l’histoire de l’Australie n’est pas la même pour les autochtones et pour les allochtones. Au début, les expositions ne présentaient qu’un discours colonialiste, mais avec le temps, à la suite de consultations, une place a été donnée à la parole autochtone. De l’avis de Judy Watson, lorsque ce musée était en construction, il y avait un premier ministre plutôt à droite, qui a refusé les politiques positives envers les autochtones pendant les quinze années où il a été au pouvoir. À l’époque, il y a eu de grosses discussions autour des budgets et de la résistance et protestation. MN renchérit :
Dès son ouverture, l’exposition actuelle a suscité beaucoup d’animosité chez les politiciens conservateurs et le gouvernement. Elle a été très contestée puisque, avant, l’histoire officielle de l’Australie racontait une colonisation pacifique. L’exposition raconte plutôt une histoire de massacre et c’est une exposition financée par le gouvernement, dans un musée d’État. C’est la première fois dans un espace public que des mots comme « guerre », « conflit », « massacre » étaient lus par les gens du public – qui n’ont pas bien réagi puisque les seules guerres auxquelles ils pouvaient penser, c’était les guerres mondiales officielles.
MN soutient que « la majorité de la population australienne s’en fout un peu (des autochtones) et que les histoires négatives les concernant sont très présentes dans les médias puisque 10 % des articles relatent de telles histoires. Ce qui fait qu’aujourd’hui la population est davantage conscientisée ».
Comment percevez-vous l’intégration des arts des Premiers Peuples dans les musées ?
Aux sous-questions « Comment travaillez-vous en tant qu’artistes dans le contexte muséal ? » et « Abordez-vous la conception d’une exposition de la même manière que la conception d’une oeuvre d’art ? » Christine Sioui Wawanoloath répond que, dans le cadre d’un projet sur le thème de la mort, sa sensibilité artistique l’a amenée à élargir la conception occidentale de la mort vers une vision autochtone où la mort n’est qu’une étape dans le cycle de la vie. Cela lui a permis de créer un design original dont elle est très fière. Par cette exposition, elle voulait exprimer que, « en tant que nations autochtones, nous avions nos propres vues sur la mort, la réincarnation, la vie spirituelle ». GIP ajoute que le fait d’être également un artiste l’amène à être sensible aux désirs des artistes. Pour lui, le rôle du conservateur consiste aussi à se « battre » avec les responsables du musée pour que les artistes et leurs travaux soient mis en valeur. Janine McAulley-Bott affirme que son art vise à faire comprendre ses peines aux autres, mais aussi aux siens, en cherchant à aider et à guérir. Ainsi, l’art est un médium à privilégier pour transmettre une façon différente d’être et permet l’expression des douleurs et des conflits, que les objets seuls n’expriment pas. Par ailleurs, cette volonté d’exprimer la différence culturelle (de voir, de savoir, de penser, de faire de la science) demande un traitement différent qui devrait influencer tous les secteurs des musées (collections, recherches, expositions) qui présentent les réalités autochtones.
Judy Watson (JW) soutient pour sa part que le musée est un endroit très important puisqu’elle peut y recueillir des savoirs sur sa propre culture et ainsi nourrir sa création. Dans l’établissement où elle travaille, l’art est un médium privilégié des expositions autochtones. Elle commente l’oeuvre L’annihilation des autochtones, de Fiona Foley, qui raconte le viol des femmes autochtones par les missionnaires : « Le comité organisateur a voulu évacuer cette oeuvre mais cet avis a été contredit par le Musée qui veut donner une voix à la diversité artistique de l’Australie, et non pas montrer uniquement des boomerangs. » Du point de vue de la conservation, cette oeuvre aurait dû être retirée durant trois ans mais, considérant son importance, JW s’est battue pour qu’elle reste en salle durant dix ans : « Mon objectif était également de montrer que nous n’allions pas plier devant les règles des conservateurs (non autochtones), qui ne cadrent pas avec nos priorités culturelles. »
L’art peut exprimer à la fois le mode de vie traditionnel et le contexte contemporain
GIP n’avait jamais cru devenir conservateur, considérant qu’il était d’abord un artiste. Mais en faisant sa recherche artistique, il dit avoir alors mesuré l’importance des relations entre les mots et les objets :
Voilà ce qui m’a amené à devenir conservateur, mon expérience artistique m’a forgé pour donner voix à l’objet et à l’artiste, pour le bien de la communauté et du territoire. Je pense que je suis un ambassadeur de ma culture à travers différents médiums que je peux utiliser : une installation, une peinture, des mots, le chant. J’ai une responsabilité de partager avec ma communauté, avec les gens, les jeunes. Je suis un artiste qui doit transmettre des connaissances à tous ceux qui veulent écouter. L’art est un outil de transmission, un témoignage laissé aux prochaines générations.
Pour GIP, un des apports que peut faire l’artiste à la muséologie est d’exprimer à la fois le mode de vie traditionnel et le contexte contemporain. Le musée est construit sur un territoire qui a une histoire mais où il y a aussi une spiritualité. Aujourd’hui, dans les communautés, les gens transmettent leurs valeurs et savoirs par le biais des écoles et des musées. Aussi lorsqu’il a un contenu à mettre en exposition, il se demande d’abord : « Quoi montrer, comment bien transmettre, de quelle façon, comment mettre en forme le discours ? »
Pour Jacques Newashish (JN) être atikamekw vient avec des règles culturelles qui dictent quoi montrer et comment le montrer. Parfois, il faut pouvoir aller plus loin que ces règles pour arriver à transmettre des valeurs et connaissances. Les gens sont plus réceptifs au langage artistique, qui permet plus facilement de transgresser ces règles. JN dit alors « prendre le côté de l’art [qui lui permet] d’oser, de surpasser les interdits. Autant au niveau politique que spirituel, je me permets la liberté, ajoute-t-il. On veut se montrer (objets, histoires), mais se montrer entièrement ».
Janine McAulley Bott (JMB) croit qu’il est important de montrer l’art autochtone contemporain dans ses relations avec les ancêtres :
C’est guérisseur. Je raconte une histoire qui m’a été racontée par ma famille. Je ne raconte pas seulement ce que je connais, mais aussi ce que ma mère m’a transmis. La plupart de mes tissages en création sont en relation avec ma mère et mes ancêtres. C’est leur présence que j’emmène au musée. Un musée ne peut exister sans sa communauté. Je veux mettre cette empreinte dans les musées.
JW croit qu’il devrait y avoir plus de controverses autour des objets dans les musées et que l’artiste doit en provoquer. Elle croit que son rôle comme artiste est de faire en sorte que jamais un objet ne meure. Elle veut faire dialoguer entre eux les objets de musées et elle croit que les artistes devraient être plus souvent en dialogue avec les musées. Comme conservatrice elle souhaite que les objets dialoguent aussi avec leur communauté d’origine, c’est pourquoi elle encourage que les objets sortent du musée – pour des cérémonies ou pour être utilisés.
Quelles devraient être les orientations prioritaires en muséologie quant à la mise en valeur du patrimoine artistique et culturel des autochtones – quel avenir pour la muséologie autochtone ?
Le vrai lieu de transmission c’est le territoire
Laureat Moreau (LM) constate que le défi de sa communauté est de transmettre des connaissances aux siens. C’est ce qui définit un musée autochtone dans une communauté autochtone. Comme le soulignent les aînés innus à qui le Musée Shaputuan a demandé comment protéger la langue et la culture, la transmission ne peut se faire en dehors du territoire puisque « la culture c’est la forêt, les animaux – et il n’y a pas d’autres moyens, c’est ce qu’il faut d’abord protéger. C’est beau d’avoir un musée, mais le vrai lieu de transmission c’est le territoire ». LM souligne toutefois qu’il est aussi important pour la Nation innue de prendre sa place dans le monde moderne. La communauté a donc mené des expériences en amenant des jeunes en territoire pendant deux mois, une initiative qu’on voudrait implanter plus largement et de façon durable. C’est un rôle que pourrait prendre le Shaputuan en collaboration avec des aînés et des enseignants. JN soutient lui aussi que « ce qui est le plus important, c’est la forêt. C’est mon musée ma forêt, c’est là que je vois ma culture ». À la question « Crois-tu que ton amauti a perdu de la valeur en étant placé dans un musée ? » Béatrice Deer répond :
Non, mais j’aurais voulu le porter dans mon village pour le montrer à mon peuple, pour leur montrer qu’on était encore capable de le faire. Notre communauté deviendrait ainsi notre musée ! Plusieurs personnes pensent qu’on n’est plus capables de fabriquer ce genre d’objets, que ce savoir a disparu. Par ce travail, j’ai ressenti une reconnexion avec mon identité culturelle et cela m’a révélé que je n’en connaissais pas assez à propos de moi-même. Je doutais de moi-même en pensant que d’autres connaissaient davantage ma culture. Mon amauti m’a prouvé que c’était à l’intérieur de moi ; tout ça a refait surface.
Ce sont les personnes qui donnent vie aux objets
Christine Sioui Wawanoloath (CSW) ajoute : « Si je voyais un amauti comme ça au Musée de l’Homme, à Paris, je le trouverais beau, mais si j’entends également le témoignage de Béatrice, j’apprends beaucoup plus, l’objet prend une bien plus grande dimension. » GIP pense que c’est justement le travail du conservateur de véhiculer cette dimension autour de l’objet, de lui faire raconter toutes ces choses, de donner vie à l’objet, de contrer la perception que l’objet est retiré de son environnement, de bien faire connaître – faire ressentir surtout. MN souligne qu’il y a présentement beaucoup d’initiatives pour tenter de reconnecter l’objet à sa culture d’origine, mais aussi de le reconnecter au contexte contemporain. C’est quelque chose vers quoi les Musées s’orientent. On ne voit plus l’objet comme inanimé mais, insufflé d’une vie, l’objet est « sujet ». JN croit que les objets dans les musées ne sont pas morts ; ils sont endormis et se réveillent par le regard des gens. MN raconte que, pour la présentation d’oeuvres du nord de l’Australie, les autochtones de cette région ont été invités par le Musée qui leur demandait en quelque sorte de redonner vie aux objets en travaillant à leur mise en contexte. Mais les autochtones considèrent que leurs objets continuent toujours à vivre. JW parle d’une grande exposition d’art aborigène à Londres où l’on a discuté des objets qui se retrouvent dénaturés dans le contexte muséal : une dame a alors proposé que les musées puissent payer un loyer de location pour les objets à leur communauté d’origine. Cet argent serait redonné aux communautés pour financer des projets comme celui de Béatrice : un projet qui permet de maintenir la culture vivante, de perpétuer les savoirs par la transmission et l’enseignement.
Comment garder la parole intacte
MN présente le modèle de gouvernance idéal pour son institution d’attache. Pour l’instant, le musée est organisé de manière hiérarchique. Cette pyramide, qui a un pouvoir centralisé, est à l’encontre de la façon autochtone de concevoir la gouvernance, une façon collaborative et horizontale de favoriser les interrelations et rétroactions. Si on garde l’idée de la pyramide, on devrait coupler un autochtone à un allochtone à chaque niveau de la pyramide. Actuellement il y a un conseil des aînés (décisionnel) qui rassemble des représentants des communautés autochtones ayant le mandat de discuter avec les différentes communautés pour définir avec elles ce qu’elles veulent faire et comment s’organiser. Les représentants doivent s’assurer alors que ces volontés soient respectées. C’est le « Steering Committee », composé d’employés du musée (non autochtones) qui travaillent à la mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil des aînés. JW dit ne pas aimer le nom de « Steering Committee », car steering veut dire « volant », comme si c’était eux qui décidaient de la direction à prendre, alors que dans les faits leur mandat est plutôt d’assurer la logistique et l’administration des budgets. GIP souligne que le Steering Committee est en quelque sorte au service des communautés autochtones et que ces dernières « ont bien compris que les Blancs dans les musées pouvaient travailler pour eux et que c’est la raison d’être de ce groupe de travail ». MN soutient qu’avec cette structure (le Conseil des aînés et le Steering Committee ), « il y a eu moins de conflits, [et] les gens ont été obligés de réfléchir et d’avancer cette réflexion dans une démarche ». GIP croit qu’il serait important que le personnel des musées soit sensibilisé aux savoirs autochtones et que les façons de faire des autochtones soient au centre des préoccupations muséales :
Les Musées doivent avoir confiance et respecter les désirs des communautés. Si les Musées ne veulent pas faire ça, les autochtones devraient mettre un embargo sur tous projets d’expositions les concernant dans les musées. Si les Musées ne travaillent pas de cette façon, c’est au détriment des autochtones ; ça ne les aide pas à sauvegarder leur culture, bien au contraire.
Pour GIP, c’est très important qu’il y ait des autochtones dans les positions de pouvoir dans les musées, et afin de ne pas diluer leur apport à la muséologie, ils doivent faire partie de la structure de gouvernance. Il faut aussi que ces musées spécialisés dans les cultures autochtones ne soient pas considérés comme des institutions de moindre importance : ce ne sont pas des annexes des musées nationaux. JW va plus loin en proposant que tous les musées soient invités à traiter des questions autochtones, quelle que soit leur vocation, et puisque « tous les musées sont érigés sur une terre autochtone, ils devraient automatiquement traiter des autochtones ». Le savoir culturel dont sont dépositaires les autochtones est très important et il doit être reconnu à sa juste valeur. Au lieu d’être un secteur thématique isolé, le thème de l’autochtonie devrait être intégré de façon transversale à toutes les sections du musée.
Un musée ne peut exister sans sa communauté
En tant que muséologue, LM soutient devoir toujours se référer au passé tout en soutenant qu’une institution muséale autochtone vit aussi au présent et a un avenir qui se définit par le contact avec les non-autochtones :
C’est comme les ancêtres, quand ils ont eu le contact avec les Européens, ils étaient contents, ils ont échangé des regards, des objets. Les nouveaux arrivants avaient aussi des besoins, il y avait des échanges d’humain à humain qui ont changé la manière de chacun de voir le monde. Pour nous, autochtones, ce qui nous intéressait le plus chez les Européens c’était l’accès au métal et aux armes à feu pour pouvoir mieux chasser, pour mieux vivre avec le territoire et non pas uniquement pour se défendre. Nous n’avions pas cette pensée, propre à la muséologie, de conserver les objets, mais ça fait partie des échanges, ça aussi ; on commence à développer notre propre muséologie, cela fait partie des technologies que nous avons reçues et qui peuvent contribuer à notre survie. La muséologie, nous la vivons différemment toutefois ; la façon de montrer les objets et de vivre l’expérience muséale est différente pour nous. Le défi est d’impliquer les gens de la communauté à raconter leur histoire par le biais d’une exposition. On a compris que nous vivions le Musée comme nos ancêtres quand ils recevaient ; le contact humain est important.
JN dit n’avoir jamais porté attention au terme « muséologie » avant son expérience avec le Musée de la civilisation :
Depuis que je vous écoute, il y a plein de questions qui me sont venues, mais aussi des réponses. Je constate que j’ai travaillé avec de grands philosophes, conservateurs, muséologues, qui ne sont peut-être plus avec nous aujourd’hui : ce sont mes aînés, mon père et bien d’autres dans la communauté. Je me souviens comment mon père me racontait le territoire, où ils allaient, où ils avaient vécu… tous les lieux, leurs noms et leurs significations. Je prends conscience de toute cette connaissance qu’ils m’ont transmise : le territoire, ce qu’ils y faisaient, les objets qu’ils utilisaient et de quelle manière, le respect avec lequel ils faisaient les choses. Je frissonne aujourd’hui quand je pense à tout ça, à la chance que j’ai eu de recevoir cette transmission.
LM mentionne que, « autant pour le Shaputuan que pour Mingan (Ekuanitshit), ce sont des musées qui sont là d’abord pour la communauté ». JMB quant à elle propose que les musées communautaires autochtones soient tous reliés entre eux de manière à constituer un grand musée et de permettre la rencontre des communautés que représentent ces musées. Pour GIP, cette idée de réseautage devrait aussi s’incarner dans la planification de la programmation. En travaillant ensemble pour savoir quels sont les plans stratégiques de chaque institution pour les années à venir, on pourrait développer des expositions qui ne répètent pas ce qui se fait ailleurs mais qui font la promotion des sujets qui pourraient intéresser d’autres musées : « … pour que chacun raconte sa propre histoire et que toutes ces histoires s’entre-complètent pour une histoire globale, pour plus de savoirs ». Pour MN, il y a une place pour le musée communautaire, une place pour le musée régional, mais aussi une place pour un musée national. Le problème, c’est que dans les grands musées nationaux on mesure par des statistiques l’engagement des musées envers les communautés :
Ça paraît bien de dire : « nous avons tant de pièces d’art autochtone, tant de galeries qui représentent les artistes autochtones » : c’est leur manière de mesurer leur succès. Mais ça ne dit rien sur la collaboration avec les communautés. Quand on intègre des objets à des collections, il faut avoir en tête qu’on doit aussi intégrer le discours et les façons de voir de la communauté d’origine.
Un portrait de l’avenir tel que souhaité
Depuis quelques décennies maintenant, des nations autochtones à travers le monde revendiquent plus que jamais d’avoir un mot à dire sur la mise en valeur de leur patrimoine. Cette volonté émane d’un large processus de décolonisation dans lequel se sont engagées un grand nombre de nations autochtones à travers le monde, depuis les années 1950. C’est notamment le cas dans le domaine muséal puisque les musées offrent la possibilité de faire rayonner les cultures vers le plus grand nombre. On constate depuis de nombreuses années qu’il existe une forme d’appropriation du médium « exposition » chez les autochtones, et ce, dans un contexte d’affirmation nationale. Mais cette volonté nécessite une transformation en profondeur des institutions de manière à adapter la muséologie aux vues et aux besoins des nations autochtones. Les participants au séminaire ont fait état des difficultés auxquelles ils sont confrontés et ils ont proposé des pistes de solutions :
-
Mieux cerner le rôle du conservateur autochtone, dont la tâche est différente de celle des conservateurs non autochtones au sein des musées nationaux. Définir une description de tâches claire et réaliste. Il n’existe pas de modèle de conservateur autochtone : on est seul et on subit seul les échecs, une position émotive exigeante.
-
Faire en sorte qu’il y ait davantage d’autochtones appelés à assumer des tâches diverses à toutes les échelles de la hiérarchie au sein des institutions nationales. Constituer des équipes autochtones pour éviter le sentiment d’isolement et celui de détenir peu d’autorité. Qu’on s’assure que la structure de gouvernance des musées voués aux cultures autochtones inclut des représentants autochtones (par exemple coupler un autochtone à un allochtone à chaque niveau de la pyramide) et qu’on tienne compte de la philosophie de gouvernance autochtone, collaborative et horizontale. Le savoir culturel que les autochtones apportent aux administrateurs et au personnel d’un musée est très important et doit être reconnu et mis à profit. Chaque institution devrait adopter un code éthique de relations avec le milieu autochtone.
-
Que les directions des musées nationaux et les autorités politiques, au niveau culturel et patrimonial, assurent un leadership fort pour que l’expertise des membres des Premiers Peuples oeuvrant à l’intérieur des institutions soit reconnue et soutenue par tout le personnel. Pour ce faire, il est essentiel que le personnel des musées soit sensibilisé aux réalités autochtones et formé à propos des savoirs autochtones qui doivent être au centre des préoccupations muséales.
-
Donner aux nations autochtones la possibilité et les ressources pour pouvoir véritablement assumer l’identification, la préservation et la transmission de leur patrimoine. Les institutions muséales nationales devraient avoir le mandat d’accompagner ces initiatives communautaires en offrant de la formation, de l’encadrement, du soutien financier et technique. Des projets qui permettent d’alimenter la culture vivante et de perpétuer les savoirs par la transmission et l’enseignement devraient être mis sur pied pour que les communautés soient des musées vivants.
-
Tout projet d’exposition devrait être réalisé en étroite collaboration avec les nations autochtones. Il ne s’agit pas de développer le plus rapidement possible les contenus mais de faire en sorte que ce soient les communautés qui conduisent le projet et décident comment elles veulent se représenter. Favoriser la possibilité que certains projets se déroulent dans les communautés, hors les murs du musée. Avoir un programme d’ambassadeurs dans chaque communauté et favoriser la participation des familles.
-
Les Musées doivent être conscients que la collecte des objets implique la responsabilité de documenter aussi la mémoire et la connaissance qui s’y rattache (savoir-faire, philosophies, histoires de vie). Les artistes autochtones devraient être sollicités pour exprimer ces aspects car l’art relie les époques, permet de transcender les tabous et d’exprimer l’intangible en sollicitant la sensibilité du public.
-
Que les musées autochtones soient reliés entre eux de manière à constituer un grand musée pour plusieurs sites : que chacun raconte sa propre histoire et que toutes ces histoires construisent une histoire globale des Premiers Peuples en produisant ainsi plus de savoirs. Développer ensemble des plans stratégiques pour les années à venir afin d’offrir des expositions qui se complètent, et travailler en réseau : musées nationaux/musées de communauté.
-
La mise en valeur du patrimoine et de la pensée autochtones devrait dépasser le cadre des expositions thématiques autochtones pour habiter tout le musée. Potentiellement tous les musées, quelle que soit leur vocation, pourraient traiter des questions autochtones et, puisque tous les musées sont érigés sur une terre autochtone, ils devraient automatiquement traiter des autochtones.
Parties annexes
Notes biographiques
Jean Tanguay
[Aucune note biographique associée à l’auteur(e)]
Élisabeth Kaine
Élisabeth Kaine, de la nation wendate, est professeure en design à l’Université du Québec à Chicoutimi. Spécialiste du développement de méthodologies collaboratives pour l’autoreprésentation des autochtones, elle a fondé La Boîte Rouge VIF ainsi que Design et Culture matérielle, respectivement organisme à but non lucratif et projet de recherche qui, par la co-création avec les Premières Nations et les Inuits, se consacrent à la production de nombreux outils de transmission culturelle et à l’étude de leurs impacts. Depuis 2017, elle est co-titulaire de la chaire Unesco en transmission culturelle chez les Premiers Peuples comme dynamique de mieux-être et d’empowerment. Elle sera scénariste pour la prochaine exposition permanente du Musée McCord portant sur les Premiers Peuples, dont l’ouverture est prévue en 2020. En 2014, elle a été récipiendaire du Prix du Gouverneur général du Canada en muséologie avec le Musée de la civilisation pour l’exposition C’est notre histoire, les Premières Nations et les Inuit au xxie siècle. Nommée au Cercle d’excellence de l’Université du Québec en 2015, elle a notamment dirigé la publication de Passages migratoires : valoriser et transmettre les cultures autochtones. Design et culture matérielle (avec É. Dubuc, PUL, 2010), ainsi que Le petit guide de la grande concertation : Création et transmission culturelle par et avec les communautés (avec D. Bellemare, O. Bergeron-Martel et P. De Coninck, PUL/BRV, 2016) et Voix, Visages, Paysages : Les Premiers Peuples et le xxie siècle (avec J. Tanguay et J. Kurtness, PUL/BRV, 2016).
Notes
-
[1]
Ont collaboré à l’organisation du séminaire : Élisabeth Kaine, professeure à l’Université du Québec à Chicoutimi, animatrice. La Boîte Rouge VIF fut partenaire de l’événement en mandatant Olivier Bergeron-Martel pour la prise de notes et la rédaction d’un premier compte rendu. Le Musée tient à remercier le Secrétariat des affaires autochtones (SAA) pour avoir contribué au financement de l’activité, de même que la Maison de la culture innue Shaputuan qui a collaboré à l’organisation de cet événement.
-
[2]
Le conservateur est responsable de la conservation des artéfacts au sein du musée pour en assurer l’accès aux générations futures. Il participe également à la mise en valeur des collections par différents médiums (exposition, édition). Les conservateurs ayant participé à cette rencontre étaient soit des employés permanents d’institutions muséales ou de centres d’interprétation ; soit des conservateurs contractuels. Les artistes présents ont souvent été invités à collaborer avec des institutions muséales dans des projets de mise en valeur de l’art autochtone ou d’interprétation où leurs oeuvres ont servi à l’expression de certaines thématiques.
-
[3]
Rapport du Groupe de travail sur les musées et les Premières Nations, Assemblée des Premières Nations et Association des musées canadiens, Ottawa, 1992. <https://museums.in1touch.org/uploaded/web/docs_fr/Task_Force_Report_1994_FR.pdf>. L’Association des musées canadiens a créé en 2017 le Conseil des musées et des questions autochtones, qui a pour mandat d’étudier les relations entre Musées et Premiers Peuples.