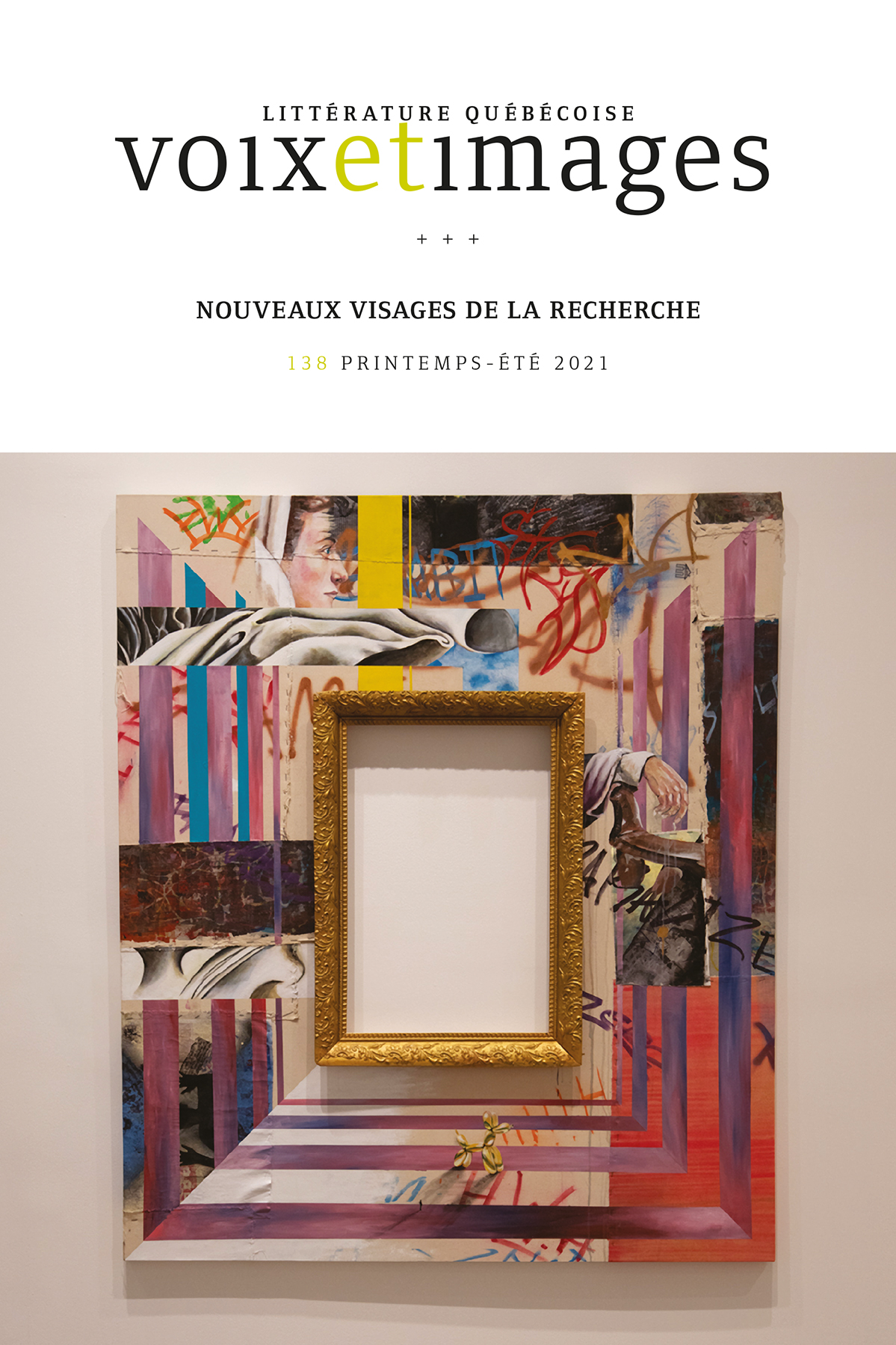Corps de l’article
Au cours des derniers mois, combien de fois suis-je restée perplexe devant ces constats d’une révolution de notre rapport au temps, dont le point zéro serait le 13 mars 2020, le jour où le Québec a été mis en pause ? Chaque fois, je me suis demandé sur quelle planète leurs auteurs vivaient. Il semblerait donc que pour plusieurs d’entre nous, le temps ait ralenti, au point de susciter l’ennui. Alain Farah affirmait même il y a quelques jours que le confinement lui avait fait retrouver le sommeil, le goût d’écrire et le plaisir d’enseigner[2]. Je suis bien heureuse pour lui et ma foi un peu envieuse, car je ne peux, hélas, en dire autant. Vous avez eu l’impression que le temps avait ralenti, vous ? Pour ma part, j’ai plutôt eu l’impression que, comme l’espace, il avait été compressé. Au terme de cette année pour le moins étourdissante, je me sens comme une girouette qu’on aurait laissée bouillir trop longtemps dans une immense soupe Zoom. C’est donc une lectrice épuisée et peu motivée que les livres empilés sur le coin du bureau lorgnaient et rappelaient à son devoir de chroniqueuse. Par chance, la rentrée poétique de 2021 est un grand cru. Ainsi j’ai pu compter sur le plaisir de la découverte pour ranimer mon désir de parler de poésie, et sur des voix fortes pour porter ma fatigue jusqu’aux premières chaleurs du printemps.
Tout est caché de Judy Quinn[3] est un livre étonnant, plein de surprises, de petites épiphanies, dans lequel l’humour, très subtil et savoureux, s’allie à une extrême finesse du regard, un regard pénétrant qui traverse les choses pour en révéler l’envers. Le livre se présente un peu comme un album de voyage (chaque poème porte un titre), dont chaque cliché serait accompagné de son négatif. Car derrière les apparences, il y a tout ce que le regard ignore et qui pourtant grouille autour de soi. Derrière les vivants, il y a tous ces fantômes qui vont et viennent, nous rappelant que nos jours sont comptés :
11On a vidé mon père avant de l’exposer
il n’avait plus de coeur
je ne lui ai pas tenu la main.
J’ai voulu savoir où on avait mis ses organes.
On m’a dit : « Tout est caché. »
L’approche est singulière. Le regard ne se fixe pas. Fruit d’une attention flottante, il balaie l’espace, presque distraitement, et c’est ainsi, un peu comme le fait la poussière dans la lumière de Delhi, que les contours des êtres se dessinent. Le projet s’apparente également à une fiction cinématographique, ce que suggère le sous-titre : « avec Ben Kingsley dans le rôle principal », dont chaque poème serait un arrêt sur image. C’est dire la place accordée à l’imaginaire dans ce livre où sont abolies les frontières entre les niveaux de perception :
15Le réceptionniste de l’hôtel Royal Deluxe
nous informe que les morts ont pris le pouvoir sur Terre.
Nous nous sentons comme des billets de loto déchirés.
Il sort de son crâne un peigne en plastique bleu.
L’étrangeté des associations est accentuée par celle de l’environnement où se trouvent les protagonistes, en l’occurrence la narratrice et son compagnon de vie et de voyage, qui revisitent leur histoire et redécouvrent leur intimité à la faveur du dépaysement :
24Nous baisons devant un portrait de Gandhi.
Une promesse peut-être s’accomplit.
Voici une mallette destinée à y mettre mon amour
et une carte qui t’aidera à le trouver.
[…]
Un indice : l’amour se tient près des mourants.
Bien qu’on ne trouve dans ce livre aucune référence à la pandémie et que l’Inde entretienne avec la mort un rapport de proximité qui échappe aux Occidentaux que nous sommes, ce défilé de fantômes semble faire écho aux statistiques des derniers mois, rappelant la pénurie de combustible et les dizaines de milliers de cadavres empilés au bord du Gange ou dans les stationnements des centres commerciaux, en attente d’être brûlés. Au fil du voyage, la question qui se pose aux protagonistes est celle de savoir si l’on peut réapprendre l’amour, et si ce réapprentissage ne commencerait pas par un délestage de soi-même. C’est du moins ce que porte à croire le très beau poème intitulé « L’absence » :
26Mais la forêt sans arbres
au centre de nos vies.
Le bruit
du vent dans ces arbres-là
me dit que nous sommes deux absents
et que cela s’additionne.
L’humour contribue à cet effort de déprise de soi, qui suscite un rire discret, très proche de la mort.
Dans ce décor où « [les] caissiers sont tous sous anesthésie » (38) et où le sable mouvant se compte en grains, le temps se dilate et les rêves le disputent au jour. Chargés de souvenirs d’enfance, ces rêves mettent en scène le père mort qui surgit en alcoolique tueur de chats et bientôt envahit la ville en « dizaines d’exemplaires » (45), toutes époques confondues. Seul un geste semble rattacher la narratrice au réel, celui de lancer une pierre dans le canal – il revient de manière récurrente. Certains poèmes ont des allures d’hallucinations, comme autant d’éclosions du réel sur la part de mystère qu’il recèle ; d’autres donnent lieu à des métamorphoses (ou peut-être des réincarnations ?). L’espace environnant, à commencer par l’hôtel et son ascenseur, agit à la fois comme un réceptacle et une chambre d’écho de la mémoire, si bien que les époques de la vie de la narratrice s’y condensent et s’y mêlent :
47L’ascenseur descend plus
bas, toujours plus bas
vers la salle d’où, hagarde
ma grand-mère m’interpelle :
« Hé, qu’est-ce que t’as fait de ma vaisselle cassée ? »
Suivant la dynamique chiasmatique des regards-fenêtres, peu à peu une équation prend forme, fondée à la fois sur le paradoxe et l’inversion. Si les vivants sont des morts en sursis et les morts des fantômes qui les hantent, aussi bien dire que le livre contredit finalement son titre : tout est caché = rien n’est caché. « Mais dans le négatif tout survient, cela/fait un grand blanc. » (76) Ainsi, bien qu’il paraisse absurde à la narratrice de croire que les étoiles existent parce qu’on les regarde, son entreprise lève cette absurdité. Le réel se révèle en somme comme les étoiles : si on cesse de le regarder, il nous anéantit :
79Ce qui n’existe pas
nous anéantit.
Ce qui existera
nous retient.
Ce sont là des poèmes à lire lentement, à méditer, littéralement, jusqu’à ce que la lumière se fasse, ou bien l’obscurité, selon la fenêtre par laquelle on y entre.
+
Je me suis tout de suite prise d’affection pour la narratrice du dernier livre de Marie-Ève Comtois, La consolatrice des affligés, lequel se rapproche de celui de Judy Quinn par plusieurs aspects, dont la présence des étoiles et la proximité de la mort. On y trouve un semblable tissage des univers, des règnes et des discours, une imagination aussi débridée, des télescopages surprenants et une propension à la métamorphose. La consolatrice des affligés (quel beau titre !) est un poème d’un seul tenant qui court sur 132 pages. Partagée entre la sédentarité et un rêve d’emportement, entre un travail d’archiviste aliénant et un monde littéraire idyllique (elle a rendez-vous avec Apollinaire, rêve à Nelligan), la narratrice gravite autour d’un petit appartement montréalais, qu’elle habite avec son chat Lucien. Elle vivote, médite, cogite. Son discours se déplace, allant de l’introspection à une adresse à un « tu » dont l’identité est changeante. Mais alors c’est moins le sujet singulier qui prime que l’interpellation elle-même, comme si à l’horizon de tous ces Serge, Joanne, Marlène, Jonathan et Geneviève, c’était au fond le « tu » générique qu’on visait, l’adresse constituant dès lors une communauté de sensibilités, fût-elle imaginaire.
Si la narratrice de Judy Quinn tient au réel par la répétition d’un geste fétiche, celle de Marie-Ève Comtois est lestée par une obsession, celle des taches, qui revient de manière récurrente, comme une cristallisation de la honte, un indice d’inadéquation, d’incapacité à se conformer aux modèles imposés par la société, à commencer par l’injonction d’être soi-même. Ce n’est pourtant pas faute d’essayer, mais la vanité de l’entreprise, de plus en plus évidente, commande le renoncement :
je sais que le brocoli
goûte le brocoli
mais moi
je ne sais pas
qui je suis (80)
[…]
je suis de celles
qui n’achètent pas de maison
parce que me construire
ne finit jamais
parce que me construire
est une fenêtre ouverte (85).
Le sujet est labile, son identité instable, mouvante (« je suis une piste de ski » [86] ; « une personne évolutive » [87] ; « une morue » [92], etc.), comme le texte qui sillonne la page, passant d’un registre référentiel à un autre, sautant du coq à l’âne. Cet éparpillement, ces débordements, ces dérapages décèlent une vérité bien plus seyante que toute fixation identitaire, car ils sont portés par un amour de la vie, cette maladie incurable[4] qui, paradoxalement, tient la mort à distance :
23Un souffle de ma plante
me rappelle
que la mort peut arriver
d’ici là je garde
l’oeil sur elle
je la surveille
de la mort que sait-on ?
elle participe de nous
chats errants.
Dans cet apparent chaos se lit un véritable éloge de l’immanence. De même que l’identité ne tient pas (« nous sommes des images/des images de rien du tout » [29]), de même les choses triviales – la vie en est faite – côtoient les appels du dehors et les rêves de voyage. Ainsi s’exprime une vulnérabilité, laquelle peu à peu se mue en force : celle d’accueillir à son tour la fragilité. L’auto-ironie contribue à cette ouverture en suscitant la complicité du lecteur :
je suis populaire
comme le réveil
avant la sonnerie (69)
[…]
j’appelle Dieu
personne ne répond (70).
Ici encore le paradoxe est endossé, dont est prise à la lettre la leçon de vérité. Ce qui apparaît d’abord comme une dysfonction sociale est finalement revendiqué comme un droit à la solitude :
99revenez plus tard
je suis encore en train
de me construire
Corrélativement, les écarts de logique gagnent en pertinence et l’envolée verbale devient de plus en plus jubilatoire. Et alors on prend la mesure de l’illusion identitaire, ce qui me semble particulièrement pertinent dans le contexte actuel où les revendications liées à l’identité prennent souvent l’allure de sables mouvants.
La finale est fort touchante, qui ramasse tout dans un bouquet de gestes, rappelant qu’au fond, ce sont eux qui comptent. Parmi ces gestes, celui de monter à pied les 16 étages de l’immeuble où se trouve l’appartement de la narratrice s’avère particulièrement significatif : le dialogue alternatif entre le corps et la conscience qu’il favorise déconstruit les structures hiérarchiques. Et si les gestes permettent d’éprouver qui l’on est, ils parlent moins d’identité que de présence :
132-133j’attendrai ton retour
qui que tu sois
[…]
arrive en ville
le plus vite possible
[…]
et emporte-moi
là où il neige fort
jusqu’au mois d’août
quand j’échappe mes mitaines
je sais qui je suis
mais encore faut-il
que ce soit l’hiver
+
Si la narratrice de Marie-Ève Comtois aspire à l’hiver, le narrateur du dernier livre de Jean-Marc Desgent[5], lui, habite le contraste des saisons. Composé de six poèmes plus ou moins narratifs, Tableaux d’hiver, tableaux d’été s’ouvre sur le massacre de Wounded Knee, commis le 29 décembre 1890 dans le Dakota du Sud, au cours duquel des centaines de Lakotas ont été tués par l’armée américaine, en seulement quelques minutes. Le narrateur revendique l’identité métisse et fait sien le grand rêve de Wovoka[6] de voir s’engloutir l’Amérique blanche dans une « immense noyade » (10), sans s’exclure pour autant de la violence des Blancs :
11Il y avait la peur des esprits danseurs,
il y avait la peur absolue des Blancs
d’être massacrés par Sitting Bull,
par ses rusés compagnons,
par ses enfants réels ou imaginés
ou par ses fous rêveurs dansants ;
il y avait les chemises blanches,les chemises des Esprits,
il y avait des Fantômes partout
la peur des danses jusqu’à la transe.
Le récit est poignant. La violence y est montrée à l’état brut (on frôle parfois le cynisme), de même que la bêtise, et surtout l’ignorance, celle de la culture et de l’histoire de l’autre, qui est sans doute la racine la plus profonde de la guerre. Après le massacre, tandis que le gouvernement américain décerne « la médaille d’honneur aux soldats » (14), on dispose des cadavres :
15-16Donc, une jolie tranchée pour servir de repos éternel
aux enfants achevés au revolver ou au sabre,
aux femmes mitraillées ou éventrées à l’épée,
confortable tranchée pour le repos éternel
des hommes qui se trouvaient là, ces Lakotas,
ces rusés Sioux qui, en mourant, rêvaient peut-être
encore à Wovoka, à Sitting Bull,
mais qui ne pouvaient plus comprendre la vie concrète,
la vraie vie blanche comme neige,
qui n’avaient pas saisi le sens de la question :
What Sioux want?
Pas plus que dans le livre de Judy Quinn il n’y a ici de référence à l’actualité. Et pourtant, en lisant cela, on ne peut éviter de penser aux restes des 215 enfants autochtones découverts à Kamloops et aux 751 sépultures anonymes trouvées sur le site de l’ancien pensionnat de Marieval.
Outre le caractère percutant du récit, la force du livre de Desgent tient à l’effet de résonance entre les poèmes – surtout les premiers. Le second poème revient sur l’enfance montréalaise du narrateur. Sa famille habite alors un vieil appartement dans un quartier populaire et sa vie, au quotidien, est marquée par l’omniprésence des rats :
20L’enfant ne s’étonne jamais de la présence des rats.
Son père en tue un par semaine,
hiver comme été, avec des trappes.
Il arrive qu’un rat se soit grugé
une patte pour échapper au piège ;
on ne retrouve donc qu’une patte prise au piège ;
ce sera, pour le temps qui lui reste à vivre,
un rat à trois pattes.
Quand les rats deviennent trop nombreux, les autorités municipales convoquent des exterminateurs. Ils débarquent dans le quartier avec leurs gros camions et épandent partout un liquide vert à l’odeur insupportable. Ils sont comparés à des soldats. Après leur passage, on assiste à l’agonie des rats, bientôt suivie par l’odeur de putréfaction, encore plus insupportable. Leur agonie est terrible, décrite minutieusement, en termes presque humains. Les cris et les gestes de panique qu’on entend à travers les murs des maisons donnent le frisson et rappellent tant le massacre de Wounded Knee que la Shoah :
24Il faut toujours gazer la vermine dit-on.
L’enfant imagine que les mots cachent
Quelque chose qu’on pense
Mais qu’il ne faut pas dire.
L’effet poétique vient également du contraste entre les saisons que les poèmes exacerbent. La chaleur et le froid se fondent aux êtres, parfois les dominent. « L’hiver, c’est loin dans la langue » est un poème enlevé, presque halluciné, le plus lyrique du livre. On peut y lire un hommage à tous les délirants du froid, les frigorifiés, les disparus, les amoureux de la toundra, Métis ou coureurs des bois, les François Paradis, les Jean Désy, ceux qu’habite la crainte ou la vénération de cette saison qui ne fait pas de quartier. Le froid en est le protagoniste ; il instille la peur et commande le respect. On se dit que la narratrice de Marie-Ève Comtois se laisserait bien emporter par cette vague de froid :
47Ça s’appelait du sauvage
en haut de la côte banquise ou en bas,
et pas d’idée faite sur la saison des frimas.
Ça se disait folie déferlante,
une vaste avalanche de tout.
Intitulé « L’hiver, l’été, le sexe de la mère », le dernier poème tient une place à part dans l’économie du livre. Retournant encore plus loin dans son enfance, le narrateur se rappelle le premier appartement qu’il a habité et les moments privilégiés qu’il y a passés avec sa mère, amatrice de comédies musicales, qui lui a appris à danser. Il fait alors son apprentissage de la séduction. C’est ni plus ni moins qu’une version du complexe d’Oedipe. S’il est touchant, ce poème détonne, car il nous amène ailleurs, et pour cela affaiblit l’ensemble, où il cadre mal. Il en va pareillement du quatrième poème (« L’été, une ville lointaine »), qui relate une agression subie dans une ville étrangère, lequel emprunte un autre registre et aurait sans doute été mieux servi par la prose de fiction. Par ailleurs, on n’y trouve pas l’effet d’échos qui donne aux premiers poèmes leur portée. Certes, il s’agit d’un recueil au sens littéral du terme, ce qu’indiquent les « tableaux » du titre. Mais il est dommage qu’en raison de sa construction et de la disparité des poèmes, sa force s’étiole quelque peu, ce qui ne rend pas justice à des textes par ailleurs estimables.
+
« Familles, je vous hais ! », écrivait André Gide. Pourtant, on y revient toujours, et si l’on parvient à les tuer, alors elles vous hantent. C’est du moins ce que raconte La voleuse de Daria Colonna[7], un livre que je trouve éblouissant :
La famille est une idée du dernier siècle à laquelle je m’accroche pourtant sans savoir pourquoi ni en quel honneur, comme s’il s’agissait d’un Dieu torturé davantage qu’absurde, et qui a joué dans ma tête jusqu’à ce que je me croie maudite et de mauvaise conscience, empoisonnée et bonne à rien, honteuse, toxique et ingrate. La fille de ma mère.
11
Dès le premier texte, tout est dit qui sera déployé par la suite. On connaît dès lors les axes qu’empruntera la réflexion dans une suite de fragments oscillant entre la prose narrative et l’introspection.
Il sera donc question de l’histoire familiale, en particulier celle des femmes, la mère et la grand-mère, mais également celle des hommes, le père, le beau-père, les demi-frères, avec qui les rapports, souvent troubles, grèvent la filiation matrilinéaire. Dans cette famille, « le goût de la mort s’est transmis comme une maladie de filles » (111) :
[C]e sont les mains des mères qui font écrire leurs filles. (111)
Nous sommes hantées. Dieu que nous sommes hantées. Une mère morte est un fantôme, et c’est pire. (120)
Fruit d’un conflit irrésolu, déchirée entre l’héritage maternel et l’héritage paternel, entachée d’une double honte, celle d’être pauvre dans un milieu bourgeois et bourgeoise dans un milieu pauvre, la narratrice ne se reconnaît nulle part, pas même dans le miroir. Elle habite le vide, et c’est depuis ce vide qu’elle écrit : « J’occupe le territoire de ma disparition. » (67)
Les souvenirs arrivent d’abord comme une nuée, jusqu’à ce que surgisse le souvenir fondateur, celui de la tentative de suicide de la mère, qui se serait ouvert les veines en 1992, dans une salle de bain d’appartement de banlieue. Ce souvenir, en bonne partie inventé, voire volé, puisque la narratrice était alors trop jeune pour l’avoir conservé, opère tel un moteur de la mémoire, à partir duquel des pans de l’histoire familiale seront reconstitués, mais aussi une seconde matrice, si bien que la narratrice se demande si ce n’est pas la mort elle-même qui l’a engendrée.
Décrétée « territoire le plus féminin de la maison » (15), parce qu’elle est souvent le seul lieu d’expression du désespoir des femmes, la salle de bain est un lieu de passage aussi bien que de passation, un lieu qui tue aussi, parce que s’y perd le temps qu’on y passe à scruter son image jusqu’à ses moindres imperfections, jusqu’à devenir sa propre ennemie. Mais pour qui ose affronter le vide du regard, elle devient métaphore du cabinet d’écriture :
Je ne me suis jamais reconnue dans le miroir et pourtant l’écriture exige d’assumer la vue tout entière.
24
Il y a la mort sur le comptoir à bord des trousses à maquillage. Que voulez-vous, je me refais le portrait.
66
Les portraits de personnages sont tous très réussis. J’ai particulièrement goûté celui de la grand-mère Jeannine. Cette femme du monde flamboyante, que l’amertume a gagnée jusqu’à la rendre violente avec ses filles, est dépeinte en des termes à la fois savoureux et terribles. De la mère et du père, Colonna embrasse la détresse avec beaucoup d’acuité. Elle décrit les premiers jours de leur amour avec une belle impudeur en même temps qu’une grande justesse.
Dans l’amour incommensurable et douloureux que la narratrice éprouve pour sa mère, un amour bouleversant, on reconnaît La bâtarde de Violette Leduc[8], qui hante le livre. On peut aussi penser à Un amour impossible, de Christine Angot[9]. Au centre de ces figures tutélaires trône Sylvia Plath, citée à quelques reprises, dont cette prescription contre la folie, complice de la mort, qui guette les femmes de la famille : « Mieux que l’électrochoc — je vous donne la permission de détester votre mère. » (64) Cette filiation littéraire ouvre la voie au paradoxe, qui semble le seul chemin à emprunter pour épuiser l’impossibilité de cet amour. Après tout, passer sa vie déchirée, n’est-ce pas un peu habiter le paradoxe ? « On ne veut pas voir mourir celle qu’on veut tuer. On a droit à ce paradoxe. » (118) Parce qu’il ne contraint pas à choisir, le paradoxe, comme l’écriture, est porteur d’une sagesse, mais aussi d’une liberté : « Il existe de beaux paradoxes, affirme encore la narratrice, comme celui-ci : ma mère m’aura offert la liberté de la fuir, offert les outils pour la quitter. Parce qu’elle m’aura donné la littérature. » (129)
Autres figures importantes dans le livre, les fleuves (le Saint-Laurent, la Seine, l’Oubangui, le Liamone) se succèdent et se superposent pour former un réseau riche en signifiance, que deux textes magnifiques (116-117) rassemblent, suggérant que le pont entre les générations est aussi celui en bas duquel on saute :
Que ce soit au-dessus de la Seine ou du Saint-Laurent, chaque pont est un bord de baignoire jauni par le temps, écaillé par des jouets d’enfants, un plancher froid qui donne à entendre le bruit étouffant de l’époque, et, tout en dessous, il y a l’overdose des femmes.
116
La lucidité, la pénétration sont saisissantes, et en 256 pages on ne note aucun relâchement. Les passages fulgurants y sont nombreux. Par exemple, cette introduction au portrait du beau-père : « C’est un homme comme les autres. On a le langage pour les plaindre, le même langage qu’on utilise pour se détester soi-même. » (93) Ou encore cette pensée de la jeune Européenne (sa future mère) fraîchement débarquée dans l’underground montréalais, qui regarde dormir son amoureux : « elle se dit, comme ça, le regardant endormi dans ce parc, endormi comme l’alcoolique qu’il est tandis qu’elle restera l’insomniaque, avec l’odeur de vomi dans la brise, elle se dit que c’est réellement émouvant d’être à ce point libre de désespérer » (163).
La voleuse (titre bien choisi et exploité avec finesse) porte le poids de la trahison, celle que doit commettre qui veut s’affranchir de l’hérédité. Il faut savoir trahir l’amour qui « fait laisse » (22). Or la trahison implique une logique qui sera poussée à son paroxysme, jusqu’au renversement qui s’opère dans les deux derniers chapitres du livre, où la narratrice évoque sa propre maternité. En libérant la mère en elle, l’enfant qu’elle a mis au monde libère du même coup sa grand-mère et induit un rapprochement. Il en va de même de l’écriture. Alors qu’au départ elle ne soigne rien, ne faisant que perpétuer la douleur et alimenter la soif de vengeance, la présence de l’enfant l’ouvre à un possible recommencement. Ainsi, après avoir imaginé un fleuve de sang, « c’est aux pieds de la vie que [la narratrice] choisi[t] de répandre[s] es os » (230). Et si le doute ne la quitte pas pour autant, elle voit désormais dans l’abandon « une maison vacante, mais voisine » (234).
Dans un petit livre au titre inspirant[10], Laurent de Sutter fait l’archéologie du concept de personne, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Plongeant ses racines dans le système judiciaire romain, l’identité moderne serait en quelque sorte une performance administrative, une réponse à l’interpellation (« citoyen, vos papiers ! »), bref une forme d’assujettissement au pouvoir. Selon le théoricien du droit, « l’histoire du développement personnel n’est rien d’autre que l’histoire de la police de l’être — l’histoire d’une police qui repose sur la catégorie d’être en tant qu’il s’agit d’une catégorie toujours-déjà normative[11] ». Il en découle que l’ontologie même est intenable, puisque le discours de l’être est en réalité le discours du devoir-être. Ainsi, loin d’être révolutionnaires, les hérauts de l’identitaire font au contraire le jeu d’un pouvoir qu’ils reconduisent, parfois à leur insu, et ce faisant succombent à une supercherie. Or, comme le montrent avec éloquence les poètes ici réunis, le sujet est et ne peut être que hors soi, car il n’est rien d’autre qu’un effet de la réalité en tant qu’elle lui advient. Ne tenant pas en place, il n’a pas davantage de lieu propre. Autrement dit, être un sujet, c’est n’être personne :
Le sujet, ce sont les circonstances ; le sujet, c’est la manière dont les circonstances produisent du devenir à partir des rencontres qui les jalonnent – c’est la manière dont chaque rencontre s’avère en puissance d’un devenir situé à jamais ailleurs que là où il pourrait y avoir un moi, un soi, une personne. De sorte qu’il y a un appel du devenir, qui est l’appel du vide rempli de puissances que les circonstances dessinent – et que c’est cet appel qui peut être dit constituer l’impersonnel auquel chaque individu abandonne la rêverie malade du « souci de soi »[12].
Abandonner « la rêverie malade du “souci de soi” » : n’est-ce pas là une proposition à la fois sage et réjouissante ? Terminant cette chronique à la veille de partir en vacances, je me dis qu’au fond, la fatigue a du bon. Comme elle empêche le sujet de se fixer, elle offre une résistance à la tentation identitaire, à ses illusions comme à ses violences. Au bal des fantômes, Je est une enfant lakota assassinée, un père alcoolique mort de désespoir qui erre dans les rues de Delhi, dort dans les parcs de Montréal, une poire trop mûre que la consolatrice n’a pu sauver du désastre. Le renoncement à soi, la vacance même, le vide salvateur : voilà ce que je retiens de ces lectures et que j’emporte avec moi, pour mieux le disséminer dans les eaux du lac Saint-François.
Parties annexes
Note biographique
DENISE BRASSARD est professeure au Département d’études littéraires de l’Université du Québec à Montréal. Poète et essayiste, elle a publié notamment L’épreuve de la distance (Éditions du Noroît, 2010), La rive solitaire (Éditions du Noroît, 2008) et Le souffle du passage. Poésie et essai chez Fernand Ouellette (VLB éditeur, 2007 – Prix Raymond-Klibansky). Elle a codirigé plusieurs ouvrages collectifs, dont États de la présence. Les lieux d’inscription de la subjectivité dans la poésie québécoise actuelle (en collaboration avec Evelyne Gagnon ; XYZ, 2010), et signé de nombreux articles, essais et fictions, parus au Québec et à l’étranger.
Notes
-
[1]
Marie-Ève Comtois, La consolatrice des affligés, Montréal, Le Quartanier, coll. « Série QR », 2021, p. 126.
-
[2]
Alain Farah, « Recoller les morceaux », Le Devoir, Montréal, 12 juin 2021, en ligne : https://www.ledevoir.com/lire/609723/serie-le-monde-d-apres-recoller-les-morceaux (page consultée le 30 juin 2021).
-
[3]
Judy Quinn, Tout est caché, Montréal, Le Noroît, 2021, 81 p.
-
[4]
« j’ai une maladie qui s’appelle/le goût de vivre » (17).
-
[5]
Jean-Marc Desgent, Tableaux d’hiver, tableaux d’été, Montréal, Poètes de brousse, 2021, 60 p.
-
[6]
Aussi connu sous le nom de Jack Wilson, Wovoka est un leader spirituel de la tribu de Païutes et est à l’origine de la Ghost Dance (danse des Esprits).
-
[7]
Daria Colonna, La voleuse, Montréal, Poètes de brousse, 2021, 256 p.
-
[8]
Violette Leduc, La bâtarde, préface de Simone de Beauvoir, Paris, Gallimard, 1976, 634 p.
-
[9]
Christine Angot, Un amour impossible, Paris, Flammarion, 2015, 217 p.
-
[10]
Laurent de Sutter, Pour en finir avec soi-même, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Perspectives critiques », 2021, 209 p.
-
[11]
Ibid., p. 48 ; l’auteur souligne.
-
[12]
Ibid., p. 185-186 ; l’auteur souligne.