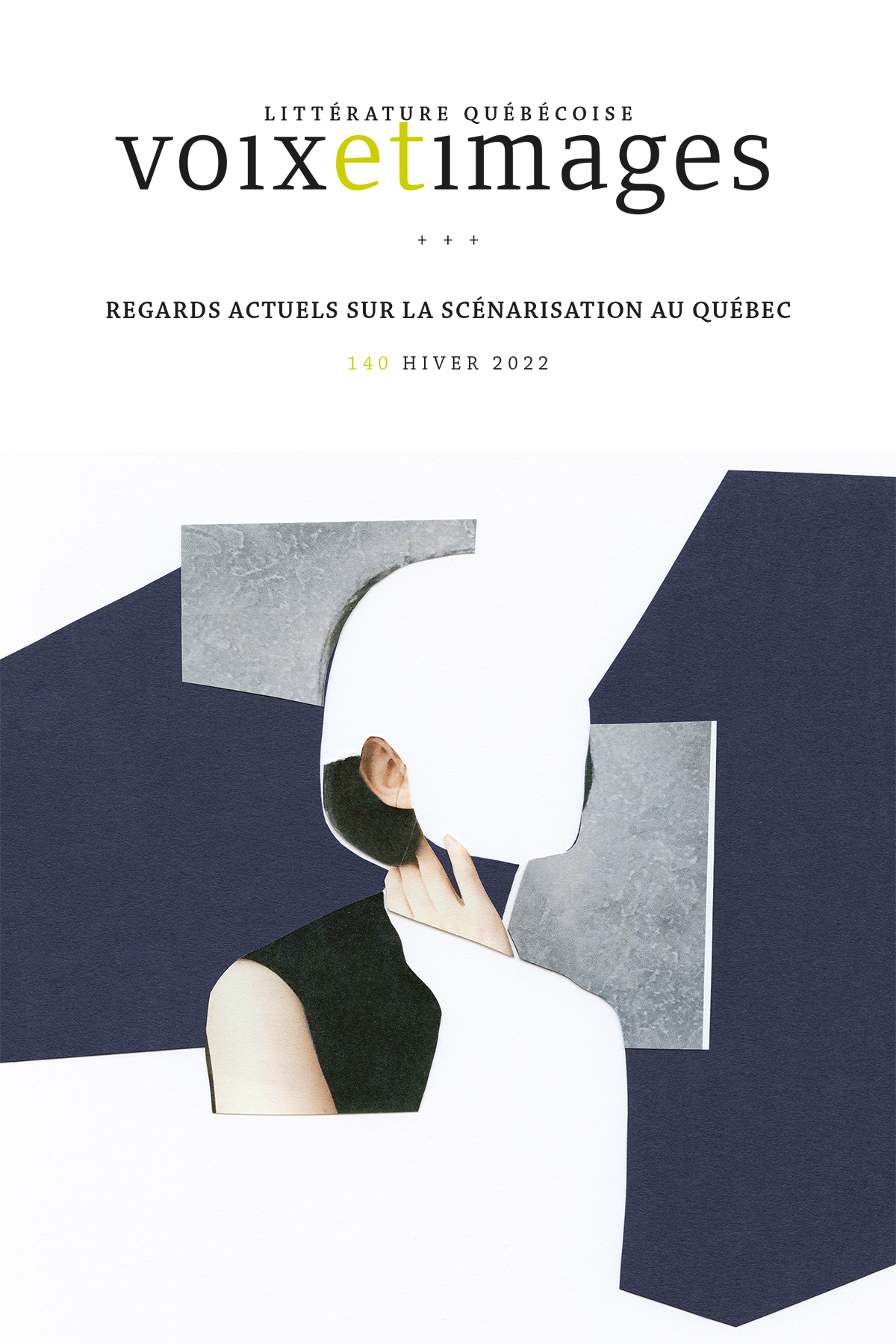Résumés
Résumé
La scénarisation est une expérience socioprofessionnelle qui s’inscrit nécessairement dans un contexte de travail soumis à différentes dynamiques de pouvoir et d’oppression, d’inclusion et d’exclusion – tantôt volontaires, tantôt systémiques. À travers une série de fragments d’entretiens réalisés à l’automne 2021, ce texte à dix têtes investit la question de la « diversité scénaristique » dans le contexte québécois contemporain. Ce faisant, la « discussion chorale » qui se déploie au fil des pages rend compte de préoccupations actuelles et cible des pistes de réflexion peu considérées jusqu’à présent au sein des études scénaristiques au Québec.
Abstract
Scriptwriting is a socio-professional act which, by necessity, falls into a working environment that is subject to a number of power, oppression, inclusion and exclusion dynamics—at times deliberate, sometimes systemic. Through a series of excerpts of interviews that took place in the fall of 2021, this collaborative article, written by ten people, investigates the notion of “scriptwriting variations” within the contemporary Québécois context. In so doing, the “ensemble discussion” that unfolds over the pages reflects current concerns and targets ways of thinking that have, until now, received little attention in scriptwriting studies in Québec.
Resumen
La guionización es una experiencia socioprofesional que se inscribe necesariamente en un contexto laboral sujeto a diferentes dinámicas de poder y opresión, de inclusión y exclusión - a veces voluntarias, a veces sistémicas. A través de una serie de fragmentos de entrevistas realizadas durante el otoño de 2021, este texto escrito por diez personas investiga la cuestión de la "diversidad guionística" en el contexto contemporáneo de Quebec. Al hacerlo, la "discusión coral" que se desarrolla a lo largo de las páginas tiene en cuenta las preocupaciones actuales y apunta a vías de reflexión poco consideradas hasta ahora dentro de los estudios guionísticos en Quebec.
Corps de l’article
À l’automne 2021, je me suis entretenue avec des scénaristes et des scénaristes-réalisateur·rices québécois·es, blanc·ches et non blanc·ches, certain·es né·es au Québec, d’autres non, tantôt professionnellement bien établi·es, tantôt en début de carrière, sinon faisant état de leur difficile intégration professionnelle. À l’origine, à travers ces entretiens durant lesquels je suis allée à la rencontre d’une majorité de personnes de couleur, avec en tête le concept bricolé de « diversité scénaristique », j’avais pour objectif de rendre compte de préoccupations actuelles et de cibler différentes pistes de réflexion encore inexplorées, à ma connaissance, au sein des études scénaristiques au Québec. Je voulais savoir dans quelle mesure le manque de diversité sur les petits et les grands écrans québécois (un phénomène de plus en plus étudié et ouvertement dénoncé sur plusieurs tribunes depuis nombre d’années maintenant) pouvait être pensé en lien avec l’écriture de scénarios. Or, rapidement, les conversations, lors des entretiens réalisés, ont débordé le strict cadre des seules pratiques scénaristiques. Si au départ mes questions se voulaient précises, il m’aura fallu me rendre à l’évidence de leur étroitesse, puisque pour parler de « diversité scénaristique », il est de fait nécessaire d’aborder une diversité d’enjeux. Pour le dire autrement : personne n’écrit de scénarios « en dehors du monde ». En effet, la scénarisation est une activité humaine, une expérience socioprofessionnelle vécue qui s’inscrit dans un contexte soumis à différentes dynamiques de pouvoir et d’oppression, d’inclusion et d’exclusion – tantôt volontaires, tantôt systémiques.
Au total, j’ai rencontré neuf personnes qui, collectivement, rendent compte d’une grande diversité de parcours et d’expériences tant dans le milieu de la télévision, de la websérie que du cinéma québécois. La « discussion chorale » livrée ici sous la forme d’une cinquantaine de fragments d’entretiens accorde une grande place aux paroles récoltées[1]. Tout au long du texte, les fragments numérotés sont regroupés par thèmes et enjeux à l’aide de sous-titres. Une certaine convergence d’idées a certes pu être observée à travers les entretiens réalisés. Il me faut toutefois souligner d’emblée ceci : la diversité ne saurait être monolithique et les personnes rencontrées ne s’expriment pas « d’une seule voix ». Malgré leur anonymat, les personnes dont le propos est aujourd’hui rapporté sont individuellement à considérer comme coauteur·rice de la présente publication. Enfin, plus globalement, ce qui est discuté dans les pages à venir doit être entendu, me semble-t-il, en étroite résonance avec différentes prises de parole et études interrogeant le manque de diversité dans le monde des arts et de la culture au Québec, non seulement du côté du cinéma, de la télévision et du Web, mais aussi du côté de la littérature, du théâtre, de la musique, de la danse et des arts visuels.
DIVERSITÉ TOI-MÊME
Fragment 1
Moi, je suis complètement indifférent·e au vocabulaire. J’utilise les mots à la mode. Un temps, je disais « racisé·e ». Et à un moment, on m’a dit « de la diversité », alors je me suis mis à dire : « Je suis un·e cinéaste de la diversité. » En général, je dis « de la diversité », mais la diversité, c’est un mot qui a été repris. J’ai vu récemment, par exemple, qu’on s’est mis à parler de « la diversité des genres » dans certains organismes. C’est quelque chose qu’on ne disait pas avant – comme quoi on peut facilement le reprendre à sa sauce : « Au Québec, on a la diversité des genres, on a de la diversité ! »
Fragment 2
« Diversité », c’est une nouvelle catégorie ! Il y a des thrillers, des drames, des comédies, etc., et maintenant, on a « des diversités »… But what does that even mean? À la base, le mot « diversité », par définition, désigne tout le monde. On en fait tou·tes partie, parce qu’on est tou·tes différent·es suivant notre genre, notre orientation sexuelle, nos origines, etc. Et là, c’est devenu un mot thème pour désigner les personnes de couleur. Ça nous marginalise encore plus : il y a d’un côté les Blanc·ches, et de l’autre, « la diversité ». C’est réducteur. On est tou·tes mis·es dans le même paquet. On voit même passer des requêtes du type : « On aimerait que tel rôle soit tenu par une actrice de la diversité… » C’est rendu qu’on parle « de la diversité » comme d’un pays ou d’une langue ! Mais ça veut dire quoi, « issu·e de la diversité » ? Les Blanc·ches aussi font partie de la diversité.
Fragment 3
Je trouve que ce qui est le plus énervant avec ça, c’est que, maintenant, c’est comme si tu étais obligé·e de parler de ça. Au sens où ça ne peut pas juste être des histoires différentes, racontées de façons différentes, depuis différents points de vue. Non. Il faut nécessairement en faire une histoire « qui parle de la diversité ».
Fragment 4
Pour moi, « diversité », ça voulait dire quelque chose avant la mort de George Floyd. Depuis, j’ai l’impression que ça veut dire quelque chose d’autre et c’est lourd. Ça pis « racisé ». Je pense que « racisé », c’est pire. Dans ma vie, je ne me réveille pas chaque matin en me disant : « Ah, je suis une personne racisée ! » Je suis une personne qui vit sa vie, tu sais. Mais on me dit : « Toi, tu es une personne racisée. » D’une manière ou d’une autre, on est tout le temps renvoyé·e à notre blackness.
« ÊTRE QUÉBÉCOIS·E »
Fragment 5
J’ai assisté à beaucoup de discussions à propos de la question de l’intégration et je demande toujours : « Mais c’est quoi, l’intégration ? » Selon moi, je suis très bien « intégré·e », mais je ne sens jamais que je suis Canadien·ne. En fait, je ne suis pas d’accord avec la définition que tout le monde utilise pour l’intégration : que tu dois parler la langue, travailler, payer tes impôts et te soumettre aux lois. Il y a plein de gens qui font tout ça – et même plus que ça ! – et qui ne sont pas intégrés. L’intégration, c’est une chose culturelle, ce n’est pas seulement quelque chose d’administratif. Je suis une personne arabe chrétienne. Ma culture est islamique, mais je ne suis pas musulman·e. Et moi, je représente la culture islamique, pas l’islam salafiste, non, mais l’islam libéral. Dans un cours à l’UQAM, peu après mon arrivée au Canada, un prof m’a demandé ceci : « Pourquoi as-tu émigré de chez toi ? » J’ai dit : « Pour une seule raison : pour donner à mes yeux la chance de regarder une vie différente. » J’ai été accepté·e pour immigrer au Canada par l’ambassade canadienne [d’un pays du Moyen-Orient] au début des années 2000 et je suis venu·e. C’est tout.
Fragment 6
C’est cliché de dire ça et de l’assumer, mais quand même, travailler pour le Wapikoni mobile[2], ça a changé ma vision du Québec, voire ma vision du monde. Ça a été un choc culturel énorme que d’être confronté·e de manière très locale à quelque chose avec quoi je n’avais jamais été mis·e en contact jusque-là dans ma vie. J’avais l’impression d’être en voyage au coeur de mon propre pays. Au début, dans les communautés autochtones que je visitais pour la première fois, je rencontrais une culture que je ne connaissais pas du tout, qui était à la fois très québécoise et très « autre chose ».
Fragment 7
C’est simple, je ne me sens pas Québécois·e.
Fragment 8
Mais pour moi, le toupet, c’est quand tu lis des articles de Christian Rioux ou autres, et que des Blanc·ches profitent de leur tribune pour 1) s’adresser aux « Haïtien·nes » comme si tou·tes les Noir·es au Québec venaient d’Haïti ; et 2) nous dire qu’on devrait s’identifier à la culture québécoise en premier et non à la culture noire. Who are you pour me dire à quoi et à qui je devrais m’identifier en tant que personne noire ? Et c’est quoi, au juste, « être Québécois·e » ? Les personnes de couleur ne sont pas présentes dans l’imaginaire culturel québécois, but yet, on devrait être fier·ère d’être Québécois·e ? L’imaginaire culturel actuel n’est pas représentatif de la réalité. On nous dit aussi qu’on devrait être fier·ère d’être francophone… Mais le français, concrètement, c’est une langue de colonisateur. Si je parle français, c’est parce que tu as colonisé my people. Il y a 30 millions de Congolais qui sont morts aux mains du roi de Belgique, et moi, je devrais être davantage fier·ère de parler français que d’être Noir·e ? Are you on crack ?! Aussi, il y a un vrai double standard : on répète aux personnes de couleur qu’il faut apprendre et préserver la langue française… Mais est-ce que tu fais le même effort, toi, pour conserver les langues autochtones ? Parce que tu n’es pas plus dans ton pays que moi ici.
REGARDS SUR LES ÉCRANS QUÉBÉCOIS
Fragment 9
Je suis étonné·e des gens qui ne font qu’applaudir tout le temps un cinéma qui est assez mauvais, à mon avis, qui ne raconte rien, en fait. On ne parle pas vraiment de la société québécoise telle qu’elle est dans les films d’ici. Je suis né·e au Moyen-Orient, j’ai vécu en France et immigré au Canada dans les années 1990 en m’établissant d’abord à Toronto. Mais j’ai tourné mon film à Montréal, parce qu’à Toronto, j’avais du mal à trouver des comédien·nes arabes qui parlent français. J’ai ensuite déménagé à Montréal avec la mission d’apporter la diversité dans la société québécoise, dans le cinéma québécois. Je pensais qu’il était possible de raconter d’autres formes d’histoires bien ancrées dans la société ici. Je ne comprends pas les gens qui font des films de voyage, qui vont tourner des choses en Europe, par exemple, et qui reviennent au Québec. Moi, je n’aime pas ces films-là.
Fragment 10
C’est comme ça : dans les films québécois, il n’y a quasiment jamais d’immigrant·es. Les Québécois·es ne s’intègrent pas à nous. C’est pour ça que, pour la plupart des immigrant·es, le cinéma québécois n’existe pas.
Fragment 11
Depuis ma petite enfance – depuis L’Héritage dans les années 1980 –, j’ai écouté toutes les séries faites au Québec. Je me suis toujours projeté·e dans les histoires qu’on me racontait, parce que c’est ça le whole point de raconter des histoires ! Mais à l’époque, je ne me rendais pas compte nécessairement que les personnages étaient pas mal tous blancs… C’est après que c’est venu. Quand j’ai réalisé, par exemple, que, moi-même, je créais juste des personnages blancs ! Lorsque je regarde la télé aujourd’hui et que je constate que pas grand-chose n’a changé finalement… je ne suis plus capable !
Fragment 12
Quand, plus jeune, j’ai pu écouter des émissions (surtout américaines) avec des personnages auxquels je pouvais vraiment m’identifier, ça a pris un next level pour moi. J’étais comme : « OK ! C’est ça, se reconnaître à la télé ?! » En fait, la télé québécoise, aujourd’hui, en tant qu’adulte, je ne l’écoute plus du tout.
Fragment 13
[Malgré votre pratique active depuis votre arrivée au Québec, sentez-vous que vous faites partie du « cinéma québécois » ?] Pas du tout. Parce que le cinéma québécois ne présente en général que les préoccupations québécoises, des histoires québécoises, il est très local. Et je trouve que c’est la raison principale pour laquelle le cinéma québécois n’a pas de résonance chez les immigrant·es. Quand on voit un film québécois, il ne nous appartient pas. On a des problèmes, nous, les immigrant·es, plus importants que les problèmes qu’ont les Québécois·es. Et les Québécois·es ne parlent pas de nous. Sauf dans le cas où ils présentent des caricatures de nous. Mais, moi, en tant qu’immigrant·e « ordinaire », je suis où, moi, dans les films québécois ? Pourquoi mon histoire n’est-elle pas racontée ?
QUI RACONTE QUOI
Fragment 14
[Avez-vous l’impression qu’on s’attend à ce qu’un·e scénariste de couleur mette en scène un récit politique ou politisé ?] Non, pas du tout. Non, au contraire, les décideurs (producteurs, financeurs, etc.) n’aiment pas ça. On s’attend à ce qu’un·e scénariste de la diversité écrive une histoire, raconte une histoire qui plaise à des gens qui ne sont pas de la diversité. Mais on ne demande pas à la diversité qu’est-ce que ça lui fait de voir tant d’écrans où il n’y a que des Blanc·ches. Il n’y a aucune enquête faite pour savoir comment, au Québec, les gens qui ne sont pas blancs se sentent en voyant une télé et un cinéma aussi blancs. On parle quand même de plus du tiers de la population de Montréal ici[3] ! Il n’y a aucun sondage là-dessus, à ma connaissance, aucune enquête réalisée. Il n’y a aucune enquête auprès des jeunes pour savoir quel impact le manque de diversité dans la culture a sur eux. Or, on n’arrête pas de nous dire « qu’on est en train de perdre les jeunes », mais le cinéma québécois ne s’occupe pas de son public. Moi, j’habite près de l’école Côte-Saint-Luc à Montréal : les gens qui font le cinéma québécois oublient que ces gens-là, ces enfants qui sont noirs, asiatiques, arabes, mixtes… Ça va être leur futur public ! Les jeunes, en tant que public, sont de plus en plus américanisés. Mais il n’y a aucune réflexion, aucun dialogue de fond là-dessus. Sur comment nous – les immigrant·es, les personnes non blanches – on voit la société québécoise, comment on voudrait qu’elle soit représentée à l’écran. Les gens de la diversité, le public de la diversité : jamais la SODEC ne va interroger ce public. Est-ce que les distributeurs ont déjà parlé du public de la diversité, de comment il faudrait cibler les films pour les rejoindre ? Pas à ma connaissance. Je n’ai jamais vu la moindre étude. Je n’ai jamais entendu personne se demander : « Est-ce que nos films de comédie touchent les gens de la diversité ? »
Fragment 15
Si nous deux, toi et moi, on est subventionné·es pour écrire deux scénarios, toi, qui es blanche et qui es née ici, tu vas écrire un scénario québécois, et moi, je vais écrire un scénario d’immigrant·e. Alors, assurément, le fait d’employer des immigrant·es pour écrire des histoires va changer les couleurs du cinéma québécois. Et les immigrant·es ne vont pas écrire sans les Québécois·es, sans mettre des personnages qui représentent la vie au Québec. Mais les Québécois·es ne savent pas écrire des histoires d’immigrant·es. C’est toujours fake. Ce n’est pas authentique. Parce que le vrai existe dans les détails.
Fragment 16
Sur un projet, l’un de nos personnages était un pasteur et c’était important pour l’histoire. Il y avait un gars (côté prod ou diffuseur, on n’a jamais vraiment su qui c’était) qui lisait les textes. Pis là, on reçoit ceci comme commentaire : « Faudrait pas qu’il y ait une histoire d’Église, parce que, tu sais, au Québec, on n’aime pas vraiment ça, la religion. » Premièrement, on est tou·tes né·es ici, et deuxièmement, oui, il y a des communautés au Québec où les gens vont à l’église ! D’ailleurs, l’église où j’allais quand j’étais jeune, c’était majoritairement une église de Blanc·ches !
Fragment 17
On nous a récemment approché·es pour écrire un projet. Une histoire vraie, super intéressante, qui se passe à Montréal-Nord. L’équipe à la tête du projet insistait beaucoup pour qu’on mette l’accent sur « la dure réalité du quartier ». Il fallait tout le temps que l’histoire soit ramenée à ça. On nous demandait de « bien montrer la misère » – ce qui est déjà vraiment raciste, en soi, de penser que tou·tes les Noir·es sont juste des thugs. Les commentaires qu’on recevait sur nos textes en début de projet, c’était comme : « Ouais, ça prendrait plus de jeunes en situation d’échec. » Deux des cinq personnages principaux étaient des aîné·es, à l’origine, mais on insistait pour nous dire que « deux aîné·es, ça fait beaucoup : faudrait qu’il y ait plus de jeunes, que l’on comprenne dès le départ qu’iels sont en situation d’échec et qu’iels sont dans un gang de rue ». J’étais comme : what?! C’est une histoire vraie, et ce n’est pas ça qui s’est passé ! Mais le préjugé à l’égard de Montréal-Nord est rendu tellement fort que, même si on veut raconter autre chose, on se fait toujours demander de revenir aux mêmes clichés. Il n’y a pas d’ouverture. Tu m’approches en tant que scénariste, mais tu veux que j’écrive ce que tu veux… Dans le fond, pourquoi tu me le demandes ? Écris-le toi-même, ton projet !
Fragment 18
Les films représentent notre interprétation artistique d’événements majeurs et, le plus souvent, ça remplace même l’histoire populaire. Par conséquent, en tant que créateur·rice, on a une responsabilité. Si tu demandes à quelqu’un, par exemple, « Quels sont tes souvenirs du débarquement de Normandie ? », iel risque de te raconter une histoire, sinon de te parler de films qui ont été tournés sur le sujet. Moi, si je pense à des favelas, je pense à City of God (F. Meirelles, K. Lund, 2002). Je n’ai jamais réellement vu, pas même dans des archives, à quoi ça ressemble, cette réalité-là au Brésil. Je pense juste à un film. Si on pense au Danemark, on pense aux films danois. Etc. On a réellement une responsabilité, parce que les gens prennent pour du cash les histoires qu’on raconte.
Fragment 19
Lorsque tu écris un rôle, est-ce que tu as nécessairement envie que sa couleur de peau soit un enjeu dramatique ? Des fois, non. Donc je pense qu’il faut ouvrir les castings et commencer à mixer les gens de sorte que ce qui est porté à l’écran ressemble un peu plus à ce qu’on peut vivre dans la « vraie vie ». Cela dit, nier le fait que la couleur de peau peut avoir un impact au quotidien, c’est problématique – même dans un contexte scénaristique. Moi, je suis Blanc·che. Et comme Blanc·ches, notre privilège est de ne même pas avoir à s’interroger là-dessus, ni à imaginer l’impact que ça peut avoir dans la vie. Donc, tu construis des personnages et tu occultes complètement un pan de ce qu’ils peuvent vivre au quotidien. Mais en même temps, tu n’as pas envie de parler juste de ça en cloisonnant des personnages – genre : un personnage a le droit d’exister et de ne pas aborder tout le temps sa couleur de peau. Je pense qu’il y a un équilibre à trouver. Lorsqu’on aura plus de créateur·rices non blanc·ches, que la diversité va avoir pris d’assaut la scénarisation et la réalisation, je pense que ça va être possible de créer des séries où, au cinquième épisode, par exemple, quelque chose se passe et il y a une discussion dans laquelle on aborde plus authentiquement certains enjeux.
Fragment 20
Notre métier de scénariste a des répercussions pas uniquement sur nous, mais aussi sur les comédien·nes de couleur qui vont jouer nos textes par la suite. On est toujours très conscient·e de cet aspect-là de notre travail.
Fragment 21
Je suis quelqu’un de très calme et je suis capable de travailler sous pression. Mais je me souviens de commentaires et de situations au cours de certains projets où j’ai failli perdre patience. Tu te retrouves devant des gens qui se croient tout permis. On te fait sentir très fort qu’il y a une hiérarchie. En télé particulièrement, il y a tellement de contraintes et on te dicte ce que tu peux ou ne peux pas faire. Ce qui est frustrant, c’est que non seulement il y a cette espèce de cadrage là très strict, mais en plus il y a une fermeture à essayer de comprendre et d’accepter d’autres perspectives. Ça empêche de diversifier les contenus. Concrètement, je trouve que ça nivelle par le bas la qualité de ce qui est créé et ça diminue la possibilité pour des gens de différents horizons de s’identifier aux histoires racontées. On finit par raconter toujours les mêmes choses.
Fragment 22
Dans un texte que j’écris en ce moment, il y a un jeune personnage qui parle un slang prononcé, avec du joual arabe et créole. Et là, on m’a averti·e : « Va peut-être falloir sous-titrer ce qu’il dit. » Ça m’a triggered : sous-titrer pourquoi ? On comprend très bien ce qu’il dit ! En tant que scénariste de couleur, ce n’est pas vrai que je vais mettre mon nom sur un projet où il y a un personnage arabe qui va être sous-titré ! Le personnage parle français ! Est-ce qu’on met des sous-titres pour moi lorsqu’on fait des scènes avec des Gaspésien·nes ?! Non.
Fragment 23
Même si le Wapikoni mobile a été fondé en collaboration avec la nation atikamekw et que Manon Barbeau était sensible dans son approche, il y avait toute la question d’arriver dans les communautés et d’être perçu·es comme des Blanc·ches qui viennent faire des films avec des instruments de Blanc·ches. Encore aujourd’hui, dans les communautés, ce sont beaucoup les aîné·es qui racontent et partagent les histoires. Les traditions orales ont leur importance. Une personne blanche qui arrive et montre aux jeunes comment raconter des histoires, est-ce qu’elle ne se substitue pas un peu à l’aîné·e, et ce, sans aucune légitimité ancestrale ? C’est une question que je me pose souvent.
Fragment 24
J’ai déjà voulu raconter l’histoire d’un Inuit qui arrivait à Montréal. Et j’ai abandonné le projet après un an et demi parce que je n’étais pas à l’aise. Et ça a pris du temps, parce que je me disais : « J’ai le droit de le faire si c’est bien fait. » Mais je n’étais pas à l’aise du tout. Pis, à un moment donné, ta réflexion se transforme, évolue. Cela dit, c’est continuellement dans ma tête, à chaque projet : est-ce que je prends la place de quelqu’un ? Et en même temps, j’ai le privilège d’avoir ces occasions-là, de pouvoir parler, de faire des films et des séries. Raconter ma vie de gars avec des problèmes de gars ou celle de gens du Plateau qui ont besoin d’un vin nature le vendredi soir… Ça ne m’intéresse pas, ça ! Chaque fois que je me suis mis à écrire une histoire près de moi, vraiment près de ma vie à moi, je me disais : « Je gaspille mon temps ! » Je n’en ai pas, de combat, moi. C’est comme les histoires d’amour : ça ne m’intéresse pas – à moins que ça soit une histoire d’amour campée dans un réalisme social.
Fragment 25
Admettons que j’écris un scénario de film ou de série sur des Haïtien·nes à Saint-Michel, je ne pense pas qu’il soit primordial que j’aie un·e Haïtien·ne dans mon équipe d’écriture… Mais il est primordial qu’en cours de route, je discute en profondeur du projet avec des gens de la communauté et qu’ils lisent et approuvent le contenu du scénario. Et que des comédien·nes de la communauté intègrent le projet, en fassent partie et le défendent avec moi. C’est un travail d’équipe, tout ça. Moi, je suis le gouvernail et j’amène ça dans un sens, mais c’est un travail d’équipe. « Je suis un auteur, et c’est moi qui décide de tout ! » : ce type d’attitude, très peu pour moi ! Tu sais, on entend souvent ça, dans le milieu culturel : « Moi, j’écris des histoires, pis c’est mon roman, c’est mon film… et je ne dois rien à personne ! » Et à ça, je réponds : « Mais ferme ta gueule ! » Comment ça, « tu ne dois rien à personne » ?! Ton livre est publié, ton film sort en salles : le monde peut le lire, le voir. Tu as une responsabilité – à moins que tu ne parles que de lutins ou de trucs insignifiants. Mais si tu parles d’un milieu de vie, tu as une sorte de responsabilité, même si tu cherches à t’en dérober.
Fragment 26
Quand j’ai commencé à travailler pour le Wapikoni, on était encore à l’ONF (Office national du film du Canada) et il y avait seulement quatre personnes dans l’équipe de bureau. Depuis, l’organisme a grossi. Le Wapikoni s’est doté d’un département de distribution, qui, lui, en résumé, veut des bons films pour aller dans des gros festivals. Au début, il y a eu un peu de tensions, puisqu’on observait une certaine tendance à encourager la coréalisation de films entre le·a participant·e autochtone et le·a formateur·rice allochtone. J’étais, et je suis encore, profondément contre ce type d’approche. Manon Barbeau était très sensible à tout ça, mais le discours de l’organisme à ce sujet-là a vraiment changé lorsqu’Odile Joannette a pris la relève à la direction du Wapikoni mobile et qu’on s’est mis à parler davantage de souveraineté narrative. C’est là un concept porteur qui met le·a créateur·rice de l’avant et s’assure qu’iel est en contrôle de son projet. Moi, en tant que cinéaste, dans mon monde professionnel, je ne fais plus ma propre caméra, je ne fais pas mon son : c’est délégué, ces affaires-là. Je n’ai pas pour autant l’impression de perdre la souveraineté narrative de mes projets. Mais là, dans le contexte des escales du Wapikoni, c’est différent, puisque c’est un contexte communautaire d’initiation et d’apprentissage. Nous, on arrive là en tant qu’expert·es, donc les participant·es vont se fier à nous. La question se pose : jusqu’où doivent-iels s’en remettre à nous pour réaliser leurs projets ? C’est un réel enjeu. Il y a des participant·es qui commencent un projet et qui abandonnent à mi-chemin : est-ce qu’on laisse le projet foirer ou bien on donne un petit push pour que le projet existe et que cette personne-là, qui était simplement découragée, soit fière de son accomplissement ? En même temps, parfois, on a fait un push un peu trop fort, et après ça, les participant·es sont envoyé·es à l’étranger dans des festivals et on leur demande de parler de leur processus créatif et… iels ne sont pas en moyen de le faire ! Ce n’est pas leur rendre service, ça. Au cours des dernières années, dans les escales, j’ai pris le parti de ne plus toucher à la caméra. On enseigne, on conseille, on donne du feedback, mais on ne touche pas à la technique pendant les tournages. Cela dit, la tentation d’intervenir est grande : les formateur·rices sont souvent des cinéastes, et durant les escales défile devant nous une série de sujets incroyables, inédits, auxquels on n’aurait jamais accès autrement… Et ça nous brûle les doigts de toucher au truc, de créer. Mais, ce n’est pas notre rôle. Avoir de plus en plus de formateur·rices autochtones aide aussi à préserver la souveraineté narrative des projets. Il m’arrive de participer au processus d’embauche de nouveaux·elles formateur·rices, et durant les entrevues, j’insiste vraiment beaucoup auprès des candidat·es (surtout les allochtones) : les films réalisés lors des escales ne sont pas vos films !
Fragment 27
Tu sais, moi, je ne pense pas que je doive taire ma voix masculine-blanche-hétérosexuelle. Je pense que j’ai le droit d’être qui je suis, mais sans chercher à toujours me mettre en situation d’opposition avec les autres. Malheureusement, c’est là un réflexe que je vois souvent chez les gars dans le milieu. Plusieurs se plaignent : « On ne peut plus rien dire ! », « On veut nous effacer ! »… Mais non, monsieur, tu es encore là. Pis le monde veut ce qu’il veut, mais on est encore là pour longtemps. Ce qu’il faut, c’est une pluralité de voix, une diversité de voix. Peut-être que, dans 10 ans, lorsqu’il y aura plein de scénaristes et de réalisateur·rices de couleur, je vais peut-être moins ressentir l’urgence de raconter certaines histoires.
Fragment 28
Si tu essaies de raconter une réalité qui n’est pas la tienne, tu viens à bout de souffle créativement, parce que ce n’est pas ton histoire. Ce n’est pas seulement une affaire d’avoir peur d’être critiqué·e et d’être pointé·e du doigt. Je repense à un projet qui a avorté et je me rends compte qu’on manquait de réflexion. Je le voyais venir : je manquais de jus, je ne connaissais pas la réalité que j’essayais de mettre en scène. J’avais atteint mes limites. Ce projet-là n’a pas vu le jour pour plein de raisons, mais s’il avait continué, il aurait fallu aller en consultation, et là, j’aurais fait de la place à quelqu’un d’autre.
Fragment 29
Je trouve que, lorsqu’on dit : « C’est de la fiction, ce n’est pas grave si ce n’est pas authentique », on se déresponsabilise. Moi, souvent, ce que je remarque, c’est que les gens, après avoir regardé un film ou une série qui se passe dans un milieu qui est très éloigné de leur petite réalité, tiennent comme vérité ce qu’ils ont vu à l’écran. C’est pour ça que je trouve qu’on a une forme de responsabilité en tant que scénariste-réalisateur·rice envers les gens, les situations et les environnements que l’on dépeint, surtout s’il s’agit de gens et de milieux de vie généralement marginalisés dans notre société. À la limite, je m’en fous si ce que je fais est bon ou pas : ce qui m’importe, c’est que les personnes que je représente ne se sentent pas insultées. Se dédouaner devant les critiques en disant : « Ah, c’est juste une histoire ! », je trouve que c’est manquer une occasion d’affirmer quelque chose, sinon d’assumer le fait qu’on s’est trompé. Moi, j’en ai dit, des affaires que je regrette ! J’évolue. Je pense que c’est important.
INTÉGRATION PROFESSIONNELLE, RACISME ET TOKÉNISME
Fragment 30
C’est simple, je ne me sens pas intégré·e. Personnellement, ça va, mais professionnellement, zéro : mon intégration est désastreuse. Pour s’intégrer dans le milieu, en fait, il faut être né·e ici. Si vous êtes né·e au Québec, vous avez fait des formations de cinéma ici, vous parlez comme les gens d’ici et tout ça – et là, vous arrivez bien ! Aussi, les métiers du cinéma s’apprennent sur le tas et, idéalement, il faut donner de l’argent aux gens pour qu’ils puissent raconter leurs histoires, parce que c’est en faisant qu’ils vont apprendre. Oui, ils peuvent apprendre un peu à mieux écrire des scénarios à l’école et à l’université, mais on revient toujours à la même chose : comment les nouveaux·elles arrivant·es peuvent-iels vraiment rivaliser avec Denys Arcand, avec Xavier Dolan devant les institutions ?
Fragment 31
J’aimerais que, si tu rencontres beaucoup de personnes comme moi pour cet article, tu fasses en sorte que les gens entendent nos voix. Il faut que les Québécois·es [de naissance], les responsables des programmes au Conseil des arts et ailleurs nous entendent. Parce que, nous, les immigrant·es, on ne voit personne, on ne parle avec personne et on a toujours quelque chose à dire, on a des histoires à raconter. On aimerait bien être intégré·e dans la machine. Ce n’est pas juste l’argent qui nous manque, c’est surtout de nouer des relations professionnelles avec des Québécois·es. On est toujours prêt·e à travailler avec les Québécois·es, mais les Québécois·es ne veulent pas de nous.
Fragment 32
Les escales du Wapikoni mobile dans les communautés s’étalent sur un mois. La roulotte-studio est transportée par un camionneur. On engage quelqu’un localement à titre de coordonnateur·rice, qui prépare un peu le terrain avant notre arrivée, qui met des affiches, qui annonce à la radio, etc. Dans l’équipe qui vient de l’extérieur de la communauté, il y a deux formateur·rices cinéastes et un·e intervenant·e. On essaie, autant que possible, d’envoyer les mêmes équipes aux mêmes endroits annuellement pour assurer une certaine continuité. Avec les années, dans les communautés, on embauche aussi des ancien·nes participant·es comme assistant·es, puis comme formateur·rices cinéastes. Ça fait partie du processus de décolonisation même du Wapikoni que de faire en sorte qu’en définitive, le pourcentage de formateur·rices autochtones soit le plus élevé possible.
Fragment 33
Les panels, les tables rondes, les articles, etc. : le plus souvent, c’est juste pour « discuter », mais sans action. C’est discuter pour se donner bonne conscience. Dans le milieu, il n’y a pas d’actions concrètes, et on nous fait porter un double fardeau : 1) déjà, on vit du racisme, et 2) il faut être capable d’en parler en tout temps d’une façon super articulée.
Fragment 34
Je ne suis plus en début de carrière. Ce dont parlent les jeunes auteur·rices aujourd’hui, je l’ai aussi vécu avant. Mais ce que j’ai trouvé dur l’année passée [en 2020], c’est que les décideur·euses ont pris certains moyens, comme les quotas, et vraiment rapidement la dynamique du milieu a viré au mépris. Je sentais du mépris à travers quantité de commentaires exaspérés que j’entendais, du genre : « Là, il faut changer les personnages ! Moi, j’ai écrit ma série avec un lead blanc, et là faut que je switch pour une femme noire ! » Ça chialait et ça chiale encore beaucoup. C’est violent : « Là, à cause de vous, faut qu’on fasse ça ! » C’est dur. Et si tu parles, tu crains d’être tassé·e d’un projet et de ne pas être payé·e. Ça ou, à l’inverse – mais ça revient au même –, on t’approche pour n’importe quel projet « qui a de la diversité ». Dans le fond, tout ce qu’on veut, c’est que ce soit plus inclusif comme milieu, mais là, c’est comme : « Bon, il faut créer des personnages noirs ! » Sans pour autant demander aux gens « de la diversité » d’écrire leurs propres projets. Mais concrètement, nous, « la diversité », on ne vous demande pas d’inventer des personnages noirs : on vous demande de nous laisser notre place ! On se retrouve souvent à devoir éduquer les gens. Par exemple, à devoir expliquer que, lorsqu’on disait qu’on voulait plus de diversité à l’écran, c’est parce qu’il fallait aussi nous inclure dans le processus créatif !
Fragment 35
On m’approche parce que je suis Noir·e. Ça m’est arrivé à plusieurs reprises. On pense à moi pour un projet juste parce que je suis Noir·e : « C’est la diversité, c’est toi, on a pensé à toi. »
Fragment 36
On m’a déjà appelée pour me pitcher une affaire à 24 heures d’avis, parce que leur projet devenait soudainement « projet femme » et avait « plus de chances d’être sélectionné ». C’est un autre enjeu là, mais j’imagine que ça ressemble à ce que peuvent vivre aussi des personnes de couleur dans le milieu. « Les gars blancs, devant la SODEC et Téléfilm, on est pénalisés d’avance ! » : ça, je l’entends tout le temps. C’est rendu socialement acceptable, dans certains petits cercles, de s’apitoyer sur son sort : « Ce n’est pas la bonne époque pour être un homme blanc ! C’est plus facile d’être Noir, d’être gai… » Le monde ne s’en cache même pas. Je trouve que c’est une connerie monumentale. Ça témoigne d’un réel manque de réflexion.
Fragment 37
Un jour, une productrice (blanche) d’une grosse boîte (avec laquelle je n’ai jamais travaillé) me téléphone. Je savais qu’il y avait un appel à projets en cours auprès d’un diffuseur et tout le monde déposait quelque chose (c’est comme ça que ça fonctionne dans le milieu). On était deux jours avant la date limite, et en raison du succès récent de certaines émissions telles que M’entends-tu ? (2018-2021) à Télé-Québec, tout le monde pense que les diffuseurs « veulent de la diversité ». Alors on appelle les deux-trois scénaristes de couleur relativement connu·es du milieu en leur disant : « Peut-on écrire votre nom sur le projet juste pour le dépôt ? » La productrice qui m’appelle, donc, me dit : « Salut, on dépose un projet et on voudrait savoir si tu souhaiterais collaborer avec l’auteur… » L’auteur en question est un homme blanc. Je demande plus d’infos. La productrice m’explique que c’est l’histoire d’une femme noire qui se transforme en homme blanc pour intégrer un univers professionnel X. Et là, il y a eu un long silence. Je demande si on envisage d’avoir recours à des prothèses et à du maquillage (à la Mrs. Doubtfire) ou si on va utiliser deux comédien·nes pour le tournage. La productrice me dit candidement : « Je pense qu’on va y aller avec deux commédien·nes. » J’étais comme : « OK, donc c’est l’histoire d’une femme noire jouée, genre, par Claude Legault… ?! » Et là, la productrice me répond : « Ah, on n’avait pas vu ça de même… mais c’est vrai… » Finalement, je raccroche. Le lendemain, je reçois un texto de l’auteur : « Salut, c’est X. La productrice m’a raconté votre conversation d’hier et je trouve que tu as vraiment des points intéressants. Peut-on se parler à 14 h aujourd’hui ? » Sérieux, non. C’est aussi quelque chose de fatiguant, ça : sentir qu’on s’attend à ce tu sois toujours disponible. On ne te demande pas tes disponibilités pour une rencontre. Non. Il faut en fait que tu sois disponible pour elleux. Et c’est toujours extrêmement à la dernière minute, et on s’attend à ce que tu aides et « sauves » le projet – même si, au détour, on te fait sentir qu’on t’accorde une faveur en t’offrant la « chance » de travailler à leur côté.
Fragment 38
Pour les personnes de couleur dans le milieu, il y a cette pression de devoir être parfait·e, de ne pas avoir le droit à l’erreur, parce que, si tu te plantes, on ne va pas dire : « Ah, tel·le auteur·rice a foiré », mais : « Ah, les Noir·es sont moins solides. »
Fragment 39
Le fait d’être une femme dans ce milieu vient avec son lot de défis, mais il y a un double down pour les femmes noires. Parce que, déjà, les femmes se font tout le temps mansplainer leur métier, mais quand tu es Noire, il y a un truc de plus : tes interlocuteur·rices blanc·ches tiennent toujours pour acquis que tu es une amatrice ou une incompétente.
Fragment 40
On m’a déjà dit en réunion : « Je ne pense pas que tu comprennes à quel point c’est un sujet délicat, le racisme systémique au Québec… » Quoi ?! Pendant plus d’une heure, il y a une bande de Blanc·ches qui m’expliquent à quel point, moi, une personne de couleur, je ne comprends pas ça, le racisme ! Et on se met à brainstorm d’autres affaires devant moi, par exemple : « On pourrait faire un sketch où, au lieu que ce soit un policier blanc qui bat un Noir, c’est un policier noir qui bat un Blanc ! » Je proteste et on me dit : « De toute façon, peu importe ce qu’on va faire, les Noir·es vont chialer. »
Fragment 41
Faut toujours qu’on mette des gants blancs (!) pour expliquer les choses. On ne vous demande pas de créer des histoires pour « combler le manque de diversité », on vous demande de nous laisser raconter nos histoires nous-mêmes ! Que des producteur·rices, des réalisateur·rices, des auteur·rices non blanc·ches soient visibles dans les médias pour que les jeunes voient et comprennent qu’il y a de la place pour elleux dans le milieu.
Fragment 42
Tu sais, lorsque les gens commencent non pas à perdre – ce n’est pas le bon mot –, mais lorsque les gens ont l’impression que leur légitimité est au minimum remise en question… Ça engendre toutes sortes de réactions. Même avec mon chum, on s’est chicanés là-dessus. À une époque pas si lointaine, on m’appelait plus que lui pour des jobs parce que « je suis une fille réalisatrice ». C’est vrai qu’on m’appelait beaucoup. Mon agent se le faisait dire : « On cherche une fille. » Le monde ne s’en cachait même pas. Pendant ce temps, mon chum se faisait zéro appeler. Évidemment, je me sentais coupable et je me questionnais : est-ce qu’on m’appelle pour mon talent ou seulement parce que je suis une fille ? Tu vas là dans ta tête. En même temps, il y a tellement de réalisatrices talentueuses que tu te dis : « Non, iels m’ont choisie parce que je suis capable de faire la job ! » Mais au début, mon chum se braquait : « Je devrais me faire appeler autant que toi. On devrait se faire appeler de la même manière… » Et j’étais comme : « Cry me a river ! » À un moment donné, faut que ça change et que ça se rééquilibre. Malgré tout, je le sais que mon chum était sincèrement content pour moi. Aujourd’hui, ses affaires roulent bien. Ce qu’il exprimait, ce n’était pas de la jalousie négative… Je pense qu’il avait simplement de la peine et il se questionnait sur comment défendre sa place, comment devenir légitime, comment affirmer sa signature… Mais à travers notre expérience à lui et moi, ce qui ressort, c’est un rapport problématique au sentiment d’entitlement, à ce que l’on considère qui nous est dû.
Fragment 43
En cinéma, comme en télé, souvent, les producteur·rices ont une drôle de manière de parler. Iels « cochent des cases ». C’est vraiment ça. Ce n’est pas une réflexion créative. Iels manquent de curiosité. Mais iels sont dans le jus et ça va vite. C’est ça qui est poche dans notre système – surtout en télé, je trouve. Les producteur·rices sont dans le jus, iels sont tout le temps booké·es, donc iels vont dans la facilité. Et, oui, iels versent dans le tokenism. Il faut que tu viennes à elleux, il faut qu’iels aient entendu parler de toi, il faut que ça sonne une cloche. Iels n’ont pas le temps. Mais ça fait partie du problème que de ne pas avoir de temps pour consommer de la culture, regarder des séries, voir ce qui se fait. Je suis comme : allez voir les courts métrages, les séries et les webséries qui sortent ! Il y a des gens qui font des trucs vraiment nice !
UN MILIEU ET SA STRUCTURE
Fragment 44
Les producteur·rices ont en main une clé que les réalisateur·rices et les scénaristes n’ont pas. Donc, je mets toujours mon chapeau de producteur·rice, parce que c’est là que je peux aller parler à Téléfilm et à la SODEC, qui financent les projets, alors que si je suis « simplement un·e réalisateur·rice », on va me dire : « Va te trouver un·e producteur·rice et reviens nous voir ensuite ! » Pour moi, en fait, le manque de diversité dans les films et les séries, ce n’est pas une question de scénarisation. C’est plutôt une question de financement. Et là, j’insiste beaucoup. Théoriquement, pour pouvoir donner des enveloppes « à la diversité », les organismes financeurs devraient en donner moins aux producteur·rices établi·es. Et, visiblement, ce n’est pas ce qu’ils veulent faire. Alors, on présente la problématique ainsi : « On n’a pas assez de gens de la diversité à l’écran, il nous faut des scénarios de la diversité, etc. », mais on ne dit jamais qu’il faudrait aussi des producteur·rices de la diversité. Même si les producteur·rices blanc·ches commencent à embaucher des Arabes ou des Asiatiques ou des Haïtien·nes ou des Africain·es pour pouvoir montrer qu’il y a de la diversité dans leurs projets, l’argent va aller en premier lieu aux producteur·rices blanc·ches. Tu vois, finalement, c’est assez rusé comme méthode, parce que, justement, les décideur·euses veulent que ce soit l’industrie québécoise blanche qui règle le « problème » de la diversité.
Fragment 45
Ça ne peut plus retomber seulement sur les épaules individuelles des créateur·rices. Je reproche aux organismes financeurs, aux diffuseurs et aux distributeurs – qui sont quand même ceux qui dictent ce qu’on regarde sur nos écrans – leur grande hypocrisie. « Il n’y a pas de réalisatrices dans le milieu, il n’y a pas d’autrices ! » : arrêtez, Téléfilm et compagnie, vous n’avez jamais financé de projet de filles ! C’est ça, la raison. Et après, vous allez mettre ça sur le dos des gars, pis vous vous vantez ensuite d’être « pro-diversité », « pro-féminisme », mais vous financez encore des affaires comme Menteur (É. Gaudreault, É. K. Boulianne) – en 2019, là – où le lead féminin est relayé à un rôle de marde tout le long du film ! Vous êtes responsables. Vous jouez les martyrs, mais vous êtes hypocrites. Vous vous dites paritaires, mais vous donnez les productions avec le moins d’argent aux filles. Je ne pense pas que tout le monde dans ces institutions-là soit nécessairement mal intentionné, mais il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond ! Vous voulez de la diversité ? Qu’est-ce que vous faites concrètement à ce sujet depuis 10 ans ?
Fragment 46
C’est tellement un petit milieu consanguin que j’ai l’impression que les gens se complaisent un peu dans un système qui les sert bien. Il y a ça aussi qui joue, je pense, dans le fait de ne pas oser parler à visage découvert. En télé, il y a trois diffuseurs au Québec, donc si tu en fais chier un, tu sais bien qu’il ne te dira plus jamais oui.
Fragment 47
Dans le milieu, il y a de la complaisance et un entre-soi à déconstruire. Je pense qu’il faudrait commencer notamment par choisir autrement avec qui on travaille et être plus curieux·euses en général. Est-ce que je le fais ? Sûrement pas assez. Il faut aussi accepter le fait qu’on puisse se tromper. Reconnaître nos maladresses et réellement être à l’écoute des personnes qui nous les pointent.
Fragment 48
Si ce que tu fais [un atelier thématique, une embauche, la création d’un personnage, voire l’écriture d’un article] se limite à n’être qu’une initiative ponctuelle dans le milieu, c’est comme un coup d’épée dans l’eau.
Fragment 49
Je pense que la solution, c’est d’avoir plus de personnes de couleur dans les postes clés : production, diffusion, etc. Je ne demande pas aux personnes blanches d’écrire des histoires pour nous – continuez d’écrire vos histoires : je me suis déjà projeté·e dans vos histoires, ce n’est pas ça le problème. C’est plutôt d’avoir notre place dans l’industrie qui est le problème. Et aussi, au lieu de me faire lire ton scénario, peux-tu lire et produire mon scénario ? Au lieu de me dire que je devrais créer des personnages blancs, « puisqu’il n’y a pas d’acteurs de couleur », peux-tu simplement faire tes recherches ? À l’origine, je pensais que c’était parce que ça coûtait plus cher de prendre le temps de faire des recherches… Mais non, c’est parce qu’on ne veut pas faire l’effort ! Faudrait qu’on mette fin à cette espèce de mauvaise foi. Je pense donc qu’il faut qu’il y ait des personnes de couleur dans des postes clés pour changer les dynamiques en présence. Parce que tu la vois, la différence, quand tu échanges avec un·e producteur·rice de couleur ! Dès que des personnes de couleur sont dans des postes clés, ça ouvre des possibilités et – peu importe le domaine – le truc devient systématiquement plus inclusif.
Fragment 50
Moi, j’aimerais bien voir le jour où il y aura plusieurs producteur·rices noir·es. Je pense que c’est vraiment important que les droits d’auteur reviennent aux Noir·es. Que ce soit Black owned. Et à partir de ce moment-là, je sais qu’il y aura des occasions de travail pour les artisan·es, les artistes, les auteur·rices noir·es.
Fragment 51
Lorsque des gens – des têtes fortes, aujourd’hui très politisées – vont se retrouver dans les bureaux de la SODEC pour défendre des projets, devant un analyste de type « homme blanc » chargé de leur dossier, je pense que quelque chose va éclater. On va nommer des choses, du genre : « Ce que tu essaies de m’imposer là, pour mon projet, c’est une vision coloniale. » Je pense que ça va se dire, et il va y avoir des gens prêts à ça et d’autres qui ne le seront pas et qui vont crier au « wokisme ». Mais je trouve qu’il est grand temps que ce type de remise en question arrive. Il faut que les gens se décentrent. Il faut que les gens arrêtent de voir le monde depuis leur seule perspective et commencent à écouter.
+
Personne ne connaît mieux que ses victimes la réalité d’une discrimination. Sommes-nous à égalité, oui ou non ? Si oui, alors la première chose à faire quand un non-Blanc vous parle de racisme, c’est de l’écouter en mettant de côté son biais blanc. De prendre le temps d’entendre ce qu’il a à dire, de réfléchir aux arguments qu’il déploie. Peut-être est-il un peu excessif, peut-être souffre-t-il d’un délire de persécution… mais peut-être pas. Et si ce qu’il dit est corroboré par un grand nombre de témoignages et soutenu par plusieurs études sociologiques, alors il a sûrement raison.
Lilian Thuram, La pensée blanche[4]
Parties annexes
Notes biographiques
GABRIELLE TREMBLAY est professeure au Département d’études littéraires de l’Université du Québec à Montréal. Ses travaux récents portent sur les liens entre littérature, cinéma et pratiques scénaristiques au Québec. En 2015, elle a publié Scénario et scénariste, un ouvrage dédié à la reconnaissance institutionnelle de l’objet scénaristique dans le monde de l’art cinématographique en France.
LES NEUF AUTEUR·RICES ANONYMISÉ·ES qui cosignent, avec Gabrielle Tremblay, le texte « Diversité scénaristique » : Une discussion chorale, sont des scénaristes et des scénaristes-réalisateur·rices travaillant au Québec. La majorité d’entre elleux sont des personnes de couleur. Collectivement, iels rendent compte d’une grande diversité de parcours et d’expériences vécues dans le milieu de la télévision, de la websérie et du cinéma québécois.
Notes
-
[1]
Je tiens à témoigner de ma sincère reconnaissance envers la générosité des personnes rencontrées lors des entretiens, ainsi qu’envers le rigoureux travail de transcription effectué par Gaëlle Baumans. Les propos recueillis ont été transcrits le plus fidèlement possible. Des reformulations et des ajouts ponctuels ont cependant été nécessaires pour assurer la lisibilité des éléments cités. Une partie des personnes rencontrées n’ont pas le français comme première langue.
-
[2]
Le Wapikoni mobile est un organisme de médiation, d’intervention, de formation et de création audiovisuelles qui, depuis 2004, va à la rencontre de nombreuses communautés autochtones, principalement au Québec, mais aussi ailleurs au Canada et à l’étranger. Pour une présentation détaillée de l’organisme, on peut consulter son site Web : www.wapikoni.ca. On trouvera également des éléments d’explication quant au fonctionnement et à la réalité de terrain du Wapikoni mobile dans les fragments 23, 26 et 32 du présent texte.
-
[3]
Selon les statistiques d’État disponibles, au Canada, une personne sur cinq appartiendrait à une minorité visible, et à l’échelle du Québec, il s’agirait d’une personne sur dix – ce qui représente plus de 800 000 personnes.
-
[4]
Lilian Thuram, La pensée blanche, Montréal, Mémoire d’encrier, 2020, p. 160.