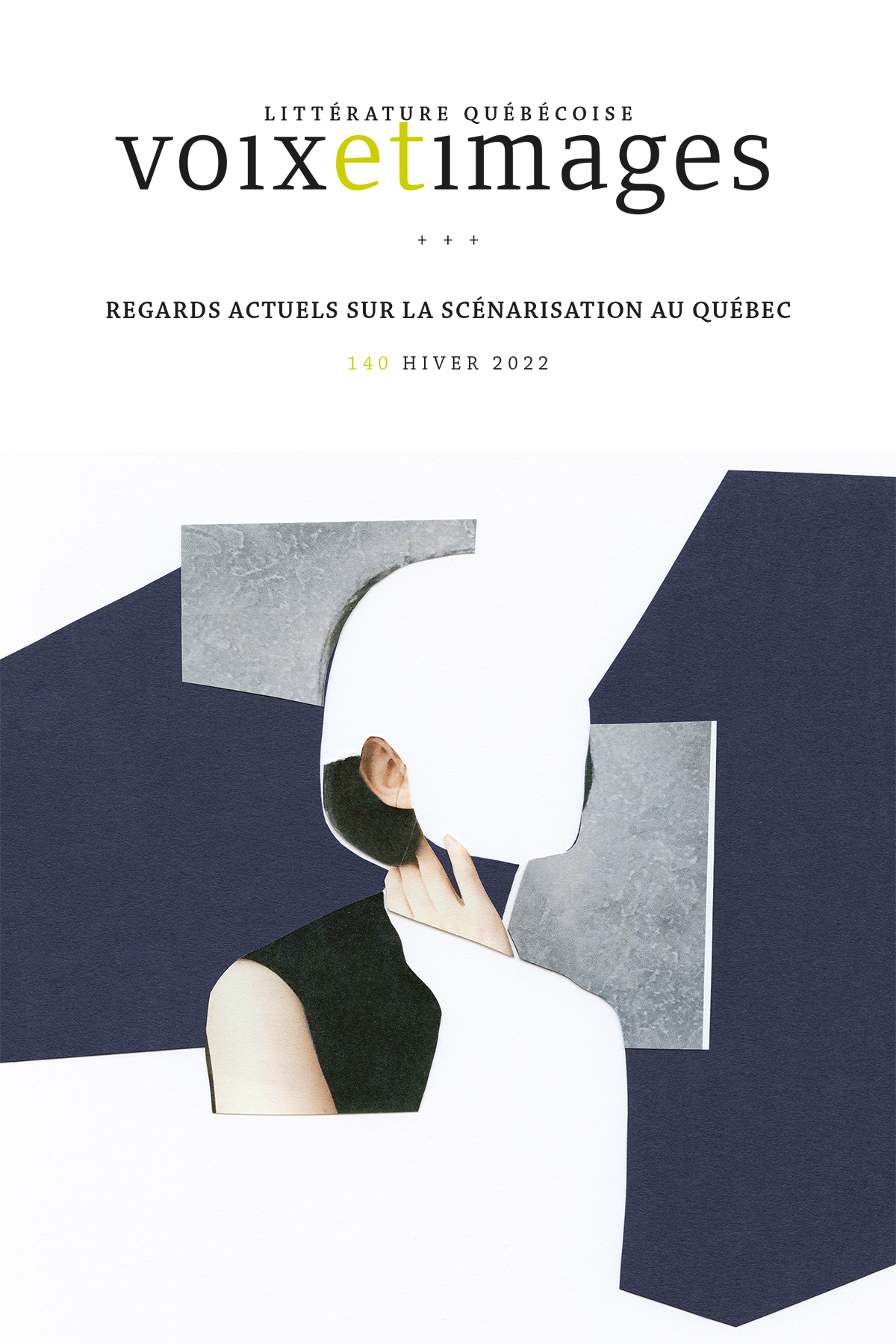Corps de l’article
À l’aune du chemin parcouru par les études queer québécoises ces dernières années, on constate un développement assez considérable. À mesure que se multiplie le nombre d’articles et de livres, de mémoires et de thèses qui abordent des sujets queer dans un contexte québécois, la diversité s’accroît même si le champ des études queer demeure émergent, surtout en contexte francophone[1]. La modeste production du côté francophone s’explique peut-être par le cheminement « particulièrement long et ardu[2] » des théories queer dans les milieux féministes franco-québécois. Malgré tout, aujourd’hui, nous avons à portée de main plusieurs textes qui retracent certaines trajectoires des discours queer québécois, et dans cette chronique, je me hasarderai à quelques remarques sur ces filiations pour tenter de répondre à cette question : qu’y a-t-il de queer dans les études queer actuelles au Québec[3] ?
Dans le livre One-Dimensional Queer, Roderick A. Ferguson problématise la façon d’imaginer les origines de la théorie queer comme étant unidimensionnelles :
Pendant très longtemps, nous avons cru que la libération queer était apparue comme un événement à problème unique qui concernait simplement la sexualité. Par conséquent, nous nous sommes dit que la politique queer en était venue aux questions de race, de colonisation, d’incarcération et de capitalisme plus tard dans son développement[4].
Le livre de Ferguson raconte « une autre histoire, dans laquelle une multitude de préoccupations multidimensionnelles étaient là dès le début, mais ont été occultées par la suite[5] ». Dans la même veine, le champ queer américain est sans doute encore trop guidé par ce que David Eng et Jabir Puar appellent une politique de localisation « non marquée » et « non interrogée » qui rend opaques les conditions matérielles de sa production. Selon Eng et Puar
les études queer sont devenues une forme particulière d’études régionales américaines – forme dont la prémisse tacite est l’exceptionnalisme américain, son économie politique et sa culture populaire ; il est nécessaire d’élargir nos archives queer pour considérer les expériences historiques en dehors du Nord global, écrites dans des langues autres que l’anglais[6].
Dans un contexte québécois, on est peut-être tenté de se féliciter de produire des travaux queer dans une langue autre que l’anglais, mais il me semble néanmoins important de réfléchir à la manière dont le queer au Québec mobilise à son tour une politique d’exceptionnalisme et de localisation non marquée et non interrogée. Quelles communautés, et quels processus de relationnalité et de sociabilité sont exclus de ce qu’on appelle le champ queer dans le contexte du Québec ? Quelles archives sont rendues lisibles, crédibles et, en effet, importantes sous l’étiquette queer ? Quelles sont les formes reconnaissables de blessures et d’attachements sexuels qui animent la résistance queer ? Et qu’est-ce qui est laissé de côté ? Ma tentative de réponse non exhaustive à ces questions est divisée en trois parties, chacune ancrée dans un discours différent. D’abord, je pose un regard rétrospectif sur l’homophobie du projet nationaliste, pour ensuite m’attarder sur ce que j’appelle le coming out queer du Québec et le discours homonational qui lui est propre. En conclusion, je présenterai plusieurs penseurs queer qui revendiquent des attaches et des filiations autres que le sujet national blanc. Pour répondre à ces questions qui portent sur le ici et maintenant, je commence par un bref retour en arrière qui nous permettra de situer le queer dans le contexte québécois.
WHO’S YOUR DADDY?
Tout d’abord, il me semble important de reconnaître ce que Robert Schwartzwald appelle « la résilience tragique des figures homophobes[7] » dans les productions culturelles québécoises. Je pense par exemple à son texte « Fear of Federasty: Québec’s Inverted Fictions », dans lequel il recense et analyse avec précision l’homophobie du projet nationaliste québécois. Schwartzwald pointe les figures homophobes qui accompagnent le discours de libération nationale, dans lequel les traîtres à la cause de la révolution sont dépeints, de façon négative et répétée, comme étant des hommes passifs[8]. Les prêtres correspondent aux « faux pères » et remplissent « des devoirs de femme dans leurs relations avec le Canada anglophone, [ce sont] des fils efféminés, des hommes ratés, des hommes en jupes », ce qui mène Schwartzwald à conclure que « l’anticléricalisme allait de pair avec l’homophobie[9] ». Le portrait est celui d’un peuple sans « vrais » hommes, sans « vrais » pères, d’une nation d’« orphelins anxieux » qui manque de « maturité phallo-nationale[10] ».
Pourtant, à mon avis, il faudrait s’attarder plus longuement sur certains aspects du discours nationaliste que Schwartzwald survole assez rapidement. Pensons à Johanne, par exemple, la fameuse amante de Claude dans À tout prendre, une femme noire sans nom de famille, qui, selon Schwartzwald, est disqualifiée du discours nationaliste en raison de son origine haïtienne. Étrangère, « elle ne peut que représenter la fuite de l’homme québécois devant son obligation de conquérir et de posséder son propre territoire[11] ». Ou encore à la panique homosexuelle qui alimente l’écriture de Hubert Aquin, lequel, dans un essai publié en 1988, a lâché un commentaire homophobe contre les arts du spectacle, les qualifiant de « forme d’expression culturelle appropriée pour les esclaves précisément en raison de son caractère imitatif et répétitif[12] ». Schwartzwald propose également que les anciennes générations, pour contourner leur angoisse d’abandon, ont essayé de se faire passer pour ce qu’il appelle des « nobles primitifs », prêts à se lancer dans un projet de (re)naissance[13]. Ces références à un personnage noir, à l’esclavagisme et aux stéréotypes autochtones font preuve d’un malaise non seulement sexuel, mais racial également.
LE COMING OUT QUEER (ET HOMONATIONAL) DU QUÉBEC
Malgré l’inventaire qu’il dresse de l’homophobie quasi ambiante entourant le projet nationaliste, Schwartzwald avance que « le Québec est, selon toutes les normes traditionnelles, une société particulièrement non homophobe[14] », lui qui a été « la première juridiction en Amérique du Nord à adopter une législation condamnant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle[15] ». La visibilité des préoccupations LGBT au début des années 1970 a sans doute inspiré certains auteurs de l’époque[16]. On pense assurément aussi aux hommes comme Pierre Vallières et Pierre Bourgault, pères gais et blancs de la pensée souverainiste. Mais quelle est la fonction de la normalisation des personnes LGBTQ+ dans la famille souverainiste qui trouve son souffle au Québec, surtout avec le mariage gai et l’homoparentalité ? L’homonationalisme, concept queer de Jasbir Puar, nous permet de penser l’instrumentalisation des enjeux LGBTQ+ au sein de rapports de pouvoir afin d’exclure et de stigmatiser des minorités racisées, et plus particulièrement les musulmans. Dans le contexte québécois, un discours homonationaliste s’élève des débats sur la laïcité et se perpétue par exemple à travers les médias gais, ou l’islam apparaît intrinsèquement lié à l’homophobie, selon les recherches doctorales d’Olivier Roy[17]. Comme l’explique la sociologue Leila Benhadjoudja, « le jeu discursif orientaliste est à l’oeuvre dans la construction du “soi” national, garant de l’égalité de genre et des sexualités, vis-à-vis d’un autre, étranger (musulman), et sexuellement pervers et oppressif[18] ».
En se penchant sur le film C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée (2005), Chantal Nadeau réfléchit elle aussi aux « liens intimes entre nationalisme et homosexualité », ou à ce qu’elle appelle « la proximité de l’espace public homosexuel et du nationalisme souverainiste[19] ». Selon Nadeau, « il n’y a pas d’exclus en termes de droits, mais que des retardataires. Il n’y a pas d’exclus en soit [sic], que des exclus inclus[20] ». Ce qui fascine Nadeau « dans cette course effrénée à la reconnaissance de la famille queer, c’est d’ailleurs ça : une obsession presque pathologique de se dire même[21] », et d’être incorporé dans la famille souverainiste. Et pareillement, dans son compte rendu de Moi aussi, j’aime les hommes, Pierre-Luc Landry tâche d’être critique à l’égard de l’ouvrage qui recueille la correspondance entretenue par deux hommes gais et blancs, Simon Boulerice et Alain Labonté. L’échange est instigué par Labonté après qu’il a vu les images au journal télévisé de l’assassinat d’un homme homosexuel par des militants de Daesh. Comme l’explique Landry, « [l]’ouvrage est pavé de bonnes intentions […], [t]outefois, cela se fait à travers des lettres infiniment mises en scène et malheureusement teintées par un homonationalisme parfois subtil, parfois évident[22] ». Mentionnant que les deux auteurs « se réjouissent d’être nés dans un pays “rassurant” [et] déplorent les décalages “effarants” entre le Moyen-Orient et les pays occidentaux », Landry souligne qu’Alain Labonté
va même jusqu’à déclarer la précellence du Québec sur le reste de la planète en prenant pour exemple la production à l’Opéra de Montréal de la pièce Les feluettes de Michel Marc Bouchard, oubliant de préciser au passage les protestations bruyantes de certains abonnés de l’Opéra qui ont refusé de voir une « pièce homosexuelle » sur scène. À Montréal. En 2016[23].
Le sujet gai blanc, tolérant, ouvert d’esprit et libéré, bref « moderne », est inclus dans les coulisses du pouvoir de la nation pour légitimer et renforcer d’autres formes d’exclusion. La sexualité devient la métrique pour évaluer les cultures dites « civilisées » ou « barbares » dont parlent Eng et Puar[24], un véhicule du racisme. Si les lois et pratiques homophobes ne peuvent être ni niées ni soutenues, réduire cette violence macropolitique et plurielle à « sa seule dimension culturelle ou religieuse » pour abaisser l’islam (ou quelque religion ou culture que ce soit) à une anti-modernité, c’est, selon l’anthropologue Abdelwahed Mekki-Berrada, « être dans le déni face aux méfaits du capitalisme sauvage transnational et à la non-redistribution des richesses, face à la militarisation croissante du monde et aux guerres qui enrichissent certains et en assassinent d’autres après les avoir rudement appauvris[25] ».
TOUJOURS ET DÉJÀ QUEER
Pourtant, nous avons de multiples exemples d’écrits queer qui revendiquent des attaches autres que la nation et le sujet blancs. Je pense par exemple à Hosanna de Michel Tremblay, où le personnage principal ne parvient pas à se situer par rapport aux deux pôles du système binaire du genre, pas plus, selon Elaine Pigeon, que par rapport à la nation[26]. Or, cette « absence complète de pouvoir constitue », comme l’écrit à bon droit Jorge Calderón, « sa plus grande force[27] ». Je pense aussi à « Une histoire de blackface » de Marilou Craft, qui s’interroge : « [L]a colère noire est-elle une prise de position queer[28] ? » Ses recherches concernant le racisme systémique présent dans le milieu théâtral québécois l’amènent à conclure que « si le théâtre est raciste, c’est que nous le sommes aussi. L’admettre, c’est adopter une posture non seulement antiraciste, mais aussi radicalement queer[29] ». Et je pense à Nous sommes un continent de Karine Rosso et Nicholas Dawson, qui a comme objectif d’amplifier la portée de la pensée de l’écrivaine chicana Gloria Anzaldúa en français[30]. Dans un entretien récent avec Salvador David Hernandez, Rosso critique la filiation queer unilinéaire et le manque d’analyse intersectionnelle :
Anzaldúa m’a aussi fait prendre conscience que le féminisme dans lequel j’évoluais à l’université est encore teinté de colonialisme, puisque j’ai vite constaté que ses apports aux théories queer, par exemple, ont été en grande partie effacés de l’historiographie de la pensée queer francophone. J’avais déjà observé que les milieux féministes francophones étaient majoritairement blancs et que le concept d’intersectionnalité était souvent vidé de sa dimension raciale, mais les travaux d’Anzaldúa m’ont permis d’étayer les modalités de cet effacement[31].
Dans Nous sommes un continent, Dawson et Rosso proposent « de traverser les continents et les disciplines du savoir afin de décentrer la parole blanche, unilingue […] qui domine les médias et la culture[32] », selon la préface. Le livre a fait l’objet d’un compte rendu dans lequel Dominic Tardif explique que les deux amis, respectivement d’origine chilienne et colombienne, se racontent leur « expérience de la violence d’un monde qui tente de les contraindre à choisir leur camp (le français ou l’espagnol, la fiction ou la théorie) » dans une « correspondance mestiza » traversée par la pensée d’Anzaldúa :
Visite des coulisses d’un milieu littéraire au coeur duquel les personnes racisées doivent réclamer le droit de parole, chronique de la naissance d’une amitié généreusement exigeante, éloge d’une démarche intellectuelle préférant le doute et l’introspection aux coups de gueule ; ces lettres à la fois clairvoyantes et digressives possèdent la principale qualité d’un échange épistolaire digne de ce nom : elles autorisent la vulnérabilité[33].
La valorisation de l’absence du pouvoir, l’aveu de l’échec de nos institutions racistes, la reconnaissance de l’apport de la vulnérabilité… voilà des thèmes toujours et déjà queer.
On pense aussi au texte de Karine Bertrand, « Sexualité autochtone, traditions et liens intergénérationnels[34] », paru dans un numéro queer de Quebec Studies. Bertrand propose plusieurs analyses des courts métrages réalisés par les jeunes Autochtones du Wapikoni mobile, un projet d’intervention socioculturelle fournissant aux jeunes Autochtones les outils et les conditions propices à la réalisation et à la diffusion de courts métrages. Elle réfléchit à la manière dont la réappropriation culturelle et la construction de l’identité sexuelle des jeunes passent par la réduction du fossé intergénérationnel et par l’expression de soi. La sexualité et le genre non binaires sont le propre de beaucoup de cultures des Premières Nations, qui n’obéissent pas systématiquement aux diktats de l’hétéropatriarcat blanc[35]. Si j’ai analysé ailleurs la façon dont Tomson Highway s’appuie sur la notion de bispiritualité pour créer, dans Champion et Ooneemeetoo (1998), des personnages queer qui transcendent les constructions binaires sur lesquelles se base la masculinité hégémonique[36], aujourd’hui, l’apport de la diversité sexuée et genrée me semble beaucoup plus large que la simple remise en question du genre binaire.
D’abord, on comprend assez rapidement qu’il existe beaucoup de façons d’être queer qui dépassent la cohérence linéaire de ce que Gayatri Gopinath appelle « un sujet “gai” pleinement réalisé[37] », entendu au sens de « ayant fait son coming out », ce qui présuppose « des formations sociales et historiques euroaméricaines[38] ». C’est d’ailleurs ce que nous dévoile l’analyse de Bertrand du court métrage Two Spirit, réalisé par l’équipe du Wapikoni. Nous y rencontrons un jeune Anishnabe dynamique qui assume en toute sérénité ses préférences sexuelles, que nous suivons dans son quotidien pendant les quelques minutes que dure le documentaire. Alors qu’il est en visite chez un aîné bispirituel, ce dernier lui explique que le phénomène du coming out n’a pas lieu d’être parce que, dès un jeune âge, les enfants sont identifiés par leur famille comme étant two spirit et reconnus comme tels[39], ce qui rend le concept de coming out incohérent. Je pense aussi à As We Have Always Done, dans lequel l’auteure michi saagiig nishnaabeg Leanne Betasamosake Simpson confie, en parlant des intersections entre les études queer et les études autochtones : « J’ai l’impression que mes ancêtres vivaient dans une société où ce que j’appelle queer, en particulier en matière d’organisation sociale, était si normal que ça ne portait aucun nom[40]. » Ces exemples révèlent au grand jour la blanchité qui se cache derrière les concepts de placard et de normativité, concepts fortement contestés aujourd’hui par nombre de chercheur·euses noir·es, autochtones et racisé·es.
Finalement, l’idée selon laquelle le Québec fut « la première juridiction en Amérique du Nord » à protéger les droits LGBTQ+ me semble également douteuse sachant que les Premières Nations, pour la plupart, n’avaient pas besoin de lois semblables puisque, dans leurs cultures, la discrimination contre les personnes queer était tout simplement impensable. Et contrairement aux stéréotypes qui font des Autochtones des êtres figés dans le passé, les écrivain·es et artistes autochtones sont à l’avant-garde en ce qui concerne les identités genrées et sexuées. « Comme l’eau qui précède la vie[41] », pour emprunter la formule poétique de Billy-Ray Belcourt dans Cette blessure est un territoire, les queeritudes autochotones précèdent ainsi la violence coloniale, les lois LGBTQ+, et le queer lui-même.
Parties annexes
Note biographique
CORRIE SCOTT est professeure à l’Institut d’études féministes et de genre à l’Université d’Ottawa et membre associée de l’Équipe de recherche en études queer au Québec (ÉRÉQQ). Elle s’intéresse actuellement à la littérature québécoise en lien avec le colonialisme, la blanchité, le racisme et la masculinité. Elle est auteure de De Groulx à Laferrière : un parcours de la race dans la littérature québécoise (XYZ, 2014), ainsi que de plusieurs articles et chapitres d’ouvrages, notamment : « La blanchité sous la loupe des écrivains autochtones » (Voix Plurielles, 2021), « Fuck l’enfant ; le temps queer et québécois au féminin », (Québequeer, 2020), et « Cowboys et Indiens : masculinités, métissage et queeritude chez Tomson Highway et Louis Hamelin », (temps zero, 2013).
Notes
-
[1]
Isabelle Boisclair, Pierre-Luc Landry et Guillaume Poirier Girard (dir.), « Avant-propos. La pensée queer », QuébeQueer. Le queer dans les productions littéraires, artistiques et médiatiques québécoises, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Nouvelles études québécoises », 2020, p. 12.
-
[2]
Geneviève Pagé, « La lente intégration du queer au féminisme québécois francophone : douze ans de résistance et le rôle de passeur des Panthères roses », Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique, vol. L, no 2, juin 2017, p. 535.
-
[3]
Clin d’oeil au célèbre numéro de la revue Social Text intitulé « What’s Queer about Queer Studies Now? » (Social Text, vol. XXIII, nos 3-4, automne-hiver 2005).
-
[4]
« For the longest time we have believed that queer liberation arose as a single-issue event that was simply about sexuality. Hence, we have told ourselves that queer politics came to issues of race, colonization, incarceration, and capitalism later in its development. » Roderick A. Ferguson, One-Dimensional Queer, Cambridge, Polity Press, 2019, p. 6. Toutes les traductions sont les miennes.
-
[5]
« This book tells a different story, one in which a multidimensional host of concerns were there from the very beginning only to be excised later on. » Ibid.
-
[6]
« Queer studies has become its own particular form of US area studies—one that takes American exceptionalism, its political economy and popular culture, as its unspoken premise—it is necessary to expand our queer archive to consider historical experiences outside the global North written in languages other than English. » David L. Eng et Jasbir K. Puar, « Introduction : Left of Queer », Social Text, vol. XXXVIII, no 4, décembre 2020, p. 4.
-
[7]
« [T]he tragic resiliency of homophobic tropes and their consequences », Robert Schwartzwald, « Fear of Federasty: Québec’s Inverted Fictions », Hortense J. Spillers (dir.), Comparative American Identities: Race, Sex, and Nationality in the Modern Text, New York, Routledge, 1991, p. 176.
-
[8]
Ibid., p. 179.
-
[9]
« [F]alse fathers, performing womanly duties in their relationship with Anglo-Canada, effeminizing sons, failed men, men in skirts », Ibid., p. 185.
-
[10]
« [A]nxious orphans », « Phallo-national maturity », Ibid., p. 180.
-
[11]
« [S]he can only represent the flight of the Québécois man before his obligation to conquer and possess his own territory », Ibid., p. 183 ; Schwartzwald souligne. Pour une discussion plus détaillée concernant le personnage de Johanne, voir Gregorio Pablo Rodríguez-Arbolay, « Black Bodies, Queer Desires : Québécois National Anxieties of Race and Sexuality in Claude Jutra’s À tout prendre (1963) », Jump Cut : A Review of Contemporary Media, no 58, printemps 2018, en ligne : https://ejumpcut.org/archive/jc58.2018/Rodriguez-ATP-race-sex/index.html (page consultée le 26 août 2022).
-
[12]
Robert Schwartzwald, « Fear of Federasty: Québec’s Inverted Fictions », p. 186.
-
[13]
« [N]oble primitives », Ibid., p. 188.
-
[14]
« Québec is, by any conventional standards, a very non-homophobic society », Ibid., p. 180.
-
[15]
« [T]he first state jurisdiction in North America to adopt anti-discriminaton legistlation on grounds of sexual orientation », Ibid., p. 180.
-
[16]
Par exemple Victor-Lévy Beaulieu, selon l’analyse que fait Bruno Laprade du roman Oh Miami Miami Miami (1973) : Bruno Laprade, « La libération par le sexe. L’homosexualité dans Race de monde et Oh Miami Miami Miami », Isabelle Boisclair et Jacques Pelletier (dir.), Victor-Lévy Beaulieu, le sexe et le genre, Montréal, Nota bene, coll. « Cahiers Victor-Lévy Beaulieu », 2014, p. 163-187.
-
[17]
Olivier Roy, « The Colour of Gayness: Representations of Queers of Colour in Québec’s Gay Media », Sexualities, vol. XV, no 2, mars 2012, p. 175-190. Je pense aussi aux recherches de Valérie Lapointe et Luc Turgeon (« Diversités sexuelles et construction nationale : une exploration des frontières de l’homonationalisme au Québec », Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique, vol. LIV, no 2, juin 2021, p. 397-415), de Leila Benhadjoudja (« Laïcité narrative et sécularonationalisme au Québec à l’épreuve de la race, du genre et de la sexualité », Studies in Religion/Sciences religieuses, vol. XLVI, no 2, juin 2017, p. 272-291 ; « Les femmes musulmanes peuvent-elles parler ? », Anthropologie et Sociétés, vol. XLII, no 1, 2018, p. 113-133), de Sirma Bilge (« “… alors que nous, Québécois, nos femmes sont égales à nous et nous les aimons ainsi” : la patrouille des frontières au nom de l’égalité de genre dans une “nation” en quête de souveraineté », Sociologie et sociétés, vol. XLII, no 1, printemps 2010, p. 197-226) et de Chantal Nadeau (« C.R.A.Z.Y. Nous/Nu », Nouvelles Vues, no 9, automne 2008, p. 1-15), entre autres.
-
[18]
Leila Benhadjoudja, « Laïcité narrative et sécularonationalisme au Québec à l’épreuve de la race, du genre et de la sexualité », p. 278.
-
[19]
Chantal Nadeau, « C.R.A.Z.Y. Nous/Nu », p. 2.
-
[20]
Ibid., p. 10.
-
[21]
Ibid.
-
[22]
Pierre-Luc Landry, « Littérature queer. Le refus du ghetto et des regroupements vaseux », Nuit blanche, magazine littéraire, no 147, été 2017, p. 36.
-
[23]
Ibid.
-
[24]
David L. Eng et Jasbir K. Puar, « Introduction : Left of Queer », p 7.
-
[25]
Abdelwahed Mekki-Berrada, « Présentation. Femmes et subjectivations musulmanes : prolégomènes », Anthropologie et Sociétés, vol. XLII, no 1, 2018, p. 28, qui renvoie alors à l’ouvrage de Lila Abu-Lughod, Do Muslim Women Need Saving ?, Cambridge, Harvard University Press, 2013, 336 p.
-
[26]
Elaine Pigeon, « Hosanna ! Michel Tremblay’s Queering of National Identity », Terry Goldie (dir.), In a Queer Country: Gay and Lesbian Studies in the Canadian Context, Vancouver, Arsenal Pulp Press, 2001, p. 46.
-
[27]
Jorge Calderón, « Hosanna, l’art queer du “flop” », Isabelle Boisclair, Pierre-Luc Landry et Guillaume Poirier Girard (dir.), QuébeQueer, p. 288.
-
[28]
Marilou Craft, « Une histoire de blackface », Isabelle Boisclair, Pierre-Luc Landry et Guillaume Poirier Girard (dir.), QuébeQueer, p. 349.
-
[29]
Ibid., p. 359.
-
[30]
Nicholas Dawson et Karine Rosso, Nous sommes un continent : correspondance mestiza, Montréal, Triptyque, coll. « Difforme », 2021, p. 9.
-
[31]
Karine Rosso et Salvador David Hernandez, « Enjeux du féminisme transfrontalier et décolonial », Nouveaux Cahiers du socialisme, vol. XXVII, hiver 2022, p. 169.
-
[32]
Nicholas Dawson et Karine Rosso, Nous sommes un continent, p. 8.
-
[33]
Dominic Tardif, « Nous sommes un continent », Le Devoir, 21 juin 2021, en ligne : https://www.ledevoir.com/lire/611739/nous-sommes-un-continent (page consultée le 26 août 2022).
-
[34]
Karine Bertrand, « Sexualité autochtone, traditions et liens intergénérationnels. Le cinéma comme bâton de parole de la jeunesse autochtone québécoise », Québec Studies, vol. LX, no 1, 2015, p. 83-104.
-
[35]
Ibid., p. 85-86.
-
[36]
Corrie Scott, « Cowboys et Indiens. Masculinités, métissage et queeritude chez Tomson Highway et Louis Hamelin », temps zéro, no 7, décembre 2013, en ligne : http://tempszero.contemporain.info/document1108 (page consultée le 26 août 2022).
-
[37]
« [A] fully realized “gay” subject ». Gayatri Gopinath, « Nostalgia, Desire, Diaspora: South Asian Sexualities in Motion », Jana Evans Braziel et Anita Mannur (dir.), Theorizing Diaspora : A Reader, Malden, Blackwell Publishing, 2003, p. 268.
-
[38]
« Euroamerican social and historical formations » Ibid., p. 272.
-
[39]
Karine Bertrand, « Sexualité autochtone, traditions et liens intergénérationnels », p. 99.
-
[40]
« [M]y sense is that my Ancestors lived in a society where what I know as “queer”, particularly in terms of social organization, was so normal it didn’t have a name. » Leanne Betasamosake Simpson, As We Have Always Done: Indigenous Freedom through Radical Resistance, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2020, p. 138 ; je souligne.
-
[41]
Billy-Ray Belcourt, Cette blessure est un territoire [This Wound is a World], traduit de l’anglais par Mishka Lavigne, Montréal, Triptyque, coll. « Queer », 2019 [2017], p. 7.