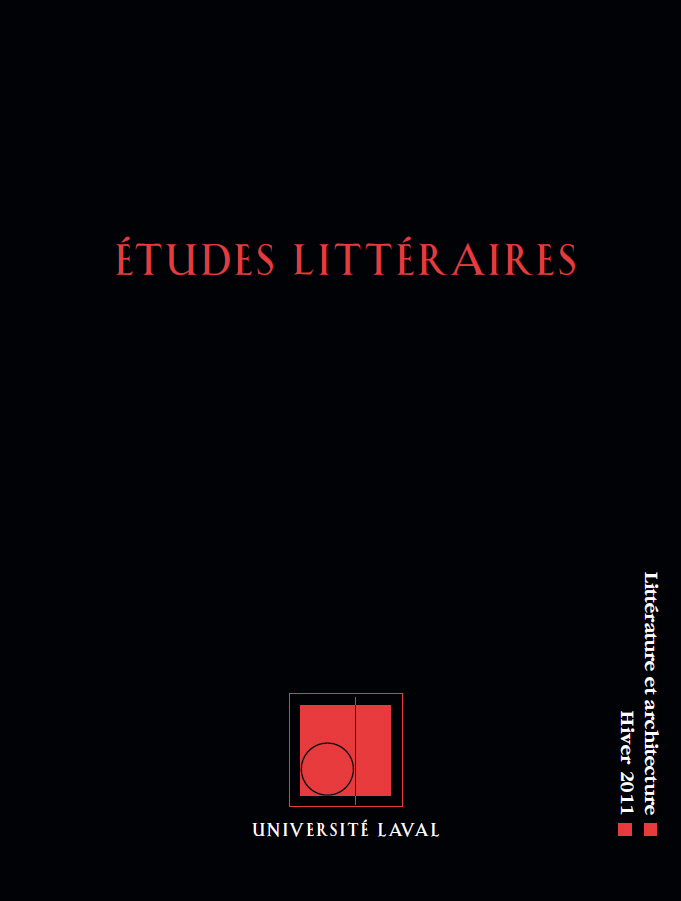Résumés
Résumé
Lorsqu’Arthur Rimbaud écrit les poèmes qui composeront par la suite Illuminations, l’architecture imaginaire n’est pas une nouveauté : les romantiques, avec Hugo, Gautier et Nerval, ont déjà exploré ce thème porteur, que Baudelaire a repris dans son poème intitulé « Rêve parisien ». Ces rêveries se rattachent à une poétique de la voyance que Rimbaud prolonge et renouvelle : l’on serait même tenté de dire que la voyance rimbaldienne trouve son expression la plus accomplie dans ces villes de rêves. Ces visions où architecture et nature se confondent à la faveur d’un style flamboyant ont fait l’objet de nombreux commentaires. De ces analyses il ressort une double ambivalence : l’architecture rimbaldienne apparaît comme un espace à la fois attractif et menaçant, une scène où se joue le drame de la création et de la destruction. L’imaginaire du poète réécrit des mythes tels que l’enfer et le paradis d’une part, la genèse, le déluge et l’apocalypse de l’autre. Ce décor mythique semble renvoyer, sur le plan psychologique, aux désirs et aux angoisses du poète. Ce qui intéresse le poéticien, ce sont non pas les mythes en eux-mêmes, mais leur appropriation par le sujet rimbaldien. L’enjeu de ce travail sera en définitive d’étudier comment l’espace et l’architecture dans Illuminations traduisent les préoccupations intimes du poète.
Abstract
During Arthur Rimbaud’s penning of the poems that would eventually become his Illuminations, imaginary architecture is no longer a novelty. Romantics such as Hugo, Gautier and Nerval have already delved in its appeal, and Baudelaire echoed it in his poem titled « Rêve parisien » (« Parisian Dream »). Such imaginings derive from a poetic framing of soothsaying that Rimbaud revisits and expands : one could even say that the oracular Rimbaud is best found in such dreamscapes. Visions of architecture melding flamboyantly with nature have given rise to much speculation. These analyses yield a dual ambivalence : Rimbaud’s architecture is both attractive and threatening, and a drama featuring both creation and destruction. The poet’s imagination recasts such myths as heaven and hell on the one hand, and genesis, deluge and apocalypse on the other. His mythical décor seems to echo his psychological wants and angst. These myths interest poeticians much less than Rimbaud’s take on them. We shall therefore look at how space and architecture in Rimbaud’s Illuminations depict his intimate preoccupations.
Corps de l’article
Architecte de mes fééries,
Je faisais, à ma volonté,
Sous un tunnel de pierreries,
Passer un océan dompté[1]
La rêverie architecturale et urbaine est l’un des thèmes favoris de la voyance poétique au XIXe siècle. En décrivant des villes imaginaires dans ses Illuminations, Arthur Rimbaud s’inscrit en filiation avec les architectures babéliennes de Victor Hugo, les constructions oniriques de Nerval, les métropoles fantastiques de Gautier[2] ou les cités minérales et épurées de Baudelaire. Cependant, les édifices rimbaldiens se distinguent de cet héritage visionnaire non seulement de par leur originalité formelle, mais aussi à travers l’importance qu’ils accordent à la subjectivité du poète. En effet, les jeux énonciatifs, la récurrence de certains motifs et la réécriture toute personnelle de plusieurs mythes incitent le poéticien à se demander comment et pourquoi cette architecture poétique en vient à représenter l’imaginaire du sujet rimbaldien. Cette analyse se situe en marge des études déjà publiées sur ce thème[3] et adopte donc la démarche de la poétique du sujet conceptualisée par Christian Chelebourg comme « un point de vue synthétique sur l’imaginaire, considéré […] comme le moyen par lequel le sujet soumet la réalité à son narcissisme[4] ».
« Ville monstrueuse » — une architecture transgressive
La ville moderne s’impose véritablement en poésie avec Les fleurs du mal et Le spleen de Paris de Baudelaire. Ce thème fondamental des Illuminations est annoncé, visionné même, dès le poème final d’Une saison en enfer : « Et à l’aurore, armés d’une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes » (157)[5]. La ville rimbaldienne se démarque toutefois de la cité minérale des Fleurs du mal et du décor brumeux du Spleen de Paris. Prélude aux excès de la décadence, elle est, comme l’écrit le poète dans un idiolecte exploitant essentiellement la polysémie[6], « monstrueuse » (163), et l’adjectif ici est à prendre, comme souvent chez Rimbaud, dans tous les sens du terme.
La ville que l’on ne cesse de visiter sur la route onirique des Illuminations est d’abord un espace de démesure. De poème en poème, Rimbaud évoque ainsi « [des] distance[s] énorme[s] » (« Enfance V », 163), une « acropole officielle » (« Villes » [2], 171) qui « outre les conceptions de la barbarie moderne les plus colossales » et qui « reproduit dans un goût d’énormité singulier toutes les merveilles classiques de l’architecture ». Monstre gigantesque, cette cité grandit et prolifère : les ponts et les monuments se multiplient à l’infini ; la singularité est une exception, l’hyperbole est la figure maîtresse : la ville rimbaldienne est une ville au pluriel, comme l’indique d’ailleurs le titre de plusieurs poèmes.
Monstrueuse, cette ville toujours réécrite l’est aussi de par sa nature composite : le poète nous décrit une hybridation de lieux, d’époques, d’esthétiques et de styles, comme dans « Métropolitain » :
Des routes bordées de grilles et de murs, contenant à peine leurs bosquets, et les atroces fleurs qu’on appellerait coeurs et soeurs, Damas damnant de longueur, — possessions de féériques aristocraties ultra-Rhénanes, Japonaises, Guaranies, propres encore à recevoir la musique des anciens […].
175
Dans cette description pleine de fantaisie, le style nominal confère à la parole poétique une force évocatoire : les éléments architecturaux et naturels (« routes bordées de grilles et de murs » / « bosquets », fleurs »), ainsi que les contrées les plus diverses (« aristocratie ultra-Rhénanes, Japonaises, Guaranies ») se conjuguent à la faveur d’une perspective dont le caractère merveilleux est souligné par l’adjectif « féeriques ». Le jeu de sonore « Damas damnant » associe la ville à cette topique infernale, combinaison que l’on retrouvera sous une forme nouvelle dans la correspondance africaine du poète[7]. À la fois hétéroclite, anachronique et « anatopique[8] », cette création proprement magique se traduit stylistiquement par une écriture de la parataxe, ainsi que l’explique Dominique Combe dans son étude consacrée aux oeuvres du poète : « Cette technique de la juxtaposition, au sein du paragraphe comme de la phrase, confirme une propension à l’énumération et à la liste inhérente à la description et à l’ekphrasis[9] ». Le signifiant est à l’image du signifié, la ville est à l’image du poème. Il s’agit d’une créature hybride qui tient, comme dans « Promontoire », de la nature et de l’art — alliance que la métaphore totale « Palais-Promontoire » (179) synthétise à merveille ; mais il s’agit aussi d’une création fantasmatique où les souvenirs londoniens du poète côtoient l’imagerie orientale, où se mélangent un exotisme de convention et des indices biographiques bien réels.
Monstrueuse encore que cette ville animée qui enfreint ouvertement les lois de la physique, comme dans la série de poèmes intitulés « Villes », où l’on voit des « chalets de cristal et de bois qui se meuvent sur des rails et des poulies invisibles » (170), ainsi que des quartiers aux « parties inexplicables » (« Villes » [2], 171). Les adjectifs « invisibles » et « inexplicables » mettent en relief, dans l’un et l’autre des poèmes, toute l’essence surnaturelle, et par là même illusoire, de ces architectures urbaines. Et le poète d’évoquer, dans « Soir historique », de manière quasi métapoétique et autocritique, le caractère à la fois surnaturel et intime de sa poésie : « Le plus élémentaire physicien sent qu’il n’est plus possible de se soumettre à cet [sic] atmosphère personnel, brume de remords physiques, dont la constatation est déjà une affliction » (180). Les lois naturelles, que défend le physicien, cèdent le pas à l’imagination du poète : laisser parler cette puissance créatrice, c’est déroger aux lois de la nature ; faire de la poésie, c’est fondamentalement verser dans le surnaturel. Rêver de villes poétiques, c’est rêver de villes surnaturelles. Le magistère universel de la raison est remplacé par la législation fantaisiste de l’imaginaire intime, « cet[sic] atmosphère personnel ». Notons au passage que le changement de genre que le poète fait subir au substantif atmosphère constitue moins une faute que le signe d’une écriture qui superpose masculinité et féminité : c’est, en l’espace d’un syntagme, traduire au moyen de la rêverie architecturale une orientation sexuelle que l’on sait problématique.
Enfin, le monstre est, d’un point de vue étymologique, la chose que l’on montre. Dominique Combe met l’accent sur le caractère descriptif et pictural des Illuminations, ce que le titre choisi par Verlaine traduit admirablement : « tout en défaisant les cadres habituels de la représentation, la prose rimbaldienne possède la faculté de faire naître des images mentales qui s’imposent avec la vivacité colorée de “painted plates”[10] ». L’essentiel des poèmes de ce recueil est en effet constitué de textes à dominante descriptive où présent de l’indicatif, lexique de la vue et autres présentatifs actualisent par la lecture les monuments prodigieux qu’échafaude la fantaisie rimbaldienne : « Ce sont des villes ! » La cité imaginée par Rimbaud est donc une créature énorme, hors-norme, que l’on voit naître, croître, s’agiter et mourir suivant les caprices du voyant. L’écriture de la ville procède chez lui non seulement de l’ekphrasis, mais aussi de l’hypotypose[11] : plus que des peintures fidèles, ce sont des tableaux vivants, proprement animés. De surcroît, les architectures rimbaldiennes se présentent comme des constructions verbales qui, tout en faisant le lien entre les aspirations de la prose baudelairienne et les prémisses de l’esprit décadent, représentent un imaginaire personnel.
Le spectacle de l’intimité
Depuis la période préromantique, le rapport à l’espace est devenu émotionnellement signifiant : les paysages décrits reflètent les états d’âme des poètes ; ils sont chargés de leurs désirs et de leurs angoisses. Chacun se souvient des pages mélancoliques que Chateaubriand consacre à la nature dans ses Mémoires d’outre-tombe. Dans le sillage de ce thème romantique, la ville deviendra un véritable mythe littéraire incarnant, de Hugo à Baudelaire, les fantasmes architecturaux des poètes voyants. De même, chez Rimbaud la cité rêvée constituera l’analogon poétique de son architecture intime, son reflet sur le papier.
Il convient en premier lieu de bien considérer les modalités de la voyance telle qu’elle est pratiquée dans les Illuminations. Dominique Combe insiste sur la présence récurrente dans le recueil, aux côtés de la dominante descriptive évoquée précédemment, de l’imagerie théâtrale :
Cette dimension dramatique des poèmes est également essentielle pour la prose des Illuminations, qui participent de la fascination de l’époque pour le théâtre. […] Rimbaud […] témoigne […] d’une tendance prononcée à dramatiser, à théâtraliser ses « fictions » poétiques. Les proses font ainsi dramatiser le narratif et le dramatique[12].
Il faut ajouter que du point de vue de l’archétypologie durandienne, les symboles spectaculaires tels que la « fenêtre » (« Ville », 169), l’« étoile » (« Phrases », 168) et la « lumière » (« Villes » [1], 170) sont d’ailleurs nombreux et le champ lexical de la vue est très présent. Mais le plus important est que cette topique théâtrale permet de définir l’écriture rimbaldienne comme procédant d’une psychomythie, c’est-à-dire « d’une fiction intime, engendrée par l’imaginaire[13] » et qui « fonde la démarche narcissique du créateur » : l’espace urbain est le théâtre où se produit le drame intérieur du poète ; mieux, il est le reflet mimétique et baroque de ce drame. Du reste, l’énallage par lequel Rimbaud passe, de poème en poème, du « Je » (« Ville », 169) au « Tu » (« Jeunesse IV ») et au « Il » (« Conte ») témoigne de cette volonté de se mettre littéralement en scène, d’être à la fois auteur, architecte, spectateur et personnage de sa création. Souvenons-nous de ce passage de la seconde lettre du voyant : « Mais il s’agit de faire l’âme monstrueuse […] ! [§] Je dis qu’il faut être voyant, se faire voyant » (227). Les soulignements invitent à lire le vocable mis en relief à la fois comme un substantif et un adjectif : pratiquer la voyance, c’est voir ce qui n’existe que dans l’imagination, mais aussi être vu et se donner en spectacle à travers la description de ses fantasmagories[14]. C’est montrer et se montrer, et ce à travers la ville, miroir de l’imaginaire du poète.
C’est dans cette optique d’une projection du moi dans l’écriture que la symbolique de l’eau et du feu à l’oeuvre dans le recueil met en lumière l’une des tensions fondatrices de cet imaginaire poétique. L’élément liquide n’est pas qu’une surface réfléchissante, comme dans le mythe de Narcisse ; il est aussi, on le sait, l’un des symboles maternels par excellence. Relisons ce que Bachelard nous dit à son propos :
L’intuition de la boisson fondamentale, de l’eau nourricière comme un lait, de l’eau conçue comme l’élément nutritif, comme l’élément que l’on digère avec évidence, est si puissante que c’est peut-être avec l’eau ainsi maternisée qu’on comprend le mieux la notion fondamentale de l’élément[15].
Dans Illuminations, la portée intime de ce symbolisme se manifeste tout d’abord à travers le motif récurrent de la « haute mer » — ayons l’oreille poétique, et entendons : lahaute mère. Partagé entre le désir et la mélancolie, ce motif traduit spatialement l’hymne à la genetrix des textes classiques, mais il constitue aussi et surtout une évocation symbolique de Vitalie Rimbaud, mère sévère, imposante et peu aimante du poète : ainsi, dans « Après le déluge », on tire des barques « vers la mer étagée là-haut comme sur les gravures » (161) ; dans « Enfance II », des « nuées s’amass[ent] sur la haute mer faite d’une éternité de chaudes larmes » (162) ; dans « Enfance IV », le poète s’imagine être « un enfant abandonné sur la jetée partie à la haute mer » (163) ; dans « Villes » [1] enfin, l’on voit « Au-dessus du niveau des plus hautes crêtes, une mer troublée par la naissance éternelle de Vénus, chargée de flottes orphéoniques et de la rumeur des perles et des conques précieuses » (170), une mer « qui s’assombrit parfois avec des éclats mortels ». La mer des Illuminations est un océan de « chaudes larmes » faisant désirer à l’enfant poète un amour féérique qui, pour « l’éternité », lui échappe. De manière significative, l’autre motif aquatique important des Illuminations est celui de la neige et de la glace, qui renvoie à la froideur renommée de Vitalie : que l’on songe à « Being beauteous » et à cet « Être de Beauté de haute taille » (165), qui n’est pas sans rappeler la « Beauté » (141) du poème liminaire d’Une saison en enfer, dans laquelle Christian Chelebourg voit une allégorie de la mère[16]. Quant au feu, lui aussi omniprésent dans le recueil, il reprend le thème de l’enfer et de la damnation, qui traverse l’oeuvre rimbaldienne, notamment à travers tel passage de « Barbare » : « les feux à la pluie du vent de diamants jetée par le coeur terrestre éternellement carbonisé pour nous » (176). Le « coeur » du poète est devenu un enfer, un lieu de damnation : en effet, qu’est-ce que le dam, sinon la privation de l’amour de Dieu ? Dans l’imaginaire du poète, la figure maternelle a remplacé la figure divine. L’eau et le feu symbolisent ainsi respectivement la frustration affective du poète et son obsession du châtiment éternel.
Cette double postulation, qui se résume à considérer le manque d’amour comme une damnation, correspond à la confusion, dans le recueil, de trois formes d’espaces clos symbolisant à la fois le désir d’un abri et la peur de l’enfermement : ces trois espaces sont la tombe, la prison et le refuge. Au début d’« Enfance V », le poète réclame une tombe, symbole christique qui permet d’euphémiser la mort en sommeil : « Qu’on me loue enfin ce tombeau, blanchi à la chaux avec les lignes du ciment en relief — très loin sous terre » (163). Le substantif « tombeau » et le locatif « très loin sous terre » mobilise deux des mythèmes infernaux : la mort et l’ensevelissement. Mais cette tombe se change peu après en prison urbaine, vertigineuse et infernale :
À une distance énorme au-dessus de mon salon souterrain, les maisons s’implantent, les brumes s’assemblent. La boue est rouge ou noire. Ville monstrueuse, nuit sans fin ! […] Pourquoi une apparence de soupirail blêmirait-elle au coin de la voûte ?
163
On assiste ici à une première rupture d’isomorphisme : le motif de la chute chtonienne s’inverse en fuite architecturale et ascensionnelle. De même, le recueil est parsemé d’espaces déserts exprimant l’absence, la solitude, le manque, mais aussi la quête d’un refuge : « auberge vide » (162), « château […] à vendre » et « loges […] inhabitées » dans « Enfance II » ; ou au contraire le repos et la plénitude paradoxale, comme le « grenier » (166) de « Vies III », où l’on a enfermé le poète. Ce balancement entre la mélancolie, le désir et la peur traverse les Illuminations. Imaginer un « autre monde » (169), comme dans « Ouvriers », c’est imaginer une « habitation bénie par le ciel et les ombrages » aussi bien qu’une prison éternelle à la fois étroite et gigantesque, souterraine et béante. En somme, un trou ouvert sur l’infini.
Dans son immensité, la ville est l’hyperbole synthétisant les antagonismes du sujet. Le poète en quête et en manque d’amour s’y projette en damné destiné à l’enfer, en enfant abandonné par sa mère et en voyant en quête de repos. La ville se situe ainsi au centre de la psychomythie mise en scène dans le recueil, et la voyance poétique se profile comme une véritable activité imaginaire et architecturale. En ce sens, l’on pourra dire que le thème de l’architecture urbaine est l’image symbolique de l’architecture intime du poète. Mais nous verrons que si ces architectures possèdent les mêmes fondations, elles ont aussi en partage le même destin.
Enfer et paradis
Le XIXe est un grand utilisateur de mythes qui, chez les plus grands poètes, viennent se polariser autour du thème architectural et urbain. De même que les édifices hugoliens[17] se présentent comme des visions mystiques, la cité rimbaldienne sert de support aux réécritures deux mythes antagonistes : le paradis et l’enfer.
Le mythe de l’enfer théologique repose sur deux mythèmes principaux : l’un spatial, celui de l’enfermement souterrain, l’autre temporel, celui de l’éternité de la damnation. La ville des Illuminations se présente en effet comme une prison infernale à laquelle s’ajoute l’idée de damnation volontaire : que l’on se souvienne du tombeau réclamé dans « Enfance V » et que l’on a étudié plus haut ; que l’on songe aussi à telle réflexion du poète, paroles de damné qui se met en scène, comme dans « Vies I » : « Exilé ici, j’ai eu à jouer les chefs-d’oeuvre dramatiques de toutes les littératures » (165). Dans « Ville », Rimbaud modernise l’éternité de la damnation et le sort des damnés tout en apportant une touche païenne à sa vision urbaine de l’enfer :
[…] de ma fenêtre, je vois des spectres nouveaux roulant à travers l’épaisse et éternelle fumée de charbon […] des Erinnyes[18] [sic] nouvelles […] la Mort sans pleurs […], un Amour désespéré, et un joli Crime piaulant dans la boue[19] de la rue.
169
Les « spectres » et la « fumée de charbon » confèrent à la description un aspect nyctomorphe[20] qui cadre parfaitement avec la topique infernale ; les allégories de la « Mort », de l’« Amour désespéré » et de l’ironique « joli Crime » associent manque d’amour maternel et amour homosexuel dans la même damnation. Les Érinyes soulignent enfin le syncrétisme de cette vision infernale.
À ce locus terribilis s’oppose une image proprement édénique de la ville. Retenons que ce mythe de l’Eden est ambivalent, car en langue, le terme paradis tend à confondre le jardin de la genèse et l’espace eschatologique du salut. Le Dictionnaire des symboles rappelle que « le paradis est le plus souvent représenté comme un jardin dont la végétation luxuriante et spontanée est le fruit de l’activité céleste[21] », une « source centrale » irriguant abondamment ce jardin. Les Illuminations offrent une forme urbanisée de ce locus amoenus biblique : dans « Villes » [1], « des moissons de fleurs grandes […] mugissent » (170) ; dans « Villes » [2], « Les parcs représentent la nature primitive travaillée par un art superbe » (171) ; dans « Promontoire » l’on voit s’ériger « des lavoirs entourés de peupliers d’Allemagne ; des talus de parcs singuliers » (179). Domestiquée par des « canaux » (« Promontoire », 179), la source édénique se décline, dans l’espace et dans le texte, en « bras de mer » (« Les ponts », 169), « méandre » (« Marine », 174), « lac » (« Enfance III », 163), « étang » (« Soir historique », 180) et « rivière » (« Métropolitain », 175). On retrouve dans cette énumération d’exemples les traits constitutifs des topoï que sont la végétation généreuse et l’eau abondante. En outre, l’allusion à Diane, aux Bacchantes et à Vénus dans « Villes » [1] rapproche le mythe judéo-chrétien de l’Eden du mythe païen de l’Âge d’or, ce qui confirme la tendance syncrétique de l’imaginaire rimbaldien. Que l’on songe à « Soleil et chair », l’un des premiers textes de Rimbaud, où le poète oppose le bonheur des temps mythologiques à la tristesse de l’ère chrétienne : « […] Oh ! la route est amère / Depuis que l’autre Dieu nous attelle à sa croix » (63).
À la fois paradisiaque et infernale donc, la ville rimbaldienne s’écrit et se bâtit sur le mode de l’antithèse. « Villes » [1] conjugue ainsi de manière vertigineuse les symboles antagonistes de l’ascension et de la chute, du salut et de la damnation :
L’écroulement des apothéoses rejoint les champs des hauteurs où les centauresses séraphiques évoluent parmi les avalanches. […] Des cortèges de Mabs en robes rousses, opalines, montent des ravines. Là-haut, les pieds dans la cascade et les ronces, les cerfs tètent Diane. […] Des groupes de beffrois chantent les idées des peuples. Des châteaux bâtis en os sort la musique inconnue. Toutes les légendes évoluent et les élans se ruent dans les bourgs […]. Le paradis des orages s’effondre.
170
Ici, les « écroulements » sont relevés par les « apothéoses », les « hauteurs » retombent en « avalanches », le substantif « cascade » répond sémantiquement au locatif « Là-haut » et enfin, image superbe, l’idée céleste du « paradis » rencontre le motif de la chute à travers le verbe « s’effondre ». Citons encore « les gouffres d’azur » (163) entrevus dans « Enfance V », ou encore les fameux « brasiers, pleuvant aux rafales de givre » (176) de « Barbare ». L’architecture rimbaldienne procède en fait d’un double mouvement d’infernalisation et d’édenisation de l’espace, dynamique qui trouve son expression la plus synthétique dans le poème « Parade » où, décrivant une procession de luxurieux, Rimbaud met en scène, à la faveur d’un astucieux mais transparent jeu de mots, « le plus violent Paradis de la grimace enragée » (164), véritable « parade sauvage » (164). De « Paradis » à « Parade », des phalanges séraphiques aux danses macabres, il n’y a qu’un pas que le poète luxurieux a franchi plus d’une fois.
En mariant les mythes de l’Eden et de l’Enfer, le sujet rimbaldien élève la ville au rang d’espace à la fois eschatologique et intime où se projettent la nostalgie d’une enfance rêvée, l’espoir d’un salut prochain, et la crainte, ou le voeu, d’une damnation inévitable.
Création et destruction
La seconde grande ambivalence de l’architecture rimbaldienne, qui prolonge d’ailleurs la première, tient au fait qu’elle procède d’une rêverie à la fois créatrice et destructrice. C’est ainsi que sous la plume de Rimbaud, les mythes de la Genèse, du Déluge et de l’Apocalypse se combinent afin de fonder une conception inédite, et paradoxalement lucide, de la voyance poétique.
Dans la Genèse, Dieu invoque la lumière et nomme les choses du monde qu’il crée. De la même manière, les proses rimbaldiennes souscrivent au programme annoncé par une lecture française du titre du recueil et confèrent à l’écriture un caractère démiurgique : l’acte créateur est à la fois une illumination et une nomination. Le plus souvent assertifs ou constitués de phrases nominales ou à présentatifs, les poèmes postulent, dès l’attaque, l’existence d’une réalité nouvelle issue du Verbe et de la lumière. Il s’agit, en termes magiques, de véritables invocations. Ainsi de « Villes » [1] : « Ce sont des villes ! » (170) ; ou encore de la première des « Veillées » : « C’est le repos éclairé » (172). Ce second exemple met l’accent sur la lumière et conséquemment sur le motif du fiat lux, qui illumine le recueil sous des formes diverses, confirmant ainsi la finalité visionnaire de la poésie rimbaldienne tout en révélant sa nature fugace et proprement artificielle : si, comme l’écrit Dominique Combe, « jamais Rimbaud n’aura mieux accompli le projet de “Voyance” qu’il s’était assigné en 1871, et auquel il feignait d’avoir renoncé dans “Alchimie du verbe”[22] », c’est précisément qu’il se détache du magisme romantique pour concevoir la voyance comme une activité proprement poétique, et non plus mystique. En effet, l’illumination, cette lumière à la fois créatrice et « qu’on a créée » (« Villes » [2], 172) est cette même force qui termine le poème et met fin à la vision. Ainsi de la clôture des « Ponts » : « Un rayon blanc, tombant du haut du ciel, anéantit cette comédie » (169). La Genèse rimbaldienne est une création qui, parce qu’elle n’est que poétique et non réelle, c’est-à-dire transitoire, contient en germe sa propre destruction. Pour comprendre cette conception de la voyance poétique, il faut se référer aux deux niveaux d’hallucinations que Rimbaud décrit dans « Alchimie du verbe » :
Je m’habituais à l’hallucination simple : je voyais très franchement une mosquée à la place d’une usine, une école de tambours faite par des anges, des calèches sur les routes du ciel, un salon au fond d’un lac ; les monstres, les mystères ; un titre de vaudeville dressait des épouvantes devant moi. [§]
Puis j’expliquai mes sophismes magiques avec l’hallucination des mots !.
151
Pour reprendre les conclusions d’un précédent travail, je dirais que « l’hallucination simple est celle des sens, l’hallucination des mots celle du sens[23] ». Cependant, l’expression « sophismes magiques » et le substantif « hallucination » mettent en lumière le caractère proprement factice de ces visions : dans la seconde lettre du voyant, Rimbaud évoquait déjà ses « inventions » (229), qu’il qualifiera de « fantasmagories » (146) dans « Nuit de l’enfer ». De même, en présentant le voyant comme un « auteur » et un « créateur » (227), le jeune poète met l’accent sur le poïein, c’est-à-dire le faire poétique. C’est ainsi que dans un passage de « Mauvais sang » Rimbaud disqualifie explicitement la poétique de la voyance : « Les saints ! des forts ! les anachorètes, des artistes comme il n’en faut plus ! » (145). La phrase oppose deux classes de mystiques : « les saints, qui doivent leurs visions à leur force de caractère, et les anachorètes, dont les visions découlent de l’isolement et de l’ascèse, d’un travail de fabrication en somme, ce qui les rapproche des “artistes”, et par conséquent du poète[24] ». Mais dans « Adieu » le dévoilement sera encore plus flagrant, la voyance poétique se réduisant à une mystification littéraire dont le poète reconnaît avoir été la première dupe :
J’ai essayé d’inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues. J’ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien ! je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs ! Une belle gloire d’artiste et de conteur emportée !
157
En somme, le poète n’est pas un intermédiaire entre le monde positif et le monde spirituel, à l’instar du mage hugolien, mais bien plutôt un créateur orgueilleux qui a eu la naïveté de croire en ses propres illusions. Cette prise de conscience apparaît aussi dans « Délires II », où Rimbaud reconnaît son égarement : « Je rêvais croisades, voyages de découvertes dont on n’a pas de relations, républiques sans histoires, guerres de religion étouffées, révolutions de moeurs, déplacements de races et de continents : je croyais à tous les enchantements » (150). Ces énumérations rappellent la poétique hétéroclite des Illuminations ; cependant, Rimbaud fait ici preuve d’une véritable lucidité et interprète « ses rêveries comme des tentatives fantaisistes visant à représenter le monde au moyen de la poésie […] et cela suivant ses désirs[25] ». Le poète éprouve ainsi les limites de la voyance poétique. Les architectures rimbaldiennes n’ont plus l’envergure mystique des visions hugoliennes : elles ne sont plus sont inspirées au poète par une puissance supérieure mais bien par les mouvements de l’âme et les intimations de son imaginaire. En ce sens, elles n’ont qu’une existence poétique qui émerge un instant du chaos pour disparaître presque aussitôt, et ce au rythme de l’écriture et de la lecture.
On comprend ainsi que Rimbaud reprenne à son compte deux mythes qui allient à la fois la destruction et la création. Le premier de ces mythes est le Déluge. Son appropriation par l’imaginaire du poète se traduit par l’usage du pluriel et de la minuscule dans « Après le déluge » et dans « Enfance I », mais aussi et surtout par sa réécriture profonde. Ce qui distingue les déluges rimbaldiens de leur modèle biblique, c’est leur dimension mélancolique et ascensionnelle. Dans le poème liminaire, où il traite d’ailleurs le véritable Déluge avec une désinvolture pleine de malice (« Après que l’idée du Déluge se fut rassise », 161), le poète semble vouloir noyer le monde à peine recréé sous ses larmes d’enfant en manque d’amour : « […] — eaux et tristesses, montez et relevez les Déluges » (161) ; de même, dans « Enfance I » décrit-il avec tristesse une « fille à lèvre d’orange, les genoux croisés dans le clair déluge qui sourd des prés, nudité qu’ombrent, traversent et habillent les arcs-en-ciel » (162). Ce dernier pluriel s’oppose au singulier burlesque sur lequel s’ouvrait « Après le Déluge », où un lièvre s’arrête dans les herbes afin de dire « sa prière à l’arc-en-ciel » (161). La réécriture du mythe, qui se fait une fois encore au moyen du pluriel, remplace l’alliance renouvelée avec Dieu par une relation mélancolique à la femme, qu’elle soit mère ou amante. Et le poète de rêver, dans « Mouvement », qui reprend la thématique de l’Arche de Noé, d’un amour rénové dans un monde nouveau, et d’un voyage à deux, après les larmes : « Un couple de jeunesse s’isole sur l’arche, / — Est-ce ancienne sauvagerie qu’on pardonne ? / Et chante et se poste » (182).
Le second mythe que reprend Rimbaud est celui de l’Apocalypse, mythe de la destruction du monde par excellence, dont la référence demeure le texte johannique. Le Dictionnaire des symboles précise cependant que l’Apocalypse est avant tout « une révélation portant sur des réalités mystérieuses ; puis une prophétie, car ces réalités sont à venir ; enfin une vision, dont les scènes et les chiffres sont autant de symboles[26] ». Il s’agit donc d’un mythe de la voyance qui conforte le poète dans sa double position de bâtisseur et de destructeur. Dans les Illuminations, les images cataclysmiques répondent aux évocations cosmogoniques : créer, c’est voir et détruire, voir pour détruire. L’on pourrait citer des poèmes tels que « Barbare », « Démocratie » ou « Guerre », mais l’on se contentera de ces deux passages tirés respectivement d’« Enfance IV » et de « Jeunesse IV », deux extraits qui confirment le caractère apocalyptique de la création rimbaldienne : « Ce ne peut être que la fin du monde, en avançant » (163) ; « Ta mémoire et tes sens ne seront que la nourriture de ton impulsion créatrice. Quant au monde, quand tu sortiras, que sera-t-il devenu ? En tout cas, rien des apparences actuelles » (178). Le présentatif restrictif « ce ne peut être que » et le gérondif « en avançant » présentent la « fin du monde » comme un progrès poétique, autrement dit le fruit d’une création : l’antithèse « créatrice » / « rien » du second exemple confirme ce paradoxe. C’est dans cette perspective eschatologique que la cité rimbaldienne se fera à la fois ville du péché et de la chute, Babylone nouvelle d’une part, identifiée dans « Nocturne vulgaire » aux « Sodomes » et « Solymes » (174) de la Bible, et nouvelle Jérusalem de l’autre, ville du salut et « Céleste Empire » (181) que l’on entrevoit dans « Soir historique ».
La réécriture des mythes de la Genèse, du Déluge et de l’Apocalypse redéfinissent les objectifs du poète : grâce à ces idiomythes, autrement dit ces mythes passés au crible de son imaginaire subjectif [27], Rimbaud ne prétend plus être le mage chargé de sonder l’Inconnu et la destinée humaine, mais se veut un modeste créateur pouvant à tout moment anéantir ce qu’il crée par le simple pouvoir du Verbe, un démiurge engagé dans une lutte spirituelle dont les implications ne sont plus mystiques, mais profondément intimes.
Monstre architectural, la ville rimbaldienne fait le lien entre la voyance romantique et les excès transgressifs de la décadence. Son organisation soumet l’espace et la matière aux tendances de l’imaginaire : écriture et architecture se confondent en une forme poétique symbolisant verbalement et spatialement les conflits psychologiques du sujet. L’appropriation des mythes de l’Enfer et de l’Eden d’une part, puis de la Genèse, du Déluge et de l’Apocalypse de l’autre confirment et dramatisent ce lien particulier existant entre architecture urbaine et architecture intime. Si les Illuminations sont demeurés un chantier, c’est peut-être bien parce qu’il était fondamentalement impossible à Rimbaud de les agencer en recueil ; ou plutôt, c’est parce qu’il lui était poétiquement nécessaire que cet ensemble épars se présente comme les ruines d’une architecture vouée à la construction et à la destruction perpétuelle. Enfin, la création architecturale des Illuminations permet un retour sur la voyance poétique. Elle révèle la portée non plus mystique mais narcissique de l’acte créateur. En définitive, Rimbaud nous fait partager sa plus importante découverte : le poète voyant n’est ni plus ni moins, pour reprendre Baudelaire, qu’un poète se faisant « l’architecte[28] » de ses « fééries ».
Parties annexes
Note biographique
Professeur certifié en Lettres Modernes, Giovanni Berjola prépare une thèse intitulée : « Je saisis la plume » — Isidore Ducasse et l’acte créateur. Auteur de l’ouvrage Arthur Rimbaud et le complexe du damné (Paris, Minard, 2007), Giovanni Berjola a aussi publié des articles sur Rimbaud (« L’Enfer chez Arthur Rimbaud. Appropriation d’un mythe et émergence d’un complexe », dans Yann Fremy (dir.), « Je m’évade ! Je m’explique ». Résistances d’Une saison en enfer, Paris, Garnier Classiques, 2010), Ducasse (« De la campagne à la ville — Pour une poétique de l’espace dans Les chants de Maldoror », dans Christian Chelebourg et Serge Meitinger (dir.), Écritures de la ville, Paris, Éditions Kimé (Cahiers de recherches sur l’Écriture et l’Espace), 2006) et sur David Lynch (« Quelques singularités de David Lynch », Image & Narrative, vol. X, no 2 (2009), [en ligne]. http://www.imageandnarrative.be/l_auteur_et_son_imaginaire/berjola.htm). Il s’oriente depuis vers la recherche en littérature de jeunesse ; il a signé l’article « Fantastique et littérature de jeunesse » dans l’Encyclopédie du fantastique (Paris, Éditions Ellipse, 2010).
Notes
-
[1]
Charles Baudelaire, « Rêve parisien » (CXXXII), Les fleurs du mal, 1972, p. 233.
-
[2]
Sur cette filiation, voir Jean Richer, « Gautier en filigrane dans quelques Illuminations », Europe, vol. 529-530 (mai-juin 1973), p. 69-76.
-
[3]
Il faut bien sûr citer les articles de Marie-Claire Bancquart, « Une lecture des “Ville(s)” d’Illuminations » ; de Margaret Davies, « Ville » ; et de Marie-Joséphine Whitaker, « Le problème de l’architecture dans les villes rimbaldiennes », dans Louis Forestier (dir.), Arthur Rimbaud 4, Caen, Minard (Lettres Modernes), 1980.
-
[4]
Christian Chelebourg, L’imaginaire littéraire. Des archétypes à la poétique du sujet, 2000, p. 109.
-
[5]
Les références paginales renvoient à Arthur Rimbaud, Oeuvres complètes — Correspondances, édition présentée et établie par Louis Forestier, Paris, Robert Laffont (Bouquins), 2004.
-
[6]
Giovanni Berjola, Arthur Rimbaud et le complexe du damné, 2007, p. 78-79.
-
[7]
Voir mes analyses sur le motif du trou, dans ibid., p. 32-33 et p. 117.
-
[8]
J’utilise ce néologisme afin de désigner l’alliance d’espaces géographiques éloignés les uns des autres dans le réel. Il est construit sur le modèle des termes anachronisme et anachronique.
-
[9]
Dominique Combe, Poésies ; Une saison en enfer ; Illuminations d’Arthur Rimbaud, 2004, p. 113.
-
[10]
Ibid., p. 130.
-
[11]
L’hypotypose est une figure qui peint « les choses d’une manière si vive et si énergique, qu’elle les met en quelque sorte sous les yeux, et fait d’un récit ou d’une description, une image, un tableau ou même une scène vivante » (Bernard Dupriez, « Hypotypose », Gradus — Les procédés littéraires, 1984, p. 240).
-
[12]
Dominique Combe, Poésies ; Une saison en enfer ; Illuminations d’Arthur Rimbaud, op. cit., p. 151.
-
[13]
Christian Chelebourg, L’imaginaire littéraire, op. cit., p. 115.
-
[14]
Giovanni Berjola, Arthur Rimbaud et le complexe du damné, op. cit., p. 80.
-
[15]
Gaston Bachelard, L’eau et les rêves, 2001 [1942], p. 144.
-
[16]
Christian Chelebourg, L’imaginaire littéraire, op. cit., p. 130.
-
[17]
Dans la seconde lettre du voyant, Rimbaud se montre cependant assez sévère à l’égard de l’architecture mystique et convenue du grand poète : « Hugo, trop cabochard, a bien vu dans les derniers volumes : Les misérables sont un vrai poème. J’ai Les châtiments sous main ; Stella donne à peu près la mesure de la vue de Hugo. Trop de Belmontet et de Lamennais, Jehovahs et de colonnes, vieilles énormités crevées » (230).
-
[18]
Les Érinyes sont, on le rappelle, les divinités vengeresses de la mythologie grecque.
-
[19]
Ce motif de la boue et du feu, que l’on a déjà rencontré, établit un lien intertextuel et thématique avec Une saison en enfer : dans « Mauvais sang » en effet, Rimbaud se souvient que « [d]ans les villes la boue lui apparaissait soudainement rouge et noire » (144), tandis que dans « Adieu », il évoque son entrée dans une « cité énorme au ciel taché de feu et de boue » (156).
-
[20]
Dans l’archétypologie de Gilbert Durand, les symboles nyctomorphes sont des images qui matérialisent dans la nuit les peurs liées au temps et à la mort. Voir Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris, Dunod, 1992, p. 96-122.
-
[21]
Jean Chevalier et Alain Gheerbrant (dir.), art. « Paradis », Dictionnaire des symboles, 1982, p. 730.
-
[22]
Dominique Combe, Poésies ; Une saison en enfer ; Illuminations d’Arthur Rimbaud, op. cit., p. 129.
-
[23]
Giovanni Berjola, Arthur Rimbaud et le complexe du damné, op. cit., p. 78.
-
[24]
Ibid., p. 79.
-
[25]
Ibid., p. 106.
-
[26]
Jean Chevalier et Alain Gheerbrant (dir.), art. « Apocalypse »,Dictionnaire des symboles, op. cit., p. 55.
-
[27]
Christian Chelebourg décrit ce concept qu’il a défini et nommé : « L’idiomythe est au mythe ce que l’idiolecte est à la langue vernaculaire. La mythocritique a bien établi que les mythes constituent des matériaux privilégiés de la création artistique, des canevas indéfiniment repris, qui irradient au sein de l’oeuvre et lui imposent leur structure. Mais cela conduit à rechercher dans un texte ce que l’on sait déjà du mythe qu’on y retrouve, et à considérer comme autant d’erreurs les entorses auctoriales au récit originel. La poétique du sujet [considère] au contraire ces écarts comme autant de procédés d’appropriation, d’idiotismes révélateurs de l’imaginaire subjectif » (Christian Chelebourg, « Petit lexique de poétique du sujet à l’usage des critiques soucieux d’étudier l’imaginaire de l’auteur », dans Image [&] Narrative [e-journal], 2009, article disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.imageandnarrative.be/inarchive/Images_de_l_invisible/Chelebourg.htm).
-
[28]
Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, op. cit., p. 233.
Bibliographie
- Bachelard, Gaston, L’eau et les rêves, Paris, Le livre de Poche (Biblio essais), 2001 [Librairie José Corti, 1942].
- Baudelaire, Charles, Les fleurs du mal, Paris, Librairie générale française (Le livre de poche), 1972.
- Berjola, Giovanni, Arthur Rimbaud et le complexe du damné, Caen, Lettres modernes Minard (Archives des lettres modernes), 2007.
- Chelebourg, Christian, L’imaginaire littéraire. Des archétypes à la poétique du sujet, Paris, Nathan Université, 2000.
- Chelebourg, Christian, « Petit lexique de poétique du sujet à l’usage des critiques soucieux d’étudier l’imaginaire de l’auteur », dans Image [&] Narrative [e-journal], vol. X, no 2, 2009 [en ligne]. http://www.imageandnarrative.be/inarchive/Images_de_l_invisible/Chelebourg.htm.
- Chevalier, Jean et Alain Gheerbrant (dir.), Dictionnaire des symboles : mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres, Paris, Robert Laffont / Jupiter (Bouquins), 1982.
- Combe, Dominique, Poésie ; Une saison en enfer ; Illuminations d’Arthur Rimbaud, Paris, Gallimard (Foliothèque), 2004.
- Dupriez, Bernard, Gradus — Les procédés littéraires, Paris, 10 / 18 (Domaine français), 1984.
- Rimbaud, Arthur, Oeuvres complètes — Correspondances, édition présentée et établie par Louis Forestier, Paris, Robert Laffont (Bouquins), 2004.