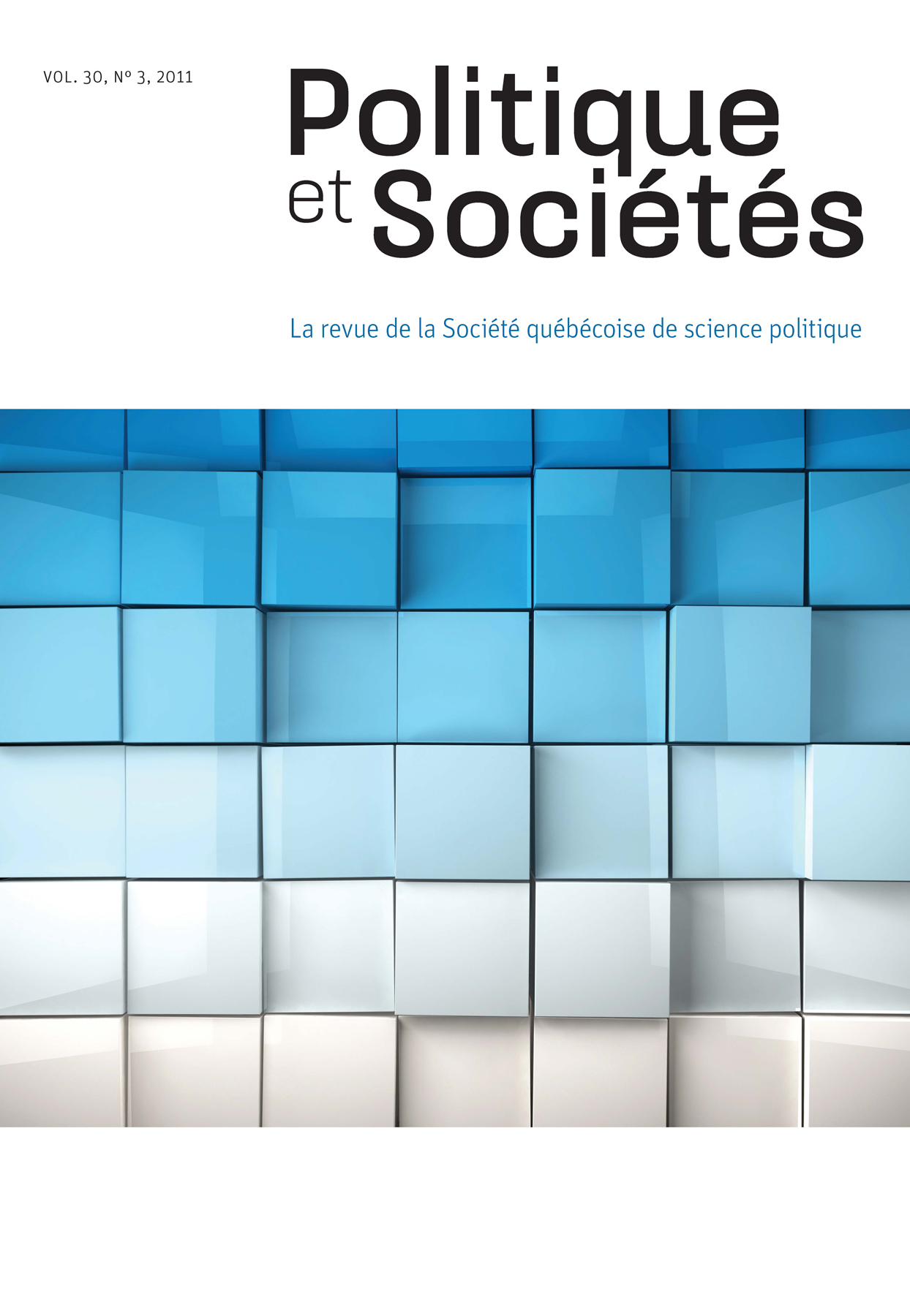Résumés
Résumé
Depuis de nombreuses années, le problème de l’absence d’élection au suffrage universel direct des délégués des groupements à fiscalité propre (GFP) a été soulevé à maintes reprises. Paradoxalement, alors qu’un large consensus s’est dégagé en faveur d’une élection directe des délégués des GFP, il n’a jamais été réellement envisagé de faire évoluer la situation actuelle. Cet article a pour objectif de comprendre pourquoi. Dans un premier temps sont détaillées les raisons plaidant en faveur de l’instauration du suffrage universel direct pour les GFP. Ces raisons apparaissant pertinentes, nous supposons alors par la suite que les élus, locaux et nationaux, ont forcément intérêt à exercer leur influence en faveur du statu quo, pour d’autres « bonnes raisons ». Parmi celles-ci sont évoquées la volonté de pérenniser les GFP, de conserver vivantes les communes comme lieux privilégiés de démocratie locale, ainsi que la volonté de conservation des mandats municipaux et de contournement de la règle de cumul des mandats.
Abstract
It has been a long time since the problem of the lack of direct universal suffrage for the French metropolitan areas with own tax systems has been pointed out. Nevertheless, nothing has ever been done to change this current situation, in spite of a wide agreement in favour of direct universal suffrage for these areas. This paper intends to understand the reasons of such a paradox. As a starting point, the arguments in favour of more democracy, through direct elections, are underlined. Then, as these arguments are supposed to be relevant, the alternative “good reasons” contended by national and local elected actors (mayors, senators…), implicitly claiming for status quo, are detailed: the will to preserve the fragile existence of these metropolitan areas, to preserve municipal boundaries as the best place for local democracy, as well as to save municipal mandates and to evade the law related to the plurality of mandates.
Corps de l’article
Introduction
L’intercommunalité en France s’est considérablement renforcée, sur le plan quantitatif, avec l’explosion du nombre de groupements à fiscalité propre (GFP), à la suite de l’entrée en vigueur de la loi Chevènement il y a maintenant une dizaine d’années[1]. La création de territoires de solidarité dotés d’une taille critique pour répondre aux nouveaux enjeux du développement local ne s’est cependant pas réalisée sans heurts et dérapages.
La littérature sur ce domaine est amplement revenue sur les failles qui se sont révélées au grand jour dans l’édification intercommunale à la française (Caillosse, 2005 ; Cour des comptes, 2005 ; Sadran, 2005 ; Dallier, 2006b ; Thomas, 2008a). Parmi celles-ci reviennent plus fréquemment la non-pertinence des périmètres, la tolérance face à de nombreuses structures « coquilles vides » contrevenant à l’esprit même de la coopération intercommunale, la permanence de structures syndicales redondantes, la non-définition de l’intérêt communautaire, l’opportunisme vis-à-vis de l’incitation financière étatique, ou encore l’inflation fiscale consolidée qui a résulté de la montée en puissance des GFP.
Un autre domaine rassemble les critiques et les interrogations. Il s’agit de la gouvernance des GFP, et plus précisément de la façon dont les membres appartenant à l’exécutif intercommunal obtiennent leur siège. Invariablement se pose le problème de l’absence d’élection au suffrage universel direct des délégués intercommunaux. Néanmoins, plus étrangement, on ne peut pas vraiment dire que ce point fasse débat.
En effet, on ne trouve guère d’opposants réels à l’instauration d’une élection directe et démocratique de ces délégués. Très nombreuses sont au contraire les voix qui s’accordent à plaider en sa faveur, en la jugeant comme « politiquement inéluctable et démocratiquement nécessaire » (Baraize et Négrier, 2001 : 295). « Aussi bien les discours des principaux responsables politiques que la majorité des Français sondés[2] […] montrent qu’un relatif consensus existe sur le principe de l’élection au suffrage universel direct des délégués intercommunaux » (Kerrouche, 2008 : 132). Pourtant, en dépit de ce relatif consensus, c’est bien le statu quo qui prévaut depuis plusieurs décennies (Girardon, 2008 : 110). On pourrait même demander « jusqu’à quel point [les] propres promoteurs [du suffrage direct pour les GFP] y croyaient-ils eux mêmes, eux qui ont semblé si prompts à s’accommoder du statu quo ? » (Bué et al., 2004 : 39).
Dès lors, comment analyser cet écart entre attentes exprimées et absence de concrétisation ? Comment comprendre que les élus locaux qui mettent en avant la participation citoyenne au sein de leur territoire sont parfois les mêmes à être partisans de la patience et du report sine die de ce changement de mode d’élection (Dallier, 2006a) ?
En nous basant sur une analyse détaillée de la littérature dans ce domaine, nous tenterons de montrer que, loin d’être incohérent, le fait de ne pas étendre la démocratie élective à la sphère intercommunale ne relève pas d’une simple inertie comportementale des élus locaux, mais bien d’une stratégie réfléchie de leur part. Ainsi cette recherche ambitionne d’analyser cet apparent paradoxe de l’absence d’élection directe intercommunale non pas sous l’angle critique habituel d’un manque (de clarté, de démocratie…), mais sous celui de la recherche, plus ou moins avouée, de la sauvegarde d’atouts stratégiques de la part des élus municipaux, essentiellement.
Pour ce faire, nous procéderons en deux temps. Tout d’abord, nous envisagerons les raisons pour lesquelles le suffrage universel direct gagnerait à s’appliquer à la sphère intercommunale. Le fait de souligner leur pertinence nous conduira, dans un second temps, à considérer les motivations alternatives suffisamment fortes qui justifieraient que l’on refuse sciemment aux GFP un changement de leur mode d’élection et, par voie de conséquence, l’obtention du statut de collectivité locale. Nous verrons alors dans quelle mesure les élus locaux ont effectivement avantage à conserver un positionnement ambivalent, prudent et collectif sur le principe, mais déterminé et individuel de façon plus concrète.
Les raisons qui plaident en faveur d’une instauration du suffrage universel direct au niveau intercommunal
Trois arguments, fréquemment déclinés dans la littérature en matière de gouvernance locale ainsi que dans les discussions à ce sujet au cours des deux dernières décennies, ont contribué à faire de l’instauration du suffrage universel direct pour les GFP un sujet récurrent. La première partie de notre article se propose de rappeler la portée de chacun d’entre eux. Tout d’abord, les délégués intercommunaux devraient être élus directement car ils gèrent les compétences les plus importantes de nos agglomérations en disposant qui plus est de la faculté de lever l’impôt. Par ailleurs, un tel changement introduirait un peu plus de stabilité et de démocratie dans une sphère intercommunale à laquelle ces éléments font pour l’instant défaut. Enfin, cela pourrait contribuer à rendre la gouvernance intercommunale moins lourde et abstraite qu’elle ne l’est actuellement aux yeux des citoyens.
Une fiscalité propre et des prérogatives essentielles en nombre croissant
L’intercommunalité française ayant pris de façon plus nette le virage de la fiscalité propre, il apparaît aujourd’hui plus difficile de justifier que des groupements qui exercent des compétences de plus en plus nombreuses et qui lèvent leurs propres impôts directs, ne voient pas leurs responsables soumis directement au suffrage des électeurs.
Des prérogatives croissantes héritées des communes, des départements et des régions
Avoir la possibilité, si leur statut les y autorise, de récupérer par convention et par délégation certaines des compétences jusqu’à présent exercées au niveau départemental ou régional confère aux GFP une importance centrale et croissante, et les positionne comme l’échelon incontournable au sein de l’administration territoriale française (DGCL, 2004). De fait, l’organisation de la Cité se pense et se vit désormais au niveau intercommunal, comme en atteste la forte croissance des distances parcourues au quotidien par les individus : cinq kilomètres par jour (les limites d’un canton) il y a 50 ans, contre 45 kilomètres aujourd’hui (Guéranger, 2008b : 47).
Face à cela, il ne s’agit plus seulement de mutualiser et de récupérer des compétences (les plus importantes et stratégiques) que l’étroitesse du cadre municipal ne permettait pas d’exercer efficacement. Il s’agit de consacrer l’échelon intercommunal comme niveau le plus pertinent d’exercice de bon nombre des compétences touchant à la vie des agglomérations, qu’elles soient urbaines ou qu’elles prennent la forme de petites communautés de communes (CC) en milieu rural.
Dès lors, cette seconde phase de croissance des compétences exercées par les GFP pose avec encore davantage d’acuité le problème de l’absence de l’élection au suffrage universel direct des délégués intercommunaux. Plus le nombre de compétences exercées ou déléguées augmente, plus il semble délicat de se réclamer d’une gestion démocratique de la vie publique locale sans pour autant permettre de sanction élective de la politique menée. Ce constat d’un « effet de ciseau » (détaillé par Chevallier, 1997) est en effet en parfait décalage avec la volonté croissante qui s’exprime aujourd’hui, dans certaines villes, de rapprocher le citoyen de la prise de décision (Delannoy et al., 2004).
Bien que mis en exergue par les phases très récentes de transferts de compétences, le problème du déni démocratique généré par les structures intercommunales est tout sauf nouveau. Dès 1973, Jean-Paul Bauguil (1973 : 117-118) soulignait en effet qu’« une des contradictions de l’administration à double niveau est de ne faire porter le contrôle direct des citoyens que sur l’accessoire […] Il est difficile d’admettre qu’un système qui galvaude ainsi l’expression du suffrage universel en lui laissant directement contrôler les affaires résiduelles va dans le sens d’un renforcement de l’autonomie et de la démocratie locale. » Pourtant, c’est bien une dichotomie nette entre les territoires de l’action (GFP) et ceux de la représentation (communes) qui tend à s’installer.
Même si, officiellement, les GFP se contentent d’un statut d’établissement public et sont censés être de simples émanations de leurs communes membres, il semblerait qu’on ait dépassé depuis longtemps les limites de la vision d’une intercommunalité subordonnée à ses communes. Dans les faits, quoique toujours dépourvus du statut de collectivité locale, ce sont bien les GFP qui sont à l’initiative des principales décisions affectant la vie publique locale et qui les imposent ensuite à leurs communes membres, et non l’inverse (Dallier, 2006a).
Une faculté de lever l’impôt qui implique un contrôle démocratique des responsabilités exercées
Les GFP sont désormais dotés de budgets supérieurs (de 40 %) à ceux des conseils régionaux (Dallier, 2006b), et surtout ces budgets sont alimentés par des impôts[3] votés par ces mêmes groupements. Dès lors, dans la mesure où les citoyens estiment qu’il est légitime de valider la politique générale (et notamment fiscale) de leur gouvernement en élisant leur président de la République et leurs députés, il serait tout aussi légitime qu’ils disposent d’un moyen de sanction (positive ou négative) de la façon dont leurs impôts locaux sont utilisés (Négrier, 2002). Si en France, contrairement à la situation en vigueur aux États-Unis d’Amérique, on ne respecte pas le fameux principe du « no taxation without representation » (Tournon, 2009), comment alors « parler de démocratie locale si les citoyens sont dépossédés de leur pouvoir de décision » (Pontier, 1999) ?
L’intercommunalité, à partir du moment où elle se dote d’un pouvoir en matière fiscale, ne peut raisonnablement faire l’impasse sur le caractère démocratique de la nomination de ses dirigeants, sans y perdre sa crédibilité et surtout sa légitimité. Le fait de lever l’impôt crée une responsabilité de ceux qui exercent le pouvoir intercommunal devant leurs contribuables. Que ces derniers deviennent électeurs directement de leurs représentants intercommunaux rétablirait l’équilibre vis-à-vis de cette responsabilité, pour l’instant sans contrepoids. Cela contribuerait donc à accroître la légitimité de l’exécutif intercommunal, dont l’actuelle nomination n’est pas garante de toute la stabilité ni de la démocratie nécessaires aux GFP pour fonctionner dans de meilleures conditions.
Un déficit flagrant de stabilité et de démocratie au niveau intercommunal
C’est en effet à la fois à un déficit de stabilité et de démocratie auquel font face les groupements intercommunaux français dans leur fonctionnement courant. Si le mode de désignation des délégués intercommunaux crée une incertitude endogène dans l’exercice quotidien du pouvoir par l’exécutif des GFP, nous verrons que le manque de transparence ainsi que d’outils participatifs pour les citoyens concourt à accroître le sentiment de démocratie virtuelle au sein de ces groupements.
L’instabilité consubstantielle du gouvernement des GFP
Les conseils communautaires se présentent comme des assemblées de cohabitation structurelle entre les élus de leurs différentes communes membres (Klopfer, 2006), d’où, dans certains cas, une relative instabilité institutionnelle, qui est favorisée, il est vrai, par le mode de désignation des délégués communautaires. La recherche de compromis s’avère alors nécessaire en vue de conserver l’exercice effectif du pouvoir. Certes, les conseils municipaux (tout au moins pour les villes d’une certaine importance) ainsi que l’Assemblée nationale incarnent également des assemblées qui, politiquement, ne sont pas monocolores. Mais l’exercice du pouvoir au sein de ces mêmes assemblées se voit la plupart du temps facilité par l’existence d’une majorité politique stable. Ce n’est pas forcément le cas pour le gouvernement des GFP, puisque les délégués communautaires ne sont pas élus, mais désignés pour effectuer leurs tâches.
Les règles encadrant l’attribution des sièges à chaque commune renforcent cet état de fait dans la mesure où, d’une part, aucune commune (centre) ne peut détenir une majorité absolue des sièges et où, d’autre part, l’influence des (très) petites communes est proportionnellement accrue puisque chacune dispose d’au moins un siège, indépendamment de sa taille. Il en résulte un fonctionnement concret des assemblées intercommunales dans lesquelles intérêt général et efficience peuvent faire défaut. En effet, la bataille pour le contrôle des GFP passe souvent par le contrôle politique de telle ou telle petite commune, ainsi que par des arbitrages savants entre concessions et promesses à telle ou telle autre (c’est-à-dire à tel ou tel maire de commune, vice-président du groupement, veillant avant tout aux intérêts de sa commune d’origine). « Dans de nombreux cas, le président [du GFP] devra composer là où le maire pourrait imposer. » (Sadran, 2005 : 45)
Si la détention du pouvoir intercommunal apparaît comme le résultat favorable d’un jeu difficile d’alliances et de compromis interpersonnels, l’équilibre obtenu au terme de ces négociations entre équipes municipales géographiquement voisines n’en demeure pas moins précaire et instable dans le temps. D’abord, quand tout repose sur des accords personnels entre personnes élues, le président du GFP n’est jamais à l’abri d’un retournement d’alliance, si le maire d’une des communes change en cours de mandat, s’il s’estime trahi ou encore s’il pense que sa commune n’est pas suffisamment avantagée par la politique du GFP. Ensuite, contrairement aux majorités municipales prévisibles en nombre de sièges[4], les GFP disposent désormais, grâce à la loi LRL[5], de la faculté de modifier le nombre de leurs sièges ou leur répartition (notamment, mais pas uniquement, lors des évolutions de périmètres).
Le déficit de légitimité et de démocratie propre aux GFP
Mais le reproche le plus fréquemment adressé à l’encontre des GFP en matière de démocratie, loin des considérations techniques et stratégiques que nous venons de mentionner, réside dans l’absence d’élection au suffrage universel direct de leurs représentants (Le Saout, 2004 ; Frinault et Le Saout, 2009). Toutefois, cette critique se doit d’être nuancée. En effet, les délégués et les dirigeants des GFP ont tous acquis une légitimité de leur élection au suffrage universel, quoiqu’à un autre niveau (municipal). Des progrès ont même été accomplis sur ce point puisque, avant la loi du 12 juillet 1999, on pouvait désigner comme délégué communautaire une personne dépourvue de tout mandat électif. On pourrait toujours rétorquer que la seule caution démocratique des délégués communautaires est une élection indirecte. Mais il conviendrait alors de ne pas oublier que, formellement, le maire, personnage qui incarne la démocratie de proximité par excellence, n’est lui-même élu que de manière indirecte par les membres du conseil municipal (Sadran, 2005).
Au-delà de cette critique de forme, il est permis de douter de la « démocratisation » et de la « transparence » intercommunales mises en exergue par la circulaire relative aux nouvelles dispositions introduites par la loi LRL (Ministère de la Fonction publique, de la Réforme de l’État et de l’Aménagement du Territoire, 2004 : § 3.5.8, p. 25). En effet, selon cette circulaire, c’est le seul envoi au maire de chaque commune membre, par le président du GFP, d’un rapport sur le groupement avant le 30 septembre de chaque année qui est censé être le garant du caractère démocratique et transparent de la gestion intercommunale. Une « soutenance » orale de ce rapport est certes prévue lors d’une séance du conseil municipal de chaque commune, au cours de laquelle, en théorie, on pourrait entendre le président du GFP, si on le désire.
Mais cette sorte de « rapport d’activités » apparaît plus comme une exigence minimale de communication souhaitée par le législateur que comme un témoin d’une réelle volonté de transparence, encore moins comme un acte de démocratisation de la vie intercommunale. Ce rapport est strictement informatif et sa valeur ajoutée relativement faible, d’autant plus qu’il arrive que sa rédaction soit tout bonnement « omise » par un nombre significatif de GFP (Cour des comptes, 2005).
Pour remédier à cela, consulter directement les citoyens par le biais d’un référendum décisionnel au niveau intercommunal eut été une mesure à l’aspect démocratique indéniable. Pourtant, la révision de la Constitution a délibérément choisi de priver cet échelon territorial d’une telle faculté (Buisson, 2005). Demeurent des possibilités de référendums strictement consultatifs, qui plus est extrêmement limitatifs et exceptionnels, puisqu’ils nécessitent l’accord de l’ensemble des maires des communes membres, de la moitié des membres de l’organe délibérant ou de 20 pour-cent des inscrits sur les listes électorales. Quant aux référendums communaux, ils perdent le peu de substance qu’ils avaient pu gagner, étant donné qu’ils ne peuvent être organisés que sur des matières qui relèvent des compétences municipales et que ces dernières sont de plus en plus transférées aux GFP (Caillosse, 2005). Ainsi, « la croissance de l’intercommunalité revient en pratique à soustraire un plus grand nombre de questions et d’enjeux locaux à l’éventuelle intervention citoyenne » (Sadran, 2005 : 49).
En outre, « la démocratie suppose une identification claire des responsabilités de chacun, que ne permet guère l’indivision actuelle » (Albertini, 2006 : 114). Ce ne serait donc pas la seule absence d’élection au suffrage universel direct des délégués intercommunaux qui poserait principalement problème en matière de démocratie. Le point le plus épineux réside dans une « occultation des enjeux (et parfois des jeux) politiques peu compatible avec l’idéal de la démocratie » (Sadran, 2005 : 46).
Comme le rappelle Jean-Pierre Sueur (Sénat, 2010 : 609), « il faudra un jour se demander s’il est moins légitime d’élire au suffrage universel direct des délégués communautaires […] que l’équipe municipale d’une commune de soixante habitants ou le conseiller général d’un canton urbain dont aucun habitant ne connaît le périmètre ». Mais, en termes de transparence démocratique, il serait tout aussi erroné de penser que l’on vote uniquement pour élire le maire de sa petite commune, avec des enjeux concrets somme toute assez réduits, alors qu’en réalité c’est peut-être l’élection de sa commune qui va faire basculer celle de l’agglomération.
On peut difficilement qualifier de démocratique une élection dont tout l’enjeu politique et stratégique échapperait à l’immense majorité des électeurs. Le « troisième tour » intercommunal à l’issue imprévue en 2001 pour la Communauté urbaine de Bordeaux a ainsi permis de mettre en lumière tout le pouvoir que possédaient par exemple, sans en avoir nullement conscience, les habitants des communes de Villenave d’Ornon et de Gradignan. Mais peut-on décider, à son « insu », de l’identité du président de son GFP si le vote aux municipales est orienté par la sympathie ou l’antipathie personnelle que l’on ressent vis-à-vis du maire actuel, ou par une mesure de « vote sanction » (trottoir sale dans sa rue, subvention municipale réduite pour son club sportif, mécontentement lié à l’action – ou l’inaction – de la police municipale, etc.) ?
Si la conscience de l’impact du vote municipal sur le futur gouvernement intercommunal était nécessaire pour que l’on puisse parler de démocratie intercommunale, il n’en demeure pas moins qu’elle s’avérerait insuffisante. En effet, même si des citoyens parfaitement informés, intéressés et conscients des enjeux exerçaient à dessein leur droit de vote, ils pourraient générer une situation de majorité inversée où, en raison de la surreprésentation des petites communes (sur laquelle nous reviendrons ultérieurement), une majorité de voix n’entraînerait pas forcément une majorité de sièges dans l’assemblée.
Or nous sommes très loin d’un tel contexte d’information « parfaite ». Il importe de ne pas sous-estimer la confusion qui tend à s’installer dans l’esprit des citoyens concernant une intercommunalité dont ils ont beaucoup de mal à cerner les contours, les compétences et le mode de gouvernance.
Une gouvernance intercommunale de plus en plus lourde, technocratique et opaque
Divers éléments permettent de mieux comprendre la distance qui s’est installée entre les habitants des communes membres d’un GFP et la gestion concrète de leur structure intercommunale. Les habitants éprouveront des difficultés à se sentir proches d’un territoire dont l’accès aux plus hautes sphères leur semblera verrouillé et oligarchique. La complexité intrinsèque de la gestion intercommunale et de ses spécificités contribuera également à accroître ce sentiment d’éloignement et d’incompréhension.
Un accès à l’exécutif intercommunal très sélectif
La gestion intercommunale, notamment à cause de la technicisation croissante des dossiers traités, apparaît de plus en plus lourde, technocratique et opaque pour le citoyen moyen. Il n’est ainsi pas surprenant que le gouvernement des GFP ne soit le fait que d’un nombre réduit d’élus clés et d’experts techniques, et qu’il parvienne de plus en plus difficilement à s’extraire d’un tel cercle très réduit. Dans le même ordre d’esprit, l’absence d’élections directes ne suffit pas à elle seule pour expliquer la grande homogénéité du profil qui apparaît chez les présidents de GFP.
Même si « assez peu d’informations récentes sont disponibles sur les présidents » de GFP (Kerrouche, 2008 : 90), un portrait type de ces derniers peut malgré tout être dressé : ce sont de façon quasi exclusive des hommes[6], majoritairement retraités ou sexagénaires, dont 53 pour-cent ont plus de 55 ans, l’âge moyen atteignant 59 ans (Le Saout, 2000b)[7]. Leur niveau d’étude est très largement supérieur à celui des personnes du même âge dans la population française. On relève également une surreprésentation des catégories socioprofessionnelles supérieures, ce qui atteste d’une professionnalisation croissante de la fonction. Enfin, la fonction de président est également très politisée. Les présidents, de façon très prépondérante, sont élus dans la ville centre du GFP ou dans l’une de celles présentant la richesse fiscale la plus élevée. Par ailleurs, ils sont beaucoup plus souvent placés dans une situation de cumul d’autres mandats électifs, par rapport à la population d’ensemble des maires de communes.
Ainsi, le capital humain (formation initiale, expérience des principaux dossiers et domaines de compétences acquis lors de plusieurs mandats municipaux) et le capital temps sont des atouts précieux pour viser cette fonction qui n’est accessible qu’à un nombre très réduit d’acteurs. Cette expérience est d’ailleurs d’autant plus indispensable à ceux qui briguent un GFP de taille plus importante[8]. Seuls les détenteurs du leadership politique sur un territoire sont à même de maîtriser les rouages de l’intercommunalité (Gamon, 2002). « Si les maires s’y retrouvent à peu près, les conseillers municipaux quant à eux ne s’y retrouvent pas vraiment et les citoyens pas du tout. » (Le Saout, 1997 : 10)
Le caractère dissuasif de la complexité intercommunale
Cette opacité est alimentée par la possibilité pour les GFP de récupérer par délégation conventionnelle des compétences départementales ou régionales. Les GFP ont éprouvé de grandes difficultés à définir leur intérêt communautaire (Thomas, 2008b) ; il est déjà complexe pour une personne, même rompue aux spécificités de l’intercommunalité à la française, de connaître précisément les compétences relevant de « son » GFP et dans quelle proportion l’intérêt communautaire du groupement permet leur transfert effectif au niveau intercommunal. Rajouter la possibilité d’enrichir encore, « à la carte », les compétences exercées de fait par chaque GFP contribue à réduire la lisibilité de leur fonctionnement auprès de la population. Ainsi, tandis que 62 pour-cent des personnes[9] déclarent connaître le rôle et l’action de leur commune, ils ne sont que 38 pour-cent à pouvoir faire de même pour leur GFP[10].
Concrètement, même si l’absence de suffrage universel direct dissuade les citoyens de s’approprier l’échelon intercommunal (Koebel, 2005), on a observé que les citoyens, quand ils se heurtent à une recherche de responsabilité en matière de gestion publique, se retranchent instinctivement et automatiquement derrière tout au plus deux niveaux : le niveau municipal (incarné par leur maire) et celui de l’État central. Cela revient à un aveu implicite d’incapacité à appréhender une architecture administrative plus complexe et à ignorer ce qu’on maîtrise mal et qui nous paraît obscur (l’administration intercommunale), en l’assimilant à un domaine et une affaire de spécialistes (Dallier, 2006a). En toute logique, comme le soulignent Nicolas Bué, Fabien Desage et Laurent Matejko (2004 : 50), « comment peut-on s’intéresser spontanément à ce que l’on ignore ? ».
On assiste ainsi en quelque sorte à une « dépolitisation » du débat intercommunal, cantonné à un cénacle d’experts, d’autant plus que l’on a affaire à un GFP en zone rurale (Vignon, 2004), si bien que, devant « la complexité de l’enchevêtrement des compétences, l’expertise technocratique tend à se substituer aux orientations politiques » (Frinault et Le Saout, 2009 : 2). On peut alors regretter que « le fonctionnement des instances intercommunales accentue l’écart entre représentants et représentés » (Sadran 2005 : 49). Il est vrai que la lourdeur institutionnelle dont font habituellement preuve les GFP ne fait qu’accroître ce sentiment d’opacité et élargir le fossé ressenti entre les citoyens et leurs GFP (Glaser et al., 2001 ; Le Bras, 2003 ; Jouve, 2005 ; Lefèvre, 2005). La genèse de ces derniers a fréquemment entraîné, pour attirer les communes périphériques, une multiplication du nombre de postes de vice-présidents : généralement au moins une vice-présidence pour chaque maire de commune appartenant à la coalition politique majoritaire.
Cette distribution très large des responsabilités officielles n’est pas étrangère à la création d’un tel sentiment de lourdeur dans la gestion des GFP, surtout lorsque le nombre de délégués, pour des raisons de stratégie et de recherche d’équilibre politique, s’avère au final disproportionné par rapport à la taille du groupement. À cet égard, le rapport de la Cour des comptes (2005) évoque le cas d’une « simple » CC de Moselle mobilisant pour son conseil quasiment 150 délégués, soit à peine un peu moins que le nombre d’élus au conseil municipal de Paris.
Dès lors, indépendamment de l’inflation fiscale ayant résulté du renforcement de l’intercommunalité en France (Thomas, 2008a), il n’est pas rare que la seule vision claire qu’ont les citoyens de leur GFP soit une ligne supplémentaire sur leurs avis d’impôts locaux[11]. Considérer les GFP comme un simple échelon supplémentaire, dispendieux, empêche bien sûr les citoyens d’« adopter » leur GFP et de s’en sentir proche. Cette distance qui s’est installée entre les citoyens et leur GFP s’avère d’autant plus regrettable que c’est à ce niveau qu’ont été le plus souvent transférées les compétences les plus importantes.
Au terme de l’examen de ces trois arguments qui plaident en faveur de l’apparition d’une élection directe des délégués intercommunaux, une réflexion s’impose. Si l’on convient que leur pertinence n’est pas susceptible d’être remise en cause, alors pourquoi refuserait-on encore (voire surtout) aujourd’hui aux GFP le droit de devenir de vraies collectivités locales ? Nous appuyant sur une analyse documentaire et un croisement problématisé de différentes contributions détaillées dans la littérature, dans la seconde partie de notre propos nous essaierons de montrer que c’est bien une volonté stratégique de préservation du statu quo actuel qui conduirait les élus, locaux ou nationaux, à déconnecter les idéaux qu’ils défendent (la démocratie locale) et les pratiques qu’ils laissent perdurer (l’absence d’élection directe des délégués intercommunaux).
Les motivations incitant les élus à découpler durablement suffrage universel direct et intercommunalité
Cette volonté stratégique reposerait sur deux modes de justification radicalement différents : des arguments officiels de fond, basés sur la construction intercommunale et la volonté de préservation de la démocratie locale d’une part, et un objectif plus officieux de maintien des mandats électifs actuels d’autre part. Ces différents registres seront successivement envisagés dans les développements suivants.
Ainsi, dans un premier temps, nous détaillerons l’argument visant à relier absence de suffrage universel direct et survie des GFP, puisque ces derniers ont précisément vu le jour grâce à un déni de démocratie, fruit d’un accord liminaire entre élus locaux et État. Les partisans de l’intercommunalité prendraient alors simplement le parti de sauvegarder leur échelon, et ce, quel qu’en soit le prix, y compris l’absence d’élection.
Les dommages induits par une telle absence d’élection seront, dans un deuxième temps, relativisés, puisque nous verrons que l’argument démocratique est au contraire fréquemment évoqué par les élus locaux en défaveur du suffrage universel direct pour les GFP. Il s’agirait alors non pas de chercher à instaurer une démocratie future et hypothétique pour les GFP, mais avant tout de sauvegarder la démocratie bien réelle et éprouvée, à travers l’échelon territorial où elle s’est le mieux exprimée jusqu’à présent : celui de la commune.
Enfin, nous soulignerons comment, indépendamment de ces arguments techniques et rhétoriques, il est possible de comprendre la situation actuelle en envisageant comme motivation supérieure des élus locaux leur volonté de favoriser leur propre réélection (Tullock, 1976), de conserver leurs mandats « acquis », et de tirer le meilleur parti possible du réflexe d’imputation de l’action publique locale au personnage central du maire.
La sauvegarde du déni conventionnel de démocratie sur lequel repose l’édification de l’intercommunalité française
Les élus se livrent couramment à un périlleux exercice : celui du dédoublement de personnalité. À certains moments, ils feront preuve d’initiative en votant des lois visant à promouvoir l’intercommunalité et son extension sur le territoire national. Mais, à d’autres moments, ils pourront revêtir le rôle d’ardents défenseurs de leurs communes, à l’image de l’attitude ambivalente, relevée par Fabien Desage[12], de l’ancien premier ministre Pierre Mauroy face à la situation dans l’agglomération lilloise. Cela est compréhensible, puisqu’officiellement ce sont les seuls territoires qu’ils représentent et desquels ils ont obtenu leur légitimité élective initiale. Néanmoins, « il n’est pas cohérent pour un responsable politique d’estimer le matin que les communautés en font trop […] et de voter l’après-midi des lois [incitant] à s’engager dans la construction de logements sociaux, la réorganisation des services publics » (Censi, 2005 : 4).
Les élus n’ont donc aucun intérêt à laisser se développer le suffrage direct pour les GFP, qui tôt ou tard pourrait concourir à leur affaiblissement. Sénat, morcellement communal et cumul des mandats : ces « trois institutions qui n’en finissent pas de se conforter » (Caillosse, 2005 : 128) constituent autant de freins à l’instauration du suffrage universel direct intercommunal. Mais alors comment développer les GFP tout en disposant de l’indispensable assentiment des élus communaux ? Trois solutions complémentaires se sont avérées nécessaires : le laisser-faire pour la définition des périmètres, la générosité budgétaire et la mise en place d’un certain « troc communal » (Frinault et Le Saout, 2009 : 2).
Réussir « l’invention politique de l’agglomération » en France, au sens de François Baraize et Emmanuel Négrier (2001), a tout d’abord obligé l’État, dès 1999, à établir une stratégie pour ne pas renouveler les erreurs du passé. Il s’agissait d’agir « moins par des mécanismes de domination classique que par des mécanismes plus insidieux, plus détournés, moins directs » (Guéranger, 2009 : 151), en cherchant à réconcilier avec la notion d’intercommunalité les élus municipaux réfractaires à l’idée de perdre une partie de leur pouvoir, quitte à contrevenir à l’esprit même de l’intercommunalité. Quand bien même lui prêterait-on un but supérieur (Thomas, 2008b), l’État, en acceptant de fait l’apparition de GFP « coquilles vides » développés par opposition (personnelle, politique…) à la commune centre[13] ou à son maire, a contribué sous une forme détournée à ne pas dissuader la création de GFP.
Cette mansuétude de l’État, quoique nécessaire, n’aurait pas suffi à promouvoir la densification du maillage intercommunal français. Si nous nous interrogeons en 2011 sur le gouvernement des GFP, c’est parce que, douze ans auparavant, les incitations financières ont été suffisamment convaincantes pour rallier à la cause intercommunale tous ceux qui, en 1992, l’avaient ostensiblement boudée. Tout repose sur le « compromis fondateur » de l’intercommunalité française : une incitation, la dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée, mais surtout une assurance : l’assurance pour les petites communes d’être en partie « protégées » de la commune centre, qui ne dispose pas de la majorité absolue des droits de vote (Desage, 2005). Le fait que dans 90 pour-cent des cas ce soit le maire de la ville la plus peuplée qui « hérite » de la présidence du GFP[14] (Le Saout, 2000a) ne fait certainement que légitimer ex post ce compromis.
En d’autres termes, sans minimiser nullement l’incitation en matière de DGF, bon nombre de GFP n’auraient pu se développer si les petites communes avaient toutes été dans la crainte de se noyer dans une minorité dépourvue de tous pouvoirs, inféodée aux ambitions hégémoniques des élus de la ville centre (Barthélémy et Martin, 2007 ; Guéranger, 2008b). « Tous les maires des villes centres […] ont minoré le poids de celle-ci quand ils ont voulu créer une intercommunalité, afin de rassurer les petites communes en leur montrant qu’il ne s’agissait pas de les écraser[15] » (Sénat, 2010 : 612).
Si le suffrage universel direct venait légitimer la possession d’un mandat de délégué intercommunal, on ne pourrait décemment plus déroger au principe fondamental de l’égalité des citoyens devant le vote. Or c’est exactement ce type de déni démocratique qui a permis à bon nombre de GFP de se développer : l’acceptation que le vote d’un habitant de la commune centre (ou d’une commune parmi les plus peuplées) ait proportionnellement moins de poids que celui d’un habitant d’une petite commune. Revenir sur l’absence de proportionnalité stricte entre nombre d’habitants et de sièges à l’assemblée intercommunale équivaudrait à remettre en question l’élément qui a fait que, à un moment donné, les élus municipaux ont accepté, en apparence, de participer à une stratégie moins égoïste et plus collective.
Ce compromis excluant de fait le suffrage universel pour les GFP présentait l’avantage notable d’alimenter un autre compromis : celui entre adversaires politiques potentiels au niveau communal, mais collaborateurs parfois en étroite relation au niveau intercommunal. Une absence de conflictualité partisane dans les débats intercommunaux, plus ou moins ouvertement assumée auprès des militants de base, à la place d’une politisation et d’un combat habituel lors des élections, puis régulièrement en assemblées : tels étaient en quelque sorte les termes du dilemme, où l’on a donc privilégié « la négociation et le compromis, plutôt que le débat et l’opposition » (Guéranger, 2009 : 154). Le résultat fut alors logiquement une « institutionnalisation singulière [des GFP] comme creusets de collusions pragmatiques entre professionnels de la politique, celle-ci ayant alors pour double conséquence (et condition) leur sanctuarisation et leur dissimulation au regard des profanes » (Bué et al., 2004 : 42). Car on peut aisément conjecturer que si le vrai débat politique avait lieu en préambule d’éventuelles élections intercommunales, il supplanterait amplement, du fait de l’importance des délégations de compétences et donc des sujets débattus, le débat au niveau municipal (Girardon, 2008). Cela revient quasiment à poser l’absence d’élection directe dans les GFP comme la condition indispensable à une relative paix politique et, par conséquent, à une certaine efficacité de l’action des groupements intercommunaux.
L’entente tacite, par delà les clivages politiques, pour différer l’instauration d’une élection directe puise ses racines dans cette volonté transversale des élus municipaux de ne pas aliéner leur autonomie et leur pouvoir. Sans ancrage électoral au niveau municipal, bon nombre d’hommes et de femmes politiques verraient leur chance de participer au gouvernement du GFP s’amenuiser. Se contenter d’une élection municipale satisfait alors leurs attentes : récolter les suffrages au niveau le plus « bas » pour ensuite favoriser leur « réélection » au niveau intercommunal.
La loi Chevènement a contribué également à sécuriser les acteurs politiques quant à leur carrière en supprimant la possibilité qu’avaient des personnes de la « société civile », dépourvues de tout mandat électoral municipal, d’être proposées à titre de délégué intercommunal (Le Saout, 2000a). Tout fut donc pensé pour que les élus municipaux conservent leur pouvoir (et le diversifient), faisant ainsi fi (pour partie) des effets des transferts de compétences des communes vers leurs groupements.
Justifier l’absence de suffrage universel direct par la nécessaire sauvegarde des GFP qui, sans cela, n’auraient pas vu le jour ne change rien au déficit démocratique attaché à ces territoires. Toutefois, une telle situation peut aussi être envisagée comme « un mal pour un bien ». Dans la mesure où l’instauration du principe « un homme une voix » générerait immanquablement une supra-communalité quasi irréversible aux conséquences redoutées et incertaines, prôner le statu quo présenterait alors la sécurité et l’avantage de sauvegarder l’échelon où cette démocratie tant recherchée s’exprime le mieux : celui de la commune.
La sauvegarde de la démocratie comme prétexte justifiant le maintien du statu quo
Si l’élection indirecte des délégués communautaires est l’un des rares sujets permettant de dépasser les clivages partisans et les frontières institutionnelles, ce consensus puiserait ses racines dans un objectif supérieur et commun : la sauvegarde de l’existence des communes, véritables creusets de la démocratie locale.
L’absence de suffrage universel direct : un point de convergence générale en dépit des frontières administratives ou partisanes
L’impact du Sénat se doit, à ce sujet, d’être considéré avec attention. Aussi bien les maires (surtout de petites communes[16]) que les sénateurs ont intérêt à endiguer la progression de l’émancipation des GFP. Avant même le développement quantitatif des GFP survenu à partir de 1999, les positions de chacun étaient clairement annoncées. Un sondage effectué en 1996 par l’Association des maires de France (AMF) (cité par Caillosse et al. 2001 : 91) faisait en effet apparaître que 70 pour-cent des maires étaient hostiles à une élection directe des délégués intercommunaux, confirmant ainsi l’opinion majoritaire « des maires qui concentrent tous les pouvoirs et ont fini par imposer une culture civique du monopole des fonctions politiques » (Vanier, 2005).
Cette volonté des élus de freiner l’évolution de la démocratie intercommunale n’a, il est vrai, fait l’objet que de critiques assez rares. Cela est d’autant moins étonnant si l’on considère que l’élection directe des délégués intercommunaux n’a pas été érigée au rang de priorité par les acteurs et les réseaux en charge du développement local. Pour ces derniers, « le déficit démocratique est avant tout un déficit de projet partagé […], plus important que de penser directement à élire des conseillers intercommunaux au suffrage direct[17] ».
D’aucuns, à l’image de Patrick Devedjian (alors ministre délégué aux Libertés locales), ont même envisagé en 2004 une solution radicale pour réfréner les velléités démocratiques intercommunales, en soulignant que « la discussion sur l’élection des EPCI [établissements publics de coopération intercommunale] au suffrage universel aura toute sa signification quand ces établissements couvriront 100 % du territoire » (cité par Sadran 2005 : 50). Certes, il est vrai qu’il est « délicat, notamment au regard du principe d’égalité, d’introduire une nouvelle élection au suffrage universel [pour les GFP] alors même que tous les Français ne [bénéficieraient] pas de cette forme de représentation » (Thibault, 2004 : 91), qui plus est au sein de GFP, quand ils existent, aux frontières encore instables.
Mais face au retard significatif et spécifique de l’intercommunalité dans des zones comme l’Île-de-France[18], conditionner l’ouverture du débat sur le scrutin direct à la couverture complète du territoire équivaut à éluder sine die, et de façon diplomatique, cette question. C’est en tout cas un alibi providentiel si l’on considère « les réticences des principaux acteurs dont aucun n’a de véritable envie ni d’intérêt primordial au changement » (Sadran, 2005 : 50), au premier rang desquels figure l’État (Guéranger, 2008a). L’intercommunalité étant soit invisible, soit nébuleuse pour les citoyens français, le gouvernement français n’a en effet strictement rien à gagner (voire tout à perdre) à se saisir d’un problème transparent et très secondaire pour le peuple, et encore moins à se couper de sa base d’élus locaux et nationaux. Tel est l’argument mis en avant par Éric Kerrouche (2008 : 137-138) quand il souligne une « réforme pusillanime […] et dépassée du système local, […] un déni de réalité et plus prosaïquement la nécessité pour le premier ministre de l’époque [Lionel Jospin] de ménager ses soutiens traditionnels ».
La vision du Sénat s’inscrit dans la droite lignée de celle de l’État français. On pourrait en effet trouver étonnant que Philippe Dallier ait adopté, dans « son » rapport très bien documenté, une opinion assez déconcertante qui rejoint, en fin de compte, les craintes les plus vives de la majorité des maires, exprimées dix ans auparavant, c’est-à-dire avant que l’intercommunalité n’ait pris son tournant actuel. Il y précise, alors que le rapport souligne, entre autres faiblesses des GFP, l’absence d’élection directe, que « le débat de l’élection au suffrage universel direct [est] prématuré » (2006a : 50). Certes, cette assertion n’intervient pas dans le corps du rapport mais dans sa discussion, qui plus est, un peu en catimini, en une ligne à la dernière page.
Mais cette prise de position apparaît moins surprenante quand on constate que la plupart des spécialistes des finances locales au Sénat (parmi lesquels Joël Bourdin) se rangent quasi unanimement derrière son avis. Elle est d’autant plus compréhensible si l’on part du principe que le suffrage universel direct pour les GFP signifierait à brève échéance la disparition des communes et donc un bouleversement du collège électoral sur lequel repose le mandat des actuels sénateurs (Caillosse et al., 2001). Aujourd’hui plus que jamais, avec la discussion sur la réforme territoriale, s’élèvent des voix pour souligner que « retenir un mode de scrutin fondé sur le suffrage universel direct […] accroîtrait de fait les pouvoirs des intercommunalités au détriment de ceux des communes et légitimerait une forme de tutelle[19] » du GFP sur ses communes, prélude à la disparition de ces dernières (Sénat, 2010 : 608).
Néanmoins, une précision s’impose. Cet argument visant à mettre en avant la menace de disparition des communes est seulement un postulat. Supposer que les communes disparaîtraient si l’exécutif intercommunal était démocratiquement élu n’est pas une assertion aisément vérifiable. Pour autant, tel est bien le coeur du message véhiculé par les 500 000 élus locaux français (Caillosse, 2001), par le biais de toutes leurs structures, leurs associations[20] et leurs lobbies s’érigeant en « groupes de défense d’intérêts corporatistes » (Le Saout, 2009 : 61). C’est en partant de ce postulat d’un risque élevé de suppression des communes qu’ils vont aboutir à un second postulat, celui faisant des communes le lieu privilégié d’expression de la démocratie au niveau local.
La préservation des communes comme source intarissable de démocratie locale
La base du raisonnement des élus locaux est la suivante. Les citoyens éprouvent des difficultés à se sentir proches des affaires politiques et, hormis les présidentielles, les élections municipales sont les seules qui les incitent à s’impliquer dans la gestion publique. De là émergerait un lien (supposé) extrêmement fort entre communes et démocratie. Les communes seraient « le » territoire où l’expression démocratique du peuple français s’exprimerait avec le plus de force. Le maintien, étrange et un peu anachronique vis-à-vis de nos voisins européens, d’un morcellement communal aussi important en France relève de ce même type de croyance.
Dès lors, si l’on suppose que la démocratie locale s’exprime essentiellement dans les communes, instaurer le suffrage universel direct pour les GFP reviendrait à provoquer la mort de ces mêmes communes : pourquoi conserver des territoires délestés de leurs compétences les moins banales, puisque le seul avantage spécifique dont ils pouvaient se targuer vis-à-vis des GFP était précisément d’être gouvernés par un exécutif émanant d’un vote populaire (Degoffe, 2005) ? De toutes ces prémisses, il résulte que si l’on veut sauvegarder la démocratie locale, il faut sauvegarder les communes, donc il faut interdire le suffrage universel direct pour les GFP.
Plusieurs points semblent néanmoins réfutables dans ce raisonnement. Tout d’abord, si un vrai sentiment de proximité, quasi affectif, existe entre les citoyens et leur commune (voire avec leur maire), qui les incite à moins s’abstenir lors des élections municipales, alors pourquoi ce sentiment souffrirait-il d’une simple modification du mode de scrutin pour un autre échelon territorial ?
En outre, si l’on tient à l’implication démocratique des citoyens, pourquoi hésiter à leur donner la possibilité de s’exprimer sur les sujets les plus importants (délégués aux GFP) qui concernent leur quotidien ? Car, dans les mots d’Adrien Zeller, alors président du Conseil régional d’Alsace et co-président de l’Institut de la décentralisation, « l’espace aujourd’hui pertinent de l’action publique et du développement local – donc inévitablement de la démocratie – n’est plus la commune mais la communauté » (cité par Guéranger, 2008b : 47). Enfin, dans la mesure où l’on ne peut guère opposer démocratie et suffrage universel direct, comment l’instauration de ce dernier pour les GFP pourrait-elle porter atteinte à la démocratie locale au niveau des communes ?
La réponse réside en partie dans la formulation de ce postulat démocratique des communes. Souvent on considère que les communes sont des territoires « démocratiques » parce que les citoyens font un effort accru de participation lors des élections municipales[21]. Mais, au-delà de cet argument purement statistique et aisément vérifiable, c’est en réalité sur un autre argument, lui aussi strictement chiffré, que repose l’essentiel du postulat démocratique : le nombre d’élus locaux.
Et c’est précisément à ce même argument que François Mitterrand a eu recours[22] pour s’opposer à plusieurs de ses ministres de l’Intérieur (notamment Pierre Joxe et Jean-Pierre Chevènement), favorables au développement de l’intercommunalité. Pour lui, il était insensé de se priver de l’atout incarné par le fait que plus de un million de Français ressentaient de l’intérêt pour la « chose publique », soit les 500 000 élus et au minimum les 500 000 autres personnes qui aspirent à être élues à leur place.
La volonté de sauvegarder leur mandat électif municipal et d’assurer leur réélection serait donc la raison principale pour laquelle les groupements d’élus locaux français utiliseraient tous les moyens possibles pour freiner la généralisation du suffrage universel direct aux GFP, rejoignant ainsi les sénateurs et leur préoccupation de maintien de leur base élective. La volonté des maires de petites communes de préserver également leur siège de délégué intercommunal s’inscrit dans cette même visée stratégique. Il ne fait en effet aucun doute qu’un suffrage universel reposant sur des bases strictement démographiques priverait la plupart d’entre eux de leur siège actuel.
Des motivations personnelles et électoralistes
Il s’agira alors pour les élus locaux de veiller à ce que les conditions de leur réélection soient préservées, indépendamment de la montée en puissance de l’échelon intercommunal, tout en tirant avantage de cet essor pour utiliser le réflexe d’imputation de l’action publique locale aux maires.
Favoriser sa propre réélection et conserver ses mandats « acquis »
Plus qu’un simple enjeu annexe venu se surajouter, l’obtention du pouvoir intercommunal est désormais l’enjeu politique majeur, supplantant la quête d’un pouvoir « seulement » municipal, même si celui-ci demeure un préalable indispensable. Supposer que c’est la volonté de conserver leur mandat existant et de favoriser leur future réélection qui guide principalement le comportement des décideurs politiques permet de mieux comprendre toutes les incohérences que l’État a tolérées en matière de périmètre des GFP (Thomas, 2008b) ainsi que l’absence de réduction du nombre de communes.
Dans sa charte d’Amiens en 2005, l’Assemblée des communautés de France (ADCF) met en exergue que « la correspondance entre les communautés et les espaces vécus est indispensable pour que [les] concitoyens s’approprient le fait intercommunal » (Cour des comptes, 2005 : 81). Pourtant, très nombreux sont les cas où le territoire des GFP diffère de celui des syndicats intercommunaux préexistants, certes très peu, mais suffisamment pour justifier la non-disparition des syndicats et le maintien de leurs fonctions d’administration (Bernard Gélabert, 2007).
La juxtaposition d’un GFP nouvellement créé et de plusieurs syndicats intercommunaux dont il aurait normalement dû entraîner la disparition présente un double avantage pour les membres de l’exécutif intercommunal. Premièrement, elle permet la multiplication des postes à responsabilité. Au-delà de la satisfaction de l’ego de leurs détenteurs, il importe de souligner que les élus qui siègent aux conseils syndicaux bénéficient d’indemnités, souvent fixées au taux plafond (de Saint Sernin, 2002). Faire coïncider les frontières d’une aire urbaine et d’une communauté d’agglomération (ou urbaine) entraînerait alors, outre la très probable suppression des anciens syndicats, la disparition pour les élus des rémunérations qu’ils considéraient comme des ressources fixes et inaliénables.
Deuxièmement, cette juxtaposition de structures redondantes contribue à entretenir une confusion, dans l’esprit des citoyens, relative au territoire économiquement pertinent pour l’exercice des compétences intercommunales, puisque le zonage et le groupement responsable (GFP, syndicat intercommunal à vocation multiple, syndicat mixte…) pourront varier en fonction des compétences (transport, traitement des déchets, développement économique…). Ne pas faire coïncider unicité du zonage et espace vécu contribue donc à ralentir le sentiment d’appropriation par les citoyens de la réalité intercommunale dans leur GFP, à la rendre « plus opaque aux yeux des citoyens » (Girardon, 2008 : 98), ce qui retarde donc d’autant le moment où l’on jugera opportun de recourir au suffrage universel direct. Le maintien des avantages et des pouvoirs électifs « acquis » serait à ce prix.
Ne pas instaurer d’élection directe des délégués communautaires permet aussi aux maires de récupérer une fonction supplémentaire (à fort contenu en pouvoir) sans pour autant que cette dernière ne rentre dans le cadre de la Loi sur le cumul des mandats (Politis, 2002). C’est certainement la principale (voire la seule véritable) raison pour laquelle les GFP ne disposent toujours pas du statut de collectivité locale. Alors que le statut d’établissement public ne convient plus du tout à la réalité de l’action contemporaine des GFP, on peut vraisemblablement imputer ce statu quo institutionnel non pas à une quelconque inertie ou lourdeur de l’administration française, mais davantage à un moyen opportun pour les élus de ne pas devoir abandonner un de leurs mandats actuels pour avoir le droit d’administrer aussi leur agglomération.
Tirer avantage du réflexe d’imputation de l’action publique au maire
Différentes raisons permettent d’expliquer le réflexe automatique d’imputation au maire de l’ensemble de l’action politique entreprise au niveau local. Tout d’abord, sa position privilégiée d’élu de proximité et la personnification de sa liste derrière sa seule identité jouent un grand rôle. La quasi-totalité des habitants d’une commune peuvent citer le nom de leur maire, mais ils ne sont qu’environ 40 pour-cent à connaître l’identité du président de leur GFP (selon un sondage de l’ADCF, 2005, cité par Dallier, 2006b). Ensuite, la complexité du mécanisme de détermination du président d’un GFP n’est pas neutre. En effet, les citoyens d’une commune donnée ne vont élire que leurs conseillers municipaux (alors qu’ils songeront très majoritairement à se déplacer pour élire leur maire, pas « seulement » ses conseillers). Et il appartiendra aux conseillers de cette commune, minoritaires face à ceux provenant des autres communes, non pas de déterminer le président du GFP, mais d’élire un bureau qui, lui-même, déterminera le président du GFP.
Ainsi, eu égard à cette complexité génératrice de distance institutionnelle entre les élus intercommunaux et leurs administrés, il sera d’autant plus rassurant pour ces derniers d’opter pour un réflexe d’imputer par défaut à l’échelon qu’ils maîtrisent le mieux (leur commune) les domaines de compétences intercommunaux. Par la même occasion, il sera alors facile pour les maires des communes périphériques de tirer avantage de cette situation et d’activer des « logiques d’imputabilité communale vis-à-vis des citoyens » (Le Lidec, 2009 : 491), en continuant à s’attribuer le mérite de la plupart des actions entreprises au niveau local, qu’elles soient de leur compétence (municipale) ou bien de celle du GFP (Le Bart, 1992).
Dans un contexte où l’apparition de réels programmes intercommunaux portés en tant que tels par les élus des communes d’un même GFP (Mevellec, 2005 : 428) relève encore de l’exception, on serait alors devant une « démocratie en trompe-l’oeil, maîtrisée par les représentants des communes » (Demaye, 1999 : 247). Si la compétence intercommunale pour une action donnée venait à être clairement affichée[23], le fait de disposer d’un poste de vice-président du GFP viendra cautionner le maintien de cette « imputation mayorale », ne serait-ce que partiellement.
Inversement, il demeurera aisé pour un maire de commune périphérique, dans sa communication municipale, de se désolidariser de son groupement dans les cas où le sujet d’imputation véhiculerait non pas une image positive (terminus du métro dans sa commune), mais négative et sujette à critiques. Ainsi, le maire d’une commune touchée par l’annonce d’une fermeture d’usine pourra se retrancher derrière le fait que le développement économique est une compétence qui n’est plus municipale et que c’est par conséquent au président du GFP qu’il faut adresser ses griefs d’inertie et d’interventionnisme insuffisant (Desage, cité par Guéranger, 2008b : 67). Il en sera de même pour toute décision impopulaire (Frinault et Le Saout, 2009 : 4). « Les maires s’approprient les réalisations permises par l’intercommunalité, en omettant de mentionner au passage qu’elle est à leur origine [et] ils rejettent sur elle la responsabilité des manques constatés » (Sénat, 2010 : 614).
Faire reposer l’entière responsabilité de l’action intercommunale sur les épaules du maire de la ville centre pourra s’avérer utile dans la mesure où les citoyens ne parviendront que très rarement à comprendre les enjeux et les interactions réels entre niveaux communal et intercommunal.
Conclusion
Le mode d’élection des délégués intercommunaux en France demeure un sujet épineux. Nombreux sont les arguments plaidant en faveur de l’établissement d’un lien direct entre les électeurs et leurs délégués, gérant des budgets de plus en plus conséquents, pour exercer des compétences clés. Cependant, nous avons mis en lumière la force des arguments prônant au contraire la permanence du système actuel. En filigrane, derrière chacun de ces « contre-arguments » figure la volonté de ne pas entamer la pérennité de l’échelon communal, soit par souci d’apaisement politique (pour l’État), soit par volonté de ne pas réduire sa base élective (pour le Sénat), soit pour conserver l’importance acquise par les élus municipaux dans leur commune, d’autant plus quand cette dernière est faiblement peuplée.
Le problème semble dès lors insoluble. Dans la mesure où le suffrage universel direct affaiblirait les petites communes au sein de leur GFP, comment instaurer une élection démocratique pour les GFP sans qu’elle soit directe ? C’est pourtant à ce paradoxe que s’est attaquée la proposition de loi du 18 mars 2009 « visant à accroître la légitimité des établissements publics de coopération intercommunale » (Assemblée nationale, 2009) et tendant à généraliser à l’ensemble des communes françaises un mécanisme inspiré du système PML[24]. Le tour de force réside en fait essentiellement dans la permanence d’une unicité de territoires électoraux, le zonage municipal devant demeurer l’unité territoriale du scrutin des GFP, en vue de ne pas trop émanciper ces derniers et satelliser exagérément les communes (Girardon, 2008).
Ainsi, cette proposition de loi parvient à instiller un supplément de démocratie intercommunale sans pour cela remettre en question le mode actuel d’attribution des sièges aux différentes communes membres. Qui plus est, le scrutin municipal voit son rôle prééminent renforcé et confirmé puisque c’est par son intermédiaire que seraient élus « directement » les délégués intercommunaux. Dès lors, le choix des délégués des GFP serait « entériné par les électeurs à l’issue du scrutin désignant les conseillers municipaux » (article 3), chaque liste candidate aux municipales désignant « un nombre de candidats au mandat de délégué égal au nombre de sièges dont dispose la commune » (article 4). Ce dernier point, déterminant, demeure donc inchangé. Ce « ravaudage » électoral apparaît à première vue providentiel, puisque tout en entérinant légalement le caractère siamois[25] des institutions municipales et intercommunales, il proposerait un compromis subtil face aux trois « contre-arguments » précédemment évoqués : les petites communes ne seraient pas fragilisées, le nombre d’élus locaux ne diminuerait pas, la sacralisation du scrutin municipal se verrait confirmée.
Il témoigne surtout du pouvoir des lobbies d’élus locaux (notamment AMF et ADCF) puisque la solution actuellement discutée s’avère très proche de celle que l’ancien ministre de l’Intérieur, Daniel Vaillant, appelait de ses voeux il y a quasiment dix ans, à savoir sa « préférence pour des élections concomitantes organisées sur la circonscription communale et sur liste commune »[26]. Et il ne traduit qu’un « consensus essentiellement défensif, destiné à éviter l’adoption de mesures susceptibles de générer des changements de plus grande ampleur » (Le Lidec, 2009 : 490). Plusieurs autres étapes seront sans doute nécessaires pour une démocratie intercommunale qui ne privilégie pas la lettre à l’esprit.
Parties annexes
Note biographique
Olivier Thomas, maître de conférences à l’Université Montpellier 1, est chercheur associé au Laboratoire d’études et de recherches sur l’économie, les politiques et les systèmes sociaux (LEREPS). Ses travaux portent principalement sur l’impact de la rigueur budgétaire sur la croissance, ainsi que sur les finances et la gouvernance des collectivités territoriales françaises.
Notes
-
[1]
Loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, connue sous le nom de « loi Chevènement ».
-
[2]
Soixante-treize pour-cent, selon un sondage IPSOS AMF cité par Kerrouche (2008).
-
[3]
Sont ici évoqués aussi bien les GFP « 4 taxes » (taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe professionnelle – avant sa réforme actuelle – et taxe d’habitation) que les GFP à TPU (taxe professionnelle unique), qu’ils aient recours ou non à la fiscalité mixte.
-
[4]
Qui demeure stable tant que la commune ne change pas de strate.
-
[5]
Loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
-
[6]
Les intercommunalités ne sont pas concernées par la Loi du 6 juin 2000 relative à la parité des mandats électifs, puisque les délégués intercommunaux ne sont pas élus par les citoyens. De fait, en 2004, les femmes représentent 47,5 % des conseillers municipaux, 11 % des maires et 5,5 % des présidents d’intercommunalité (Kerrouche, 2008).
-
[7]
Ce profil type est corroboré notamment par l’enquête faite par Kerrouche (2008) sur les structures intercommunales de la région Aquitaine en 2005 ainsi que par celle Vignon (2004) concernant les GFP du Département de la Somme. La référence de base demeure Le Saout (2000b).
-
[8]
Le Saout (2000b) avait en effet relevé que 36 % des responsables de GFP de plus de 50 000 habitants étaient des parlementaires, contre seulement 2,8 % pour les petits GFP.
-
[9]
Selon un sondage de l’Assemblée des communautés de France (ADCF) réalisé en octobre 2005 (cité par Dallier, 2006b).
-
[10]
On trouve des résultats analogues dans le sondage Sofres cité par Thibault (2004 : 98), qui met en exergue le fait que, pour 64 % des sondés, « le principal inconvénient de l’intercommunalité se trouve dans une plus grande difficulté pour les citoyens à savoir qui fait quoi ».
-
[11]
Que ce soit, encore une fois, pour les CC 4 taxes, ou pour les GFP à TPU ayant opté pour la fiscalité mixte (Cour des comptes, 2005).
-
[12]
Entretien réalisé en 2003 par Fabien Desage, cité par Bué et al. (2004 : 39).
-
[13]
Baraize et Négrier (2001) détaillent à quel point l’hostilité de la commune communiste de Limay à intégrer l’agglomération de Mantes-la-Jolie fut vraisemblablement moins motivée par le relais de la dénonciation du manque de démocratie des GFP effectué par le Parti communiste français (PCF) que par des intérêts opportunistes strictement locaux.
-
[14]
Si ce dernier rassemble plus de 50 000 habitants, la proportion tombe à quasiment 60 % pour les petits groupements (moins de 10 000 habitants).
-
[15]
Opinion défendue par Dominique Braye, sénateur UMP (Union pour un mouvement populaire) jusqu’en 2011, qui, en dépit de son appartenance à la majorité présidentielle qui entend légiférer en faveur du suffrage universel direct pour les délégués intercommunaux, condamne cette proposition comme étant contraire à « l’esprit de l’intercommunalité » (Sénat, 2010 : 612).
-
[16]
Rappelons d’ailleurs que les maires des communes françaises sont très majoritairement maires de communes de petite taille. Parmi les 36 778 communes françaises, 92 % ont en effet moins de 3500 habitants et 28 % moins de 200 habitants. La taille moyenne avoisine 1600 habitants (Demazière, 2005).
-
[17]
Propos défendus par Olivier Dulucq, délégué général de l’Union nationale des acteurs et des structures de développement local (UNADEL), et recueillis dans le n° 462 de la revue Territoires » (novembre 2005).
-
[18]
Au 1er janvier 2007, 91 % des communes françaises sont membres d’un GFP, contre seulement 69 % en Île-de-France. Le taux de couverture de la population par les GFP n’y est que de 58,2 %, avec des Départements en net retard : 26 % pour la Seine-Saint-Denis, 45 % pour le Val-de-Marne, 51 % pour les Hauts-de-Seine, sans compter le cas particulier mais non moins épineux de Paris (Albert et al., 2008)
-
[19]
Telle est en tous cas l’opinion défendue par Josiane Mathon Poinat et, à travers elle, notamment, le groupe communiste, ainsi que des personnalités aussi reconnues, d’une part, et centrales dans l’histoire de l’intercommunalité, d’autre part, que Michel Charasse et Jean-Pierre Chevènement.
-
[20]
Association des maires de France, Association des maires des grandes villes de France, Association des Départements de France, Association des Régions de France, Association des maires ruraux de France…
-
[21]
La participation aux municipales de 2008 a été de 66 %. Quoique en nette baisse par rapport aux années antérieures (73 % en 1989 et 79 % en 1983), elle demeure nettement supérieure à celle observée lors des autres élections, présidentielles exceptées (41 % aux européennes de 2009, 46 % aux régionales de 2010, 44 % aux cantonales de 2011).
-
[22]
Il semblerait d’ailleurs que l’on puisse lui en attribuer la paternité. On se référera à ce sujet aux propos rapportés par Philippe Marchand, alors ministre délégué aux Collectivités locales, rapportés par Guéranger (2000), ainsi qu’à Le Saout (1998).
-
[23]
Grâce à une action de marketing public par exemple…, mais cela supposerait que les citoyens en soient majoritairement conscients, ce qui, nous l’avons déjà développé, n’a que peu de chances d’arriver.
-
[24]
La loi PML, promulguée le 31 décembre 1982 par le gouvernement Mauroy, organise les élections municipales à Paris, Marseille et Lyon à un double niveau : celui de l’arrondissement et celui de la commune en entier. La déclinaison de ce système aux GFP laisserait malgré tout entier le problème dans le cas des communes de moins de 3500 habitants, dont il faudrait repenser le mode de scrutin de façon plus radicale.
-
[25]
Selon Kerrouche (2008), pour souligner l’imbrication étroite entre communes et GFP, tout en laissant la porte ouverte, en poursuivant l’analogie médicale, à une séparation potentielle, mais grandement risquée.
-
[26]
Propos tenus le 8 novembre 2001 et cités par Thibault (2004 : 95).
Bibliographie
- Albert, Jean-Luc, Vincent De Briant et Jacques Fialaire, 2008, L’intercommunalité et son coût, Paris, L’Harmattan.
- Albertini, Pierre, 2006, « Le débat sur la légitimité démocratique des structures intercommunales doit être ouvert », Pouvoirs locaux, nº 68, p. 113-115.
- Assemblée nationale, 2009, Proposition de loi nº 1536 visant à accroître la légitimité des établissements publics de coopération intercommunale, présentée par Jean-François Mancel et enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 18 mars 2009.
- Baraize, François et Emmanuel Négrier, 2001, L’invention politique de l’agglomération, Paris, L’Harmattan.
- Barthélémy, Fabrice et Mathieu Martin, 2007, « Critères pour une meilleure répartition des sièges au sein des structures intercommunales : une application au cas du Val d’Oise », Revue économique, vol. 58, nº 2, p. 399-426.
- Bauguil, Jean-Paul, 1973, Les groupements de communes, thèse de doctorat, Université Montpellier 1.
- Bernard Gélabert, Marie-Christine, 2007 [6e éd.], L’intercommunalité, Paris, LGDJ.
- Bué, Nicolas, Fabien Desage et Laurent Matejko, 2004, « L’intercommunalité sans le citoyen. Les dimensions structurelles d’une moins value démocratique », dans Rémi Le Saout et François Madoré (sous la dir. de), Les effets de l’intercommunalité, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 39-58.
- Buisson, Jacques, 2005, « La révolution intercommunale », Regards sur l’Actualité, nº 314, p. 5-16.
- Caillosse, Jacques, 2001, « En attendant le pouvoir d’agglomération ? », Pouvoirs locaux, nº 50, p. 25-31.
- Caillosse, Jacques, 2005, « Les intercommunalités de l’acte 2 », Pouvoirs locaux, n° 67, p. 121-128.
- Caillosse, Jacques, Patrick Le Lidec et Rémi Le Saout, 2001, « Le procès en légitimité démocratique des EPCI », Pouvoirs locaux, n° 48, p. 91-97.
- Censi, Marc, 2005, « Intercommunalité : les mises au point qui s’imposent », Pouvoirs locaux, n° 67, p. 3-6.
- Chevallier, Jacques, 1997, L’intercommunalité, bilan et perspectives, Centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie (CURAPP), Paris, Presses universitaires de France, p. 273-279.
- Cour des comptes, 2005, L’intercommunalité en France, rapport au Président de la République, 14 novembre 2005.
- Dallier, Philippe, 2006a, Rapport d’information nº 193 fait au nom de l’Observatoire de la décentralisation sur l’intercommunalité à fiscalité propre, Sénat, 1er février 2006.
- Dallier, Philippe, 2006b, Rapport d’information nº 48 fait au nom de l’Observatoire de la décentralisation sur le bilan et les perspectives de l’intercommunalité à fiscalité propre, Sénat, 30 octobre 2006.
- de Saint Sernin, Dominique, 2002, « La difficile appréciation des finances des établissements publics de coopération intercommunale », La Revue du trésor, nº 6, p. 363-367.
- Degoffe, Michel, 2005, « Les EPCI dans les institutions », Regards sur l’Actualité, nº 314, p. 33-42.
- Delannoy, Max-André, Jérôme Rieu et Frédérique Pallez, 2004, « Intercommunalité : une réforme qui cherche ses objectifs », Politiques et management public, vol. 22, nº 2, p. 75-93.
- Demaye, Patricia, 1999, « La recherche de la démocratie intercommunale », dans La Démocratie locale : Représentation, participation et espace public, Centre de recherches administratives, politiques et sociales de Lille (CRAPS) et Centre universitaire de recherches administratives politiques de Picardie (CURAPP). Paris, Presses universitaires de France, p. 237-270.
- Demazière, Christophe, 2005, « Le développement de l’intercommunalité », Cahiers français, n° 328, p. 44-50.
- Desage, Fabien, 2005, Le consensus communautaire contre l’intégration intercommunale. Séquences et dynamiques d’institutionnalisation de la Communauté urbaine de Lille 1964-2003, thèse de doctorat, Université de Lille.
- Direction générale des collectivités locales (DGCL), 2004, « La Loi Liberté et Responsabilités Locales », Démocratie locale, nº 99.
- Frinault, Thomas et Rémi Le Saout, 2009, « Intercommunalité et démocratie, l’intercommunalité comme ressource dans le cadre des élections municipales, l’exemple de Rennes », Communication au congrès de l’Association française de science politique, Grenoble, 7-9 septembre 2009.
- Gamon, Véronique, 2002, « Les intercommunalités contre l’intercommunalité ? », Pouvoirs locaux, nº 52, p. 23-28.
- Girardon, Jean, 2008, L’intercommunalité, Paris, Ellipses, coll. « Mise au point ».
- Glaser, Mark A., Lee E. Parker et Stephanie Payton, 2001, « The Paradox between Community and Self-interest : Local Government, Neighbourhood, and Media », Journal of Urban Affairs, vol. 23, n° 1, p. 87-102.
- Guéranger, David, 2000, « Structuration des pouvoirs locaux et réforme de l’intercommunalité : l’exemple de la loi ATR », Politiques et management public, vol. 18, n° 3, p. 121-134.
- Guéranger, David, 2008a, « L’intercommunalité créature de l’État, analyse socio-historique de la coopération intercommunale, le cas du bassin chambérien », Revue française de science politique, vol. 58, nº 4, p. 595-616.
- Guéranger, David, 2008b, « L’intercommunalité en questions », Problèmes politiques et sociaux, nº 951-952.
- Guéranger, David, 2009, « L’intercommunalité au prisme de la gouvernementalité, réflexions prospectives pour un agenda de recherche sur la coopération intercommunale », dans Paul Boino et Xavier Desjardins (sous la dir. de), Intercommunalité : politique et territoire, Paris, La Documentation française, p. 147-154.
- Jouve, Bernard, 2005, « La démocratie en métropoles : gouvernance, participation et citoyenneté », Revue française de science politique, vol. 55, nº 2, p. 317-337.
- Kerrouche, Éric, 2008, L’intercommunalité en France, Paris, Montchrestien.
- Klopfer, Michel, 2006, « Les enjeux de l’interdépendance financière entre communes et groupements à taxe professionnelle unique », Notes Bleues de Bercy, nº 302.
- Koebel, Michel, 2005, Le pouvoir local ou la démocratie improbable, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant.
- Le Bart, Christian, 1992, La rhétorique du maire entrepreneur – critique de la communication municipale, Pedone, Centre d’études et de recherche sur la vie locale.
- Le Bras, David, 2003, La fiction intercommunale, étude du processus de construction identitaire des communautés d’agglomération de Grenoble, thèse de doctorat, Lens-Liévin et Voiron, École des hautes études en sciences sociales.
- Le Lidec, Patrick, 2009, « Réformer sous contrainte d’injonction contradictoire : l’exemple du comité Balladur sur la réforme des collectivités locales », Revue française d’administration publique, n° 131, p. 477-496.
- Le Saout, Rémi (sous la dir. de), 1997, « L’intercommunalité : logiques nationales et enjeux locaux », Rennes, Presses universitaires de Rennes.
- Le Saout, Rémi (sous la dir. de) 1998, « Les enjeux de l’intercommunalité », Problèmes politiques et sociaux, nº 811.
- Le Saout, Rémi, 2000a, Le pouvoir intercommunal. Sociologie des présidents des établissements intercommunaux, Orléans, Presses universitaires d’Orléans.
- Le Saout, Rémi, 2000b, « L’intercommunalité, un pouvoir inachevé », Revue française de science politique, vol. 50, nº 3, p. 439-461.
- Le Saout, Rémi, 2004, « Un enjeu interne au champ politique, intercommunalité et démocratie », Pouvoirs locaux, n° 62, p. 67-73.
- Le Saout, Rémi, 2009, « L’intercommunalité, une strate politique pertinente ? », dans Christian Bidégaray, Stéphane Cadiou et Christine Pina (sous la dir. de), L’élu local aujourd’hui, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, p. 59-68.
- Lefèvre, Christian, 2005, « Faire des métropoles des territoires démocratiques », Pouvoirs locaux, n° 65, p. 81-84.
- Ministère de la Fonction publique, de la Réforme de l’État et de l’Aménagement du Territoire, 2004, Circulaire relative aux nouvelles dispositions concernant l’intercommunalité introduites par la Loi liberté et responsabilités locales, 15 septembre 2004.
- Mevellec, Anne, 2005, La construction politique des agglomérations : logiques politiques et dynamiques institutionnelles : une comparaison franco-québécoise, thèse de doctorat, Québec, Université du Québec à Chicoutimi.
- Négrier, Emmanuel, 2002, « Les variables locales de l’intercommunalité », Pouvoirs locaux, n° 52, p. 29-30.
- Politis, Karen, 2002, « Quelle démocratie d’agglomération ? », Pouvoirs locaux, nº 52, p. 15-16.
- Pontier, Jean Marie, 1999, « La nouvelle réforme des structures de coopération intercommunale », Revue administrative, nº 311, p. 516.
- Sadran, Pierre, 2005, « Démocratiser les structures intercommunales ? », Regards sur l’Actualité, nº 314, p. 43-53.
- Sénat, 2010, Compte rendu intégral de la séance du mercredi 27 janvier 2010, Journal officiel de la République française, p. 558-625.
- Thibault, Florent, 2004, Intercommunalité : la voie étroite du suffrage universel direct, Voiron, Lettre du Cadre territorial.
- Thomas, Olivier, 2008a, « Intercommunalité française et hausse de la pression fiscale : effet collatéral ou stratégie politique délibérée ? », Revue française d’administration publique, n° 127, p. 461-474.
- Thomas, Olivier, 2008b, « L’acceptation des dérapages de l’intercommunalité en France : une manière détournée d’établir les fondements d’une fusion implicite entre communes ? », Cahiers du GRES (Groupement de recherches économiques et sociales), nº 12.
- Tournon, Jean, 2009, La république antiparticipative : les obstacles à la participation des citoyens à la démocratie locale, Paris, L’Harmattan.
- Tullock, Gordon, 1976, The Vote Motive, Londres, The Institute of Economic Affairs.
- Vanier, Martin, 2005, « Effets territoriaux de l’intercommunalité : le nouveau pouvoir communal-communautaire », Territoires, nº 461.
- Vignon, Sébastien, 2004, « Les rétributions inégales de l’intercommunalité pour les maires ruraux. Les improbables retours sur investissement(s) politique(s) », dans Rémi Le Saout et François Madoré (sous la dir. de), Les effets de l’intercommunalité, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 17-38.