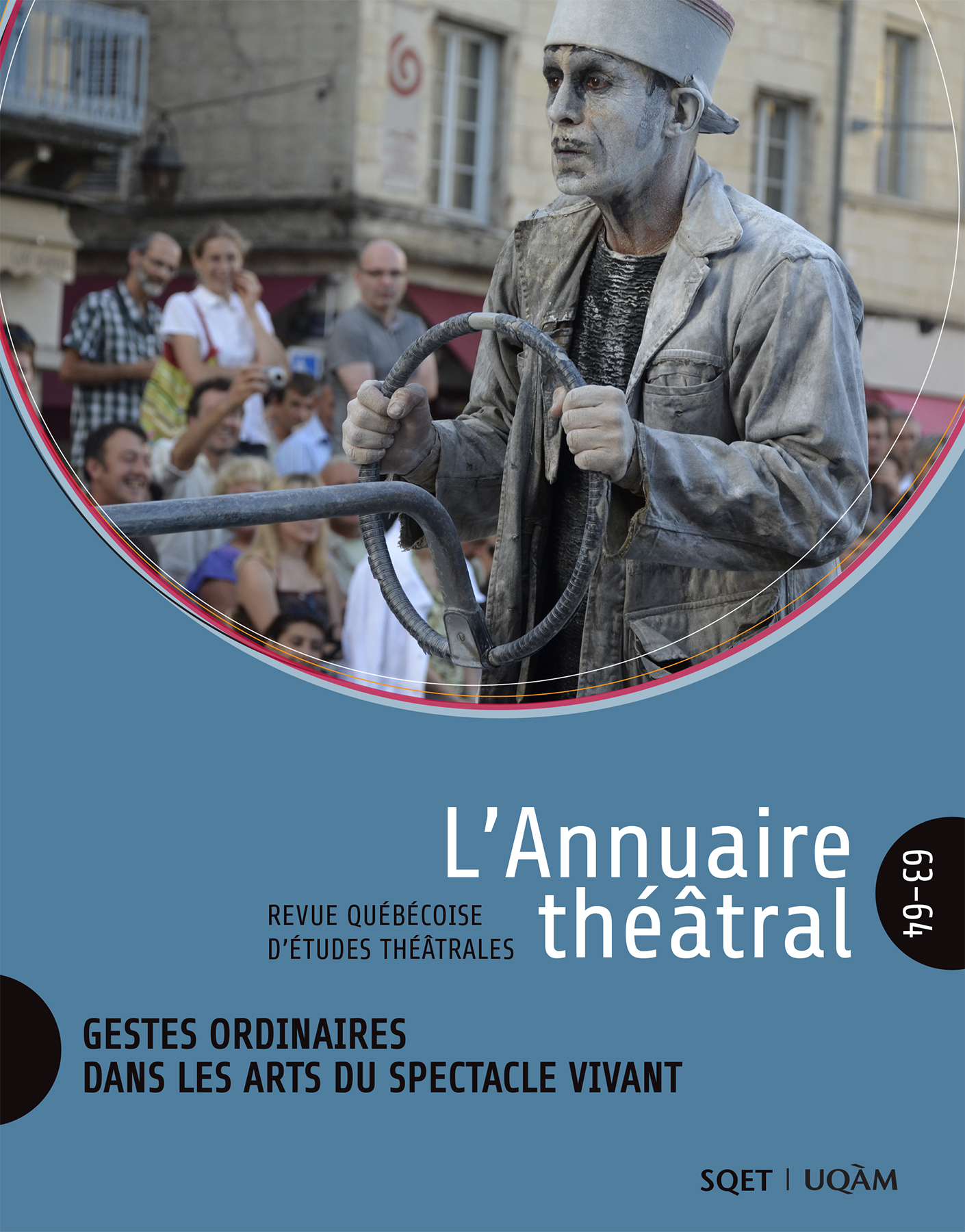Abstracts
Résumé
Cet article examine l’usage du corps et le rôle du geste dans l’art performatif caribéen et plus particulièrement dans la société post-esclavagiste guadeloupéenne. Avec la techni’ka, la chorégraphe Léna Blou réinvente les gestes ordinaires hérités de l’esclavage en états de corps fondamentaux, qui subliment la contrainte somatique en créativité, et deviennent des outils d’expression socio-esthétiques déclinables à l’infini. Les parades iguanesques des performeurs Annabel Guérédrat et Henri Tauliaut donnent sens au corps vulnérable de la société antillaise. En imposant des états de corps extraordinaires dans l’espace public, ils questionnent les modes de relations racisés mis en place par le racisme colonial. L’invention d’une grammaire corporelle, régie par la contrainte somatique et le déséquilibre, réinscrit l’histoire de l’esclavage dans une stratégie mémorielle réparatrice qui dépasse un héritage historique traumatique grâce à un encodage neuf de ses legs somatiques.
Abstract
This article examines the use of the body and the role of gesture in Caribbean performance, more specifically in Guadeloupe’s post-plantation society. With techni’ka, the choreographer Léna Blou reinvents the ordinary gestures inherited from slavery into fundamental body states that convert bodily constraint into creativity and become unlimited socio-aesthetic instruments of expression. The iguana parades of performers Annabel Guérédrat and Henri Tauliaut make sense of the vulnerability of French Caribbean society. By imposing extraordinary body movements in the public space, they challenge the racialized body language established by colonial racism. The invention of an embodied grammar governed by bodily constraint and imbalance restores the history of slavery within a reparative memorial strategy that goes beyond a traumatic historical heritage thanks to a new coding of its somatic legacy.
Article body
Les îles de la Caraïbe et l’Amérique caribéenne continentale partagent une histoire esclavagiste commune, née avec l’expansionnisme et le mercantilisme des puissances européennes, et mue par les énormes profits financiers drainés par la traite triangulaire. Pour ne citer qu’un exemple significatif, le système bancaire britannique tel qu’il existe aujourd’hui est apparu et s’est structuré avec les gains de l’esclavage. La France, l’Angleterre, la Hollande, l’Espagne et le Portugal ont trouvé pendant plus de quatre siècles dans la Caraïbe le lieu fertile à l’établissement du système de plantation, qui reposait sur l’exploitation systématique de corps par d’autres corps. Ce système s’appuyait sur la déshumanisation des hommes, femmes et enfants, réduits en esclavage. En terre esclavagiste, l’esclave n’est plus un homme, mais un bien meuble dont le statut est déterminé par le code noir[1]. Son corps est un outil au service du maître, à qui il convient de définir, de contrôler et de punir chaque geste par un autre geste. La culture caribéenne porte la mémoire de cette gestuelle du racisme, empreinte de violences ordinaires, légitimée juridiquement et déployée durant plusieurs siècles. La mémoire collective des sociétés antillaises postcoloniales d’aujourd’hui est marquée par cette histoire des corps noirs qu’on a réifiés, animalisés et livrés au bon vouloir des maîtres; des corps noirs qui ont été cassés sous le coup du fouet et de la baguette; qu’on a tordus dans des cachots où ils ne tenaient pas debout; qu’on a nourris de fruit à pain; qu’on a écartelés, castrés, amputés, violés.
Le passage à la postcolonialité, dès la fin du XIXe siècle dans la Caraïbe hispanique et au milieu du XXe siècle dans la Caraïbe anglaise, hollandaise et française, a conduit chaque île à construire sa mémoire collective et, plus particulièrement, sa mémoire de l’esclavage selon une histoire locale en tension avec l’histoire européenne. Les histoires nationales (française, anglaise, portugaise, espagnole) racontent l’esclavage des Africains par les Européens à partir de son abolition. En d’autres termes, les récits nationaux des pays qui se sont enrichis de la traite partent des principes suivants, erronés et européocentriques : puisque l’esclavage a été aboli depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, qu’il aurait été aboli par des Européens blancs et qu’il était pratiqué outre-mer et non en métropole, il n’y aurait plus lieu de nos jours de continuer de parler d’esclavage, de remuer le passé et, encore moins, de demander des réparations[2]. C’est une vision partielle et mensongère[3]. Non seulement les legs de l’esclavage ont structuré les relations sociales dans les pays caribéens, mais ils ont produit dans le monde européen les gestes ordinaires qui trahissent l’idée de la suprématie des corps blancs sur les autres corps, non blancs. Ce racisme est un héritage de l’esclavage qui continue de structurer toutes les relations humaines dans l’espace caribéen, tant les rapports de genre, de classe que de pouvoir politique.
C’est ce non-dit, cette acceptation sourde que le racisme est une fatalité inscrite dans le corps, que les artistes conceptuels[4] de la Caraïbe malmènent depuis une vingtaine d’années par des performances qui proposent de nouveaux états de corps extraordinaires, dansés ou performés. Je mets ici de l’avant le terme de bodydiscourses, qui se situe dans la lignée des travaux de Jill Bennett (2005), pour caractériser la manière dont certains artistes caribéens, plutôt que de mettre le corps en exergue comme objet premier de témoignage traumatique, proposent des modes de langage esthétique inscrits dans le geste afin de susciter le débat civique et de bousculer les gestes ordinaires hérités de l’esclavage. Mes recherches actuelles consistent à identifier un corpus artistique caribéen de bodydiscourses et à en mettre en lumière les paradigmes communs. Les propositions de ces artistes repositionnent la notion de résilience dans le champ de la créativité et de l’innovation et, par conséquent, dépassent l’idée que la résilience serait seulement l’expression d’une résistance à un état de fait auquel on se résigne par atavisme. Je parle essentiellement des arts visuels et de la performance définie comme mise en scène du corps, dansée ou chorégraphiée dans un espace public et à un moment unique. Dans le corpus présenté ici, le corps de l’artiste, montré et regardé, mais aussi le corps du regardant, sollicité dans une relation sensorielle et parfois explicitement engagé dans une interaction entre l’oeuvre et la démarche de l’artiste, sont autant d’espaces propices à l’émergence d’interrogations conceptuelles où sentir et penser cohabitent et s’influencent mutuellement.
En 2015, dans le cadre de mon projet de recherche intitulé « Réparations dans la Caraïbe francophone » et financé par la British Academy, j’ai suivi et accompagné les artistes contemporains de la Guadeloupe pendant six mois, pour comprendre et analyser leur démarche en matière de langage corporel et de résilience. J’ai conçu cette collaboration comme une suite à mon ouvrage The Post-Columbus Syndrome: Identities, Cultural Nationalism and Commemorations in the Caribbean, publié en 2014, dans lequel j’avais identifié comment l’héritage de l’esclavage et de l’histoire coloniale produit aujourd’hui différentes narrations postcoloniales dans les îles hispaniques, anglophones et françaises de la Caraïbe. Ces récits nationaux ont en commun de donner un rôle phare aux traumatismes du passé qui servent de substrat à l’identité nationale, empêchant qu’un travail de réparation se fasse. Dans la conclusion de ce livre, j’esquissais l’idée que c’est à l’échelle performative que semble se jouer la possibilité de créer un réseau de sens pancaribéen tourné vers une démarche réparatrice efficace, non seulement symbolique, mais aussi concrète. C’est cette idée que j’ai développée et explorée auprès d’artistes performeurs et danseurs de la Guadeloupe en 2015 tels que Léna Blou, Annabel Guérédrat et Henri Tauliaut. J’ai souhaité m’immerger dans un espace de création où des états de corps deviennent catalyseurs à l’ouverture d’un dialogue postracial dans les sociétés postcoloniales actuelles.
Léna Blou et le corps ka : réinventer les gestes ordinaires de l’esclavage
Guadeloupéenne, Léna Blou est danseuse, chorégraphe, professeure de danse et chercheuse. Il existe encore peu de travaux sur elle. Sa démarche pédagogique est pourtant ancienne et connue dans le milieu de la danse : elle a fondé le Centre de Danse et d’Études Chorégraphiques (CDEC) à Pointe-à-Pitre en 1990, école qui continue à ce jour de former des danseurs au niveau international. En 2005, elle a publié l’ouvrage théorique Techni’Ka et, en 2010, a créé le Centre de Formation en Techni’Ka (CFTK). On notera aussi le film de Laurence Rugard, Techni’Ka (2008), disponible en ligne.
En Guadeloupe, département français d’outre-mer, la mémoire postcoloniale n’a émergé dans l’espace public que depuis une vingtaine d’années, après près de deux siècles d’amnésie institutionnelle. Le bicentenaire de l’abolition de l’esclavage en 1998 est un moment charnière pour les Antillais français qui mettent alors en déroute le schoelchérisme à l’unisson (Chivallon, 2012). Forgé sur le nom de Victor Schoelcher, l’homme politique français qui signa le décret d’abolition de l’esclavage en 1848, le schoelchérisme devient après l’abolition, mais surtout après la départementalisation en 1946, un récit de mémoire nationale à la gloire de la République française qui passe sous silence l’histoire de l’esclavage dans les sociétés antillaises pourtant totalement façonnées par la domination du Blanc français sur le Noir et sur l’Autochtone. Alors que de nouveaux espaces dédiés à la mémoire de l’esclavage et à son importance dans l’histoire mondiale sortent de terre dans la Caraïbe française, comme le Mémorial ACTe en Guadeloupe, ouvert au public en juillet 2015 à Pointe-à-Pitre[5], la mise en place et la mise en commun d’un espace mémoriel, et le souvenir de l’esclavage continuent de peser sur la société guadeloupéenne, où les opportunités professionnelles, les champs d’intérêt et les chemins de vie dépendent fortement de critères de race et de couleur de peau.
Profondément engagée dans l’histoire de la Guadeloupe, Blou utilise le corps du danseur comme un outil d’analyse et de réflexion sociale sur la Caraïbe, ainsi que comme médium théorique d’avant-garde pour innover dans l’art de la danse à l’échelle transnationale et globale. Initialement diplômée en danse jazz et en danse contemporaine, elle a créé une technique de danse, la techni’ka, à partir de l’histoire du corps caribéen et de la codification naturelle du gwo-ka. Le gwo-ka, qui signifie littéralement gros (gwo) tambour (ka) en créole guadeloupéen, désigne tout autant le rythme et la musique que les chants et la danse qui se posent sur la cadence des tambours durant des rassemblements festifs appelés léwòz[6].
Le ka n’est pas seulement l’instrument de musique (le tambour), mais tout un système rythmique complexe où les danseurs se succèdent les uns après les autres au centre de la scène, selon des codes corporels bien particuliers. Ils sont entourés et encouragés par les participants du léwòz qui attendent leur tour pour entrer individuellement dans la ronde. Le gwo-ka est un genre musical très populaire en Guadeloupe. Né avec l’esclavage, il n’a jamais cessé de jouer un rôle clé et vivace dans les modes de socialisation, de réunion collective et de ritualisation familiale.
Il existe sept rythmes dans le gwo-ka, associés au travail agricole et à la fête, aux souffrances et aux réjouissances du corps, en référence directe avec l’esclavage. Le graj est un rythme à quatre temps, rattaché au travail, que l’on jouait autrefois en râpant le manioc pour préparer les galettes de kassav; le tumblak est un rythme à deux temps, plus rapide que le graj, lié à la fête : les danseurs virevoltent avec rapidité et vivacité; le menndé, rythme à quatre temps, rapide et très sensuel, fut considéré comme obscène par les missionnaires catholiques et interdit par les esclavagistes; le kaladja, rythme à deux temps, plus ou moins rapide, exprime souvent la peine et la souffrance, et se prête à un contenu sociopolitique; le woulé est un rythme à trois temps de travail, qui renvoie au damage des rues, aux corvées d’eau, au travail des champs, aux semailles et au labour; le padjanbèl est un rythme guerrier, associé à la fierté, à l’affirmation de soi; enfin, le léwòz, rythme à deux temps que l’on jouait tous les quinze jours dans les habitations[7], a donné son nom aux rassemblements des esclaves en temps de repos, où ils étaient autorisés à chanter et à danser. Il désigne aujourd’hui des fêtes populaires ayant souvent lieu lors des fins de semaine dans des lieux privés ou publics, où les Guadeloupéens viennent se divertir en famille (LAMÉCA - La Médiathèque Caraïbe).
L’armature rythmique du gwo-ka est donnée par le tambour appelé boula, plus gros, sur lequel le joueur s’assied pour marquer une mesure fixe et constante pendant tout le morceau. S’y ajoute le tambour marqueur, plus petit, instrument de celui qu’on nomme aussi le marqueur (makè en créole guadeloupéen), qui improvise et donne le rythme correspondant à l’un des sept rythmes possibles du gwo-ka. Les danseurs, les chanteurs et le public identifient le rythme par l’encodage sonore qui le caractérise. Le chanteur entre en dialogue avec le makè, et ils se relayent l’un l’autre, tandis que des répondeurs accompagnent le chanteur, par un contrepoint vocal qui répète en cadence les paroles proférées par le chanteur. Les chants du gwo-ka, gutturaux et puissants, racontent en créole les gestes du corps : la coupe de la canne, la traversée de la rivière, le quotidien rural de l’esclave. Lors des léwòz, ces fêtes où l’on joue, chante et danse le gwo-ka, le danseur, qu’il soit homme, femme ou enfant, entre seul dans la ronde et se meut au rythme donné par le marqueur. Ce sont les postures de ce corps dansant le gwo-ka que Blou a inventoriées, identifiées et regroupées en paradigmes corporels de ce qu’elle a nommé « le corps ka », et qui sont les fondements de la techni’ka.
La techni’ka est le fruit de quinze ans de recherches et d’analyses pour identifier et conceptualiser la grammaire corporelle du corps du danseur de ka, un corps façonné par le travail forcé, le mépris, la survie et la résilience, bref, par l’histoire de l’esclavage et de la plantation, où la danse a joué un rôle clé en tant que mode d’expression identitaire, culturelle et artistique.
La techni’ka déconstruit les appuis du corps et les postures de la danse traditionnelle européenne : dans le classique, le contemporain et le jazz, le pied est tantôt à plat, tantôt en demi-pointe, puis éventuellement en pointe à l’aide de chaussons. Blou a répertorié chacune des postures du corps du danseur de gwo-ka pour en faire des paradigmes, des états de corps, qui, à partir d’un état psychique dansé, offrent une nouvelle grille de mouvements techniques propres à produire des chorégraphies originales, en dehors du gwo-ka. Ainsi, le danseur ka se tient sur ses talons, ses orteils, et sur les kantés (les bords intérieur ou extérieur du pied). Son corps est toujours en déséquilibre, car il inscrit son mouvement dans un contretemps corporel. Blou a nommé bigidi ce déséquilibre fondateur du mouvement produisant une virtuosité innovante et totalement inédite dans la danse européenne. Le bigidi représente pour Blou une allégorie de toute la société antillaise, dont le corps s’inscrit dans la résilience et la survie. En créole guadeloupéen, bigidi veut dire manquer de tomber, trébucher comme si on allait tomber ou se rattraper sans tomber. Le corps du danseur ka évolue dans une série de bigidis en dialogue avec le bigidi musical et rythmique du marqueur et du chanteur. Dans les changements dynamiques des points dʼappui, jamais le corps du danseur de ka ne tombe. Il s’agit d’un corps qui esquive, qui semble aller d’un côté pour, au dernier moment, se projeter de l’autre : un art de l’échappement, de l’adaptation et de la survie.
La techni’ka repose sur quatre piliers fondamentaux : d’abord, la maîtrise des codes musicaux (tout apprentissage de la techni’ka commence par l’écoute et la reconnaissance du rythme des tambours, sur lequel le danseur va pouvoir inscrire son corps, ses silences, ses arrêts et ses accélérations, et exprimer sa virtuosité); ensuite, le travail du bas du corps, notamment le transfert rapide de tous les appuis (talons, orteils, côtés internes et externes des pieds) et l’apprentissage des postures de rotation vers l’intérieur ou l’extérieur; puis les postures dites ka, tantôt ouvertes quand la cage thoracique est ouverte, les mains sur les hanches et le port de tête fier, tantôt fermées quand les épaules sont rentrées et le corps recroquevillé sur lui-même. Plus l’élève progresse dans la maîtrise de ces codes, plus la connaissance des postures des sept danses du gwo-ka et de leurs multiples combinaisons devient riche.
En 2008, Blou collabore avec Sylvaine Dampierre pour le film Le pays à l’envers, dans lequel la réalisatrice part à la recherche de ses ancêtres esclaves en Guadeloupe et questionne les fondements somatiques d’une société « née sous X » où l’histoire de l’esclavage a été mise en amnésie par les institutions républicaines françaises. Pour Blou, la pratique et l’enseignement de la danse ont une puissance réparatrice : « Quand tu pétris des corps, tu pétris des esprits », affirme-t-elle (citée dans Rugard, 2008). Blou construit, pendant le tournage du documentaire, la danse de Jeannette dite l’Ignorée. Elle danse et incarne le personnage, d’abord par des postures rentrées, lentes et ramassées qui disent le mépris et l’invisibilité dont Jeannette est victime dans une société telle que la société antillaise, où le racisme structurel établi au temps de la plantation continue d’informer les rapports sociaux entre les hommes et les femmes, et entre les Blancs et les Noirs. Ces postures du corps ramassé sur lui-même appartiennent au registre de ce que Blou a nommé les postures ka fermées. Puis, au fil de sa danse, le corps de Jeannette se libère de son enfermement atavique dans une démonstration somatique de résilience : une capacité à résister psychiquement aux épreuves de l’existence. Le corps de la danseuse exécute alors des postures désignées comme postures ka ouvertes, caractérisées par le dégagement de la cage thoracique, les mains sur les hanches et le port de tête très droit, par lesquelles Jeannette exprime son droit fondamental à être debout, c’est-à-dire à être digne. La techni’ka se présente donc à la fois comme un témoignage de la grammaire corporelle issue du temps de l’esclavage et comme un champ de multiples réinterprétations somatiques mettant en valeur le corps résilient du descendant d’esclave dans la société antillaise, autant traditionnelle que contemporaine :
Quand je vais faire des stages sur le plan international, dit Blou, je bouscule le corps des danseurs qui semblaient avoir tout vu et tout appris au niveau des appuis du pied. Le gwo-ka apporte des espaces d’exploration insoupçonnables. Personne ne danse sur ses talons, mais pour nous c’est dans le code, les talons, le kanté, le bord interne et externe du pied : c’est récurrent chez un danseur de léwòz de finir avec les pieds à l’intérieur. C’est une difficulté articulaire et musculaire. Je mets en difficulté, je pose une ouverture, une nouvelle façon de tourner, et ça c’est le gwo-ka qui l’apporte
(idem).
En même temps que la techni’ka naît des analyses de Blou sur les fonctionnements somatiques de sa société, cette technique de danse fait advenir un nouveau code-corps que tout danseur, guadeloupéen ou non, peut s’approprier et exprimer avec la virtuosité qui est la sienne dans son propre contexte socio-esthétique. D’ailleurs, Blou enseigne la techni’ka à des compagnies de danse diverses et variées, tels les ballets Béjart et Alvin Ailey. En d’autres termes, si le gwo-ka est une trace tangible de la permanence de l’histoire de l’esclavage dans le corps caribéen, c’est-à-dire d’une mémoire historique inscrite dans le corps individuel et passée dans le corps culturel, la techni’ka n’en est ni la commémoration folklorique ni la thérapie comportementale. C’est une technique corporelle d’un genre propre, apparue dans et avec la Caraïbe, qui fait de la résilience psychique, dont le corps est le vaisseau, un principe esthétique fondateur et générateur constant de sens nouveau. Le corps qui danse est, pour Blou, une ouverture sur l’autre, la possibilité d’une relation réparée avec l’autre : « Plus on comprend son corps, plus on l’accepte, plus on l’aime, plus on peut aller à la rencontre de l’autre, dès lors qu’on sait qui on est, on est fort et puissant et on n’a plus peur de l’autre » (idem).
Ce que Blou nous apprend avec la techni’ka, c’est que la mémoire du corps est empathique; elle se souvient du passé tout en transformant le traumatisme en virtuosité adaptative et créative, en langue culturelle diffuse, élargie et ramifiée. Blou trouve dans l’extrême maîtrise du corps local un outil d’analyse du corps national (guadeloupéen) et régional (caribéen) ainsi que les fondements d’une technique du corps-monde (international). La danse telle que Blou la conçoit nous révèle que le corps social garde en mémoire les traumatismes du passé et qu’il n’a de cesse de les négocier selon des codes culturels locaux. Dans l’espace caribéen, cette négociation est ouvertement et majoritairement artistique. Appliquer une justice globale qui reconnaît la responsabilité des crimes du passé est la condition fondamentale à l’établissement d’une lecture empathique du monde. Cette dernière ne sera possible, selon moi, que par l’inscription somatique et émotionnelle des corps dans ce présupposé d’empathie, c’est-à-dire dans la reconnaissance de la souffrance autant que dans le désir de la transformer en expression propre, distanciée de la scène du traumatisme, à l’opposé du système capitaliste qui régit les modes de relation depuis deux siècles selon la dépendance (au capital) et la crainte (d’en perdre le privilège et l’usufruit).
Le duo Guérédrat / Tauliaut : l’extraordinaire vulnérabilité du corps social caribéen
La danseuse Annabel Guérédrat et le plasticien Henri Tauliaut, originaires respectivement de la Martinique et de la Guadeloupe, expérimentent les rapports entre le corps, le temps et l’espace (Brebion, 2015) dans des duos performatifs qui créent du lien social tout en bousculant les schémas mémoriels qui cloisonnent l’espace caribéen. De leur collaboration, qui allie art visuel et art chorégraphique, est née la série A Smell of Success (dont j’ai accompagné la mise en place et la production durant l’été 2015), alors que les deux artistes étaient en résidence à l’Artocarpe, une association d’art contemporain basée dans la ville du Moule en Guadeloupe.
La démarche artistique du couple Guérédrat / Tauliaut est à la fois esthétique et politique dans son contenu comme dans sa forme. Conçue comme une série de performances uniques (dites one-shot), A Smell of Success repose sur certains des principes essentiels des happenings : l’éphémère, le spontané, la provocation, l’interactivité avec le public, la représentation hors les murs et dans l’espace public. Elle s’en différencie néanmoins dans la mesure où chaque performance s’appuie sur une partition préalablement écrite, appelée score, qui comprend trois éléments fondamentaux qui servent d’armature à la performance : la progression du corps au ralenti (slow motion), quatre positions clés appelées positions d’or (la marche, l’assise, la position debout, la position allongée) et l’étreinte entre les deux performeurs (hug).
Cette partition s’inspire de la technique de Body-Mind Centering (BMC), fondée par la danseuse et ergothérapeute Bonnie Bainbridge Cohen[8], avec qui Guérédrat s’est formée. Le BMC est une approche somatique avant-gardiste du mouvement corporel, participant du développement de la personne selon une démarche interdisciplinaire; il repose sur une écoute du corps, une prise de conscience aigüe des mouvements corporels ainsi qu’une mise en accord de l’esprit et du corps par les sens. La réconciliation somatique est l’un des présupposés des performances de Guérédrat et Tauliaut, d’autant qu’elles s’inscrivent dans l’espace public, pourrait-on dire dans le corps sociohistorique meurtri des sociétés antillaises dont les deux artistes sont originaires, où les performances que je vais analyser ici ont eu lieu.
L’approche du corps en mouvement selon les principes du BMC rappelle que la démarche du duo artistique se déploie dans l’immédiateté et dans le présent, une caractéristique inhérente à la théorie des réparations morales selon la philosophe Margaret Urban Walker. Cette dernière démontre qu’en matière de réparation post-traumatique, tant psychologique que morale, l’ancrage dans le présent est essentiel et salutaire (Urban Walker, 2014) : il permet non seulement une mise à distance avec le passé et avec la scène traumatique, mais prévient aussi une projection dans le futur, contreproductive, puisque l’espoir sans cesse imaginé (donc illusoire) que le traumatisme ne se reproduise plus jamais empêche de concentrer ses efforts sur les bienfaits d’une réparation dans le présent (ibid. : 128).
A Smell Of Success explore trois mondes allégoriques profondément caribéens dans leur conception, mais tournés vers une propédeutique universelle, c’est-à-dire un processus d’apprentissage en plusieurs étapes orienté vers le développement de l’individu et son rapport à l’autre, quelle que soit son origine. Dans chacun de ces univers, la provocation sert de moteur à la libération par le corps afin de créer les conditions de relation (le lien social) et d’émancipation d’un encodage corporel traumatique, deux notions fondamentales au concept de réparation. La dimension si bien ordinaire qu’extraordinaire du geste joue un rôle clé dans chacun de ces univers. Le premier monde, Agua, est un monde subaquatique qui offre au corps du performeur un espace de contact embryonnaire avec l’autre, le public ainsi que tout participant acceptant de se prêter aux jeux aquatiques (Watergames). Le deuxième monde, Afro-Punk, est librement inspiré du travail de James Spooner, réalisateur originaire de Sainte-Lucie qui, en 2003, explore l’identité noire américaine dans le milieu punk dans un documentaire intitulé Afro-Punk. Le monde afro-punk de Guérédrat et Tauliaut mélange les artifices et les codes (sadomasochistes, fétichistes, punk, queer) et choisit comme terrain de prédilection des lieux à forte charge historique dans la société guadeloupéenne, comme le cimetière de Morne-à-l’Eau ou le parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste du Moule, qui sont en même temps des lieux de sociabilité ordinaire où certains gestes rituels se répètent[9]. Iguana, le troisième monde, est un univers où les artistes portent la crête de l’iguane, un animal commun à tout l’archipel caribéen et originaire de la région, et mettent leur corps aux prises avec l’espace public dans une poétique du risque, de la vulnérabilité et du handicap. Je m’attarderai sur deux performances dites afro-punk « iguanesques » – qui mêlent l’univers Afro-Punk et l’univers Iguana – dans deux espaces publics : le parvis de l’église de la ville du Moule, au sortir de l’office du dimanche, et le Stardust Café, un restaurant populaire du Moule, le même jour.
Quand le duo s’installe sur le parvis de l’église du Moule à onze heures du matin le dimanche 19 juillet 2015, le corps et le visage entièrement revêtus d’une combinaison de lycra argenté, portant une perruque à crête multicolore de style punk et des chaussures plateformes à talons aiguilles rappelant l’univers drag queen ou fétichiste, ce sont deux êtres non identifiables par leur phénotype humain qui s’avancent à pas mesurés, très lentement, aveugles et avec une agilité limitée par leur tenue vestimentaire. Le carnaval est un moment phare de la culture antillaise, et on est habitué aux accoutrements créatifs en Guadeloupe. Dans le cas présent, hors période de carnaval, ces deux individus interpellent les passants, non pas tant par leur tenue farfelue que par les gestes qui les accompagnent. La progression lente du corps féminin et du corps masculin l’un vers l’autre dure plus d’une heure avant de donner lieu à une longue étreinte silencieuse (hug) pendant que la foule sort de l’office du dimanche. Les performeurs doivent en effet atteindre un état somatique d’hyperconnectivité pour entrer dans leur performance, construite sur le ralenti (slow motion). Cette lenteur permet que se crée un espace d’interprétation vacant que le public s’approprie par ses réactions multiples de surprise, de malaise et, surtout, de curiosité extrême. Guérédrat et Tauliaut cherchent à façonner un espace relationnel où leur proposition performative offrirait aux spectateurs la possibilité de s’approprier ce qu’ils voient et ressentent, et de donner sens à ce spectacle par rapport à leur vécu et à leur histoire propre : « Il y a des moments où Henri et moi sommes dépassés par notre propre action, la performance est écrite sous forme de partition, mais, à un moment, elle est livrée au public et c’est le public qui s’en empare et, du coup, elle n’appartient plus au performeur », affirme Guérédrat (citée dans Lafarge, 2016).
Ce même jour, l’après-midi, le duo livre avec le même costume une performance au Stardust Café, un petit restaurant local sur la place principale de la ville du Moule. Là encore, la force de la performance réside dans le fait que les performeurs transforment les gestes ordinaires de la sociabilité : dans ce cas précis, s’attabler à un café très fréquenté pour consommer, et ce, en déclinant des propositions corporelles énigmatiques qui forcent le public à faire un choix entre rester, partir, communiquer avec eux ou bien les regarder de loin en cherchant les regards de connivence du reste du public. Tonton, le propriétaire du bar, les a vus le matin devant l’église. Il affirme que ce sont des saints chassés de l’église par le prêtre, et que le bon Dieu les lui envoie. Les deux êtres, que des clients du restaurant qualifient d’anges ou d’extraterrestres, se comportent comme des êtres ordinaires, puisqu’ils viennent prendre place à la table du café, mais leurs gestes sont extraordinaires et résistent aux codes culturels de la sociabilité. Ils sont aveugles, muets, le visage et le corps cachés intégralement par une combinaison à effet deuxième peau. Pourtant, ce sont leurs gestes ralentis et sans paroles qui sont difficiles à identifier et qui forcent les participants à s’impliquer dans une démarche interprétative de communication. La gestuelle extraordinaire du couple afro-punk « iguanesque » soulève des questions : les uns se demandent quoi leur proposer à boire ou à manger, et les autres, comment les servir. Après un peu d’hésitation, une serveuse glisse une paille à l’intérieur des mailles de leur combinaison de lycra, un client vient à la rescousse et touche du bout des doigts leur visage pour trouver la bouche et les faire boire. Le public, dans son ensemble, a compris le corps des iguanes afro-punk comme celui de personnes en situation de handicap. Par là même, les performeurs ont suscité le lien et poussé les personnes autour d’eux à réinventer les gestes de la relation, au-delà des clivages et des présupposés raciaux qui guident le comportement des uns envers les autres aux Antilles.
Ces deux performances créent les conditions d’une relation émancipée de la grille de lecture coloniale et des étiquettes socio-raciales qui cultivent le malaise de l’identité antillaise. Que le corps des artistes soit identifié comme souffrant, déchu, puni, et qu’il appelle un désir de secours me semble particulièrement riche de sens. Dans une société où les inégalités entre les corps (blancs et non blancs) sont vécues comme une malédiction, où un atavisme est inscrit dans les gestes depuis si longtemps qu’on ne peut pas concevoir les rapports sociaux autrement, il est significatif que le langage corporel extraordinaire des performeurs, précisément dans des lieux de sociabilité ordinaire, dévoile la vulnérabilité et le handicap comme quelque chose qui ne va pas de soi, à quoi on ne se résigne pas et face à quoi il faut inventer un nouveau mode de sociabilité. Cette performance fait bouger les lignes de démarcation qui délimitent les rapports de force dans les sociétés de plantation et montre au passage à quel point la réparation sociale est un désir somatique essentiel de la société antillaise[10]. Guérédrat et Tauliaut mettent leur corps en danger dans un espace public codifié par une grille d’interprétation identitaire racisée, où le souvenir de l’esclavage continue de susciter la honte et la culpabilité. En annulant sa couleur, son âge, son sexe et son origine, et en revêtant le costume de l’iguane mythique – un être premier caribéen –, le duo artistique crée les conditions d’une réconciliation et force à réinventer les gestes ordinaires de la sociabilité par la responsabilisation. La vulnérabilité des êtres iguanes afro-punk renvoie à l’inconscient collectif de l’esclavage où l’homme noir est déshumanisé par le Blanc pour résoudre une situation économique basée sur la dépendance et le besoin. Dans un monde où le commerce européen eut besoin de main-d’oeuvre bon marché pour continuer de faire fortune, le Blanc inventa le Noir comme la couleur de la force prolétarienne – puisque c’est la résistance physique du corps noir que le Blanc exploite – et, en même temps, comme la couleur du handicap social le plus extrême, celui de la privation de liberté mentale et physique. Dans ce monde dont les pays de la Caraïbe d’aujourd’hui sont héritiers, la norme est de nier toute dignité et tout libre arbitre à celui qui porte les stigmates de cette relation de dépendance. Le corps noir, « handicapé » socialement par le système esclavagiste et raciste, a dû inventer des stratégies de résistance pour affirmer son autonomie par le geste. De même, le couple d’iguanes afro-punk, que les habitants du Moule prennent tantôt pour des « anges », tantôt pour des « extraterrestres[11] », affiche les marques de multiples handicaps que révèle la lenteur de ses mouvements, dont on ne connaît ni la raison ni la cause. La démarche conceptuelle des deux artistes consiste à produire une vulnérabilité allégorique qu’on ne peut identifier par la grille de lecture des races et des classes qui régissent les rapports sociaux caribéens. Leurs sens sont fragilisés par leur inadaptation au milieu dans lequel ils évoluent en utilisant un langage gestuel hors du commun : les iguanes afro-punk communiquent sans se parler, par la mise en fusion progressive de leur corps jusqu’à l’étreinte finale. Ils sont accueillis dans l’espace public comme des êtres vivants, car ils sont vulnérables. La vulnérabilité cesse ainsi d’être un héritage ordinaire pour devenir le lieu d’invention d’une nouvelle sociabilité.
***
La Caraïbe, où l’histoire des gestes est intrinsèquement liée à l’histoire de l’esclavage, est un espace sociétal complexe où le passé et le présent continuent de coexister. Le corps vulnérable dans l’art contemporain y est producteur d’un sens allégorique. Chez Blou et pour le duo formé par Guérédrat et Tauliaut, le geste participe d’une politique du témoignage et advient dans un espace artistique qui invite le public à prendre part à une chorégraphie somatique, dont la force et la créativité puisent au coeur même de la vulnérabilité extraordinaire du corps caribéen, alors même que l’héritage esclavagiste a habitué les habitants de la Caraïbe à concevoir le corps noir comme inférieur. Ce corps dont les appuis sont cassés, en déséquilibre sur de hauts talons chez Guérédrat et Tauliaut et en bigidi chez Blou, transforme sa vulnérabilité en principe de résilience. Le traumatisme n’est pas représenté dans ces performances : il est la condition de la représentation, le présupposé manifeste d’une histoire douloureuse, la trace de l’histoire à partir de laquelle le présent agit et fait agir l’artiste et son public.
Les chorégraphies hypercontemporaines de la techni’ka et des iguanes afro-punks, dans des contextes artistiques différents, mettent à l’honneur la contrainte somatique, car c’est du déséquilibre que naissent l’adaptation et l’énergie corporelle créatrices. Les artistes convoquent bien un encodage somatique premier (la grammaire corporelle du ka chez Blou, la partition du BMC chez Guérédrat et Tauliaut), sans jamais réitérer ni rejouer la scène traumatique. Le malaise physique, social et moral génère des états de corps qui fondent l’autonomie et la capacité d’autodétermination d’un nouveau geste, plutôt que des rappels constants d’un traumatisme fétichisé en objet d’identité, comme c’est encore le cas dans certaines utilisations culturelles de l’histoire de l’esclavage aux Antilles. Le corps devient le lieu de production de l’empathie et de la responsabilité, un outil de participation au réel dont la portée m’apparaît transnationale et globale. La performance artistique stimule donc un questionnement critique, où l’empathie ne se fait pas par identification avec la vulnérabilité de l’autre, mais par la reconnaissance de la gestuelle extraordinaire du corps vulnérable et l’acceptation de sa différence.
Appendices
Note biographique
Fabienne Viala, agrégée de lettres modernes, docteure en littératures comparées de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (2004), est professeure associée à l’Université de Warwick, au Royaume-Uni. Elle enseigne les littératures et l’analyse culturelle comparée dans le domaine latino-américain et caribéen au département d’études hispaniques. Elle dirige le centre de recherches interdisciplinairesYesu Persaud Centre for Caribbean Studies à l’Université de Warwick. Depuis 2016, elle est la présidente de laSociety for Caribbean Studies UK, l’association des chercheurs sur la Caraïbe en Angleterre. Elle a publié des ouvrages sur le roman historique latino-américain et européen, le roman policier cubain, espagnol et belge ainsi que l’ekphrasis chez Alejo Carpentier. Sa dernière monographie, The Post-Columbus Syndrome: Identities, Cultural Nationalisms and Commemorations in the Caribbean,est parue en 2014 chez Palgrave MacMillan (New York).
Notes
-
[1]
Le code noir est un édit royal qui a été rédigé par le ministre de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert, et qui est entré en vigueur en 1685. Il fixe les conditions dans lesquelles doivent s’exercer la traite des « Nègres » d’Afrique et les méthodes selon lesquelles les maîtres doivent les traiter dans les plantations. Le but de cet édit est essentiellement de maintenir la souveraineté de la France sur le commerce du sucre. Le code noir affirme que l’homme noir a la valeur d’un bien meuble : il appartient à son maître (cela inclut l’utérus des femmes dont le fruit ne sera pas la propriété de la mère ni du chef de famille, mais du maître blanc). Ce maître légifère les punitions corporelles qui peuvent être infligées aux esclaves désobéissants (coups de fouets, amputations, privations, humiliations…). Voir Sala-Molins, 1987.
-
[2]
Je citerai ici, à titre emblématique, le cas de la ville de Bordeaux, premier port négrier de France, alors que rien dans l’espace public actuel n’en fait mention, passant sous silence le fait que la richesse de cette capitale du vin est née avec la traite. Le 3 mai 2018 est paru un rapport sur la question de l’esclavage et de la traite négrière à Bordeaux, sous la direction du maire de la ville Alain Juppé et de son adjoint Marik Fetouh. Si ce rapport, issu des travaux d’une commission mémoire pendant deux ans, conclut avec dix propositions en vue de remédier à l’amnésie publique sur l’esclavage, il donne aussi la parole aux opposants à cette mémoire, qui sont pourtant nettement minoritaires. Sur 563 répondants au sondage, une très nette majorité (493) juge insuffisante l’offre mémorielle sur l’esclavage proposée par la ville de Bordeaux. Il n’y a que 17 personnes qui marquent une opinion « autre », mais celle-ci est clairement détaillée, à travers des citations comme « ras-le-bol à la repentance », « totalement hypocrite considérant le fait que le passé négrier de Bordeaux est largement exagéré », « insupportable », « surdimensionné », « Assez! Il y en a marre! Que ces personnes qui veulent nous culpabiliser rentrent chez elles! » (2018 : 22.) Si ce genre de propos ne reflète qu’une partie des opinions analysées dans ce rapport, il serait irresponsable et absurde de nier qu’ils restent le son de cloche récurrent à chaque fois que la France se penche sur ce moment de son histoire. L’ignorance, en matière d’histoire de l’esclavage et envers les sociétés antillaises qui sont des territoires français, est lourde et manifeste dans la société française et dans son système scolaire et éducatif.
-
[3]
Le peuple noir d’Haïti s’est libéré du joug de l’esclavage dès 1804, bien avant les abolitions européennes, avec la révolution haïtienne et l’instauration d’une république de citoyens libres; la vente d’hommes, de femmes et d’enfants esclaves par leurs maîtres était une pratique commune dans les métropoles européennes des pays pratiquant la traite et pas seulement outre-mer.
-
[4]
Né dans les années 1960, l’art conceptuel n’est pas un courant artistique à proprement parler et il regroupe des artistes et des disciplines très hétérogènes. L’art y est considéré avant tout comme un véhicule d’idées, où l’importance n’est plus l’objet artistique en soi, pas plus que son style, sa valeur esthétique ou sa permanence. Voir Godfrey, 1998 ainsi que Corris, 2004.
-
[5]
À ce sujet, voir mon texte « Eruptive Memory in Guadeloupe: The Memorial ACTe and the Seism of Slavery Remembrance » dans l’ouvrage collectif à paraître en 2020 sous la direction d’Étienne Achille, Charles Forsdick et Lydie Moudileno : Postcolonial Realms of Memory, Liverpool, University Press of Liverpool, « Contemporary French and Francophone Cultures ».
-
[6]
Le léwòz est un rassemblement festif, nocturne et populaire en Guadeloupe, où l’on chante et danse autour d’un groupe de joueurs de gwo-ka. Au temps de l’esclavage, le léwòz était un moment de relâchement pendant le temps libre accordé par le maître une fois le ramassage de la canne terminé, à la nuit tombée.
-
[7]
« Habitation » désigne dans ce contexte la plantation avec la maison des maîtres et ses dépendances, les champs et les cases des esclaves.
-
[8]
Bonnie Bainbridge Cohen est professeure de danse et de kinésiologie, discipline scientifique qui étudie les mouvements et les postures du corps. Elle fonde l’école du Body-Mind Centering en 1973, à New York. L’école a depuis ouvert plusieurs centres aux États-Unis (Oregon, Californie et Texas), en Europe (Allemagne, Angleterre, France, Italie, Pologne, Slovaquie) et au Brésil. Pour les rapports entre danse et thérapies somatiques, voir Bainbridge Cohen, 1993.
-
[9]
Les lieux de culte et les lieux de mort ont joué un rôle fondamental dans l’histoire de l’esclavage. Les esclaves n’avaient pas le droit de faire famille (selon le code noir, les enfants nés de femmes esclaves appartenaient au maître comme un bien meuble; le petit était séparé de sa mère selon le bon vouloir du maître, comme dans le cas du petit d’une femelle animale). Les esclaves, par ailleurs, n’avaient pas de sépultures. La fosse commune leur était destinée, ce qui cause un véritable problème en Martinique et en Guadeloupe aujourd’hui puisqu’il est impossible d’identifier les corps et de se recueillir sur la tombe de ses ancêtres esclaves. Les cimetières et les églises sont des lieux clés que les anciens esclaves ont pu réinvestir comme des lieux de dignité et de citoyenneté à part entière après l’abolition de l’esclavage.
-
[10]
L’identité antillaise se définit par la quête d’une possible réconciliation du corps noir avec lui-même, prisonnier d’un complexe d’infériorité créé par les siècles d’esclavage et par l’angoisse d’une impossible réconciliation entre le corps noir et l’autre, idéalisé, le corps blanc. Je pense à Franz Fanon, qui, dans Peau noire, masque blanc (1952), a défini les bases psychosomatiques de ce mal-être. Pour une analyse du poids de la race dans la représentation identitaire dans les territoires francophones d’outre-mer, voir Richard D. E. Burton et Fred Reno, 1995.
-
[11]
Je cite ici les commentaires de certains membres du public pendant la performance.
Bibliographie
- BAINBRIDGE COHEN, Bonnie (1993), Sensing, Feeling and Action: the Experiental Anatomy of Body-Mind Centering, Massachusetts, Contact.
- BENNETT, Jill (2005), Empathic Vision: Affect, Trauma and Contemporary Art, Paris, Alto; Californie, Stanford University Press, « Cultural Memory in the Present ».
- BLOU, Léna (2005), Techni’Ka, Guadeloupe, Jasor.
- BREBION, Dominique (2015), « Duo de choc », Aica Caraïbe du Sud, 3 septembre, www.aica-sc.net/2015/09/03/duo-de-choc/
- BURTON, Richard D. E. et Fred RENO (1995), French and West Indian: Martinique, Guadeloupe and French Guiana Today, Virginie, University of Virginia Press.
- CHIVALLON, Christine (2012), L’esclavage, du souvenir à la mémoire :contribution à une anthropologie de la Caraïbe, Paris, Karthala, « Esclavages ».
- CORRIS, Michael (dir.) (2004), Conceptual Art: Myth, Theory, and Practice, New York, Cambridge University Press.
- DAMPIERRE, Sylvaine (2008), Le pays à l’envers, Paris, Centre national de la cinématographie.
- GODFREY, Tony (1998), Conceptual Art, Londres, Phaidon.
- LAFARGE, Pierre (2016), entretien avec Annabelle Guérédrat dans le cadre de l’émission « Notes d’hier et d’aujourd’hui », Martinique 1re, 4 décembre, YouTube, enregistrement audiovisuel, www.youtube.com/watch?v=o0-WHoJXGM4
- LAMÉCA (s.d.), La Médiathèque Caraïbe, www.lameca.org
- LOPEZ, Yoann et al. (2018), « La mémoire de l’esclavage et de la traite négrière à Bordeaux », rapport final de la commission d’enquête sur la traite et l’esclavage ainsi que leur mémoire au sein de l’espace public bordelais, www.bordeaux.fr/images/ebx/fr/groupePiecesJointes/49310/2/pieceJointeSpec/155152/file/Rapport_09052018.pdf
- RUGARD, Laurence (2008), « Techni’Ka », YouTube, enregistrement audiovisuel, www.youtube.com/watch?v=n-YvW3w8XGE
- SALA-MOLINS, Louis (1987), Le code noir, Paris, Presses universitaires de France, « Quadrige ».
- URBAN WALKER, Margaret (2014), « Moral Vulnerability and the Task of Reparations », dans Catriona Mackenzie, Wendy Rogers et Susan Dodds (dir.), Vulnerability: New Essays in Ethics and Feminist Philosophy, New York, Oxford University Press, p. 110-133.
- VIALA, Fabienne (2014), The Post-Columbus Syndrome: Identities, Cultural Nationalism and Commemorations in the Caribbean, New York, Palgrave MacMillan, « New Caribbean Studies ».