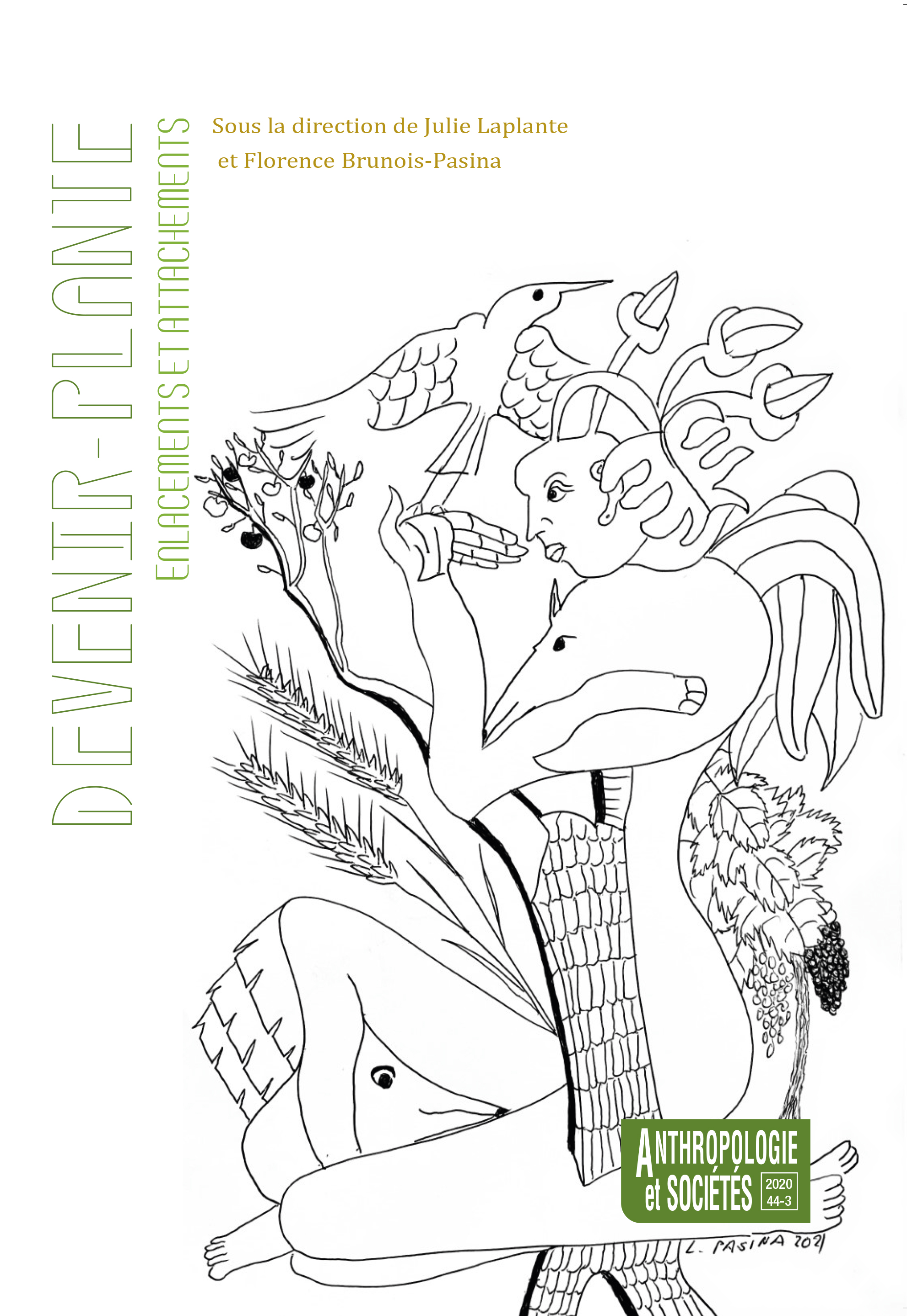Abstracts
Résumé
Cet article a pour but de montrer comment l’attention au végétal a été au coeur de l’une des contestations historiques les plus fortes du régime de séparation dualiste des Modernes. L’oeuvre d’Étienne Bonnot de Condillac combine ainsi un déplacement majeur de l’attention métaphysique aux plantes, de l’oeil à l’odeur, avec une enquête générale sur l’origine du langage. Cette combinaison érige les formes de la sensibilité en condition de l’institution. Le repérage de cette combinaison permet d’engager un dialogue avec l’oeuvre de Philippe Descola concernant la matrice ontologique générative des collectifs. Ce chemin de Condillac à Descola et retour n’est pas spéculatif : il s’enracine dans la mémoire affective de l’odeur des fleurs, qui sert ici de point archimédien au renversement du dualisme. Reste alors à savoir comment les plantes contribuent à l’institution des collectifs ou, au contraire, y résistent.
Mots clés:
- Bertrand,
- odeur,
- fleurs,
- ontologie,
- langage,
- sensation,
- mémoire,
- esprit,
- métaphysique,
- sensible,
- institution,
- Condillac,
- Descola
Abstract
This article aims to show how attention to the plant has been at the heart of one of the strongest historical contestations of the dualistic separation regime of the Moderns. Étienne Bonnot de Condillac’s work thus combines a major shift in the metaphysical attention to plants, from the eye to the smell, with a general inquiry into the origin of language. This combination raises the forms of sensibility in condition of the institution. The identification of this combination allows a dialogue with the work of Philippe Descola about the generative ontological matrix of collectives. This path from Condillac to Descola and back is not a speculative one: it stems in the affective memory of the smell of flowers, which serves here as an Archimedean point against dualism. The question then arises as to how plants contribute to the institution of collectives, or, to the contrary, resist it.
Keywords:
- Bertrand,
- smell,
- flowers,
- ontology,
- language,
- sensation,
- memory,
- mind,
- metaphysics,
- sensitive,
- institution,
- Condillac,
- Descola
Resumen
El objetivo de este artículo es mostrar cómo el interés por lo vegetal ha estado en el centro de una de las controversias históricas más fuertes del régimen de separación dualista de los Modernos. La obra de Etienne Bonnot de Condillac conjunta un vuelco importante del interés metafísico hacia las plantas, de la vista al olor, con una inquisición general sobre el origen del lenguaje. Esta combinación erige las formas de la percepción en condición de instituir. La identificación de esta combinación permite entablar un dialogo con la obra de Philippe Descola sobre la matriz ontológica generativa de colectividades. El camino de Condillac a Descola y de regreso no es especulativo: se funda en la memoria afectiva del aroma de las flores, que aquí sirven de punto arquimediano a la subversión del dualismo. Resta por saber cómo las plantas contribuyen al establecimiento de colectividades o, al contrario, se resisten.
Palabras clave:
- Bertrand,
- aroma,
- flores,
- ontología,
- lenguaje,
- sensación,
- memoria,
- espíritu,
- metafísica,
- sensible,
- institución,
- Condillac,
- Descola
Article body
La systématique et la taxonomie sont usuellement considérées comme les disciplines à travers le prisme desquelles les plantes ont été « bonnes à penser », non seulement pour les philosophes mais aussi pour les anthropologues (Lévi-Strauss 1962 : 132). Elles ont tout à la fois donné des appuis à la notion métaphysique d’« espèce naturelle » et à l’objectivation de la pensée sauvage. Ce faisant, la connaissance des attachements singuliers aux arbres, aux arbrisseaux ou aux herbes des prés est restée dans l’ombre, se réfugiant dans l’intimité des mémoires subjectives et de l’expression artistique. Pourtant, au moment même du basculement vers la modernité, certains philosophes se sont alliés au végétal pour prendre le dualisme distinctif du naturalisme de l’Occident à revers. Étienne Bonnot de Condillac fait incontestablement partie de ces très nombreux philosophes qui ont contesté, déplacé ou tenté de dépasser l’opposition de la nature et de la culture. Il est de ceux qui ont philosophiquement récusé avec force le régime de séparation des Modernes. Dans Par-delànature et culture, Philippe Descola fait ainsi à juste titre une place particulière à Condillac, jugeant son oeuvre « exemplaire » (2005 : 247). Mais, à son avis, Condillac resterait « ambivalent », cette ambivalence témoignant d’un « paradoxe constitutif du naturalisme moderne, lequel n’a cessé de voir en l’animal tantôt le plus petit commun dénominateur d’une figure universelle de l’humanité, tantôt le contre-exemple parfait permettant de caractériser la spécificité de celle-ci » (ibid. : 249). Quoi qu’il en soit de cette ambivalence, l’oeuvre anthropologique de Descola et l’oeuvre métaphysique de Condillac partagent une approche qui érige l’examen des structures de la sensibilité en condition de la description des systèmes d’action et de savoir. De sa première à sa dernière oeuvre, l’ambition de Condillac a été en effet d’analyser les conditions logiques des institutions, dont les langues humaines sont le paradigme. Et, de ce point de vue-là, il est possible que l’originalité de Condillac tienne moins à ses thèses sur l’animal qu’à son attention métaphysique très singulière au végétal.
Dans le Traité des sensations, Condillac montre qu’imaginer une succession d’effluves, soit l’« odeur de rose, d’oeillet, de jasmin, de violette », suffit pour penser la possibilité logique des opérations élémentaires de l’esprit (Condillac 1947 : 224). À la lisière de la poésie et de la philosophie, il invite à une expérience de pensée avec le végétal. Les plantes n’y sont pas des « objets » à étudier et à classer ni des prétextes à métaphores philosophiques (arbre des connaissances, paradigme du développement ou du système transformant le germe en fleur et en fruit[1], etc.) : les fleurs s’y révèlent les maîtresses inaperçues de la dynamique de la pensée. Cette expérience nécessite un artifice dont Condillac souligne la bizarrerie lorsqu’il l’explicite dans un « Avertissement au lecteur » qu’il juge lui-même incompréhensible au moment où on le lit : la lecture du Traité des sensations requiert un exercice mental consistant à se mettre à la place d’une statue imaginaire, « d’extérieur tout de marbre » et « organisée intérieurement comme nous, mais privée de toute espèce d’idées » (ibid. : 222) ; les sens de cette statue seront limités d’abord à l’odorat.
L’exercice d’imagination et de réflexion proposé par Condillac a parfois été interprété comme une « suspension » de l’attitude naturelle anticipant l’épochê husserlienne. Certes, si l’on y tient, il peut être compris comme une description phénoménologique, comme une fable logique ou même comme une impossible « quête du moi[2] ». Le début du texte indique cependant tout autre chose : il explore les opérations mentales dont les plantes sont, par leur odeur, les médiatrices, et cette exploration suppose une autre méthode que celle de l’introspection. L’attention accordée aux plantes par Condillac entretient une relation essentielle avec la thèse du Traité des sensations faisant de la capacité de sentir — appelée le sentiment — la qualité première de l’esprit. Mais elle permet aussi, de façon tout aussi essentielle, de déplacer la façon usuelle dont la philosophie naturaliste moderne pense les conditions logiques de l’institution des collectifs.
Si la philosophie de Condillac mérite en effet la lecture des anthropologues contemporains, ce n’est pas seulement pour la place singulière qu’elle accorde aux animaux et aux plantes au sein d’un système de la nature, mais surtout en raison du rôle à la fois subreptice et cardinal des plantes dans la réflexion qu’elle mène sur l’institution. Cet article évitera ainsi le penchant de la métaphysique abstraite à croire que l’activité conceptuelle, fût-elle soucieuse des plantes, ait la puissance propre de configurer ou de reconfigurer les mondes, et il évitera tout autant la naïveté délicieuse d’imaginer que le XXIe siècle naissant découvre l’intelligence des plantes. Il a pour objet d’initier, comme en un parlement des savoirs, un dialogue entre l’anthropologie de la nature de Descola et l’oeuvre de Condillac à un point de rencontre qui nous semble particulièrement fécond : la recherche commune d’une matrice génétique permettant d’ordonner les structures des collectifs à partir de leur constitution ontologique. Puisse cependant une telle méthode anthropologique et philosophique croisée inciter à ressaisir plus largement la puissance du végétal qui traverse les collectifs, y compris à leur insu.
S’il est bien connu que Condillac renverse la hiérarchie philosophique traditionnelle des sens en commençant son Traité des sensations par l’odorat, il n’a pour ainsi dire pas encore été remarqué jusqu’ici que l’arrière-plan de ce renversement métaphysique était une modification du régime sensoriel de l’attention au végétal. Condillac se conforme implicitement à cette hiérarchie ancienne dans son premier ouvrage, l’Essai sur l’origine des connaissances humaines. Il utilise l’analyse de la perception visuelle des plantes pour contrer la définition cartésienne de l’intuition comme acte de l’esprit « pur et attentif » (Condillac 1947 : 222). La décomposition discursive de la perception des arbres lui sert de modèle pour montrer que connaître n’est pas « voir » des idées, d’une vue claire et distincte, mais instituer et lier des signes. Condillac décrit ainsi comment les notions simples naissent des notions complexes (2014 : 253) et comment les premières phrases ont été composées (ibid. : 255, 257). Le coeur de l’argument consiste à décrire la façon dont l’analyse discursive de la perception visuelle d’un arbre permet la formation des idées. La manière dont Condillac considère le statut épistémique de la perception visuelle, notamment celui de la vision des figures, et le rôle qu’il donne au langage parlé montre que, dans l’Essai sur l’origine des connaissances humaines, il reste prisonnier de la philosophie de Locke, qui développe elle-même certains aspects des oeuvres de Descartes et, au-delà, de Galilée :
§ 48. Je dis que je me sens nécessairement amené, sitôt que je conçois une matière ou substance corporelle, à la concevoir tout à la fois comme limitée et douée de telle ou telle figure, grande ou petite par rapport à d’autres, occupant tel ou tel lieu à tel moment, en mouvement ou immobile, en contact ou non avec un autre corps, simple ou composée, et par aucun effort d’imagination je ne la puis séparer de ces conditions ; mais qu’elle doive être blanche ou rouge, amère ou douce, sonore ou sourde, d’odeur agréable ou désagréable, je ne vois rien qui contraigne mon esprit de l’appréhender nécessairement accompagnée de ses conditions ; et, peut-être, n’était le secours des sens, le raisonnement ni l’imagination ne les découvriraient jamais. Je pense donc que ces saveurs, odeurs, couleurs, etc., eu égard aux sujets dans lequel elles nous paraissent résider, ne sont que de purs noms et n’ont leur siège que dans le corps sensitif, de sorte qu’une fois le vivant supprimé toutes ces qualités sont détruites et annihilées ; mais comme nous leur avons donné des noms particuliers et différents de ceux des qualités [accidenti] réelles et premières, nous voudrions croire qu’elles en sont vraiment et réellement distinctes.
Galilée 1980 : 239
Parmi les modifications des corps qui produisent les perceptions, Condillac distingue donc, suivant Locke, les qualités premières des qualités secondes :
Cela, on doit distinguer dans les corps deux sortes de qualités, celles qui sont entièrement inséparables du corps, en quelque état qu’il soit, de sorte qu’il les conserve toujours, quelques altérations et quelques changements que le corps vienne à souffrir ; […] ces qualités du corps qui n’en peuvent être séparées, je les nomme qualités originales et premières, qui sont la solidité, l’étendue, la figure, le nombre, le mouvement, ou le repos, et qui produisent en nous des idées simples, comme chacun peut, à mon avis, s’en assurer par soi-même.
§10. Il y a, en second lieu, des qualités qui dans les corps ne sont effectivement autre chose que la puissance de produire diverses sensations en nous par le moyen de leurs premières qualités, c’est-à-dire, par la grosseur, figure, contexture et mouvement de leurs parties insensibles, comme sont les couleurs, les sons, les goûts, etc. Je donne à ces qualités le nom de secondes qualités […].
Locke 1998 : 89
En raison de cette division en qualités premières et qualités secondes, les idées abstraites nées de la perception visuelle n’ont pas toutes la même valeur. Étant entendu que la nature est écrite en langue mathématique, les idées des figures et de la verdure, notamment, qui sont aussi simples les unes que les autres et ont toutes la même origine, n’ont pas le même statut. Sauf illusion d’optique, le jugement qui permet d’attribuer aux arbres certaines figures a toutes les chances d’être exact. En revanche, il n’est pas possible d’affirmer que la sensation visuelle de la verdeur indique une qualité propre aux arbres : nous savons seulement que le feuillage des arbres occasionne en nous une perception de la couleur verte. Autrement dit, tandis que le jugement selon lequel les arbres possèdent des figures est toujours vrai, nous ne savons pas si la verdeur des arbres indique une de leurs qualités propres et moins encore pourquoi elle pourrait l’indiquer. Cette analyse de la perception visuelle des arbres exposée dans l’Essai sur l’origine des connaissances humaines est cohérente avec la classification des sciences qui domine depuis Galilée : la physique est réputée constituer le modèle auquel les autres sciences devraient se conformer. Cependant, à la différence de Locke, Condillac considère que ce privilège de la physique n’est que relatif. La relation particulière qui existe entre les mathématiques, langue de l’analyse des grandeurs, et la physique ne signifie pas que la physique nous donne la connaissance des substances : « Les philosophes, voyant qu’en mathématiques la notion de la chose emporte la connaissance de son essence, ont conclu précipitamment qu’il en était de même en physique, et se sont imaginé connaître l’essence même des substances. » (Condillac 2014 : 269.)
En effet, quoi qu’il en semble, la langue mathématique n’est pas la langue de la physique : la première a été d’emblée parfaite, tandis que la seconde, comme le montre l’histoire des sciences, est un cortège de corrections successives (id. 1948 : 121). Mais, même lorsqu’elle est exacte, la science physique ne mesure que des grandeurs qui ne nous permettent pas de connaître l’essence des corps. Condillac s’appuie sur la botanique, et plus particulièrement sur la connaissance des arbres, pour le montrer : si l’abstraction de la grandeur est d’un usage très commode pour distinguer des classes de végétaux, comme celle qui oppose les arbres aux arbrisseaux, une telle abstraction est inadéquate pour saisir avec exactitude les différences intrinsèques des plantes. Et lorsque l’on tente d’affiner cette division, et qu’on la combine avec d’autres abstractions, par exemple l’architecture des arbres ou encore les caractères de leurs fruits, ces distinctions ne nous donnent pas davantage la connaissance de l’essence des arbres[3]. Grâce aux mathématiques, la langue de la physique dispose d’un outil lui permettant de contribuer facilement au progrès des connaissances ; mais elle ne donne accès qu’à des connaissances d’un certain type. En l’occurrence, l’étude des rapports entre les grandeurs est très loin de permettre la connaissance des végétaux, y compris d’un point de vue classificatoire. Dans La logique, sa dernière oeuvre, Condillac tire de cette analyse une conclusion nominaliste valable pour l’ensemble des classifications ontologiques :
Tout est distinct dans la nature ; mais notre esprit est trop borné pour la voir en détail d’une manière distincte. En vain nous analysons ; il reste toujours des choses que nous ne pouvons analyser, et que, par cette raison, nous ne voyons que confusément. L’art de classer, si nécessaire pour se faire des idées exactes, n’éclaire que les points principaux : les intervalles restent dans l’obscurité, et dans ces intervalles, les classes mitoyennes se confondent. Un arbre, par exemple, et un arbrisseau sont deux espèces bien distinctes. Mais un arbre peut être plus petit, un arbrisseau peut être plus grand ; et l’on arrive à une plante qui n’est ni arbre ni arbrisseau, ou qui est tout à la fois l’un et l’autre ; c’est-à-dire, qu’on ne sait plus à quelle espèce la rapporter.
Ce n’est pas là un inconvénient : car demander si cette plante est un arbre ou un arbrisseau, ce n’est pas, dans le vrai, demander ce qu’elle est ; c’est seulement demander si nous devons lui donner le nom d’arbre, ou celui d’arbrisseau. Or il importe peu qu’on lui donne l’un plutôt que l’autre : si elle est utile, nous nous en servirons et nous la nommerons plante. On n’agiterait jamais de pareilles questions, si l’on ne supposait pas qu’il y a dans la nature comme dans notre esprit, des genres et des espèces. Voilà l’abus qu’on fait des classes : il le fallait connaître.
Condillac 1948 : 381
Ni les espèces ni les genres n’existent donc dans la nature : ceux-ci sont toujours relatifs à la manière dont nous attribuons les noms. Notons que cette relativité n’invalide pas les tentatives de traduction des noms des plantes sous le prétexte que la classification en genres et en espèces serait rivetée à la singularité des langues et des coutumes des différentes nations. Mais le fait indubitable que toutes nos connaissances viennent des sens n’a pas pour corollaire le principe selon lequel la perception sensible nous donnerait d’une manière ou d’une autre accès à des universaux[4]. C’est l’inverse qui est vrai, et c’est pourquoi les connaissances, qui ne sont jamais que des connaissances de ce que les choses sont en effet (id. 2014 : 60), sont aussi diverses que les langues. Comment penser dès lors les relations épistémiques liant la botanique et la physique ? Doit-on s’efforcer de modéliser des plantes comme si elles étaient des machines pour pouvoir en décrire exactement les ressorts physiques ? Faut-il renoncer à connaître les principes de l’organisation des corps vivants et se contenter de les saisir par une science seulement classificatoire ou nominale ? Convient-il, à l’inverse, d’attribuer un esprit aux plantes et de doter la matière de certains des attributs de l’esprit pour expliquer la possibilité de l’organisation des corps vivants[5] ? Quels rapports établir entre l’organisation des corps et leur animation ? La distribution des intériorités et des physicalités, au sens de Descola, est au coeur de la philosophie moderne du végétal.
Les relations épistolaires de Maupertuis et de Condillac ont gardé une trace particulièrement explicite de cette exploration du statut ontologique des plantes. Elles accordent une attention métaphysique particulière aux feuilles des plantes et reviennent à la question de leur verdeur. Maupertuis fait l’hypothèse audacieuse[6] que la verdeur pourrait être une qualité substantielle des arbres au même titre que leurs formes :
Si l’on dit qu’on peut dépouiller l’arbre de sa verdeur, et qu’on ne le peut de son étendue, je réponds que cela vient de ce que dans le langage établi on est convenu d’appeler arbre ce qui a une certaine figure, indépendamment de sa verdeur. Mais si la langue avait un mot tout différent pour exprimer un arbre sans verdeur et sans feuilles, et que le mot arbre fût nécessairement attaché à la verdeur, il ne serait pas plus possible d’en retrancher la verdeur que l’étendue.
Condillac 1948 : 537
L’attention visuelle à la verdeur des arbres amorce ici une remise en cause de l’opposition lockéenne entre les qualités secondes et les qualités premières. Suivant le principe de moindre action qu’il a découvert, Maupertuis suppose que la couleur verte des feuilles pourrait être le signe d’une propriété substantielle des arbres indépendamment de leur étendue et de leur figure. L’argument est à la fois d’ordre ontologique, logique et linguistique. Il n’est pas absurde en effet d’imaginer une langue désignant ces deux états de ce que nous nommons « arbre » par deux mots complètement différents, signifiant ainsi par (a-arbre) les formes ligneuses dépourvues de verdure, comme celles des arbres à feuilles caduques en hiver, et par (b-arbre) des formes ligneuses feuillues. Maupertuis montre alors qu’une telle langue rendrait impossible de concevoir l’idée du mot (b-arbre) ou de l’utiliser sans lien avec la verdeur. Il en conclut que la verdeur peut être considérée comme une propriété substantielle des arbres indépendamment de l’étendue et des figures. En tout état de cause, le fait qui intrigue Maupertuis et dont il part est l’uniformité de la couleur des feuilles des arbres.
Au premier abord, la réponse de Condillac semble se placer sur un plan d’abstraction tenant les qualités substantielles des arbres pour négligeables. Se pourrait-il qu’elle néglige délibérément la portée des arguments de Maupertuis faisant de la verdeur des feuilles (et non de la couleur de n’importe quel objet) une qualité première et non une qualité seconde ? Les arbres sont en effet requalifiés par Condillac de simples « objets » dont la particularité serait d’être verts, exemplifiant la règle générale selon laquelle un « objet » est toujours étendu, quoi qu’il en soit de sa couleur (ibid. : 537). Mais cette réponse déborde le cadre de l’articulation de la philosophie de la connaissance et du système de la nature qui organise la démonstration de Maupertuis. Condillac rappelle qu’il ne défend pas l’existence des universaux, fussent-ils sensibles, et reproche à Maupertuis d’avoir négligé le rôle du langage d’action dans l’institution des langues. À vrai dire, au moment de cet échange épistolaire avec Maupertuis sur la verdeur des arbres, Condillac admet avoir « trop donné aux signes[7] », ce qui revient à dire qu’il juge lui-même insuffisante l’analyse donnée dans l’Essai sur l’origine des connaissances humaines, acceptant en partie le bien-fondé des critiques que Rousseau et Diderot n’ont pas manqué de lui adresser, soit, respectivement, l’existence d’une circularité par laquelle l’institution du langage présuppose elle-même un langage et l’accusation d’idéalisme consécutive à la relativisation du concept de l’étendue élaboré par Locke et Descartes. Ce qui importe alors à Condillac est de pouvoir faire droit à l’intelligibilité de la diversité des langues et des perceptions, et non d’affirmer, à l’instar de Maupertuis, que, d’une part, les êtres humains partagent la même nature, et que, d’autre part, la verdeur des feuilles des arbres est une de leurs qualités substantielles.
Dans les termes contemporains de l’anthropologie de Descola, Condillac est alors contraint à approfondir l’analyse des conditions logiques ou structurales de l’institution des collectifs. La solution qu’il trouve aux apories du langage est d’en déplacer les coordonnées, en réinscrivant le langage parlé des êtres humains dans l’immense ensemble des langages institués des êtres vivants, lesquels partagent avec les êtres humains la disposition d’un langage naturel (ibid. : 396). Mais pour décrire ainsi sans circularité l’institution des langues et, dans les termes de Descola, celle des collectifs, il faut rompre avec le cartésianisme et renverser le statut des sensations pour en faire l’élément d’un langage commun. Or, les plantes, bien plus que les animaux, vont jouer un rôle décisif dans ce renversement. Exposée dans le Traité des sensations, ce que Condillac appelle l’analyse du « sentiment » montre que ni la dynamique des opérations de l’esprit ni l’usage de la réflexion ne dépendent du langage parlé. Grâce à une attention méthodique aux qualités des végétaux, il devient possible de comprendre que les mondes se distribuent à partir d’une archê-expérience d’indistinction fondatrice et générative, à l’origine de la diversité des ontologies, que Condillac modélise grâce à l’odeur de rose.
Au premier abord, la démonstration du Traitédes sensations repose sur des arguments assez comparables à ceux que Maupertuis utilise pour affirmer que la verdeur pourrait être une qualité première des arbres. Condillac opère cependant trois déplacements considérables par rapport à cette argumentation : le premier est de porter attention non pas à l’uniformité des sensations visuelles des arbres en général, mais aux sensations olfactives de fleurs singulières ; le second est d’inventer un dispositif méthodique pour capter cette attention olfactive ; le troisième, enfin, est de donner une fonction démonstrative à une expérience fictive exhibant un principe architectonique réordonnant la description de l’esprit humain et permettant de rétablir la valeur épistémologique des sensations.
On pourra juger à juste titre qu’un certain nombre de thèses exposées dans le Traité des sensations sont des reprises d’idées anciennes : il est possible d’en trouver trace chez Montaigne ou dans le corpus sceptique. On pourra même, et les lecteurs du XVIIIe siècle ne s’en sont guère privés, considérer que la fiction sur laquelle ce texte repose, l’hypothèse d’une statue qui s’éveille progressivement, n’est pas originale. Mais Condillac a beau jeu de souligner la nouveauté proprement métaphysique de son ouvrage, celle d’une méthode montrant que la sensation est un fait suffisant pour expliquer la génération des idées et des opérations de l’âme, notamment de la réflexion, indépendamment de l’institution des signes du langage parlé (id. 1947 : 121). Ce fait n’est donc pas une simple évidence interne, dite évidence de sentiment (id. 1948 : 411). Ainsi, tandis que le Discours de la méthode raconte l’histoire d’un esprit au moyen d’une autofiction par laquelle Descartes décrit son isolement dans un poêle[8], le Traité des sensations met en abyme une situation d’interlocution. Commençant par rappeler qu’il tient de ses conversations avec Mlle Ferrand l’idée de sa méthode, Condillac substitue à la narration à la première personne un dispositif d’écriture qui requiert un exercice d’imagination reposant sur une réflexion analogique.
L’ouvrage commence par un avis qui demande au lecteur de se mettre « à la place d’une statue », jusqu’à la métamorphose imaginaire de cette dernière en « homme isolé qui jouit de tous ses sens » (Condillac 1947 : 221). Le lecteur est ainsi invité à attribuer analogiquement à cette statue la capacité de sentir, puis à observer en lui-même ce que cette statue pourrait éprouver au cours d’une expérience soigneusement menée. Si le Traité des sensations est une description ordonnée des effets de diverses impressions sur les différents sens, d’abord pris séparément puis joints les uns aux autres, il décompose surtout les conditions logiques permettant à chaque être humain d’analyser correctement les actions d’un autre pour instituer (ou apprendre) une langue commune. Pour comprendre ce qu’il en est des autres, il faut d’abord être capable de « se mettre à leur place[9] » en imaginant « l’ensemble de l’outillage biologique qui permet à une espèce d’occuper un certain habitat et d’y développer le mode d’existence distinctif par quoi on l’identifie au premier chef » (Descola 2005 : 190). Ce principe est l’exact inverse de la méthode cartésienne de révocation en doute de l’existence d’autres esprits[10]. Il retourne également l’ensemble des termes classiques de l’étude mécanique des corps : en supposant que la statue est « organisée comme nous », il coupe court à la fascination (morbide) exercée par la description des corps organisés comme s’il s’agissait de machines[11]. Condillac prend donc à revers l’argumentation de Descartes contre le langage et l’âme des bêtes. Plus que la simple fiction d’une statue animée peu à peu, il définit une méthode métaphysique d’attention de type perspectiviste qui fait de la sensation la condition logique de toute institution :
J’avertis donc qu’il est très important de se mettre exactement à la place de la statue que nous allons observer. Il faut commencer d’exister avec elle, n’avoir qu’un seul sens, quand elle n’en a qu’un ; n’acquérir que les idées qu’elle acquiert, ne contracter que les habitudes qu’elle contracte : en un mot, il faut n’être que ce qu’elle est. Elle ne jugera des choses comme nous, que quand elle aura tous nos sens et toute notre expérience ; et nous ne jugerons comme elle, que quand nous nous supposerons privés de tout ce qui lui manque. Je crois que les lecteurs, qui se mettront exactement à sa place, n’auront pas de peine à entendre cet ouvrage ; les autres m’opposeront des difficultés sans nombre.
Condillac 1947 : 221
L’analyse du Traité des sensations s’organise ainsi à partir de ce que Condillac appelle dans La logique le « langage naturel », lequel permet à un face à face de se transformer en un dialogue, dans un mouvement d’attribution en miroir : « Aussi notre conformation extérieure est-elle destinée à représenter tout ce qui se passe dans l’âme : elle est l’expression de nos sentiments et de nos jugements ; et, quand elle parle, rien ne peut être caché » (id. 1948 : 396).
Si la sensation est un fait, ce n’est donc pas (ou pas seulement) un fait interne. Elle est l’élément d’un langage naturel, comme l’observation des mouvements d’un corps organisé indique les opérations de son esprit, dès lors que l’observateur se place en position d’interlocution, en attribuant à ce corps une « organisation intérieure » comme la nôtre. Le dispositif méthodique du Traité des sensations dispense ainsi son lecteur de l’examen d’analogies superficielles (mal faites, dans le vocabulaire de Condillac), comme celle des sons émis par les oiseaux parleurs avec les phrases humaines ou celle des actions des animaux avec des mécanismes horlogers, pour l’inciter à observer les conditions qui permettent d’attribuer un esprit à un corps, fût-il d’abord supposé inerte[12], et former des analogies exactes. L’attention philosophique usuellement accordée aux animaux et à leurs échanges tapageurs ou même à la réflexion alors à la mode sur le progrès des connaissances humaines, particulièrement celui de la physique, est détournée par Condillac vers les sensations de l’odeur des fleurs. Les controverses sur les animaux apparaissent alors avoir obscurci l’analyse logique de l’institution du langage[13].
Mais la méthode du Traité des sensations n’a pas d’abord pour but de débrouiller les polémiques sur l’esprit et le langage des bêtes ou d’imaginer la possibilité d’échanges avec les non-humains. Principielle, elle bouleverse les attendus de la logique : elle montre que pour pouvoir gloser sur l’exactitude du raisonnement, il faut remonter jusqu’à une logique non prédicative, celle du langage naturel. L’analyse logique exige de revenir au fait de la sensation dont dépend in fine l’exercice de la raison. De ce point de vue, la surprise essentielle du Traité des sensations est d’étendre subtilement le langage naturel aux plantes, grâce à une sorte de trompe-l’oeil. En prenant l’odorat comme point de départ de son analyse des sensations, Condillac renverse la hiérarchie métaphysique usuelle des sens ; mais en choisissant l’odeur d’une fleur, il élargit au végétal le spectre de la situation en miroir qui lie le lecteur à la statue. Par le jeu d’une imagination rigoureuse, le lecteur est invité silencieusement, aveuglément, et comme par une pétrification de l’attention, à se mettre à la place d’une statue sentant une rose. L’exercice ici requis n’a évidemment rien d’un entraînement à l’observation ou à la classification botanique : il vise à mettre en évidence les conditions de l’institution d’un langage, conditions que nous partageons avec l’ensemble des êtres vivants et qui tient à l’existence d’un langage expressif commun.
Sans jamais discuter les thèses panpsychiques de Diderot ou de Maupertuis, ni s’aventurer sur le terrain d’une « bio »-logie encore à naître, Condillac opère donc dans le Traité des sensations un passage à la limite. Mais pour tirer des conclusions ontologiques de cette thèse logique du point de vue d’un système de la nature, par exemple concernant la capacité de sentir, et partant l’esprit, des plantes ou des animaux minuscules, il faudrait mobiliser d’autres arguments. Certes, le Traité des sensations campe une méthode générale qui sera déclinée dans le Traité des animaux pour éclairer ce qu’il pourrait en être de l’âme des animaux et de leur langage à partir de l’observation de leur propre organisation :
Les cris inarticulés et les actions du corps sont les signes de leur pensée ; mais pour cela il faut que les mêmes sentiments occasionnent dans chacun les mêmes cris et les mêmes mouvements ; et par conséquent, il faut qu’ils se ressemblent jusque dans l’organisation extérieure. Ceux qui habitent l’air, et ceux qui rampent sur la terre, ne sauraient même se communiquer les idées qu’ils ont en commun […].
Condillac 1947 : 361
Mais cette ébauche de méthode pour connaître les capacités de connaissance des êtres vivants relativement à leur organisation sensorielle reste très vague et plus qu’allusive en ce qui concerne les plantes[14]. Tout juste Condillac précise-t-il que la statue limitée à l’odorat « peut nous donner une idée de la classe des êtres dont les connaissances sont les moins étendues » (ibid. : 224). Ce qui importe à Condillac dans le Traité des sensations est de montrer que le langage naturel est partagé avec la classe de ces êtres-là et qu’il n’a pas la même grammaire que les langues parlées qui servent aux échanges des êtres humains. Cette grammaire est révélée par l’expérience de l’odeur des fleurs qui indique que l’esprit ne se définit pas par un principe d’automation (c’est-à-dire de commande de mouvement) mais par un principe architectonique d’analyse logique (à savoir de transformation des sensations). Ce principe architectonique est opératoire bien en deçà de la formation des représentations ; il n’est pas ordonné en vertu de la connaissance objective du monde ; au contraire, c’est lui qui la conditionne. La statue limitée à l’odorat juge, imagine, désire, sans être capable de former la moindre représentation du monde.
En déplaçant l’attention au végétal de l’oeil à l’odeur, Condillac dissipe les équivoques ontologiques de la discussion avec Maupertuis sur la verdeur des arbres. Non seulement il n’est pas question de botanique dans le Traité des sensations, mais il n’est pas non plus à propos de savoir ce qu’il en est des qualités des plantes sur le plan substantiel. Le procédé méthodique d’attention au végétal utilisé par Condillac lui permet à l’inverse de transgresser l’opposition moderne de la subjectivité et de l’objectivité. Condillac insiste : la statue est d’abord odeur de rose :
Si nous lui présentons une rose, elle sera par rapport à nous, une statue qui sent une rose ; mais par rapport à elle, elle ne sera que l’odeur même de cette fleur.
Elle sera donc odeur de rose, d’oeillet, de jasmin, de violette, suivant les objets qui agiront sur son organe. En un mot, les odeurs ne sont à son égard que ses propres modifications ou manières d’être ; et elle ne saurait se croire autre chose, puisque ce sont les seules sensations dont elle est susceptible.
Condillac 1947 : 224
Au premier terme cartésien par lequel l’esprit se saisit lui-même, Condillac substitue une expérience de pensée voulant que l’odeur soit antérieure à l’opposition d’un soi et d’un non-soi. Tandis que l’acte de l’esprit cartésien est conditionné par une fiction de retranchement, l’analyse sensorielle condillacienne déploie un dispositif méthodique qui efface l’opposition du soi et du non-soi et la distinction de l’intériorité et de l’extériorité. La méthode du Traité des sensations disqualifie ainsi l’agencement argumentatif ontothéologique liant chez Locke l’identité réflexive, la mêmeté du corps propre et la définition de la personne. L’antériorité logique d’archê-opérations de l’esprit, indépendantes de l’opposition du soi et du non-soi, suffit ensuite à expliquer la possibilité de la diversité des peuplements ontologiques des mondes. Pour en rendre raison, encore faut-il décrire comment peuvent être générées l’opposition du soi et du non-soi et la distribution des étants.
Condillac attribue cette génération aux sensations nées de l’autocontact. À l’épreuve originaire des modifications de soi auquel l’odorat pourvoie à lui seul se combine en effet la distribution spatiale du soi et du non-soi, réglée par le tact, qui génère la réflexion, puis les représentations :
Ce n’est qu’avec le tact, que détachant ces modifications de son moi, et les jugeant hors d’elle, elle en fait des touts différemment combinés, où elle peut démêler une multitude de rapports […]. Or cette attention qui combine les sensations, qui en fait au-dehors des touts, et qui réfléchissant, pour ainsi dire, d’un objet sur un autre, les compare sous différents rapports ; c’est ce que j’appelle réflexion.
Condillac 1947 : 264
Lorsque la statue est dotée de tous nos sens, d’abord étonnée « de ne pas être tout ce qu’elle touche » (ibid. : 257), elle remplit peu à peu le monde d’êtres visibles et invisibles « qu’elle prie de travailler à son bonheur » (ibid. : 242) ; « elle s’adresse aux arbres, et elle leur demande des fruits, ne doutant pas qu’il dépend d’eux d’en porter ou de n’en pas porter » (ibid. : 242).
Dans le chapitre deux, « Structures de l’expérience », de Par-delà nature et culture, la matrice structurelle des continuités et discontinuités ontologiques repose essentiellement sur un principe génétique de type psychologique. Lire Par-delà nature et culture avec le Traité des sensations déplace cette génération du côté des conditions logiques de l’institution des langages d’action, ce qui est cohérent avec l’inclusion des non-humains dans les collectifs. Les modes d’agentivité propre aux végétaux pourraient alors être pensés comme des éléments déterminants de la fixation des schèmes d’identification.
Cette piste est indiquée par Descola lui-même lorsqu’il aborde la notion de « schème », se référant à l’habileté acquise des bons chasseurs achuars, lesquels ont besoin d’une trentaine d’années pour développer « un schème cognitif spécialisé, capable de s’adapter à une famille de tâches apparentées, et dont l’activité inintentionnelle est tributaire d’un certain type de situations » (Descola 2005 : 147). Cependant, au cours de ce chapitre deux, le souci d’enraciner la matrice structurale dans les travaux de la psychologie contemporaine conduit l’auteur à minorer une première fois, temporairement, le rôle des non-humains dans la genèse des schématismes collectifs :
On peut les définir [les schèmes collectifs] comme des dispositions psychiques, sensori-motrices et émotionnelles, intériorisées grâce à l’expérience acquise dans un milieu social donné, et qui permettent l’exercice d’au moins trois types de compétence : d’abord, structurer de façon sélective le flux de la perception en accordant une prééminence significative à certains traits et processus observables dans l’environnement ; ensuite, organiser tant l’activité pratique que l’expression de la pensée et des émotions selon des scénarios relativement standardisés ; enfin, fournir un cadre pour des interprétations typiques de comportements ou d’événements, interprétations admissibles et communicables au sein de la communauté où les habitudes de vie qu’elles traduisent sont acceptées comme normales […].
Descola 2005 : 151
Descola élargit bien entendu aussitôt le « milieu social » aux non-humains en s’appuyant sur l’article séminal d’André-Georges Haudricourt « Domestication des animaux, culture des plantes et traitement d’autrui » (1962), et il insiste sur le rôle déterminant des affects dans le processus de schématisation (Descola 2005 : 157) avant de donner aux schèmes d’identification un statut distinctif, soit une préséance logique sur les schèmes de relation. Mais il affirme aussi qu’en un certain sens les schèmes d’identification sont des schèmes de relation, puisqu’ils sont fondés « sur des jugements d’inhérence et d’attribution » (ibid. : 165), ces relations n’étant toutefois pas extrinsèques, à la différence de celles des schèmes dits de relation, par exemple ceux de prédation ou de protection. Pourtant, dans l’analyse qui suit cette proposition, et qui fait la part belle à la phénoménologie, toute référence à ces relations intrinsèques disparaît, comme si finalement la répartition ontologique des continuités et des discontinuités pouvait être effectuée par une
expérience de pensée […] menée par un sujet abstrait dont il est indifférent de savoir s’il a jamais existé, mais qui produit des effets tout à fait concrets, puisqu’elle permet de comprendre comment il est possible de spécifier des objets indéterminés en leur imputant ou en leur déniant une « intériorité » et une « physicalité » analogues à celles que nous nous attribuons à nous-mêmes.
Ibid. : 168
C’est à ce point de l’analyse que l’expérience fictive de la statue-odeur de rose de Condillac pourrait venir se combiner à cette fabrique des schèmes d’identification, et cela d’une double façon : en déplaçant le principe abstrait du repérage des continuités et discontinuités du côté de l’étude des modalités sensorielles de l’expérience, et en faisant intervenir ensuite dans le processus de schématisation de nouvelles conditions logiques — cette fois non subjectives — que Condillac pense sous les espèces du langage naturel. Cet article n’est pas le lieu d’un tel développement, qui obligerait entre autres à déterrer les racines kantiennes de la notion contemporaine de « schème » pour en déplacer l’ancrage philosophique dans un terrain plus ancien qui donne aux sensations une double fonction logique, celle de l’ordonnancement du divers et celle de structuration des attributions analogiques d’intentionnalité. Mais il est certainement l’occasion appropriée d’en indiquer certaines conséquences intéressantes en ce qui concerne le rôle propre des plantes dans les processus de schématisation ontologique. Nous en soulignerons deux, l’une relative à ce que Florence Brunois (2018) a appelé « vide ontologique » pour dire les difficultés de la description ethnographique des relations avec les plantes, et l’autre tenant à la singularité du naturalisme et des conditions de sa constitution historique.
Si tant est que les ontologies ne se repèrent guère dans les mythes et autres créations culturelles discursives mais, plutôt, dans l’observation quotidienne des pratiques, notamment avec les non-humains, le paradoxe apparent de l’anthropologie structurale déployée par Descola est de reposer, bien plus peut-être que celle de Lévi-Strauss, sur l’expérience irremplaçable de l’ethnographe sur le terrain (Descola 2005 : 143). Or, si les interactions avec les plantes peuvent être observées du dehors, il est extrêmement difficile, pour ne pas dire quasi impossible, de décrire dans les termes naturalistes et objectivants d’une science sociale la palette des conversations entretenues entre les plantes et les êtres humains. Outre la très belle expression de « vide ontologique », cette difficulté malheureuse est qualifiée par Brunois d’« angle mort » (2018) et d’« obstacle épistémologique » (2007), ce qu’elle a éprouvé dans l’ethnographie des Kasua qu’elle mène depuis de nombreuses années. Le premier aspect de cette difficulté est certainement le caractère particulier de chacune de ces conversations, lié non seulement à la singularité des habitudes nouées entre les êtres végétaux et humains, mais aussi à la singularité même des lieux dans laquelle elles s’inscrivent, incluant tous ceux qui les habitent, gibier ou ver de terre, dans un ordonnancement institué. Le second est l’absence de « phrasé » de ces échanges demandant que soit questionné le chaman qui possède le pouvoir de dire les mots des arbres dans la langue des esprits. Mais le dernier, qui est le plus critique pour notre propos, est de pouvoir discerner les signes des manifestations des esprits qui habitent les arbres, dont, notamment, la perception distincte des odeurs : « Tu n’as pas senti ? Les esprits sont là, ils se sont faits beaux, ils se sont revêtus de leur plus bel apparat pour attaquer les convois de la compagnie » (id. 2018 : 19).
Le « vide ontologique » est ce à partir de quoi peuvent s’apercevoir les enlacements dont les Modernes sont exclus. L’art ethnographique qui se déploie dans Le jardin du casoar, la forêt des Kasua (id. 2007) est de dire ensuite ces relations qui non seulement se dissimulent à l’ethnographe, mais sont en fait contradictoires avec le monde auquel elle appartient. Il ne s’agit pas là d’une généralité que l’on pourrait décliner pour tout terrain anthropologique, mais d’un noeud propre à l’histoire que le naturalisme, au sens de Descola, entretient avec le végétal. Il se pourrait en effet que les collectifs modernes n’aient pu s’instituer qu’en excluant l’équivoque née de la compagnie quotidienne des plantes qui mêle le sentiment de soi à leurs odeurs.
Dans le Traité des sensations, l’étude de la génération de l’opposition entre ce que l’on est et ce que l’on n’est pas s’opère à partir de l’expérience des continuités et discontinuités observées au gré des variations de la sensation de solidité. Or, ni les fleurs ni les plantes, et moins encore les arbres qui, par ailleurs, ne cessent de croître, ne se laissent facilement entourer, alors même que la capacité de parcourir un corps avec la main est une condition nécessaire pour pouvoir se le représenter comme un objet distinct. Si les plantes peuvent, en un sens, être enlacées, elles résistent à l’archê-expérience d’objectivation décrite au chapitre un de la troisième partie du Traité des sensations, puisque, même en cumulant des expériences successives visant à établir la continuité de leurs parties, il n’est tout simplement pas possible d’entourer toute la surface d’une plante (excepté dans son état de graine ou de semence). L’enlacement des plantes est ainsi davantage un processus infini qu’une expérience analysable.
Il ne s’agit pas là de réintroduire des explications causales, déterministes, écologiques ou environnementales dans la compréhension de la structuration anthropologique des collectifs, mais de considérer que si un collectif n’est décidément pas une société humaine, il convient d’éclairer le répertoire des modes d’identification qui lui sont logiquement possibles. Pourquoi et comment, à l’époque moderne, les végétaux sont-ils devenus les éléments d’un décor visuel ou l’objet d’une systématique ? La distribution des continuités et discontinuités des physicalités et des intériorités a-t-elle été reconfigurée par la disparition de l’immersion dans le végétal due à la destruction de la forêt européenne ? Les plantes sont « objectivées » par un raccourci perceptivo-mémoriel par lequel les sensations visuelles des contours tiennent lieu de sensations tactiles. Mais pour composer un monde dans lequel l’intériorité des êtres humains est distincte et opposée à l’ensemble des physicalités, il faut aussi que les odeurs des végétaux puissent être perçues comme de simples qualités appartenant à ces « objets ». À une chronique de l’objectivation des plantes par le regard obligeant à réarticuler des pans entiers de l’histoire des beaux-arts et des sciences occidentales, il faudrait joindre l’analyse de l’usage des nouvelles techniques telles que la distillation des parfums végétaux et leur solution dans l’alcool, qui ont fait circuler dans le monde humain des « extraits » d’odeur en l’absence même des fleurs ou des arbres, rejetant dans les profondeurs d’une mémoire affective intime les souvenirs des événements et des lieux où les modifications de soi et les odeurs se confondent.
Ce n’est que très tardivement que les sciences contemporaines ont « objectivé » cette valence hédonique, les odeurs se caractérisant du point de vue cognitif par leur polarisation affective. Encore les neurosciences contemporaines ne disent-elles rien de ce que ce caractère hédonique implique quant aux relations que les êtres humains nouent avec les plantes. Tout juste reconnaissent-elles une filiation historique entre la découverte récente des propriétés des récepteurs olfactifs et les propriétés affectives des odeurs décrites par Marcel Proust et… Condillac. Rétrospectivement, il est étonnant que la postérité immédiate de la philosophie de Condillac ait pu être, notamment avec Lavoisier[15], le transfert de sa méthode d’analyse à la chimie, et partant la réduction des vertus des plantes aux molécules. Ce qui s’est perdu alors, et pour longtemps, a été une certaine attention métaphysique au végétal et, par conséquent, l’ambition de comprendre la diversité des formes de l’attachement aux plantes avec lequel faire monde. Peut-être n’est-ce néanmoins pas tout à fait un hasard si Lavoisier a mis le premier en évidence le rôle de l’oxygène dans la respiration animale, instaurant le long chemin par lequel les sciences exactes décriront à leur tour la dépendance ontologique des êtres humains au végétal qui détermine les équilibres gazeux de la biosphère. Condillac n’a pas bâti lui-même de système de la nature à partir des découvertes de Joseph Priestley sur la respiration des plantes. L’étude de la respiration, ce jeu de la machine où commence la vie (Condillac 1947 : 251), lui a permis en revanche de montrer comment le sentiment fondamental de soi participe à l’institution des mondes. Car sentir (au sens de l’olfaction) est toujours aussi respirer. Par-delà la philosophie moderne et l’aristotélisme, Condillac affirme donc que ce sont les plantes qui ont donné aux êtres humains leur première idée de l’esprit, au moins en tant que celui-ci échappe à la vue :
Les hommes ayant toujours aperçu du mouvement et du repos dans la matière, ayant remarqué le penchant ou l’inclination des corps, ayant vu que l’air s’agite, se trouble et s’éclaircit, quand les plantes se développent, se fortifient et s’affaiblissent, ils dirent le mouvement, le repos, l’inclination et le penchant de l’âme. [...] Le terme d’esprit, d’où vient-il lui-même, si ce n’est de l’idée d’une matière très subtile, d’une vapeur, d’un souffle qui échappe à la vue ?
Condillac 2014 : 87
Appendices
Notes
-
[1]
Pour les textes de référence cardinaux de ces deux métaphores dans l’histoire de la philosophie, voir Descartes (2009 : 260) ou la préface de Hegel (1998).
-
[2]
Voir Baertschi (1984) et Markovits (2018).
-
[3]
« Nous avons, par exemple, mis dans la classe d’arbre, les plantes dont la tige s’élève à une certaine hauteur, pour se diviser en une multitude de branches, et former, de tous ses rameaux, une touffe plus ou moins grande : voilà une classe générale, qu’on nomme genre. Lorsqu’ensuite on a observé que les arbres diffèrent par la grandeur, par la structure, par les fruits, etc., on a distingué d’autres classes subordonnées à la première, qui les comprend toutes ; et ces classes subordonnées sont ce qu’on nomme espèces. » (ibid. : 379.)
-
[4]
Si la philosophie de Condillac s’enracine dans l’analyse logique des structures antéprédicatives, elle ne fraie pas pour autant la voie phénoménologique d’une métaphysique réaliste, récusant par avance la notion d’« universaux de la sensibilité » que l’on trouve aujourd’hui, par exemple, chez Claude Romano (voir Les repères éblouissants : renouveler la phénoménologie [2019]).
-
[5]
Sur l’idée de matière sensible, voir Diderot (1965) ou Maupertuis (1965-1974).
-
[6]
Rappelons que la photosynthèse ne sera découverte qu’au siècle suivant…
-
[7]
En ce sens et dans ce contexte, les « signes » désignent les mots.
-
[8]
« Mais je serai bien aise de faire voir, en ce discours, quels sont les chemins que j’ai suivis, et d’y représenter ma vie en un tableau » (Descartes 1963 : 570) ; et, plus loin : « J’étais alors en Allemagne, où l’occasion des guerres qui n’y sont pas finies m’avait appelé ; et comme je retournais du couronnement de l’empereur vers l’armée, le commencement de l’hiver m’arrêta en un quartier où, ne trouvant aucune conversation qui me divertît, et n’ayant d’ailleurs, par bonheur, aucuns soins ni passions qui me troublassent, je demeurais tout le jour enfermé dans un poêle, où j’avais tout loisir de m’entretenir de mes pensées. » (Ibid. : 579.)
-
[9]
Voir Descola (2005 : 196) et Viveiros de Castro (1996, 2014). L’opération mentale qui conditionne ce que ces anthropologues discutent sous le nom de perspectivisme est analogue à celle de la méthode d’analyse métaphysique qui, pour Condillac, est nécessaire à l’explicitation des conditions logiques de toute institution.
-
[10]
« Si par hasard je regarde d’une fenêtre des hommes qui passent dans la rue, je ne manque pas de dire que je vois des hommes. Et cependant que vois-je de cette fenêtre, sinon des chapeaux et des manteaux, qui peuvent couvrir des spectres ou des hommes feints qui ne se remuent que par ressorts ? » (Descartes 1967 : 426-427.)
-
[11]
L’artifice de la statue évite en effet de recourir à l’argument paresseux de l’instinct ou d’opposer abstraitement l’instinct à la raison, comme Condillac le dira très clairement dans le Traité des sensations (1947 : 362).
-
[12]
« [N]ous supposâmes encore […] l’extérieur tout de marbre » (id. 1947 : 222).
-
[13]
Le Traité des sensations ne s’aventure pas de ce côté-là, pas plus qu’il ne discute la notion même de « sensation ». Condillac n’interviendra dans la controverse que dans le Traité des animaux, notamment en réfutant l’idée de « sensation matérielle » défendue par Buffon. Il montrera alors que la modélisation mécanique du mouvement des animaux n’explique ni le principe de leurs actions ni celui de leur organisation, et qu’elle rend inintelligible la notion même de « sensation », dont l’analyse ne peut se réduire à la description d’une impression des sens.
-
[14]
Voir Condillac (1947 : 342) ; la sensitive est évoquée au cours d’une argumentation dans laquelle Condillac reproche à Buffon d’avoir confondu sentir et se mouvoir.
-
[15]
Sur cette improbable filiation sur le plan épistémologique, voir Bensaude-Vincent (2010). Il n’est cependant question ni d’odeurs ni de plantes dans cette étude.
Références
- BaertschiB., 1984, « La statue de Condillac, image du réel ou fiction logique ? », Revue philosophique de Louvain, 82, 55 : 335-364. Consulté sur Internet (https://www.persee.fr/doc/phlou_0035-3841_1984_num_82_55_6300), le 9 février 2020.
- Bensaude-Vincent B., 2010, « Lavoisier lecteur de Condillac », Dix-huitième siècle, 1, 42 : 473-489. Consulté sur Internet (https://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2010-1-page-473.htm), le 9 février 2020.
- Brunois F., 2007, Le jardin du casoar, la forêt des Kasua. Savoir-être et savoir-faire écologiques. Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme.
- Brunois F., 2018, « Savoir-être avec les plantes : un vide ontologique ? », Cahiers philosophiques, 2, 153 : 9-24.
- Condillac É. (Bonnot de), 1947, Oeuvres philosophiquesde Condillac (édition Georges Le Roy). Volume 1 : Essai sur l’origine des connaissances humaines, Traité des systèmes, Traité des sensations, Traité des animaux, Cours d’études pour l’instruction du Prince de Parme, Grammaire, De l’art d’écrire, De l’art de raisonner, De l’art de penser. Paris, Presses universitaires de France.
- Condillac É. (Bonnot de), 1948, Oeuvres philosophiques de Condillac (édition Georges Le Roy). Volume 2 : Cours d’études, Le commerce et le gouvernement, La logique, La langue des calculs, Correspondance. Paris, Presses universitaires de France.
- Condillac É. (Bonnot de), 1951, Oeuvres philosophiques de Condillac (édition Georges Le Roy). Volume 3 : Dictionnaire des synonymes. Paris, Presses universitaires de France.
- Condillac É. (Bonnot de), 2014, Essai sur l’origine des connaissances humaines (édition Martine Pécharman et Jean-Claude Pariente). Paris, Vrin.
- Descartes R., 1963, Oeuvres philosophiques (édition Ferdinand Alquié). Tome 1 : 1618-1637. Paris, Garnier.
- Descartes R., 1967, Oeuvres philosophiquesde Condillac (édition Ferdinand Alquié). Tome 2 : 1638-1642. Paris, Garnier.
- Descartes R., 2009, Principes de la philosophie. Première partie, sélection d’articles dans les parties 2, 3 et 4 et Lettre-préface. Paris, Vrin.
- DescolaP., 2005, Par-delà nature et culture. Paris, Gallimard.
- Diderot D., 1965, Entretien entre d’Alembert et Diderot, Le rêve de d’Alembert,Suite de l’entretien. Paris, Garnier-Flammarion.
- Galilée, 1980, L’essayeur de Galilée (édition Christiane Chauviré). Besançon, Annales littéraires de l’Université de Besançon et Paris, Les Belles Lettres.
- Haudricourt A.-G., 1962, « Domestication des animaux, culture des plantes et traitement d’autrui », L’Homme, 2 : 40-50.
- Hegel G. W. F., 1998, Phénoménologie de l’esprit. Paris, Aubier.
- Lévi-Strauss C., 1962, Le totémisme aujourd’hui. Paris, Presses universitaires de France.
- Locke J., 1998, Essai sur l’entendement humain. Livre 2. Paris, Vrin.
- Markovits F., 2018, La statue de Condillac. Les cinq sens en quête de moi. Paris, Hermann.
- Maupertuis, 1965-1974, « Système de la nature » : par. XIV, inOeuvres. Volume 2. Olms, Hildesheim.
- Romano C., 2019, Les repères éblouissants : renouveler la phénoménologie. Paris, Presses universitaires de France.
- Viveiros de Castro E., 1996, « Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio », Mana, 2 : 115-144.
- Viveiros de Castro E., 2014, « Perspectivisme et multinaturalisme en Amérique indigène », Journal des anthropologues, 138-139 : 161-181.