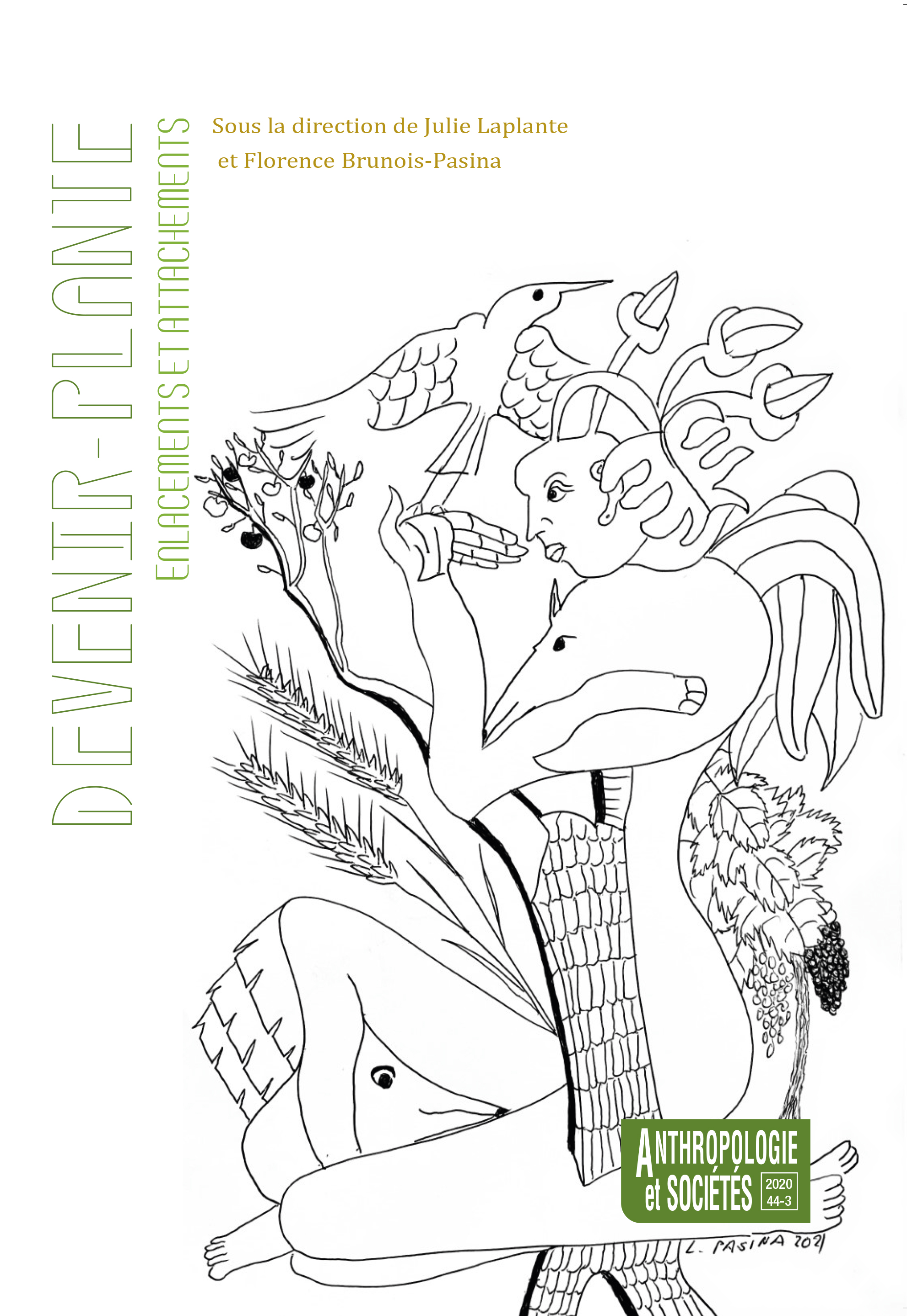Abstracts
Résumé
Le chamanisme shipibo (Amazonie péruvienne) exerce aujourd’hui un attrait tout particulier pour une clientèle nouvel âge occidentale en quête d’expériences hallucinogènes — ce qui, à première vue, serait à l’origine d’une certaine forme d’acculturation de l’institution « traditionnelle ». Or, l’analyse de la cure thérapeutique réservée aux touristes occidentaux, de même que les dispositifs de traduction et d’appropriation de composantes modernes telles que la médecine allopathique, semblerait plutôt mettre en relief une certaine forme de résilience, de la part des chamanes shipibo, par le biais de la mise en avant du règne végétal dans les thérapies. En effet, les plantes utilisées seraient capables d’« indigéniser » le corps du patient occidental dans un but curatif, mais aussi afin de faire subir au touriste une forme de socialisation par les plantes. Une telle action constituerait une réponse aux bouleversements que connaît aujourd’hui la société shipibo dans le contexte de la globalisation.
Mots clés:
- Slaghenauffi,
- Shipibo,
- Amazonie,
- chamanisme,
- rituel thérapeutique,
- tourisme chamanique,
- perspectivisme
Abstract
Shipibo shamanism (Peruvian Amazon) now has a particular appeal to a Western New Age clientele in search of hallucinogenic experiences, which, at first glance, would be the origin of some form of acculturation of the “traditional” institution. However, the analysis of the therapeutic cure reserved for Western tourists, as well as the mechanisms of translation and appropriation of modern components such as allopathic medicine, would seem to rather appear to emphasize a certain form of resilience, on the part of shipibo shamans, through the promotion of the vegetable kingdom within therapies. Indeed, the plants used would be able to “indigenize” the body of the Western patient for a curative purpose, but also to make the tourist undergo a form of socialization by plants. Such action would be a response to the upheavals that shipibo society is experiencing today in the context of globalization.
Keywords:
- Slaghenauffi,
- Shipibo,
- Amazon,
- shamanism,
- therapeutic ritual,
- shamanic tourism,
- perspectivism
Resumen
El chamanismo Shipibo (Amazonia peruana) ejerce hoy un atractivo muy particular entre una clientela occidental new age en busca de experiencias alucinógenas, lo que, a primera vista, sería el origen de una cierta forma de aculturación de la institución «tradicional». Ahora bien, el análisis de la cura terapéutica destinada a los turistas occidentales, así como los dispositivos de traducción y apropiación de componentes modernos como la medicina alopática, parecerían más bien poner de relieve una cierta forma de resiliencia, por parte de los chamanes shipibo, a través de la promoción del reino vegetal dentro de las terapias. En efecto, las plantas utilizadas serían capaces de «indigenizar» el cuerpo del paciente occidental con fines curativos, pero también para someter al turista a una forma de socialización por las plantas. Tal acción constituiría una respuesta a los cambios que experimenta hoy la sociedad shipibo en el contexto de la globalización.
Palabras clave:
- Slaghenauffi,
- Shipibo,
- Amazonia,
- chamanismo,
- rito terapéutico,
- turismo chamánico,
- perspectivismo
Article body
Dans le contexte d’un sous-continent à la fois composite et éclaté, entre grandes familles linguistiques et petits groupes isolés, la société shipibo[1], fruit de l’agrégation, au début du XXe siècle, de plusieurs groupes de langue pano, parmi lesquels les Shetebo, les Shipibo et les Konibo, forme actuellement le groupe ethnique pano le plus nombreux avec une population de 34 152 personnes selon le recensement national de 2017 (INEI 2018). Située dans une zone qui correspond au département d’Ucayali et à la partie méridionale du département de Loreto, elle bénéficie d’un habitat riverain privilégié le long des riches plaines alluviales de l’Ucayali et de ses affluents, l’écosystème le plus riche de la haute Amazonie. On constate une migration importante, ces trente dernières années, vers Pucallpa, la capitale du département d’Ucayali, et Lima.
Depuis une trentaine d’années, le chamanisme vernaculaire shipibo connaît une commercialisation grandissante avec l’arrivée en masse, dans certains villages, de touristes occidentaux nouvel âge (New Age) en quête d’expériences hallucinogènes[2]. Cette évolution sociologique est symptomatique du phénomène plus global, en Amazonie péruvienne, de commercialisation du chamanisme local végétaliste, désormais « internationalisé » (Labate 2011) et en proie à une certaine homogénéisation en raison de l’adoption de pratiques rituelles standardisées destinées à satisfaire les exigences des visiteurs (Losonczy et Mesturini Cappo 2010). Parce qu’il est considéré comme porteur d’une forte agentivité fondée sur sa réputation d’hallucinogène puissant, l’ayahuasca[3], en tant que substance médiatrice, devient ainsi le point d’ancrage de cette circulation multidirectionnelle entre perspectives autochtone et occidentale (ibid. 2011). C’est dans ce contexte que les chamanes shipibo (onanya, médico[4]) prétendent aujourd’hui être capables de soigner les « maux » des Occidentaux (Kirinko[5]) — VIH, cancer, dépression et dépendances en tout genre (drogue, pornographie, boulimie, etc.) —, ce qui leur vaut un vif succès auprès de touristes occidentaux et latino-américains déçus par la médecine allopathique et la psychothérapie classique.
Comptant environ 3 000 habitants[6] vivant dans une zone périurbaine située à proximité de la petite ville de Yarinacocha, le village péruvien de San Francisco — dans lequel j’ai mené mes enquêtes ethnographiques[7] — apparaît de toute évidence pionnier de cette évolution sociologique. Contrairement à l’ensemble des autres villages beaucoup plus isolés et encore liés à un mode de subsistance « traditionnel » fondé sur la pêche, la chasse et l’horticulture, l’économie de San Francisco est principalement orientée vers des activités commerciales et touristiques : bars et petits commerces alimentaires, « tourisme chamanique », vente d’artisanat[8]. Ajoutons la présence de nombreuses institutions exogènes : un centre de santé qui distribue des antibiotiques et des vaccins, une garderie accueillant des enfants de deux à trois ans, deux établissements scolaires (école publique primaire et secondaire, lycée agricole), trois églises protestantes, un cybercafé et une discothèque.
Ce rapide survol pourrait conduire à considérer le village comme un exemple de « sociétés en transition », suivant la conception de Roger Bastide (1955), où « tradition » et « modernité » se rencontrent et où l’exploitation par les Autochtones de leur propre patrimoine culturel relèverait du paradigme « néo-indigéniste » dont on peut voir des exemples du nord au sud du continent américain[9].
Derrière cette apparence d’acculturation, cependant, l’étude ethnographique permet de mettre en relief une certaine résistance de la logique vernaculaire sur laquelle repose la cure chamanique, principalement fondée sur le rôle majeur des plantes dans la constitution des personnes, dans le cadre d’un mode de pensée commun à de nombreuses sociétés amazoniennes (Descola 1986, 2005 ; Viveiros de Castro 2009) qui envisage les ontologies selon une conception animiste établissant un rapport de fluidité entre les règnes humain et non humain, et considère l’individu comme le résultat de ce qu’il incorpore par « contagion » (kopia[10]) des propriétés des substances absorbées.
Sous quelle forme cette logique vernaculaire se manifeste-t-elle dans le contexte actuel du néo-chamanisme, où l’apparente pacification des moeurs cache mal les tensions assez violentes qui résultent de la coexistence d’éléments modernes et traditionnels dans l’univers autochtone ? En nous appuyant sur nos matériaux, recueillis grâce à une longue et profonde expérience de la vie sociale et des pratiques chamaniques de San Francisco, nous montrerons de quelle façon l’« indigénisation » du corps du touriste occidental fonctionne comme une forme de résilience destinée à faire valoir la « supériorité » de la médecine autochtone sur la médecine occidentale, permettant au chamane de rehausser son statut au sein de la société nationale et globale et de renforcer le « prestige » qui lui est traditionnellement accordé.
Après une brève présentation de la conception ontologique shipibo, puis l’examen de la façon dont les médicos perçoivent le corps du patient occidental, nous verrons comment les techniques de la cure chamanique conduisent à un dispositif progressif de socialisation par les plantes du corps du patient occidental.
Une vision du monde animiste
À l’aune d’un « environnement socialisé » (Descola 1986), sorte de microcosme que les Shipibo qualifient de « monde » (nete), les humains (joni), les animaux sauvages (niimeayoina) et certains végétaux considérés comme étant dotés d’un pouvoir (rao[11]) sont conçus par ces Autochtones comme pourvus d’un « poids ontologique ». Si rien n’indique qu’humains et non-humains soient dotés des mêmes instances animiques et principes vitaux, tous possèdent néanmoins un « maître » (ibo), détenteur de l’espèce qu’il a engendrée (Leclerc 2003 : 42 ; Colpron 2004 : 261), considéré comme une métaespèce générique ou une figure excessive contenant toute l’ontologie (niwe[12]) de ses créatures. Ces « espèces » sont conçues par les Shipibo comme des « personnes » capables, au même titre que les humains, de s’organiser en communautés ou en sociétés, généralement au sein de la forêt. Elles sont dès lors dotées de connaissances précises qui ne sont accessibles qu’aux chamanes détenteurs du savoir ésotérique institué.
La forêt est quant à elle envisagée non pas comme un système écologique, mais comme un espace peuplé d’« êtres » potentiellement dangereux dotés de pouvoirs maléfiques capables de rendre malades les vivants. Ces entités, qualifiées de « yoxin », constituent les ennemies par excellence des Shipibo. S’il existe une gamme très variée de yoxin associés à la nature, les mawa yoxin (esprits des morts), décrits comme des fantômes errants et solitaires susceptibles de nuire aux vivants, sont les plus redoutés dans le village de San Francisco. Plus que radicalement mauvais, la majorité des yoxin seraient en réalité dotés d’un statut ambivalent, étant capables de tuer comme de soigner.
Chaque entité vivante humaine, végétale et animale serait ainsi détentrice d’une « part yoxin » (Leclerc 2003 : 49-52, 329-357 ; Colpron 2004 : 256, 263), soit d’une « part prédateur » ou d’une « part active ». Un tel système ontologique reposerait dès lors sur une taxinomie par degrés allant du yoxin quasi inoffensif au yoxin radical incarné par la figure du mawa yoxin, qui ne contient aucune part proie et apparaît comme un prédateur total. Les plantes rao ont également leur place dans cette classification. Leur part yoxin est qualifiée de « rao yoxin » et est évaluée en fonction de la taille du végétal, allant des plus dociles (petites plantes et arbustes) aux plus redoutables (grands arbres).
Conception shipibo du Kirinko
Nous avons vu que la personnalité s’acquiert à partir de l’ingestion de substances exogènes selon un principe de contagion. Dans un tel contexte, la maladie (isin) est conçue comme le résultat d’une agression extérieure, autrement dit d’une agression relevant de la sorcellerie produite par une entité humaine ou non humaine qui contamine ses victimes par son ontologie pathologique. La maladie est dès lors foncièrement associée à la mort et à un état individuel et social délétère auquel n’échappe pas le patient occidental. Pour comprendre ce point, il faut se pencher sur les modalités de la cure suivie par les touristes. La connaissance des « maux » dont souffrent les patients et de leur étiologie est directement liée à l’expérience visionnaire qui survient au cours des rituels. Lorsque le chamane ingère l’ayahuasca, il prétend être capable d’établir un diagnostic consistant en une sorte de « saisie par balayage visuel » lui permettant de « voir » à l’intérieur et à l’extérieur du corps du patient, et ainsi d’effectuer un bilan « médical » qui tient compte à la fois de son état de santé physique et du style de vie qu’il mène. Selon mes informateurs, d’une manière générale, le corps du malade occidental apparaît au cours des rituels comme chargé de « métaux » (yamibo) logés dans un complexe de « noeuds pathologiques » qualifiés par les médicos d’« intestins » (« xamanbo[13] »), qui apparaissent sous forme de « boules » venant obstruer les différents organes.
Prenons l’exemple d’une oeuvre picturale réalisée par le peintre et chamane Filder Agustín représentant le corps du patient occidental tel qu’il le visualise au cours des rituels (fig. 1). Selon ses explications, les particules situées dans le ventre du Kirinko sont les résidus des médicaments, des drogues et de la nourriture « industrielle » qu’il a ingérés en excès, et qui sont perçus par le médico comme des « métaux » porteurs du « poids ontologique » d’entités malveillantes qualifiées de « virus[14] » par les Shipibo. Le rond inscrit au milieu du front du personnage est emblématique d’un « esprit vide » (paxna xinan), c’est-à-dire consumé par les virus qui se sont installés dans son corps. Les pathologies occidentales seraient ainsi le résultat d’un style de vie pernicieux associé à la technologie et la pollution, conçues comme possédant un « maître » susceptible de « contaminer » les individus en introduisant des virus dans leur corps.
Fig. 1
Corps du patient occidental. OEuvre du chamane Filder Agustín (2017)
Les activités cognitives, telles que la lecture et l’usage de l’ordinateur, n’échappent pas à cette classification. En effet, bien qu’à certains égards elles soient, pour ces Autochtones, objets de fascination, elles renvoient également à l’habitus occidental et sont de ce fait perçues comme porteuses d’une « mauvaise pensée » (jakoma xinan), dans la mesure où elles s’opposent à la conception cognitive shipibo qui associe étroitement sensation et cognition, faisant simultanément appel à la pensée et aux sentiments[15].
Un tel constat ferait dès lors apparaître le « touriste chamanique » comme le sujet par excellence du déficit de vitalité, stigmatisé par les médicos de San Francisco qui, d’une manière générale, opposent au manque de vitalité et aux « mauvaises pensées » des Occidentaux leur soi-disant grande vitalité (jakon jati[16]) et leur « bonne pensée » (jakon xinan), lesquelles leur auraient été transmises par leur contact direct avec la nature et les plantes rao. Ces attributs feraient ainsi de ces Autochtones des personnes « saines », c’est-à-dire ayant un état de santé caractérisé par l’harmonie entre le corps, l’esprit et leur environnement social et naturel (Leclerc 2003 : 43). La grande vitalité des Shipibo contrasterait de ce fait avec la faiblesse des Kirinko, ce que viennent corroborer les observations de Bernd Brabec de Mori (2014 : 221) selon lesquelles le comportement non maîtrisé des touristes occidentaux, lorsqu’ils sont sous l’effet du breuvage ayahuasca, est considéré par les Shipibo comme un indice de faiblesse.
Dans un tel contexte, l’une des conditions essentielles à l’efficacité de la cure est de « transformer » le corps du Kirinko afin de le rendre plus réceptif au règne végétal, autrement dit lui faire subir une forme d’« indigénisation ».
La « diète » : un dispositif de socialisation par les plantes
Le processus de la « diète » (sama) prescrite au patient occidental par le thérapeute autochtone est très similaire à celui de l’apprentissage chamanique, lui-même qualifié à l’aide du même vocable en langue vernaculaire. Dans les deux cas, l’impétrant est tenu de se plier à toute une série de pratiques corporelles liées à des végétaux spécifiques — ingestion, inhalation,—, et accompagnées de restrictions alimentaires, sociales et sexuelles rigoureuses, dont l’objectif est l’incorporation des attributs ontologiques de ces plantes.
Selon une logique similaire à la « prédation subjectivante » analysée par Eduardo Viveiros de Castro (1993, 2009), ces différentes pratiques obéissent à une logique relationnelle impliquant l’ingestion d’entités exogènes envisagées comme des « sujets » porteurs d’agentivité avec lesquels l’individu, selon un principe de « contagion », tente d’établir une relation afin d’incorporer et de faire siens leurs attributs. Conformément à une représentation du corps comme contenant d’un vaste ensemble de manières, de modes d’être, d’affects et de capacités, un habitus, en somme (id. 2009), soigner un patient, qu’il soit local ou occidental, consiste dès lors à « peupler » son corps du « poids ontologique » des plantes rao et à en expulser les substances polluantes matérielles et immatérielles.
Le régime alimentaire est généralement fondé sur l’abstinence de sel[17], de sucre, de graisse, de boissons alcoolisées, mais aussi de certains fruits, légumes[18] et poissons à dents réputés « couper » la « diète » comme le piranha. Le patient peut également être amené, à une ou plusieurs reprises, à avaler des plantes émétiques sous la forme d’un breuvage dont il est tenu de boire plusieurs litres afin de « désintoxiquer » son estomac. Les différentes préparations ingérées au cours de la « diète » sont généralement « soufflées » (coxonti ; soplada, en espagnol local) par le spécialiste accomplissant le rituel, ce qui consiste en une rapide mélodie, à mi-chemin entre sifflement et soufflement, dont l’objectif est d’activer les attributs ontologiques des végétaux, à la manière d’une consécration. Le patient peut également être invité à consommer du tabac (rome), lequel, d’une manière générale, constitue un élément central de la thérapie chamanique en Amazonie (Gebhart-Sayer 1986 : 211 ; Arévalo Valera 1994 : 154 ; Chaumeil 2000 : 151). Enfin, son corps peut être soumis à une série de petits fouettements (panianti) par des plantes réputées absorber le « mal », soit l’ontologie des entités malveillantes qui l’affectent, qui s’achève par une fumigation réalisée avec du parfum (ininti) industriel[19].
Si le but de tous ces exercices consiste à « imprégner » (kopia) le corps du patient des plantes rao par le biais d’une relation symbiotique avec les végétaux (Colpron 2004 : 284-287), il s’agirait là d’une forme de désocialisation de l’habitus occidental et de son remplacement progressif par l’habitus autochtone, sans quoi l’efficacité thérapeutique ne pourrait être atteinte.
Une telle thérapie aurait pour effet la modification du comportement des touristes, jugé non conforme aux critères de moralité shipibo, c’est-à-dire le façonnement de leur personnalité par les plantes. Il s’agira par exemple de rendre insoutenable, pour son consommateur, tout usage de drogue et d’alcool, mais également « d’adoucir » un individu colérique ou jugé trop impulsif ou encore « d’ouvrir » une personne considérée trop solitaire, trop introvertie ou trop intellectuelle. Le façonnement de la personnalité des Kirinko en accord avec la morale shipibo viserait ainsi à redonner la vie à des Occidentaux perçus comme morts en raison de la présence de virus dans leur corps, en leur transmettant la vitalité des plantes rao.
Si la « diète » ne constitue qu’une première étape de ce cheminement, l’usage rituel d’ayahuasca vient consolider la configuration chamanique dans laquelle se trouve le touriste occidental.
Le rituel
Si, traditionnellement, seul le thérapeute ingère l’ayahuasca afin de pouvoir visualiser et soigner les maux dont souffre le patient, la commercialisation du chamanisme vernaculaire a entraîné de nombreux changements dans le déroulement de la cure. L’un d’entre eux est l’ingestion du breuvage par les patients kirinko, dont l’objectif est d’assouvir la quête de soi et de mysticisme popularisée par le mouvement nouvel âge.
Le rituel de consommation d’ayahuasca (nixi pae), qui accompagne, à raison d’une à trois fois par semaine, les pratiques précédemment décrites, fonctionne comme un catalyseur permettant de rendre opératoires les différents végétaux ingérés par le patient. Prenons comme exemple une peinture représentant la dépendance vue par le chamane, que nous analyserons en fonction des explications fournies par son auteur (fig. 2).
Fig. 2
La dépendance. OEuvre de Filder Agustín (2017)
Il est frappant d’observer une nette symétrie entre la partie située à gauche, qui représente le « monde » du médico et des « maîtres », et la partie située à droite, qui se réfère au « monde » du patient occidental. Le premier monde est chargé de l’ontologie des « maîtres » des plantes (rao ibo), qui se traduit par une vitalité métahumaine (brillance, couleurs vives, mouvements ou vibrations), une version analogue des esprits xapiri décrits par le chamane et leader yanomami Davi Kopenawa (Kopenawa et Albert 2010). Le second est, quant à lui, chargé de l’agentivité des virus et des entités malveillantes qui y sont associées, et caractérisé par des attributs opposés au premier : flou, absence de couleurs vives et mouvements circulaires en forme de spirale qui semblent « emprisonner » le malade. Dès lors, à l’aune d’une configuration antinomique entre rao ibo porteurs de vitalité et virus morts, il semble que la cure thérapeutique s’organise autour d’une sorte de combat entre les deux camps dont l’objectif final est la délivrance du malade et la « contagion de son « monde » par les attributs — soit la vitalité — des « maîtres ». Les mouvements multicolores constituent les « chemins » (kano) des « maîtres » que le médico, tel un chef d’orchestre, doit simultanément construire et diriger — par le biais des chants qu’il prononce, interprétés comme la « voix des maîtres » (joi ibobo) — vers le « monde obscur » (wino nete) du malade afin de « rompre la barrière » qui sépare les deux camps. Par cette action, le spécialiste accomplissant le rituel est en mesure de transmettre au patient la vitalité des « maîtres » afin de le « nettoyer » des virus toxiques présents dans son corps et ainsi activer son principe vital (kaya[20]).
La cure chamanique s’inscrit dès lors dans un processus synesthésique où les « voix des maîtres » deviennent le véhicule sonore des images appréhendées par le chamane de manière visuelle. Comme l’explique Agustín, lorsque l’effet de l’ayahuasca se fait sentir, il voit les « maîtres » « descendre du ciel » sur lui en même temps qu’il entend leur voix. Il se met alors à les imiter (mawati) en chantant avec eux. Au fur et à mesure que l’intensité des chants augmente, les visions s’activent et vice versa. L’élément olfactif, en tant que puissant véhicule d’agentivité (Albert 1988 ; Fausto 2016), constitue la troisième composante du procédé synesthésique, faisant des bonnes odeurs (plantes odorantes, parfums utilisés dans le rituel) les odeurs des « maîtres ».
Ce dispositif va de concert avec un mouvement de condensation des différents « maîtres » — qui semblent alors enchâssés dans les « chants-chemins » d’une même zone d’indiscernabilité et d’une même séquence d’action fondée sur l’actualisation d’un réseau de relations porteur d’intentions et d’émotions entre les participants humains et non humains —, par le biais du chanteur, qui devient un « énonciateur complexe » (Severi 2007), porte-parole d’entités du monde autre. En ce sens, l’efficacité thérapeutique reposerait sur une dynamique relationnelle spécifique débouchant sur un dispositif performatif total permettant au médico d’accéder à une vision holistique du malade, indispensable à sa guérison. Les « maîtres » agiraient ainsi comme une totalité ontologique venant pénétrer et imprégner le corps du patient au moyen de la coopération entre êtres humains et non humains. L’exercice s’achève par une imposition des mains sur le front et la fontanelle du malade — ce que les Shipibo qualifient d’« arkana » —, destinée à « fermer » son corps et y fixer la vitalité des « maîtres » tout en empêchant les virus d’y pénétrer.
Cette configuration rituelle, on l’aura compris, fonctionne comme un approfondissement du dispositif de socialisation par les plantes mis en place au cours de la « diète ». Les Shipibo envisagent la « contagion » du patient (local comme occidental) par les attributs ontologiques des « maîtres » végétaux comme ce qu’ils qualifient d’« habillement » (habiller : senenti). Sur la scène chamanique, « habiller » le patient[21] se traduit par le don de vêtements et de parures immatériels porteurs de l’agentivité des « maîtres » : paoti (banderole qui se porte sur la poitrine symbolisant un bouclier protecteur), maiti (couronne placée en haut de la tête représentant la matérialisation de l’intelligence), tari (robe traditionnelle masculine utilisée par les médicos durant les rituels). En effet, si ces graphismes étaient autrefois utilisés comme décoration et symbole de l’esthétisme shipibo par excellence (Gebhart-Sayer 1988), ils représentent également, pour les Shipibo, une protection (pana) considérable contre des entités malveillantes (yoxin) (fig. 3[22]), dans la mesure où leur forme même, caractérisée par la symétrie et la duplication, fonctionne comme un filtre qui, telle une toile d’araignée, permet de sélectionner les différentes influences extérieures et de préserver le corps du patient/disciple d’agressions potentielles (Lagrou, cité par Leclerc 2003 : 235, note de bas de page no 44). Ajoutons la fonction thérapeutique de ces parures, qui deviennent les garantes d’un parfait état de santé chargé des principes ontologiques des « maîtres » lorsqu’ils sont projetés sur le corps du patient par le médico[23].
Cette reconfiguration du corps du patient occidental, désormais paré des mêmes graphismes invisibles que le patient local, participerait dès lors à son « indigénisation ». En effet, si le kene constitue la marque et le véhicule de l’agentivité des « maîtres », plutôt que de masquer l’identité de son porteur, il participe au contraire à sa fabrication en accord avec l’habitus autochtone, en tant que « surfaces qui contiennent des corps » et ne se contentent pas de les représenter (Lagrou 2011 : 76).
Ceci renvoie à la notion d’« humanité » telle qu’elle est comprise par les Shipibo. Loin de constituer une espèce naturelle attachée à une forme stable, l’humanité se définit plutôt comme un procédé culturel étroitement corrélé au corps, lequel, on l’a vu, n’est pas conçu comme un simple réceptacle neutre, mais bien comme un habitus. Dès lors, l’humanité s’acquiert par le biais d’un façonnement physique (peinture corporelle, déformation crânienne, tatouage, perforation, parure, vêtements) (Descola 2005 ; Viveiros de Castro et Taylor 2006), dont l’objectif est de conformer l’individu au modèle de comportement en vigueur. Toute personne qui ne passerait pas par les procédés requis serait d’emblée appréhendée comme déviante, autrement dit comme souffrant d’un défaut d’humanité. Dans un tel contexte, si, autrefois, les Shipibo pratiquaient le rapt d’individus de peuples voisins qu’ils considéraient comme inférieurs, soit moins humains, et s’efforçaient, par ce biais, de les incorporer à leur société, ce qui impliquait de les rendre plus humains en accord avec les normes de comportement requises (Santos-Granero 2009), cette préoccupation pour « l’humanisation » de l’Autre semble perdurer aujourd’hui dans le contexte touristique. En effet, l’« habillement » du Kirinko constituerait le prolongement de la socialisation par les plantes, visant à faire des étrangers de « vraies » personnes à la fois humaines et vivantes, soit exemptes des attributs de mort des virus.
Fig. 3
Peinture faciale au genipa (Genipa americana) et couronne maiti ornées de motifs kene. Photo de l’auteure (2019)
Une « chirurgie cosmique »
Dans de nombreux cas, l’« indigénisation » du corps du Kirinko passe par ce que les Shipibo qualifient de « chirurgie cosmique ». Cela consiste en un dispositif de récupération et de traduction de la médecine allopathique par les médicos, lesquels, au cours des rituels, se transforment en chirurgiens hospitaliers et soignent leurs patients — locaux et occidentaux — grâce à une « technologie végétale » qui leur est transmise par les « maîtres » végétaux métahumains (fig. 4), une invention thérapeutique qui rappelle à certains égards le « chamanisme chirurgical » yagua (autre peuple d’Amazonie péruvienne) décrit par Jean-Pierre Chaumeil (2003 : 169-170). Examinons le récit du médico Mateo Arévalo :
Le chirurgien doit être précis dans les incisions qu’il réalise. Nous aussi, on doit être précis. Nous sommes comme les médecins membres honoraires du Collège médical du Pérou. Quand tu n’as pas le diplôme au nom de la nation, tu n’es pas autorisé à exercer. Un pédiatre ne peut pas réaliser une intervention chirurgicale parce que ce n’est pas sa spécialité. C’est pareil pour nous. Des infirmières et de jeunes docteurs arrivent et me disent : « Tu connais ça ? — Oui, je connais. » Si je ne connais pas la maladie, je ne peux pas la diagnostiquer. Ils m’ouvrent une pharmacie ou ils m’emmènent dans un hôpital et je deviens moi-même un médecin avec son uniforme, sa mallette et même l’appareil pour prendre le pouls. Je deviens un docteur. Ils me présentent un malade, me le font diagnostiquer. Je suis même en train d’écrire une ordonnance que je donne à ma secrétaire pour qu’elle aille acheter les médicaments.
L’ayahuasca, en tant que « commutateur de perspectives » (Déléage 2005 : 24), rend possible la transformation du chamane en docteur et la métamorphose de la scène rituelle en institution hospitalière ou en salle opératoire dotée de personnel médical d’apparence humaine, mais dont l’origine ontologique est végétale. Cette « puissance perspectiviste » du praticien agit comme un marqueur de puissance considérable. Mentionnons que pour les Shipibo la capacité transformationnelle est un attribut de pouvoir (koxi), d’intelligence (xinan) et de savoir (onan) conféré au chamane, ainsi qu’un gage d’efficacité thérapeutique. Le spécialiste accomplissant le rituel, possédant ce genre d’aptitude, est d’autant plus puissant qu’il est capable d’alterner entre la perspective autochtone et la perspective occidentale. S’il sait prendre l’identité du jaguar ou de l’anaconda, il est également capable de se transformer en figures convoitées de la société dominante. D’office, ce jeu de dédoublement constituerait une stratégie de pouvoir permettant d’intégrer les composantes du monde moderne dans une cosmologie locale structurellement propice à toutes sortes de bricolages par le biais de médiations chamaniques entre différentes perspectives.
Fig. 4
Chirurgie cosmique. OEuvre de Filder Agustín (2017)
Examinons maintenant le témoignage du médico Eduardo Muñoz :
Eduardo : La technologie d’aujourd’hui ne peut pas se connecter. Elle est très fragile. Les esprits ont leur technologie future qui n’existe pas encore. Quand tu prends la plante, tu peux voir une technologie à venir très sophistiquée. Plus tard, cette technologie arrivera sur Terre.
Doriane Slaghenauffi : Vient-elle des plantes ?
Eduardo : Oui, c’est avec la diète qu’on peut la voir. Ils descendent avec leurs uniformes blancs de docteurs. Mais ils ont une technologie qui vient du futur, pas de la ville. Il y a aussi des parachutistes qui descendent avec leur matériel. Ils ouvrent la porte : salle d’opération. Moi, je suis là aussi avec mon uniforme blanc pour voir comment ils font. Tu es présent parce que tu prends des plantes. Tu peux voir très clairement comment ils opèrent, ce qu’ils enlèvent. Quand tu passes par-là, il n’y a plus de douleur et tout est enlevé. Après, tu peux aller faire un test à l’hôpital et les médecins de l’hôpital voient qu’il n’y a plus rien : « Qu’est-ce qui s’est passé ? » Eux ne sont pas convaincus. C’est comme une radiographie, un scanner [tomodensitomètre], comme à l’hôpital. Tu peux confondre leur technologie avec celle de l’hôpital. Mais elle vient d’un autre monde, plus puissant. Ils te font une étude complète ; tu peux voir comment le sang circule dans ton cerveau, comment tout est tissé à l’intérieur.
Dans son ethnographie des compositions chamaniques élaborées par les chamanes shipibo incluant des éléments d’altérité tels que la technologie, les livres et la religion chrétienne, Anne-Marie Colpron (2012, 2013) constate que le chamanisme shipibo appréhende de manière indifférenciée les composantes locales et exogènes en fonction de la relation que le spécialiste accomplissant le rituel parvient à instaurer avec ces « sujets » de connaissance. L’auteure justifie entre autres son analyse en se référant à certains mythes pano qui confèrent à la technologie et au monde occidental une origine sylvestre et des ancêtres pano. Le récit précédent vient néanmoins relativiser ce constat en établissant une distinction entre la « technologie végétale » et la technologie humaine, un paradigme corroboré par l’ensemble des médicos de San Francisco. À l’aune d’une société qui envisage le monde végétal comme le modèle de connaissance par excellence, avant tout autre système d’apprentissage (Leclerc 2003), les actes chirurgicaux inspirés des « maîtres » végétaux sont, dès lors, pour les chamanes shipibo du village, supérieurs à la chirurgie allopathique dans la mesure où ils puisent leur force dans un dispositif hautement relationnel qui traduit la vitalité métahumaine des « maîtres » condensés dans les « chemins » thérapeutiques évoqués précédemment. Cette « chirurgie cosmique » s’oppose à la médecine occidentale jugée morte, voire pathogène, car hors de tout complexe relationnel.
L’« indigénisation » du corps du patient, conjuguée à un dispositif de récupération et de traduction de la médecine allopathique par les chamanes shipibo, constituerait de ce fait un mécanisme concurrentiel destiné à renverser la relation traditionnellement asymétrique entre « Blancs » et Autochtones, jusqu’à prendre le dessus sur le monde occidental. Ce constat est renforcé par la croyance commune, dans le village, que les « maux » dont souffrent les Occidentaux sont plus faciles à soigner que ceux des patients locaux, si bien que les pathologies occidentales constitueraient une version plus douce des prédations symboliques locales, avec des virus beaucoup moins redoutables que les entités malveillantes locales yoxin. L’on voit dès lors se dessiner une configuration antagonique entre, d’un côté, des yoxin associés à la forêt amazonienne et ses avatars, qui hantent depuis toujours l’univers endogène des Shipibo sans possibilité de transformation chamanique de leur ontologie, et, de l’autre, des virus moins puissants se rapportant aux éléments chimiques et technologiques du monde occidental, que le chamanisme peut traiter en les « indigénisant », les privant ainsi de leur pouvoir de nuisance.
L’évolution sociologique des pratiques chamaniques qui vient d’être exposée révèle toute la force de résilience que sont capables de déployer les chamanes shipibo. En effet, si le chamanisme shipibo connaît aujourd’hui une forme de néo-chamanisation souvent décrite comme acculturante, la logique vernaculaire sur laquelle il repose semble néanmoins persister de manière identique. Les différents constats montrent en effet que les compositions chamaniques évoquées précédemment sont les signes manifestes du mode cognitif perspectiviste des médicos qui leur permet d’alterner, au cours des rituels, entre la perspective autochtone et la perspective occidentale. En cela, ils correspondent, dans une large mesure, aux situations paradoxales analysées par Carlo Severi (2007), fondées sur l’articulation de traits ontologiques contradictoires et qui agissent comme un moyen de résister à la pression culturelle extérieure en réponse à une période de crise ou de conflit. Comme dans les nouvelles religions messianiques autochtones d’Amérique du Nord citées par Severi, les tensions entre deux cultures (shipibo et occidentale) sont ici interprétées par le recours au paradoxe au moyen de la condensation en soi de traits antagonistes qui donnent la primauté aux savoirs autochtones sur les savoirs occidentaux. Ces mécanismes fonctionnent dès lors comme des stratégies permettant de résoudre une situation de crise par la manipulation, par les médicos, du pouvoir des Kirinko ou par leur capacité à faire face à leur ennemi tout en l’incarnant.
Ainsi, l’aptitude chamanique à alterner entre la perspective autochtone et la perspective occidentale, c’est-à-dire à posséder deux points de vue concomitants, n’est autre qu’une stratégie permettant d’adopter la perspective des Kirinko tout en les maintenant à distance, en proclamant la supériorité de la médecine autochtone sur la médecine occidentale. Une telle configuration ferait des médicos des traducteurs de « mondes » capables de mettre du sens et de relier différentes perspectives qui peuvent sembler incommensurables à première vue (Carneiro da Cunha 2016).
Dans le contexte actuel de la déforestation, cette stratégie perspectiviste de même que l’« indigénisation » du corps du patient occidental, on l’aura compris, constituent des moyens d’accroître les trois attributs du pouvoir valorisés par la société shipibo : onan (connaissance), xinan (intelligence) et koxi (force). En effet, il semblerait que l’incorporation, par le chamanisme shipibo, de nouvelles formes de connaissance et de pouvoir liées à l’altérité des Occidentaux, qui fonctionnent en complément du pouvoir « traditionnel », constitue une forme de palliation à l’affaiblissement du règne végétal. Il s’agit bien alors de stratégies visant ce que Marshall Sahlins (2007 : 318) qualifie « d’indigénisation de la modernité » en tant que volonté de faire valoir sa différence et de disposer d’un espace propre au sein du système-monde.
Appendices
Notes
-
[1]
Les Shipibo sont aussi dénommés « Shipibo-Konibo » par l’État péruvien et les organisations autochtones. Or, ce double ethnonyme a aujourd’hui tendance à tomber en désuétude (Espinosa 2012 : 467, note de bas de page no 1). J’ai donc choisi de privilégier l’emploi de l’ethnonyme shipibo, d’autant plus que les individus rencontrés s’identifient eux-mêmes comme Shipibo, quel que soit leur village d’origine.
-
[2]
Une telle orientation n’est pas étrangère aux efforts de mobilisation politique dont ces Autochtones ont fait preuve depuis les années 1970, lesquels ont contribué à la consolidation d’une identité culturelle forte par le biais d’une conscientisation politique et d’une volonté accrue d’être maîtres de leur destin sur le plan local, national et transnational (Morin 1992).
-
[3]
Ayahuasca est le nom donné aux lianes du genre Banisteriopsis dont l’écorce sert à la composition d’une décoction hallucinogène obtenue grâce à la combinaison de la liane avec des feuilles de chacruna (Psychotria viridis).
-
[4]
Le chamanisme shipibo est caractéristique d’un « chamanisme à géométrie variable » (Chaumeil 2003), dont l’acquisition se fait par niveau de compétence. Le raomis (herboriste), rôle souvent attribué aux femmes, est doté de compétences inférieures à celles de l’onanya (qui vient d’onan : « connaissance, savoir » ; littéralement : « celui qui a la connaissance »), aussi qualifié en espagnol par les termes médico et yobe ou xitana (sorcier, traditionnellement extracteur de dards magiques [yotoa]), qui a lui-même des compétences inférieures à celles du meraya, sorte de métachamane doté du pouvoir de disparaître corporellement, aujourd’hui quasiment disparu en raison de l’incompatibilité de son ascèse chamanique avec la modernité, le monde urbain et la société nationale.
-
[5]
Kirinko ou Rinko désigne l’Occidental.
-
[6]
Il s’est avéré impossible de trouver un chiffre exact. Cette information m’a été fournie par différents habitants du village.
-
[7]
L’ethnographie a été réalisée entre 2016 et 2018 dans le cadre d’une thèse doctorale soutenue le 12 décembre 2019 (Aix-Marseille Université–Idemec) et effectuée sous la direction de Frédéric Saumade. Épouse d’un chamane shipibo et mère de ses trois filles, j’ai vécu quatre années à San Francisco où j’ai été initiée à la pratique chamanique. L’essentiel du travail théorique mené dans le cadre de ma thèse est revenu à associer cette connaissance de première main à une approche scientifique respectant autant que possible la distance vis-à-vis de l’objet d’étude. Les peintures (figures 1, 2 et 4) qui se trouvent dans ce texte ont été réalisées par mon mari, à ma demande.
-
[8]
Les objets en céramique autrefois utilitaires, ainsi que les graphismes traditionnels (kene) qui servaient jadis d’ornements, sont devenus aujourd’hui une forme d’artisanat commercialisé.
-
[9]
Jacques Galinier et Antoinette Molinié (2006 : 24) définissent le mouvement néo-indien comme une communauté d’acteurs aux contours flous liés les uns aux autres par certaines affinités électives d’inspiration nouvel âge sans adhésion à un dogme ou à un système de croyances restreint. Cette nébuleuse réunit autant les « peuples témoignages » (descendants directs des peuples frappés par la colonisation espagnole) que des populations métisses ou encore des « indianistes » européens empruntant certains traits du style de vie autochtone (ibid. : 22-23). Dans le cas présent, la néo-indianité se manifeste par un jeu d’instrumentalisation du chamanisme vernaculaire que les chamanes shipibo s’efforcent d’intégrer à la société globale au moyen d’une valorisation du passé ethnique de leur peuple et d’une professionnalisation de la pratique en fonction des exigences des visiteurs.
-
[10]
Kopia vient du quechua kopiti, qui signifie « donner, rendre, échanger ». Ce concept se retrouve un peu partout en Amazonie péruvienne sous le terme quechua plus répandu de cutipado.
-
[11]
Les rao désignent les plantes médicinales et hallucinogènes, mais aussi les végétaux capables d’influer sur le comportement des personnes ou de le modifier (dans ce cas précis, ils sont qualifiés de « waste » — piri piri en espagnol [cyperaceae]) : aphrodisiaques, contraceptifs, poisons, plantes réputées accélérer le processus d’apprentissage des enfants ou augmenter les aptitudes à la chasse, à la pêche, au football, pour l’artisanat, etc.
-
[12]
Littéralement, niwe veut dire « vent, air ».
-
[13]
Chaque organe peut en contenir : « intestins » du cerveau (mapo xamanbo), « intestins » du coeur (jointi xamanbo), « intestins » des os (xao xamanbo), « intestins » de l’estomac (poko xamanbo), etc.
-
[14]
Le terme virus, employé en espagnol, qualifie les entités maléfiques associées aux maladies des Occidentaux et se distingue de l’expression « jakoma yoxin » (mauvaise entité), qui désigne les entités liées aux maladies locales.
-
[15]
En ce sens, le verbe xinanti veut dire à la fois « penser » et « sentir ».
-
[16]
Jakon jati, littéralement « bien vivre », veut dire également « être en bonne santé ».
-
[17]
L’abstinence de sel dans les cures et apprentissages chamaniques est récurrente en Amazonie, chez les Métis comme chez les Autochtones, et serait liée à l’association du minéral avec le monde civilisé, en opposition à la forêt. Cette substance serait envisagée comme un isolant empêchant celui qui réalise la « diète » d’établir le rapport symbiotique recherché avec la nature.
-
[18]
Les restrictions en matière de fruits et de légumes sont très variables d’un spécialiste à un autre.
-
[19]
Le chamane shipibo utilise généralement plusieurs variétés d’eau de Cologne (Agua de Florida, Aguade Kananga, Agua de Rosa, Agua de Huaringa, etc.) qu’il se procure dans les marchés de la ville. Il s’agit en réalité d’un emprunt au chamanisme métis local et au curanderismo norteño, pour lesquels le parfum est un gage de chance et de protection et est utilisé dans des remèdes destinés à obtenir le succès amoureux, la fortune économique et le pouvoir politique.
-
[20]
Kaya se traduit généralement par « âme », mais l’idée de « principe vital » semble plus proche de sa définition.
-
[21]
L’apprenti (samatai) passe par le même processus d’« habillement » lorsqu’il acquiert le statut de médico et ses parures deviennent ses instruments de pouvoir, qu’il utilise au cours des rituels.
-
[22]
À ce propos, Frédérique Rama Leclerc (2003 : 232) a montré que la robe cérémonielle du chamane (tari), qui est toujours ornée de dessins géométriques, incarne une protection contre les mauvais esprits. Anne-Marie Colpron (2004 : 148) a soulevé l’importance des peintures corporelles chez les Shipibo, qui protégeaient et « fermaient » le corps du nourrisson, considéré faible et susceptible de subir des agressions extérieures. Els Lagrou (2011) a fait le même constat chez les Kaxinawá (autre groupe pano). Dans le même ordre d’idées, Angelika Gebhart-Sayer (1988) a montré que, traditionnellement, lors de la grande fête de l’Ani Xeati (littéralement « la grande beuverie »), les participants se peignaient le corps de motifs géométriques qui les protégeaient des autres participants humains et des instances invisibles.
-
[23]
D’autres auteurs ont évoqué l’élaboration, par le médico, d’un graphisme kene invisible sur le corps des malades shipibo (Gebhart-Sayer 1986 ; Illius 1992 ; Leclerc 2003 : 231 ; Colpron 2004 : 302).
Références
- Albert B., 1988, « La fumée du métal : histoire et représentations du contact chez les Yanomami (Brésil) », L’Homme, 106 : 87-119.
- ArévaloValera G., 1985, « El ayahuasca y el curandero Shipibo-Conibo del Ucayalí », América Indígena, 46, 1 : 147-161.
- Bastide R., 1955, « Le principe de coupure et le comportement afro-brésilien » : 493-503, in H. Baldus (dir.), Anais do XXXI Congreso internacional de Americanistas (São Paulo, 23 a 28 agôsto de 1954). Volume 1. São Paulo, Editoria Anhembi.
- BrabecdeMori B., 2014, « From the Native’s Point of View. How Shipibo-Konibo Experience and Interpret Ayahuasca Drinking with “Gringos” » : 206-230, in B. Caiuby Labate et C. Cavnar (dir.), Ayahuasca Shamanism in the Amazon and Beyond. New York, Oxford University Press.
- CarneirodaCunha M., 2016, « Le chamanisme amazonien, écho même du travail de traduction » : 233-248, in P. Erikson (dir.), Trophées. Études ethnologistes, indigénistes et amazonistes offertes à Patrick Menget. Volume 2. Nanterre, Publications de la Société d’ethnologie.
- Chaumeil J.-P., 2000, « Chasse aux idoles et philosophie du contact » : 151-164, in D. Aigle, B. Brac de la Perrière et J.-P. Chaumeil (dir.), La politique des esprits. Chamanismes et religions universalistes. Nanterre, Publications de la Société d’ethnologie.
- Chaumeil J.-P., 2003, « Chamanismes à géométrie variable en Amazonie » : 159-175, in R. N. Hamayon (dir.), Revue Diogène. Chamanismes. Paris, Presses universitaires de France.
- Colpron A.-M., 2004, Dichotomies sexuelles dans l’étude du chamanisme : le contre-exemple des femmes chamanes shipibo-conibo. Thèse de doctorat, Département d’anthropologie, Université de Montréal.
- Colpron A.-M., 2012, « Fluctuations et persistances chamaniques parmi les Shipibo-Conibo de l’Amazonie occidentale » : 387-416, in M.-P. Bousquet et R. Crépeau (dir.), Dynamiques religieuses des Autochtones des Amériques. Paris, Karthala.
- Colpron A.-M., 2013, « Contact Crisis: Shamanic Explorations of Virtual and Possible Worlds », Anthropologica, 55, 2 : 373-383.
- Déléage P., 2005, Le chamanisme sharanahua. Enquête sur l’apprentissage et l’épistémologie d’un rituel. Thèse de doctorat, Anthropologie sociale et ethnologie, École des hautes études en sciences sociales.
- Descola P., 1986, La nature domestique. Symbolisme et praxis dans l’écologie des Achuar. Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme.
- Descola P., 2005, Par-delà nature et culture. Paris, Gallimard.
- Espinosa O., 2012, « To Be Shipibo Nowadays: The Shipibo-Konibo Youth Organizations as a Strategy for Dealing With Cultural Change in the Peruvian Amazon Region », Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, 17, 3 : 451-471.
- Fausto C., 2016, « L’odeur des Blancs. Les avatars de la culture chez les Kuikuro du haut Xingu » : 170-186, in P. Erikson (dir.), Trophées. Études ethnologistes, indigénistes et amazonistes offertes à Patrick Menget. Volume 2. Nanterre, Publications de la Société d’ethnologie.
- Galinier J. et A. Molinié, 2006, Les néo-Indiens. Une religion du IIIe millénaire. Paris, Odile Jacob.
- Gebhart-Sayer A., 1986, « Una terapia estética: los diseños visionarios de la ayahuasca entre los Shipibo-Conibo », América Indígena, 46, 1 : 189-218.
- Gebhart-Sayer A., 1988, « Some Reasons Why the Shipibo-Conibo (Eastern Peru) Retain Their Art » : 293-307, in Identidad y transformación de las Américas. Memorias 45° Congreso internacional de Americanistas. Bogotá, Universidad de los Andes.
- Illius B., 1992, « The Concept of Nihue Among the Shipibo-Conibo of Eastern Peru » : 63-77, in J.-M. Langdon et G. Baer (dir.), Portals of Power: Shamanism in South America. Albuquerque, University of New Mexico Press.
- Instituto nacional de estadística e informática (INEI), 2018, III Censo de comunidades nativas 2017. Lima, INEI.
- Kopenawa D. et B. Albert, 2010, La chute du ciel : paroles d’un chaman yanomami. Paris, Plon.
- Labate B., 2011, Ayahuasca Mamancuna merci beaucoup: internacionalização e diversificação do vegetalismo ayahuasqueiro peruano. Thèse de doctorat, Anthropologie sociale, Universidade Estadual de Campinas.
- Lagrou E., 2011, « Le graphisme sur les corps amérindiens. Des chimères abstraites ? », Gradhiva, 13 : 6893.
- Leclerc F. R., 2003, Des modes de socialisation par les plantes chez les Shipibo-Conibo d’Amazonie péruvienne. Une étude des relations entre humains et non-humains dans la construction sociale. Thèse de doctorat, Ethnologie, anthropologie sociale et culturelle, Université Paris Nanterre.
- Losonczy A.-M. et S. MesturiniCappo, 2010, « Entre l’“Occidental” et l’“Indien”. Ethnographie des routes du chamanisme ayahuasquero entre Europe et Amériques », Autrepart, 56, 4 : 93-110.
- Losonczy A.-M. et S. MesturiniCappo, 2011, « Pourquoi l’ayahuasca ? De l’internationalisation d’une pratique rituelle amérindienne », Archives de sciences sociales des religions, 153 : 207-228.
- Morin F., 1992, « Les premiers congrès shipibo-conibo dans le contexte politique et religieux des années 60-70 », Journal de la Société des Américanistes, 78, 2 : 59-77.
- Sahlins M., 2007, La découverte du vrai sauvage et autres essais. Paris, Gallimard.
- Santos-Granero F., 2009, Vital Enemies: Slavery, Predation, and the Amerindian Political Economy. Austin, University of Texas Press.
- Severi C., 2007, Le principe de la chimère : une anthropologie de la mémoire. Paris, Rue d’Ulm et Musée du quai Branly.
- ViveirosdeCastro E., 1993, « Le marbre et le myrte. De l’inconstance de l’âme sauvage » : 365-431, in A. Becquelin et A. Molinié (dir.), Mémoire de la tradition. Nanterre, Publications de la Société d’ethnologie.
- ViveirosdeCastro E., 2009, Métaphysiques cannibales. Lignes d’anthropologie structurale. Paris, Presses universitaires de France.
- ViveirosdeCastro E. et A.-C. Taylor, 2006, « Un corps fait de regards » : 149-215, in S. Breton et M. Coquet (dir.), Qu’est-ce qu’un corps ? Afrique de l’Ouest, Europe occidentale, Nouvelle-Guinée, Amazonie [catalogue de l’exposition présentée au Musée du quai Branly du 23 juin 2006 au 25 novembre 2007]. Paris, Musée du quai Branly et Flammarion.
List of figures
Fig. 1
Corps du patient occidental. OEuvre du chamane Filder Agustín (2017)
Fig. 2
La dépendance. OEuvre de Filder Agustín (2017)
Fig. 3
Peinture faciale au genipa (Genipa americana) et couronne maiti ornées de motifs kene. Photo de l’auteure (2019)
Fig. 4
Chirurgie cosmique. OEuvre de Filder Agustín (2017)