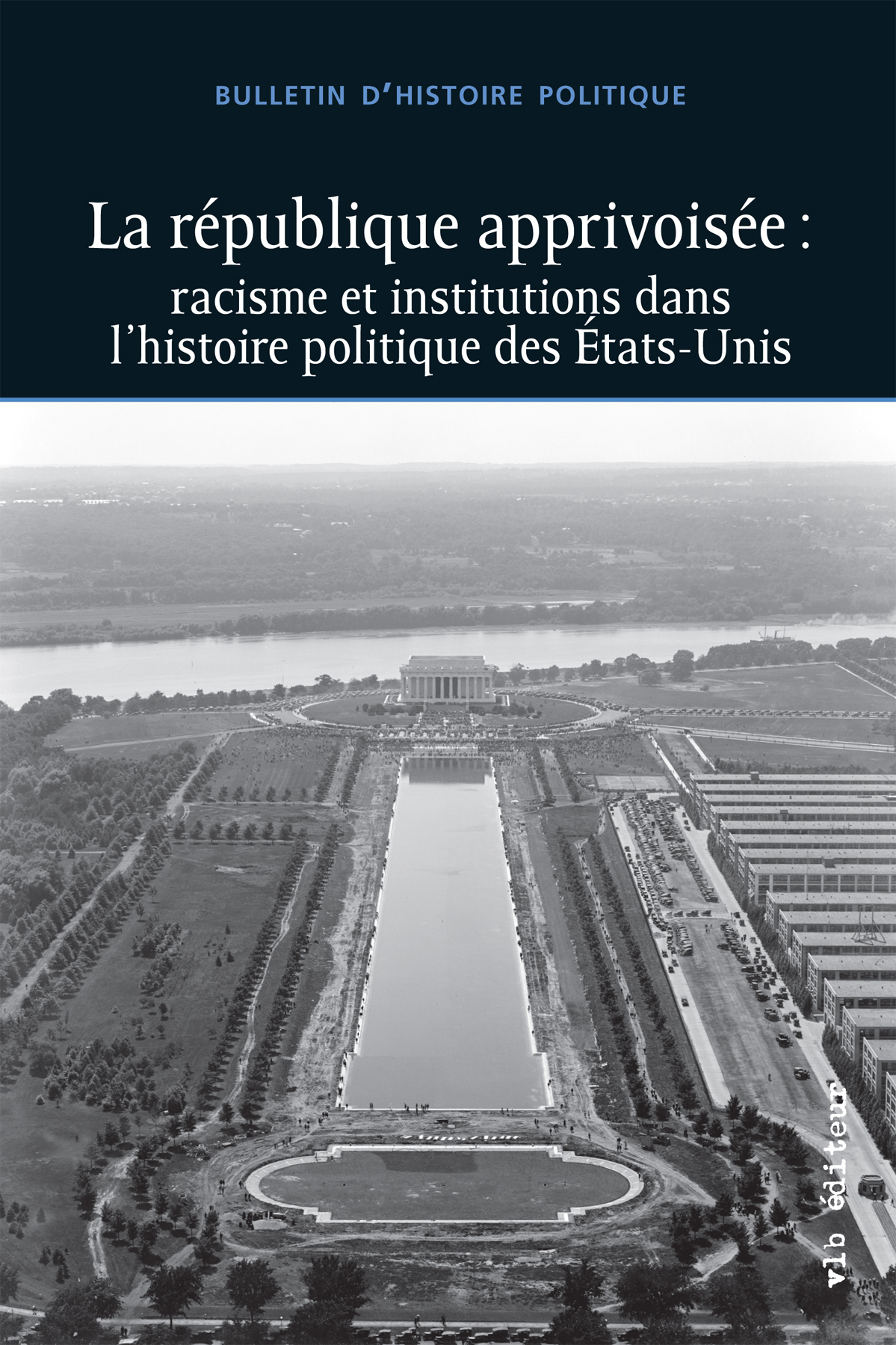Article body
Voilà un titre qui n’est pas sans rappeler les travaux dirigés jadis par Fernand Dumont, Jean Hamelin et Jean-Paul Montminy sur les idéologies au Canada français, travaux qui ont formé toute une (sinon deux) génération d’historiens et historiennes au Québec. Avec le présent ouvrage, bien qu’il ne s’en réclame pas ouvertement, Hugues Théorêt reprend pour l’essentiel le même credo en investissant journaux et revues afin de cartographier un pan du paysage intellectuel québécois du XXe siècle.
Pour se faire, l’historien a constitué un corpus de 690 textes tirés parmi vingt publications de l’époque qui, selon lui, reflètent « l’ensemble du spectre idéologique du Canada français de l’entre-deux-guerres » (p. 13). De ce corpus, Théorêt désire analyser « la circulation des discours entourant les droites radicales européennes » (p. 12), celles incarnées par les dictatures de Mussolini, d’Hitler, de Franco et de Salazar. Grosso modo, il s’agit d’examiner comment les journalistes d’ici ont réagi à l’avènement des régimes autoritaires en Europe et quelles ont été les modalités de réception des journaux canadiens-français devant ces projets de société.
À cette proposition, l’auteur pose deux conditions. La première est de considérer le climat idéel du Québec d’alors, caractérisé par la position hégémonique de l’Église catholique sur la scène discursive et les mentalités. Une position fondée sur la valorisation de thèses traditionalistes et qui, compte tenu de sa prééminence, est susceptible de favoriser une certaine ouverture à l’égard de modèles faisant la promotion de la religion catholique (Mussolini, Franco et Salazar). C’est l’hypothèse que formule le chercheur. La deuxième condition est d’employer le terme « droites radicales » plutôt que « fascisme » pour désigner ces régimes conservateurs, étant donné qu’il n’existe pas de consensus historiographique sur l’emploi du terme « fascisme ». Une nuance dont on saisit mal l’importance, d’autant plus que la définition donnée par l’auteur à l’expression « droites radicales » apparaît évasive : « une terminologie englobante [qui] permet d’inclure l’ensemble des dictateurs et écrivains dont la pensée et le programme se situent à des degrés divers sur le spectre idéologique de l’extrême droite » (p. 13). On se demande alors concrètement de quoi il est question lorsqu’on parle d’extrême droite : s’agit-il d’un mouvement unitaire fondé sur un socle de valeurs et de pratiques particulières comme le titre de l’ouvrage le suggère au mode singulier, ou bien d’avatars historiques différenciés tel qu’évoqué en introduction ? Le chercheur lui-même jongle avec les deux conceptions du début à la fin.
Divisé en six chapitres, l’ouvrage épouse une trame chronologique et narrative répondant en tout point à de l’histoire-bataille. Une histoire axée sur la dimension diplomatique, privilégiant une logique événementielle alimentée par de « grands personnages » (politiciens, papauté, SDN) et de « grandes dates » (publication d’encycliques, Marche sur Rome/1922, accords de Latran/1929, Guerre civile espagnole/1936-1939, accords de Munich/1938, Pacte germano-soviétique/1939, Seconde Guerre mondiale/1939-45, etc.). Au gré des conjonctures, on s’emploie ainsi à repérer les adhésions et les rejets véhiculés dans la presse sur certaines doctrines (corporatisme, nazisme, nationalisme), décisions politiques (occupation de l’Éthiopie par l’Italie, cooptation du Vatican par les régimes nazi et fasciste) ou préjugés (antisémitisme, anathème du communisme) endossés par ces régimes d’extrême droite. Convoquant de nombreux extraits de périodiques divers, allant des publications marginales de la jeunesse (Vivre, La Relève) au magazine féminin (La Revue Moderne), en passant par les quotidiens généralistes grand public (La Presse, La Patrie, Le Soleil) et des périodiques destinés à l’élite socioculturelle (Le Devoir, L’Ordre, L’Action nationale) ; l’auteur nous montre qu’effectivement, ces modèles politiques ont été amplement débattus au Canada français, tout comme le modèle bolchevique, quoique de manière indirecte. C’est-à-dire qu’on évoque moins la représentation de Staline et de la réalité soviétique (les grands procès de Moscou par exemple), que celle projetée par les dénigreurs du communisme à l’étranger (un régime athée ayant combattu Franco aux côtés des Républicains). À cette période, si Fernande Roy avait souligné le consensus de rejet qui prévalait au Québec à l’endroit de « l’étatisme »[1], force est ici de constater que la même unanimité semble de mise à l’encontre du communisme. L’historien expose très bien comment la dénonciation du « péril rouge » en vint à devenir un lieu commun au Canada français. Si l’idée d’une stigmatisation n’est pas neuve – voir l’étude pionnière d’Andrée Lévesque (1984) sur la gauche au Québec – en revanche, Théorêt apporte ici un nouvel éclairage en établissant une parenté d’opinions sur cette instrumentalisation du « péril rouge » au sein des discours de l’extrême droite européenne et des salles de nouvelles de la province. Par-delà cet enjeu, l’un des apports importants de cet ouvrage est d’attirer notre attention sur l’importance, bien que difficilement quantifiable, que revêt la question des relations internationales dans le dispositif médiatique québécois de l’entre-deux-guerres, malgré le fait, ironiquement, que cette question demeure secondaire pour le chercheur. Celui-ci axe ses conclusions sur l’idée que le Canada français a rejeté les propositions des droites radicales européennes et que si flirt il y a eu, avec Franco et Mussolini par exemple – abstraction faite des sympathies nazies d’Adrien Arcand – cela est imputable à des affinités confessionnelles.
Cela dit, globalement, la démonstration manque de profondeur et demeure rivée à un ordre de généralités qui laisseront historiens et historiennes quelque peu sur leur faim. Nul doute que les restrictions inhérentes à l’édition et la transposition d’une thèse de doctorat en ouvrage « grand public » ont dû peser dans la balance. Il faut dire que la densité chronologique de la période étudiée n’aide pas la cause du chercheur. En effet, une bonne partie de l’ouvrage est consacrée uniquement à décrire les événements ponctuant l’Europe de l’entre-deux-guerres. Par conséquent, le versant Canada français se réduit bien souvent à des considérations minimales sur le contexte intellectuel du moment, où l’auteur n’apporte pas grand-chose de neuf, si ce n’est tout de même de précieux éléments biographiques sur des journalistes méconnus.
En fait, le défaut de ce livre est d’appréhender le média d’information exclusivement comme un médium d’endoctrinement ou bien un journal partisan se confondant volontairement avec l’organe de propagande – termes que l’auteur emploie à l’occasion de manière interchangeable. Or cette approche induit l’idée que les propriétés d’intelligibilité d’un journal ou du média se réduisent à très peu de choses, à savoir des positionnements idéologiques ; ce qui correspond à une interprétation étriquée et franchement anachronique du journal au XXe siècle. De sorte qu’en faisant l’impasse sur l’historiographie de la presse alors qu’il nous annonçait que « la presse est au coeur de l’analyse » (p. 13), de même qu’en éludant totalement les dimensions multiformes qui conditionnent la pratique du journalisme et l’industrie de la presse, l’auteur donne l’impression de se commettre en erreur d’appréciations. Le fait qu’un journal traite d’un sujet d’actualité, parfois abondamment, ne veut pas dire ou n’implique pas forcément qu’il prenne position sur le sujet ; il peut très bien s’en tenir à recenser ou commenter les nouvelles et informer la population sans biais politique. Et l’inverse est tout aussi vrai : feuilles d’opinions, d’idées ou partisanes continuent de circuler à cette période. Malheureusement, l’auteur ne cherche pas à départager ce qui relève de la « couverture médiatique » répondant des codes journalistiques les plus élémentaires, de l’énonciation d’un « parti pris » formel et explicite. Un exemple ? Le fait que Le Soleil titre en une le 4 juin 1938 : « Le massacre des populations civiles soulève l’indignation », doit-il vraiment s’interpréter stricto sensu comme une dénonciation du régime franquiste et une prise de position du journal, au sens plein du terme, comme le défend l’auteur (p. 184) ? Serait-ce un raisonnement tordu d’avancer que ce choix de titre et non le contenu de l’article, répond plutôt (ou aussi) de logiques communicationnelles intrinsèques au média de masse en lui-même ou bien alors, de la dimension morale de l’incident recensé ?
Plus surprenant encore est d’analyser ce qui se lit dans les journaux de la période sur l’étranger sans considérer l’existence des dépêches internationales alors que celles-ci sont généralement la première source d’information de l’extérieur pour les éditeurs, ou évoquer, même de manière marginale, le rôle des agences de presse. Une réalité qui pourtant, dès les années 1920, comme l’a démontré Gene Allen, conduit à une marchandisation transnationale de l’information comportant des implications déterminantes dans la rédaction, la circulation et la publication des contenus[2]. Cette omission est difficile à comprendre en regard de la problématique d’ensemble.
Bref, étudier les journaux du XXe siècle selon une grille d’analyse qui postule la prééminence d’une vocation idéologique de la presse et néglige les conditions qui contextualisent les tenants et aboutissants de cette industrie rencontre ici certaines limites, et présente des pièges méthodologiques auxquels Hugues Théorêt n’a pas échappé[3]. Des limites qui n’annulent en rien la légitimité de pareille démarche et les apports de ce livre. Cependant, du fait que ces limites et ces pièges se rencontrent ponctuellement dans certains travaux portés en histoire culturelle québécoise, d’hier à aujourd’hui, le temps semble venu pour que le milieu historien soit sensibilisé davantage sur cet enjeu. Enfin, rectifions quelques erreurs factuelles : le journal L’Ordre cesse d’être publié en 1935, non pas en 1936 (p. 88, note 94), ni même en 1937 (p. 209) et cela dit, il n’est pas un hebdomadaire (p. 143), mais bien un quotidien.
Appendices
Notes
-
[1]
Fernande Roy, Histoire des idéologies au Québec aux XIXe et XXe siècles, Montréal, Boréal, 1993, p. 89.
-
[2]
Gene Allen, Making National News : A History of Canadian Press, Toronto, University of Toronto Press, 2013, 443 p.
-
[3]
J’ai moi-même été amené à constater et exposer les limites de cette approche dans mon mémoire de maîtrise, déposé à l’UQAM en janvier 2019, consacré au dernier journal édité par Olivar Asselin. Il devrait être disponible prochainement sur le portail Archipel (http://archipel.uqam.ca) sous le titre suivant : L’hebdomadaire La Renaissance (juin-décembre 1935 ) , la dernière aventure d’Olivar Asselin dans la presse montréalaise.