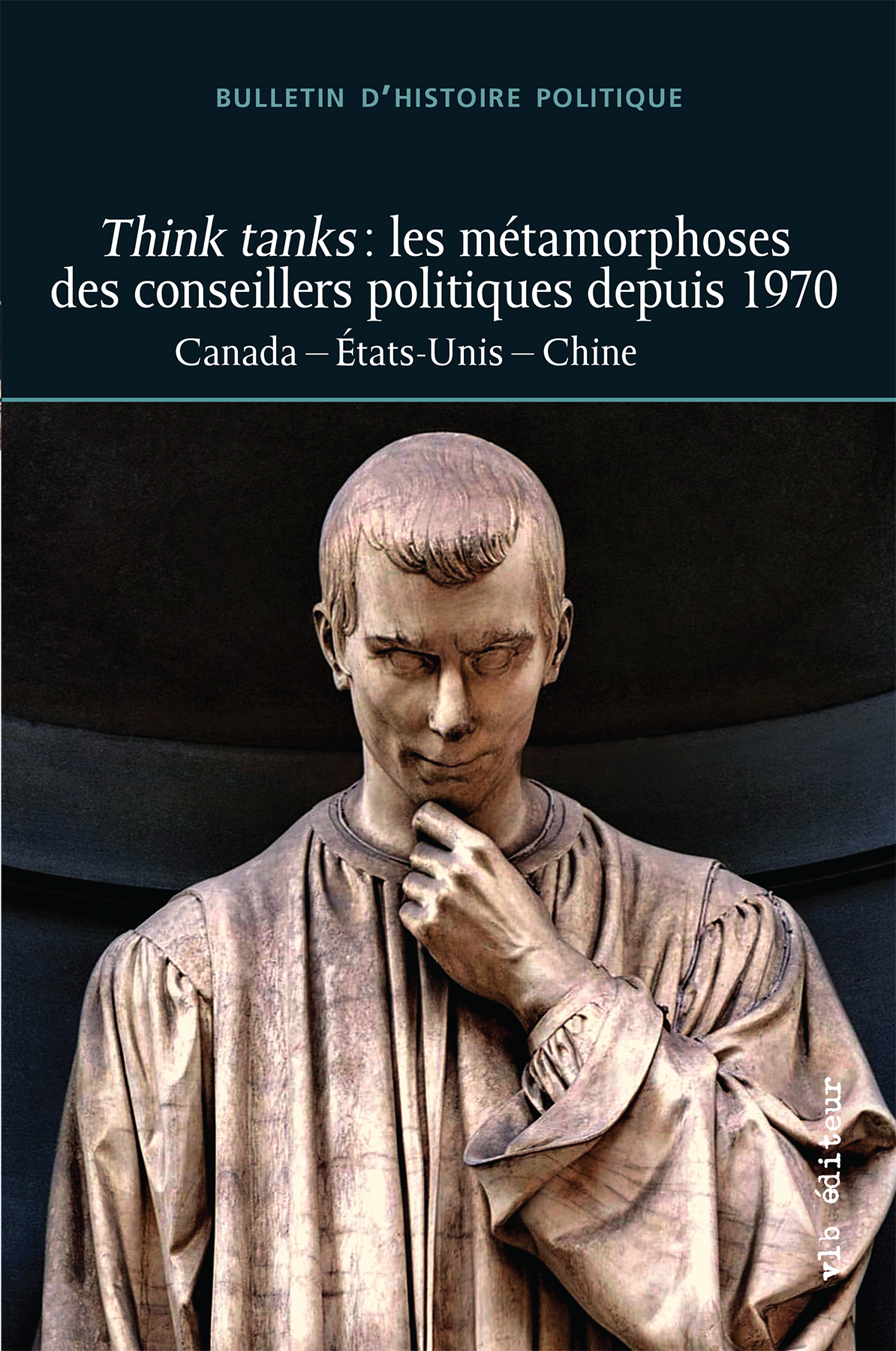Abstracts
Résumé
Le paysage des laboratoires d’idées canadiens n’a connu son véritable essor qu’au cours du dernier tiers du XXe siècle, mais il comporte aujourd’hui une diversité importante d’organisations oeuvrant à produire et diffuser des connaissances, des analyses et des commentaires relatifs aux politiques publiques fédérales, provinciales et internationales. En avançant une conception des think tanks comme étant insérés dans des communautés distinctes, cet article propose une analyse de la création des laboratoires d’idées canadiens en fonction des principaux sites de leur intégration, soit : les universités, la fonction publique, les partis politiques, les débats idéologiques et divers réseaux de politiques publiques spécialisés.
Mots-clés :
- think tanks,
- laboratoires d’idées,
- Canada,
- politiques publiques,
- experts,
- institutions
Article body
La littérature universitaire des trente dernières années ne cesse de confirmer que les think tanks sont situés à l’intersection de divers champs – qu’il s’agisse de l’État, des entreprises, des sciences sociales, des mouvements politiques, etc. En conséquence de cela, une question mérite d’être posée : faire l’histoire des think tanks, c’est faire l’histoire de quoi ? Aux États-Unis, divers chercheurs ont abordé l’histoire de ces organisations à travers l’angle de la transformation des formes organisationnelles[1], de l’évolution de la demande politique pour les idées[2] ou de la concurrence politique et intellectuelle[3]. D’autres ont suggéré que l’émergence et l’évolution des laboratoires d’idées canadiens et américains soient intimement liées à l’ascension et la consolidation de l’autorité des sciences sociales et à la généralisation de celles-ci dans les espaces publics et les luttes politiques de la deuxième moitié du XXe siècle[4].
Or, se poser cette question, c’est aussi s’interroger sur la nature de ces organisations. Cherchant une forme organisationnelle définie à l’image de l’expérience américaine, les politologues qui se sont penchés sur l’histoire des think tanks canadiens ne purent qu’observer, avec raison, leur absence relative dans le contexte canadien jusqu’à la période de l’après-guerre[5] ou encore jusqu’au début des années 1970[6], même si au début du XXe siècle, le Canada commençait à disposer d’autres arrangements institutionnels pour assurer des fonctions similaires[7]. À ce titre, il est probablement futile ou du moins nécessairement normatif de vouloir fonder l’histoire des laboratoires d’idées sur l’émergence de vrais bons think tanks comme si ceux-ci constituaient un type naturel[8]. De même, il est peut-être illusoire de chercher parmi ces organisations des répertoires d’expertise immuable qui n’auraient d’autres prétentions que d’agir comme courtiers de connaissances ou comme éminences grises au nom de quelques principes universels également incarnés par l’État. Constatant l’inadéquation entre les laboratoires d’idées canadiens et l’image archétypique du think tank, Evert Lindquist alla jusqu’à conclure que ces organisations sont en fait des « clubs » principalement caractérisés par leur « capacité d’analyse limitée » et leur propension à jouer un rôle particulier pour des « auditoires spécifiques[9] ».
Pour autant que les experts et les intellectuels universitaires et autres produisent des connaissances sur les politiques publiques, ils le font à partir de points de vue particuliers que ce ne soit qu’en fonction du regard d’une discipline ou des préoccupations d’un État libéral[10]. De même, depuis les années 1970, plusieurs laboratoires d’idées ont adopté des postures plus militantes au nom des perspectives idéologiques qu’ils partagent avec leurs alliés et leurs financiers[11]. Plus largement, les think tanks entretiennent des horizons discursifs spécifiques et occupent des niches particulières au sein desquelles ils doivent oeuvrer à maintenir leur réputation et leur marque de commerce[12]. Selon le sociologue Thomas Medvetz, cela implique un jeu d’équilibre dynamique par lequel les administrateurs de think tanks doivent signaler l’indépendance et la crédibilité scientifique de leur organisation, tout en affichant, à des moments opportuns, leur influence, leurs convictions et leur utilité dans l’optique d’attirer la faveur de mécènes ou de clients aptes à les financer ou les embaucher, ou encore l’attention d’instances médiatiques portées à diffuser leurs idées[13].
Dit autrement, chaque think tank s’entoure d’une communauté spécifique constituée à partir des relations et des ressources vis-à-vis desquelles il doit constamment renouveler ses accès. Ainsi, peu importe la définition que l’on adopte, il est envisageable que l’histoire des laboratoires d’idées (ou du moins leur histoire sociale) doive comprendre l’histoire des individus, des groupes et des institutions qui réunissent les pratiques et les conditions nécessaires à la constitution d’organes consacrés à la mobilisation de connaissances pour informer les objectifs et les modalités de l’action publique.
S’il puise dans des développements plus anciens, cet article fait surtout l’histoire des laboratoires d’idées au Canada depuis 1985 en insistant sur leur entrelacement avec les conditions particulières de ce qu’il convient d’appeler leurs sites d’intégration. Cette date butoir marque à peu près l’époque à partir de laquelle le paysage actuel des think tanks canadiens quitte la phase de sa fondation pour entrer dans celle de son expansion.
Ce texte développe d’abord une conceptualisation des think tanks comme intégrants des communautés spécifiques. Il explore ensuite la création de nouveaux think tanks canadiens depuis 1985 en fonction des espaces sociaux qui les soutiennent : soit les universités, la fonction publique, le secteur privé, les partis politiques, la guerre des idéologies et divers réseaux de politiques publiques spécialisés. Ce portrait me permet d’avancer quelques observations concernant la constellation actuelle des think tanks canadiens et les rôles qu’y jouent l’État, les institutions postsecondaires, les intérêts économiques, les mouvements politiques et les partis.
Qu’est-ce qu’un site d’intégration ?
Dans son livre Think tanks in America, Thomas Medvetz théorise les fondements sociaux de l’histoire des laboratoires d’idées aux États-Unis et modélise leur organisation sociale en rappelant la théorie des champs sociaux de Pierre Bourdieu. Pour Medvetz la rencontre des think tanks technocratiques des deux premiers tiers du XXe siècle et des think tanks militants du dernier tiers de ce siècle constitue un espace propre à la concurrence qu’ils se livrent – c’est-à-dire un champ compris comme un lieu de lutte pour contrôler une forme de pouvoir (voire de capital) spécifique à ce système de relation. Dans le cas du champ des think tanks, il s’agit d’un « champ interstitiel » à l’interface des champs économique, politique, bureaucratique, universitaire et médiatique. L’enjeu pour ces organisations est de capter les ressources de ces champs (crédibilité scientifique, visibilité médiatique, accès politiques et bureaucratiques et contributions financières), mais aussi de garantir leur reconnaissance à titre de think tanks légitimes et prestigieux. À travers ces rapports, les think tanks dominants – qui disposent davantage de capitaux matériels et symboliques – exercent une influence disproportionnée sur les critères qui définissent ces organisations et les normes pratiques qui régulent leurs activités[14].
Dans le contexte canadien, on retrouve un peloton de laboratoires d’idées généralistes imposant des contours aux paysages des think tanks de ce pays à partir des années 1970. Certaines de ces organisations sont plus anciennes et encourent des transformations ou des gains en matière de statut qui facilitent leur intégration à un secteur qui leur est propre où circulent des idées et des membres de personnel. Celles-ci incluent le Conference Board du Canada (1954), la Fondation canadienne de Fiscalité (1945), le Canadian Council on Social Development (1920) et l’Institut C. D. Howe (1958), mais elles côtoient aussi des organes gouvernementaux comme le Conseil économique du Canada (1963-1993) et le Conseil des sciences du Canada (1966-1993). En même temps, l’Institut de recherche en politiques publiques (1972), c’est-à-dire l’IRPP, témoigne des efforts du gouvernement pour moderniser ce secteur en créant un institut indépendant[15]. Ces organisations sont rapidement rejointes par des think tanks plus militants qui investissent la guerre des idées dans un contexte de flux politique et idéologique important. Ces derniers comprennent l’Institut Fraser (1974), la Canada West Foundation (1973), l’Institut canadien de politique économique (1979-1984) et le Centre canadien de politiques alternatives (1980). Cette époque est aussi marquée par la multiplication d’organismes à but non lucratif, parfois financés par l’État, qui investissent des réseaux d’analyse de politiques publiques particuliers dans l’optique d’aborder des enjeux spécifiques : la condition des femmes, le développement international, la paix, la sécurité, les politiques sociales, l’environnement, etc. Ces organismes ne s’arriment pas toujours à l’image archétypique que l’on se fait des think tanks, mais plusieurs se mêlent de manière fluide dans leur monde.
Dans la mesure où ils agissent en des lieux où les frontières entre les grandes institutions modernes (par ex. la science, les médias, le politique, les marchés et l’État) sont négociées, les think tanks et leurs cousins organisationnels ont comme particularité d’investir « les espaces entre les champs[16] » où ils participent à l’échange et la circulation de ressources matérielles et symboliques entre ceux-ci. C’est par la rencontre de telles ressources venant de champs environnants (accès, idées, crédibilités, fonds, mains d’oeuvre, etc.) que les think tanks arrivent à se constituer et à jouer un rôle. De même, ce sont des agents particuliers de ces champs qui leur fournissent ces ressources et qui constituent, par extension, les sites de leur intégration au corps politique et au processus d’élaboration des politiques publiques. C’est dire que les organes qui participent à l’analyse des politiques publiques s’organisent de manières différentes selon la niche qu’ils occupent ou, plus précisément, en fonction des rapports sociaux leur permettant de survivre, d’avoir un auditoire et de jouer un rôle. En d’autres mots, les laboratoires d’idées existent en entretenant une communauté structurée par des rapports concrets avec des groupes occupant des positions particulières dans les principales institutions des sociétés modernes : l’État, l’économie de marché, les universités, les médias, les partis politiques, etc. C’est ainsi que l’on peut comprendre la création de nouveaux think tanks canadiens depuis le dernier tiers du XXe siècle à travers leur intégration à des sites particuliers constitués en interface avec ces institutions.
Les sites d’intégration des think tanks canadiens
La communauté politique canadienne du dernier tiers du XXe siècle a dû composer avec la croissance exponentielle des sciences sociales dans les universités et le déploiement particulièrement prononcé de ces sciences dans les débats publics et les forums d’élaboration des politiques publiques. Or, malgré l’émergence de think tanks militants à partir des années 1970, cette généralisation du discours expert ne se limite pas à son inscription dans la guerre des idéologies. Elle comprend, plus largement, toute une gamme de domaines de préoccupations spécialisés laissant entrevoir une économie symbolique des problèmes légitimes susceptibles de motiver l’organisation d’une capacité d’analyse parfois avec le soutien matériel ou moral de l’État. De même, cette généralisation n’est pas seulement alimentée par la création de think tanks, mais aussi par les activités d’associations professionnelles, d’instituts universitaires, de firmes de consultation et d’ailes de recherche d’ONG et de groupes d’intérêts. À partir de cette époque, la multiplication des think tanks canadiens participe à la constitution d’un contexte d’élaboration des politiques publiques plus ouvert et distendu, mais aussi plus compétitif et fragmenté[17]. En d’autres mots, cette multiplication porte les traces de l’organisation de sous-systèmes de production discursifs distribués rattachés à des sites d’intégration qui leur fournissent leurs conditions d’existence. Ces sites incluent les marges de l’État, les universités, les jonctions entre le champ politique et le champ économique, les partis politiques et divers réseaux d’action publique spécialisés.
L’État comme site d’intégration
L’État canadien a joué un rôle croissant dans l’émergence d’instances pour l’analyse des politiques publiques depuis les années 1920. Il consolide ensuite ce rôle dans la période de l’après-guerre de concert avec l’édification des instances d’ajustement keynésien et des programmes de l’État-providence. Dans les années 1960, le gouvernement de Lester B. Pearson (1963-1968) entame le remaniement des agences centrales de l’État et fonde des quasi-think tanks gouvernementaux comme le Conseil économique du Canada (1963-1993) et le Conseil des sciences du Canada (1966-1993).
Au tournant des années 1960 et 1970, Pierre Elliott Trudeau et une nouvelle génération d’experts bureaucrates prolongent ce mouvement en instaurant des dispositifs d’évaluation de programme et de planification horizontale au sein du Conseil du Trésor, des comités du Cabinet et du Bureau du Conseil privé. Au cours de cette période, l’analyse formelle des politiques publiques se répand dans les ministères et organismes fédéraux, dont de nouvelles instances créées pour asseoir l’expansion des rôles technocratiques de l’État[18]. De nouveaux conseils gouvernementaux vont émerger dans ce contexte, dont le Conseil national du bien-être social (1969-2012), la Commission de réforme du droit du Canada (1971-1993, 1997-2006) et le Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme (1973-1995). Le gouvernement fédéral va aussi créer un think tank indépendant – soit l’Institut de recherche en politiques publiques (1972) – et étendre sa générosité à des organismes de recherche non gouvernementaux qui investissent des causes particulières. L’Institut canadien de recherches sur les femmes (1975), le Canadian Energy Research Institute (1975), le North-South Institute (1976-2014), et plusieurs centres universitaires liés à la recherche en défense et en sécurité sont créés, en partie ou en entier, grâce à des fonds publics.
La dernière moitié des années 1970s marque une période de restrictions budgétaires et un déclin dans la confiance des élites canadiennes par rapport à la planification technocratique centralisée, mais l’État va tout de même continuer à investir dans la capacité d’analyse de la communauté politique canadienne, par exemple, en fondant l’Institut canadien pour la paix et la sécurité internationale (1984-1992) et la Fondation Asie-Pacifique (1984).
La chose se complique, cependant, après 1985 alors que le champ politique canadien converge de plus en plus vers les idées néolibérales articulées dans le rapport de la Commission Macdonald (1982-1985). Alors que la volonté de contrôler les dépenses du gouvernement se marie à l’ascension de discours appelant à la décroissance de l’État, l’élite politique, bureaucratique et économique canadienne semble prête à rompre avec les ambitions de planification centralisée incarnées par des initiatives comme l’Exercice de priorisation du Bureau du Conseil privé (1974-1975) et le Programme énergétique national (1980-1985).
Le Forum des politiques publiques (1987) incarne cette volonté de rompre avec la planification centralisée en militant pour l’ouverture et la flexibilité des structures bureaucratiques et en oeuvrant à titre de facilitateur de discussions en matière d’action publique entre acteurs publics et privés. On observe aussi cette tendance dans la création par le gouvernement fédéral du Forum canadien de recherche sur la situation d’emploi (1991) et dans la multiplication de forums citoyens plus large. En parallèle, le prolongement du thème de la réforme de la gouvernance, qui apparaît dans les commissions royales et dans les enquêtes des think tanks généralistes canadiens des années 1990[19], donne sens à la création de nouveaux think tanks consacrés aux enjeux de la participation et de la représentation politique comme l’Institute on Governance (1990) et l’Institut Pearson-Shoyama pour des politiques inclusives (1993-c.2004). Au Québec, l’Institut du Nouveau Monde (2004) fait le pont entre le modèle de la gouvernance par la consultation et le thème de la démocratisation en organisant des forums citoyens composés d’acteurs publics et privés.
Depuis les années 1970, le champ discursif de l’analyse des politiques publiques prend des allures plus ouvertes et fragmentées et le gouvernement est de plus en plus porté à prioriser la consultation sectorielle dans l’élaboration des politiques publiques. À partir des années 1990, il va aussi démanteler ses propres structures de planification. Ostensiblement pour des raisons de compressions budgétaires, le budget progressiste-conservateur de 1992 signe la mort de plusieurs conseils et instituts gouvernementaux[20]. L’État s’engage aussi dans une externalisation plus large de sa capacité analytique alors que ses besoins en la matière augmentent en même temps qu’elles sont interprétées à travers des valeurs du New Public Management[21]. Dans les années 1980 et 1990, cette tendance nourrit l’expansion des firmes de consultation dont les rôles ont pris de l’importance depuis la Commission Glassco (1960) et depuis la création de leurs associations professionnelles dans les années 1960 et 1970[22]. La capacité d’analyse interne du gouvernement fédéral est également dégradée par les mesures d’austérité des libéraux entre 1993 et 1997. Or, l’État va continuer à mandater la création d’organes de recherche comme le Centre Pearson pour le maintien de la paix (1994-2013) et le Centre canadien pour le développement de la politique étrangère (1996-2001). Il va aussi agir comme site d’intégration pour les laboratoires d’idées qui se frayent une niche à l’interface du gouvernement – notamment pour faciliter le tournant consultatif de celui-ci.
En dépit de pouvoir agir comme conseillers privilégiés, un petit groupe de think tanks canadiens va servir l’État en vaquant à l’organisation de conférences publiques sur la question des réformes constitutionnelles en amont de l’accord de Charlottetown de 1992[23] et en anticipation du budget fédéral de 1994[24]. De même, suivant la fermeture du Conseil économique du Canada en 1992, sa directrice, Judith Maxwell, semble suivre le cours de l’époque lorsqu’elle fonde le Canadian Policy Research Networks (1994-2009) pour entretenir des réseaux d’échanges regroupant des acteurs publics et privés. Ken Battle va aussi investir les marges de l’État lorsqu’il quitte la direction du Conseil national du bien-être social pour fonder le Caledon Institute of Social Policy (1992-2017), un think tank qui va profiter du réseau de Battle pour atteindre la fonction publique[25].
À la fin des années 1990, le gouvernement fédéral envisage d’investir une part des surplus encourus par ses compressions dans la reconstruction de sa capacité d’analyse, mais les architectes de ces réformes n’envisagent pas de reproduire les structures vertigineuses des technocrates précédents[26]. Ils érigent plutôt des réseaux d’échange et de consultation qui partent d’organes comme le Projet de recherche sur les politiques (1997) pour s’étendre vers une capacité d’analyse distribuée comportant des universitaires, des think tanks et des consultants[27]. Le Projet de recherche sur les politiques est restructuré en 2011 pour devenir Horizons de politiques Canada, mais l’engagement de l’État avec la consultation et la coproduction de connaissances va se poursuivre[28]. Le niveau municipal forme aussi un lieu pour entretenir des partenariats de recherche en matière de politiques publiques avec l’État, comme en témoignent les activités du Canadian Urban Institute (1990). Les marges du gouvernement forment ainsi un site d’intégration important pour les think tanks canadiens, mais elles offrent aussi un faux sentiment de sécurité. Cela est particulièrement apparent vu les ravages que provoquent les mesures d’austérité des années 1990 et la fermeture d’autres organes de politiques publiques dans le sillage des compressions entreprises par le gouvernement conservateur de Stephen Harper entre 2006 et 2015.
Les universités comme site d’intégration
La constitution des universités comme site d’intégration pour des laboratoires d’idées ou pour des organismes connexes repose en première instance sur leur rôle dans l’organisation des sciences sociales. La consolidation du pouvoir symbolique du discours expert en sciences sociales dans la période de l’après-guerre fut en partie alimentée par l’expansion de leurs assises dans les universités. Les bases universitaires de ces sciences ont d’abord pris de l’importance avec la croissance de l’éducation postsecondaire au Canada dans les années 1920, mais leurs assises universitaires demeurent relativement marginales jusqu’en 1945. Après la Deuxième Guerre mondiale, une espèce de G.I. Bill canadien – soit un programme de bourse pour les anciens combattants – contribue à une infusion soudaine d’inscrits dans divers programmes universitaires[29]. Entre-temps, le rôle des universités dans l’effort de guerre nourrit l’effervescence de la confiance populaire dans la puissance des sciences et des technologies. À partir des années 1950, la croissance des inscriptions à l’éducation postsecondaire et l’anticipation de retombées économiques et stratégiques motivent le gouvernement à jouer un rôle plus important dans le financement et l’expansion des universités[30].
Avant les années 1950, les sciences sociales canadiennes et leurs centres de recherche universitaires dépendent considérablement de la philanthropie des grandes fondations américaines[31]. Or, le rythme de création de nouveaux centres augmente de manière extraordinaire avec l’expansion du rôle des provinces et de l’État canadien dans le financement de la recherche. Selon Mike Almeida, 90 % des centres universitaires en sciences sociales créés entre 1945 et 1980 émergent après 1960 alors que l’État intensifie son soutien envers la recherche pour devenir le principal bailleur de fonds pour ces sciences[32].
À partir de la fin des années 1950 et au cours des années 1960, le financement de l’éducation postsecondaire est avancé comme moteur pour la croissance économique, la mobilité sociale et l’égalité des chances, mais cette fonction est mise en doute dans les années 1970[33]. Dans le contexte des incertitudes économiques de cette décennie, le coût de plus en plus important du secteur universitaire impose une révision de sa rentabilité et de la capacité de l’économie à absorber les torrents de nouveaux diplômés[34]. Dans les années 1980, l’éducation universitaire est de plus en plus envisagée comme un investissement individuel dont les coûts doivent être portés par l’étudiant. La recherche, pour sa part, est intimée à se faire utile, alors les universités sont invitées à réorienter leurs priorités vers des activités « profitables » ou « pertinentes » pouvant alimenter les rapports entre les institutions du savoir et l’industrie[35].
Le déclin ou la stagnation du financement des universités qui débute dans les années 1970[36] n’empêchent guère l’expansion des bases institutionnelles des sciences sociales[37] ni celle de l’enrôlement d’étudiants dans ces disciplines, laquelle continue son élan jusqu’à la fin des années 1980[38]. Ce contexte est aussi propice à la création de nouveaux centres de recherche dont le caractère appliqué peut répondre aux soucis de pertinence sociale et de rentabilité de « l’université entrepreneuriale ». Plus de 300 centres de recherche universitaires sont formés entre 1980 et le début des années 2000, et ce, très souvent dans des domaines appliqués[39]. Au cours de cette période, l’État réduit la part de sa cotisation dans le financement des universités alors que celles venant des frais de scolarité et de sources privées augmentent[40]. On exige que les universités fassent plus avec moins et qu’elles jouent un rôle plus immédiat dans les activités productives de la nation, notamment à titre de moteurs de « l’économie du savoir ». Pour les sciences sociales, cela se traduit par un mandat général de « faire utile » au profit symbolique des pôles plus appliqués ou engagés de ces disciplines, quoique la recherche libre a pu maintenir sa prééminence[41].
Les sciences sociales ont toujours entretenu des préoccupations pratiques et plusieurs de leurs spécialistes ont développé des ambitions de maîtrise techniques du monde social au cours du XXe siècle[42]. Pareillement, les universités ont toujours maintenu des relations diverses avec les forces temporelles de leurs sociétés[43] et les centres de recherches universitaires furent souvent orientés en fonction de préoccupations politiques, notamment dans le contexte de la guerre froide[44]. Or, les impératifs de l’université entrepreneuriale et la multiplication renouvelée des centres de recherche appliqués qu’elle engendre occasionnent des transformations qui semblent signaler une certaine convergence du monde universitaire et de l’univers des think tanks, particulièrement en encourageant la prolifération d’organisations universitaires portées à produire des analyses en matière de politiques publiques.
Certes, les centres de recherche universitaires doivent composer avec des budgets modestes et diviser leur énergie entre leurs activités de recherche et de diffusion et leurs fonctions éducatives[45], mais plusieurs adoptent des postures qui les rapprochent de la figure du laboratoire d’idées. Le Western Centre for Economic Research (1985-2013) de l’Université de l’Alberta, par exemple, fut décrit comme un think tank universitaire[46] en raison de ses interventions publiques et de sa production de livres, chapitres et rapports subventionnés portant sur des enjeux de politiques publiques. Plusieurs de ces centres, comme le Canadian Research Institute for Law and the Family (1987), le Centre for Trade Policy and Law (1989) et le Centre d’études en gouvernance (1997), réunissent non seulement des chercheurs, mais aussi des praticiens et produisent des études spécialisées axées sur des questions d’intérêts publics ou de politiques gouvernementales. Pareillement, les domaines de la défense, de la sécurité, des relations internationales et des affaires internationales forment un réseau d’organisations universitaires bien intégré par des praticiens.
Or, si certains organes priorisent surtout les conversations universitaires, d’autres comme le Mowat Centre (2010-2019) à l’Université de Toronto adoptent explicitement l’identité du think tank. Celui-ci était intégré à la Munk School of Global Affairs and Public Policy et opérait principalement pour informer les politiques publiques ontariennes et intergouvernementales jusqu’à ce que ses vivres soient éliminés par le gouvernement ontarien en 2019. De même, l’Institut pour l’intelliProspérité (2007) – ou Smart Prosperity Institute en anglais – opère à partir de l’Université d’Ottawa. D’abord nommé Sustainable Prosperity, il se décrit comme un think tank mobilisant une communauté d’acteurs publics et privés pour avancer des solutions économiques et environnementales priorisant des instruments basés sur la logique du marché.
Dans certains cas, la communauté qui entoure ces centres de recherche les rapproche à des intérêts politiques ou économiques particuliers et les dispose à adopter des postures idéologiques ou cognitives spécifiques. Le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (1993), par exemple, est soutenu par une collection de « partenaires » universitaires, gouvernementaux et privés correspondant à une position politique à l’écoute des préoccupations du patronat québécois en matière de compétitivité et de performance économique[47]. L’Institut du Québec (2014) né d’une collaboration entre HEC Montréal et le Conference Board of Canada occupe une position structurelle similaire. Le Centre sur la productivité et la prospérité (2009), à HEC Montréal, pour sa part, est formellement associé à une fondation privée et plus ouvertement militant dans ses positions néolibérales. Ces centres contrastent vivement avec le Parkland Institute (1996) de l’Université de l’Alberta, par exemple, qui intègre une communauté d’intellectuels activistes de gauche plus près des milieux syndicaux.
Dans une certaine mesure, le rapprochement entre le monde des think tanks et celui des centres et instituts universitaires découle de propriétés plus anciennes propres aux sciences sociales. Ces propriétés incluent la valorisation de l’utilité sociale des découvertes et les réseaux que tissent les spécialistes avec une communauté plus large d’acteurs sociaux[48]. Au cours du XXe siècle, ces conditions ont facilité la création de divers centres de recherche, mais la transformation des normes du monde universitaire depuis les années 1980 favorise une convergence d’autant plus prononcée avec le monde des laboratoires d’idées en encourageant la diffusion plus large des connaissances universitaires et en orientant les programmes de recherche vers la prestation de services. Dans les années 2000, cette tendance devient particulièrement manifeste avec l’émergence d’écoles de politiques publiques qui organisent des forums et produisent des rapports en plus de vaquer à leurs fonctions de recherche et de formation. Celles-ci incluent la Munk School of Global Affairs (2000) de l’Université de Toronto, la Johnson-Shoyama Graduate School of Public Policy (2007) en Saskatchewan et la School of Public Policy (2008) de l’Université de Calgary. On remarque aussi cette tendance dans la Rotman School of Management de l’Université de Toronto qui crée ou consolide plusieurs instituts de recherche dans les années 2000.
Si la tendance se maintient, on peut croire que les universités vont continuer à constituer un terrain de croissance organisationnelle propice pour des organisations qui se rapprochent de la figure du laboratoire d’idées. Plusieurs de ces organisations demeurent mariées à la logique du champ universitaire, mais la réorganisation des normes de ce champ offre une marge de manoeuvre pour la réorientation de ses ressources vers l’entretien de mobiles portés aux interventions publiques et à l’analyse des politiques publiques.
Les réseaux de politiques publiques et les think tanks spécialisés
L’État et les universités constituent des sites d’intégration bien institutionnalisés, mais les réseaux de recherche spécialisés qui s’y installent ou qui font le pont entre les deux vont aussi abriter des organismes plus indépendants. Les organisations qui intègrent ces réseaux ne s’arriment pas toujours aussi bien que les laboratoires d’idées généralistes à la figure du think tank. Certaines adoptent simplement l’identité plus large de l’ONG, mais ils participent au même mouvement historique en se consacrant principalement à la production et la circulation d’informations et d’analyses sur les enjeux sociaux et politiques qui les concernent. D’autres sont mieux intégrés au champ des think tanks et s’engagent expressément dans les cercles de discussion consacrés à l’analyse des politiques publiques. Or, l’ensemble de ces organes ont comme caractéristique commune de s’appuyer sur des réseaux de recherche spécifiques qui s’organisent autour de domaines d’intervention politique spécialisés. Leur création et le maintien de leurs ressources et de leurs communautés dépendent d’une économie des problèmes légitimes qui classe les enjeux susceptibles de recevoir des ressources de sources diverses pour organiser une capacité d’analyse. Par ailleurs, le rôle de ces organisations s’étend souvent au maintien de la visibilité et de l’importance symbolique de leur domaine de prédilection.
À bien des égards, la vitalité de ces réseaux et de leurs organisations membres dépend des ressources qu’ils peuvent obtenir de leur communauté. Le domaine de la défense, de la sécurité et des études stratégiques, par exemple, comporte un nombre de laboratoires d’idées qui réunissent des acteurs de divers champs, dont des fonctionnaires, des entrepreneurs, des professeurs, des étudiants, des politiciens et des membres des forces armées. Ces rapports favorisent l’entretien de ce domaine de recherche qui connaît une expansion importante dans les années 1970 et 1980, notamment à la différence du domaine de la recherche sur la paix. Ce dernier chevauche le réseau des études stratégiques, mais forme une communauté d’activistes et d’universitaires plus précaire malgré la création du Canadian Peace Research Institute (1961-1981), de Projet Ploughshares (1976), du Peace Research Institute-Dundas (1977-2004) et de l’Institut canadien pour la paix et la sécurité internationale (1984-1992) mentionné plus haut[49].
La recherche universitaire en défense et en sécurité fut aussi appuyée par le Programme d’études militaires et stratégiques (1967) du ministère de la Défense nationale, ensuite renommé Forum sur la sécurité et la défense[50]. Ses vivres sont réduits en 2011, mais plusieurs centres universitaires qui reçoivent des fonds de ce programme sont appuyés par d’autres sources de financement et se rapprochent du monde des think tanks par leurs activités de diffusion. Le développement de l’expertise universitaire dans ce domaine vient également appuyer les activités d’organes indépendants comme le Canadian Institute of Strategic Studies (1976-2008) fondé par George Gray Bell, brigadier général et professeur à l’Université de York. Ce réseau continue d’ailleurs de croître au cours de la décennie suivante avec l’arrivée de l’Institut Mackenzie (1986) et l’Institut de la Conférence des associations de la défense (1987).
Au milieu des années 1980, le domaine des affaires internationales en général – incluant la paix et la sécurité, mais aussi les relations internationales, le développement, le commerce mondial et les études régionales – s’organise autour d’un réseau élargi d’organisations qui chevauchent l’État et les universités ou occupent les interstices entre ces institutions[51]. Au cours des années 1990 et 2000, le domaine de la recherche et de la consultation en développement international est agrémenté par des organismes comme la Canadian Foundation for the Americas (1990-2011), Unisféra (2002) et l’International Institute for Sustainable Development (1990), mais il perd le North-South Institute (1976-2014) suivant la compression de ses subventions gouvernementales.
Dans les années 2000, les laboratoires d’idées dans le domaine des affaires internationales semblent se consolider autour d’initiatives privées. Le Canadian Defence and Foreign Affairs Institute (2001) – qui devient l’Institut canadien des affaires mondiales en 2015 – est surtout financé par des individus, des fondations et des compagnies. De même, le Centre for International Governance Innovation ou CIGI (2001) est fondé par les codirecteurs de la compagnie derrière les produits BlackBerry, Mike Lazaridis et Jim Balsillie. Ce dernier semble d’ailleurs aspirer à fonder un legs institutionnel à l’image de ceux mis en place par les philanthropes américains du début du XXe siècle[52]. En 2007, il crée la Balsillie School of International Affairs (BSIA) qui opère en collaboration avec CIGI ainsi que l’Université de Waterloo et l’Université Wilfrid Laurier. La même année, l’influence de Balsillie fut aussi déterminante dans la transformation du vénérable Canadian Institute of International Affairs (1928) qui devient, à ce moment, le Canadian International Council. En 2008, le Canadian International Council absorbe également le Canadian Institute of Strategic Studies (cf. supra) pour créer un groupe de travail en études stratégiques codirigé par l’Institut canadien des affaires mondiales[53]. Or, ces efforts de consolidation institutionnelle et la réalisation de la vision de Balsillie furent aussi controversés et stimulèrent des inquiétudes relatives à l’autonomie des facultés universitaires, en particulier vis-à-vis de l’influence recherchée par CIGI et, par extension, Balsillie sur les finances et les mandats de recherche du BSIA. Suivant le congédiement du professeur Ramesh Thakur à titre de directeur du BSIA (qui résistait, semble-t-il, à ce qu’il percevait comme des ingérences indues), l’Association canadienne de professeures et professeurs d’université mandata une investigation[54] et menaça de réprimander formellement les universités impliquées[55]. La controverse se solde en novembre 2012 par le retrait de cette réprimande suivant la production d’un protocole d’entente clarifiant le cadre de gouvernance pour l’école et les mesures envisagées pour protéger la liberté universitaire[56], mais elle entraîne entre-temps l’échec d’une entente entre CIGI et la Faculté de droit de l’Université York par cause de protestations de la part du corps professoral[57].
Dans le sillage du mouvement écologiste des années 1960 et des crises pétrolières des années 1970, les politiques environnementales et énergétiques forment un autre domaine de préoccupation qui gagne des laboratoires d’idées dans les années 1970 et continue à soutenir de nouvelles organisations par la suite. L’Association canadienne du Club de Rome (1974) va pour un temps bénéficier de la popularité de son organisme mère qui signe le fameux rapport The Limits to Growth (1972). Ses membres vont d’ailleurs intégrer le réseau de hauts fonctionnaires et de politiciens qui entoure le premier ministre Pierre Elliott Trudeau[58]. Par ailleurs, des organismes très différents les uns des autres – autant en leurs approches qu’en leurs philosophies – comme la Pollution Probe Foundation (1969), l’Energy Probe Research Foundation (1980), et la Fondation David Suzuki (1991) vont agrémenter leurs interventions publiques et politiques de produits de recherche, mais le Pembina Institute for Appropriate Development (1984) adopte plus visiblement la figure du laboratoire d’idées et va devenir l’un des think tanks canadiens les plus cités dans les médias nationaux[59].
Depuis le dernier tiers du XXe siècle, tout se passe comme si chaque domaine de préoccupation doit acquérir un complément d’organe de recherche spécialisé pour produire des discours expertisés et entretenir la visibilité de leur cause ou de leur fonction. Plusieurs de ces corps demeurent relativement petits et entretiennent des préoccupations restreintes limitant leur aspiration à intégrer la scène des think tanks nationaux. Néanmoins, les domaines des politiques internationales et des enjeux énergétiques et environnementaux forment des communautés impliquées dans des débats d’envergure nationale et plusieurs de leurs laboratoires d’idées sont bien intégrés au monde des think tanks. Enfin, avec la formation du Wellesley Institute (2006) à Toronto le Canada dispose d’un think tank spécialisé en santé.
La guerre des idées et le champ politique
Mise à part leur prolifération, deux tendances ont marqué les think tanks des pays anglo-saxons depuis les années 1970, soit la multiplication des laboratoires d’idées spécialisés et l’émergence de think tanks militants et proactifs dans leurs tactiques de diffusion. Ces transformations furent attribuées à la saturation du paysage des think tanks[60], à l’augmentation de la demande politique pour les idées[61] et à la concurrence entre les technocrates de l’après-guerre et les activistes-experts des mouvements conservateurs et progressistes[62]. Ensemble ces explications suggèrent que les think tanks se sont multipliés en réponse à l’affermissement du statut du discours expert alors que celui-ci est devenu le langage privilégié de l’élaboration des politiques publiques au point de s’infiltrer dans les arènes de luttes politiques et idéologiques.
Dans le sillage des revirements culturels et politiques des années 1960, les années 1970 sonnent la fragilisation du consensus de l’après-guerre, la fin de la prospérité économique des trente glorieuses et l’épuisement des structures de planification technocratiques de l’État. Elles marquent aussi l’ascension de nouvelles structures organisationnelles pour le patronat et le mouvement ouvrier, dont la fondation du Conseil canadien des chefs d’entreprises (1976) et l’organisation de capacités de recherche plus importantes au sein du Congrès du travail du Canada (1956). Entre-temps, l’Institut Fraser (1974) prépare l’ascension du mouvement néolibéral au Canada, la Canada West Foundation (1973) défend les intérêts économiques et politiques de l’Ouest canadien, l’Institut canadien de politique économique (1979-1984) forme un véhicule pour le nationalisme économique et le Centre canadien de politiques alternatives (1980) rallie les syndicats et des intellectuels de gauche pour contrer le déclin de la confiance en l’État-providence associé aux progrès des discours néolibéraux.
Depuis les années 1990, la tendance est vers la régionalisation de ces lignes de faille. L’Atlantic Institute for Market Studies (1994) en Nouvelle-Écosse, l’Institut économique de Montréal (1999) et le Frontier Centre for Public Policy (1999) qui dispose de bureaux dans les provinces des Prairies viennent appuyer les mouvements néolibéral et conservateur et sont ensuite rejoints par un autre think tank national, le Macdonald-Laurier Institute (2010). Le mouvement progressiste, pour sa part, est agrémenté par GPI Atlantic (1997) en Nouvelle-Écosse, l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (1997) au Québec, le Parkland Institute (1996) à l’Université de l’Alberta et le Polaris Institute (1997) au niveau fédéral. Or, GPI Atlantic et le Polaris Institute semblent être largement inactifs depuis quelques années.
Les règles de l’Agence du revenu du Canada, les normes associées à la valorisation de l’indépendance des laboratoires d’idées, les institutions politiques canadiennes et les habitudes de consultation interne des partis politiques canadiens découragent ces think tanks à s’associer ouvertement à un parti politique[63]. Les laboratoires d’idées militants opèrent ainsi à un degré de distance du champ politique. Ils forment plutôt des forums où les oppositions idéologiques du champ politique sont reproduites en partie selon les intérêts qui s’expriment dans le champ économique. Or, dans d’autres juridictions, comme aux États-Unis et en Grande-Bretagne, certains laboratoires d’idées entretiennent des relations informelles, mais étroites, avec les partis politiques et les candidats électoraux. En Allemagne, les partis ont systématiquement recours à des fondations qui soutiennent le développement et la diffusion de leurs idées ainsi que le réseautage de leurs partisans[64].
Les think tanks militants offrent déjà un soutien moral et idéologique aux causes de certains partis politiques, mais au fur et à mesure que les think tanks se rapprochent structurellement du champ politique, ils adoptent des rôles davantage structurés par les enjeux de celui-ci. Cela peut prendre la forme de transferts de personnel à des partis ou à l’administration publique lorsque ces derniers remportent des élections. Cela peut aussi passer par des appuis à des plateformes électorales. Cependant, les partis politiques deviennent un véritable site d’intégration pour les laboratoires d’idées lorsque ces rapports deviennent plus formels et lorsque les think tanks adoptent des fonctions directement attribuables à l’entretien du parti ou de sa communauté.
Au Canada, il existe certains exemples historiques de rapports de proximité entre des groupes de réflexion et des partis politiques. La League for Social Reconstruction (1932-1942) fut proche de la Fédération du Commonwealth coopératif. L’Institut canadien de politiques économiques (1979-1984), parrainé par l’ancien ministre des Finances Walter Gordon, rejoint une faction nationaliste et quelque peu désillusionnée du Parti libéral de l’époque. De même, la National Citizen’s Coalition (1967) est dirigée par Stephen Harper avant son retour en force en politique en 2001 et l’alliance entre le Parti conservateur du Canada et la droite religieuse passe par des organes précaires comme l’Institute for Canadian Values (2005) et un centre de recherche plus prospère comme l’Institute of Marriage and Family Canada (2005-2016)[65] – aujourd’hui amalgamé au programme de recherche sur la famille de Cardus (2000), le principal organe intellectuel chrétien du Canada. Or, l’importance de la fonction publique permanente, les règles de l’Agence du revenu du Canada et la relative brièveté des élections canadiennes limitent l’intégration des laboratoires d’idées dans le champ politique canadien[66]. L’exception qui prouve la règle est probablement la National Foundation for Public Policy Development (1982) qui fut immédiatement abandonnée et fermée par le Parti progressiste-conservateur dans la foulée des préparations électorales et suivant le refus de son statut d’organisme de bienfaisance[67].
La chose se complique cependant avec l’arrivée du Centre Manning pour le renforcement de la démocratie (2005) et de l’Institut Broadbent (2011) dédiés respectivement à l’entretien des mouvements derrière le Parti conservateur du Canada et le Nouveau Parti démocratique. Le Centre Manning fut créé pour entretenir le mouvement conservateur canadien en organisant des conférences, en proposant des rapports et des occasions de réseautage et en offrant des programmes de formation pour la relève conservatrice, mais il a depuis recentré ses pratiques sur son rôle de forum et d’instrument de réseautage. Comme le remarque Frédéric Boily, sa création suggérait une émulation des stratégies du mouvement conservateur américain[68] qui confèrent des fonctions similaires à des organes comme la Heritage Foundation[69] ou Americans for Tax Reform[70]. Cette stratégie a aussi suscité un sentiment d’urgence au sein de la gauche politique qui fonde l’Institut Broadbent en partie pour rattraper les conservateurs et remplir des rôles similaires, cette fois pour le Nouveau Parti démocratique.
Parallèlement, le Centre Pearson pour des politiques progressistes (2013) affiche des liens étroits avec plusieurs vétérans du Parti libéral du Canada et fut créé pour contrer les organes de réflexion conservateurs dans le sillage de la majorité du Parti conservateur du Canada emportée en 2011. De même, Canada2020 (2006) est fondé et gouverné par des conseillers qui gravitent autour du Parti libéral et entretiennent des liens avec Justin Trudeau. Ces organes sont plus subtils dans leur rapport au champ politique, mais ils intègrent une élite de centre gauche qui partage un réseau avec le Parti libéral du Canada.
Conclusion
Les contours actuels du paysage des think tanks canadiens remontent aux années 1970, mais ce paysage a aussi évolué depuis et comprend maintenant une grande diversité d’organisations associées à différents sites d’intégration. Ces développements laissent aussi présager les occasions et les contraintes qui agiront sur l’évolution future du monde des laboratoires d’idées canadiens. À cet égard, il n’est pas certain que cette forme organisationnelle va continuer à prospérer dans tous les contextes où elle trouve des modalités d’intégration.
Les médias font encore usage de leurs rapports et les membres du personnel des think tanks canadiens écrivent encore des éditoriaux pour les journaux et leurs sites web[71], mais les laboratoires d’idées concourent dorénavant avec des organes de diffusion d’idées politiques numériques qui se multiplient sur Internet par l’entremise des réseaux sociaux. Ceux-ci sont d’ailleurs plus légers, plus souples et moins contraints par des normes techniques ou intellectuelles.
Par ailleurs, les ressources du champ bureaucratique vont probablement continuer à alimenter une niche pour l’entretien de laboratoires d’idées aux marges de l’État malgré les incertitudes par rapport au financement que cela comporte. Vu l’indépendance relative du champ bureaucratique canadien vis-à-vis du champ politique, les think tanks qui investissent cette niche vont aussi probablement continuer à graviter autour du centre politique[72] et évoluer avec celui-ci en fonction de la succession des « paradigmes politiques » dominants[73]. Or, des recherches plus approfondies sur les organismes et ministères gouvernementaux dans lesquelles se « branchent[74] » différents think tanks pourraient laisser entrevoir une différenciation des groupes et intérêts associés aux laboratoires d’idées qui gravitent autour de l’État en fonction de leur domaine d’intervention : que ce soit les politiques économiques et industrielles, les politiques scientifiques et l’économie du savoir ou les politiques sociales, la gestion de la pauvreté et la prestation de services aux citoyens.
En ce qui a trait au champ universitaire, on peut croire que les écoles, les instituts et les centres de recherche vont continuer à vouloir démontrer leur pertinence et leur utilité en intégrant les arènes du discours public et de l’élaboration des politiques qu’occupent, entre autres, les think tanks. Cependant, la question se pose à savoir jusqu’à quel point le monde de la recherche et de l’enseignement universitaire sera en mesure de continuer à augmenter le volume des ressources qu’il réachemine vers ces activités. L’évolution des normes au sein du champ universitaire et la négociation des rapports entre les universités et les gouvernements qui les financent sont aussi à surveiller.
En parallèle, les think tanks de la guerre des idées opèrent, semble-t-il, déjà dans un environnement saturé dont les lignes de faille datent des années 1980, voire d’avant. Néanmoins, la possibilité d’une reconfiguration des conflits idéologiques ou d’une transformation des conditions de son financement ou encore l’émergence de nouveaux courants importants pourraient générer des occasions pour de nouveaux arrivants sur la scène des think tanks militants ou troubler les vétérans de la guerre idéologique. Enfin, si la valeur symbolique du discours expert a véritablement décliné comme le laissent croire certains commentateurs[75], on peut se demander si les mouvements qui soutiennent les partis politiques canadiens vont voir la pertinence de continuer d’investir dans cette ressource. Le repli récent du Centre Manning sur ses activités de réseautage semble répondre par la négative, mais d’aucuns imaginent des arrangements différents pouvant alimenter la capacité de recherche des partis avec l’aide de fonds publics afin de combler le « déficit démocratique[76] ».
Appendices
Notes
-
[*]
Cet article scientifique a été évalué par deux experts anonymes externes, que le Comité de rédaction tient à remercier.
-
[1]
R. Kent Weaver, « The Changing World of Think tanks », PS : Political Science and Politic, vol. 22, no 3, septembre 1989, p. 563-578.
-
[2]
David M. Ricci, The Transformation of American Politics : The New Washington and the Rise of Think tanks, New Haven, Yale University Press, 1993.
-
[3]
James Allen Smith, The Idea Brokers : Think tanks and the Rise of the New Policy Elite, New York et Toronto, The Free Press, 1991 ; Thomas Medvetz, Think tanks in America, Chicago, University of Chicago Press, 2012.
-
[4]
Julien Landry, « Les Think tanks », dans François Claveau et Julien Prud’homme (dir.), Experts, Sciences et Sociétés, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2018, p. 117-134.
-
[5]
Donald E. Abelson, Do Think tanks Matter ? Assessing the Impact of Public Policy Institutes, 2e édition, Montréal-Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2009 ; Idem, Northern Lights : Exploring Canada’s Think tank Landscape, Montréal-Kinston, McGill-Queen’s University Press, 2016.
-
[6]
Evert A. Lindquist, « A Quarter Century of Canadian Think tanks : Evolving Institutions, Conditions and strategies », dans Diane Stone, Andrew Denham et Mark Garnet (dir.), Think tanks across Nations : A Comparative Approach, Manchester, Manchester University Press, 1998, p. 127-144 ; Idem, « Three Decades of Canadian Think tanks : Evolving Institutions, Conditions and Strategies », dans Diane Stone et Andrew Denham (dir.), Think tank Traditions : Policy Analysis Across Nations, New York, Palgrave, 2004, p. 264-280.
-
[7]
Doug Owram, The Government Generation : Canadian Intellectuals and the State, 1900-1945, Toronto, University of Toronto Press, 1986.
-
[8]
Thomas Medvetz, op. cit.
-
[9]
Evert A. Lindquist, « Think tanks or Clubs ? Assessing the Influence and Roles of Canadian Policy Institutes », Canadian Public Administration, vol. 36, no 4, 1993, p. 576-577.
-
[10]
Thomas Medvetz, op. cit. ; Andrew Rich, Think tanks, Public Policy, and the Politics of Expertise, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
-
[11]
Donald E. Abelson, « From Policy Research to Political Advocacy : The Changing Role of Think tanks in American Politics », Canadian Review of American Studies, vol. 25, no 1, janvier 1995, p. 93-126 ; James G. McGann, « Academics to Ideologues : A Brief History of the Public Policy Research Industry », PS : Political Science & Politic, vol. 25, no 4, 1992, p. 733-740.
-
[12]
Donald E. Abelson, Northern Lights…, op. cit.
-
[13]
Thomas Medvetz, op. cit. ; Thomas Medvetz, « “Public Policy is Like Having a Vaudeville Act” : Languages of Duty and Difference among Think tank-Affiliated Policy Experts », Qualitative Sociology, vol. 33, no 4, juin 2010, p. 549-562.
-
[14]
Thomas Medvetz, op. cit.
-
[15]
Evert A. Lindquist, « A Quarter Century… », loc. cit. ; Evert A. Lindquist, « Three Decades… », loc. cit.
-
[16]
Gil Eyal, « Spaces Between Fields », dans Philip S. Gorski (dir.), Bourdieu and Historical Analysis, Durham, Duke University Press, 2013, p. 158-182.
-
[17]
Michael J. Prince, « Soft Craft, Hard Choices, Altered Context : Reflections on Twenty-Five Years of Policy Advice in Canada », dans Laurent Dobuzinskis, David H. Laycock et Michael Howlett (dir.), Policy Analysis in Canada : The State of the Art, Toronto, University of Toronto Press, 2007, p. 163-185.
-
[18]
Stephen Brooks, « The Policy Analysis Profession in Canada », dans Laurent Dobuzinskis, David H. Laycock et Michael Howlett (dir.), op. cit., p. 21-47 ; Richard French, How Ottawa Decides : Planning and Industrial Policy-Making 1968-1984, Canadian Institute for Economic, Toronto, James Lorimer & Co., 1984.
-
[19]
Laurent Dobuzinskis, « Trends and Fashions in the Marketplace of Ideas », dans Laurent Dobuzinskis, Michael Howlett et David H Laycock (dir.), op. cit., p. 91-124.
-
[20]
Donald E. Abelson, Do Think tanks Matter ?…, op. cit. ; Laurent Dobuzinskis, « Back to the Future ? Is There a Case for Re-establishing the Economic Council and/or the Science Council ? », dans Laurent Dobuzinskis, Michael Howlett et David Laycock (dir.), op. cit., p. 449-498.
-
[21]
Anthony Perl et Donald J. White, « The Changing Role of Consultants in Canadian Policy Analysis », Policy and Society, vol.21. no 1, 2002, p. 49-73.
-
[22]
Denis Saint-Martin, « The New Managerialism and the Policy Influence of Consultants in Government : An Historical–Institutionalist Analysis of Britain, Canada and France », Governance, vol. 11, no 3, juillet 1998, p. 319-356.
-
[23]
Donald E. Abelson, Do Think tanks Matter ?…, op. cit.
-
[24]
Evert A. Lindquist, « Citizens, Experts and Budgets : Evaluating Ottawa’s Emerging Budget Process », dans Susan D Phillips (dir.), How Ottawa Spends, 1994-95 : Making Change, Ottawa, Carleton University Press, 1994, p. 91-128.
-
[25]
Donald E. Abelson, Do Think tanks Matter ?…, op. cit.
-
[26]
George Anderson, « The New Focus on the Policy Capacity of the Federal Government », Canadian Public Administration, vol. 39, no 4, décembre 1996, p. 469-488.
-
[27]
Herman Bakvis, « Rebuilding Policy Capacity in the Era of the Fiscal Dividend : A Report from Canada », Governance, vol. 13, no 1, janvier 2000, p. 71-103 ; Jean-Pierre Voyer, « Policy Analysis in the Federal Government : Building the Forward-Looking Policy Research Capacity », dans Laurent Dobuzinskis, David H Laycock et Michael Howlett (dir.), op. cit., p. 317-341.
-
[28]
Greffier du Conseil privé, « Destination 2020. Objectif 2020. », Gouvernement du Canada, 2014, http://www.clerk.gc.ca/local_grfx/d2020/Destination2020-fra.pdf ; Thomas Townsend et Robert Craig Keigo Kunimoto, Capacity, Collaboration and Culture : The Future of the Policy Research Function in the Government of Canada, Ottawa, Policy Research Initiative, 2009.
-
[29]
Jean-Philippe Warren et Yves Gingras, « Job Market Boom and Gender Tide : The Rise of Canadian Social Sciences in the 20th Century », Scientia Canadensis : revue canadienne d’histoire des sciences, des techniques et de la médecine, vol. 3021, no 2, 2007, p. 5- ; Jean-Louis Trudel, « Born in War : Canada’s Postwar Engineers and Toronto’s Ajax Division », Scientia Canadensis : revue canadienne d’histoire des sciences, des techniques et de la médecine, vol. 21, no 50, 1997, p. 3-27.
-
[30]
Paul Axelrod, Scholars and Dollars : Politics, Economics, and the Universities of Ontario, 1945-1980, Toronto, University of Toronto Press, 1982 ; Donald Fisher, The Social Sciences in Canada : 50 Years of National Activity by the Social Science Federation of Canada, Waterloo, Ont., Wilfrid Laurier University Press et Social Sciences Federation of Canada, 1991.
-
[31]
Ibid. ; Mike Almeida, « Comment se rendre utile : les centres de recherche universitaires en sciences sociales au Canada », Scientia Canadensis : revue canadienne d’histoire des sciences, des techniques et de la médecine vol. 30, no 2, 2007, p. 97-122 ; Theresa R Richardson et Donald Fisher (dir.), The Development of the Social Sciences in the United States and Canada : The Role of Philanthropy, Stamford, Conn., Ablex Pub. Corp., 1999.
-
[32]
Mike Almeida, loc. cit.
-
[33]
Paul Axelrod, op. cit.
-
[34]
Ibid. ; David M. Cameron, « The Challenge of Change : Canadian Universities in the 21st Century », Canadian Public Administration/Administration publique du Canada, vol. 45, no 2, juin 2002, p. 145-174.
-
[35]
Mike Almeida, loc. cit. ; David M. Cameron, loc. cit.
-
[36]
Ibid.
-
[37]
Donald Fisher, op. cit.
-
[38]
Jean-Philippe Warren et Yves Gingras, loc. cit.
-
[39]
Mike Almeida, loc. cit.
-
[40]
David M. Cameron, loc. cit.
-
[41]
Benoît Godin, Michel Trépanier et Mathieu Albert, « Des organismes sous tension : les conseils subventionnaires et la politique scientifique », Sociologie et sociétés, vol. 32, no 1, 2000, p. 17-42.
-
[42]
Peter Wagner, « Public Policy, Social Science, and the State : An Historical Perspective », dans Frank Fischer, Gerald Miller et Mara S Sidney (dir.), Handbook of Public Policy Analysis : Theory, Politics, and Methods, Boca Raton, CRC/Taylor & Francis, 2007, p. 29-40 ; Peter Wagner, A History and Theory of the Social Sciences : Not All That Is Solid Melts into Air, London (England), SAGE, 2001.
-
[43]
Yves Gingras, « L’université en mouvement », Égalité, no 50, 2004, p. 13-28.
-
[44]
Mike Almeida, loc. cit.
-
[45]
Donald E Abelson, Northern Lights…, op. cit.
-
[46]
Allan Tupper, « Think tanks, Public Debt, and the Politics of Expertise in Canada », Canadian Public Administration, vol. 36, no 4, 1993, p. 530-546.
-
[47]
Peter Graefe, « La topographie des think tanks patronaux québécois. La construction d’un paysage néolibéral », Globe : Revue internationale d’études québécoises, vol. 7, no 1, 2004, p. 181-202.
-
[48]
Pierre Bourdieu, Homo academicus, Paris, Éditions de Minuit, 1984.
-
[49]
Rod Byers, « L’État de la recherche sur la paix et des études stratégiques au Canada », Anthropologie et Sociétés, vol. 7, no 1, 1983, p. 193-212.
-
[50]
Donald E. Abelson, Northern Lights…, op. cit. ; Jane Boulden, « Independent Policy Research and the Canadian Foreign Policy Community », International Journal, vol. 54, no 4, octobre 1999, p. 625-647.
-
[51]
Ibid.
-
[52]
James Allen Smith, op. cit. ; Donald T. Critchlow, The Brookings Institution, 1916-1952 : Expertise and the Public Interest in a Democratic Society, DeKalb (Ill.), Northern Illinois University Press, 1985.
-
[53]
Donald E. Abelson, Northern Lights…, op. cit.
-
[54]
Len Findlay, « Investigation into the Termination of Dr. Ramesh Thakur as Director of the Balsillie School of International Affairs, Affiliated with the University of Waterloo, Wilfrid Laurier University, and the Waterloo-Based Centre for International Governance Innovation », Ottawa, Canadian Association of University Teachers, 2010.
-
[55]
Canadian Association of University Teachers, « CAUT Warns of Censure for Waterloo & Wilfrid Laurier », CAUT Bulletin Archives 1996-2016, 2012, bulletin-archives.caut.ca.
-
[56]
Canadian Association of University Teachers, « McGill, Wilfrid Laurier & Waterloo Actions End Threat of Censure », CAUT Bulletin Archives 1996-2016, 2012, bulletin-archives.caut.ca.
-
[57]
Tristin Hopper, « York University Rejects RIM Co-Founder Jim Balsillie’s $60-Million Deal », National Post, 3 avril 2012.
-
[58]
Jason L. Churchill, « The Limits to Influence : The Club of Rome and Canada, 1968 to 1988 », Thèse de doctorat (histoire), University of Waterloo, 2006.
-
[59]
Donald E. Abelson, Northern Lights…, op. cit.
-
[60]
Diane Stone, Capturing the Political Imagination : Think tanks and the Policy Process, London, Frank Cass, 1996.
-
[61]
David M. Ricci, op. cit.
-
[62]
James Allen Smith, op. cit. ; Thomas Medvetz, op. cit.
-
[63]
Donald E. Abelson, Do Think tanks Matter ?…, op. cit.
-
[64]
Gerald Baier et Herman Bakvis, « Think tanks and Political Parties in Canada : Competitors or Collaborators ? », dans Adolfo Garcé et Gerardo Uña (dir.), Think tanks and Public Policies in Latin America, Buenos Aires, Fundación Siena, CIPPEC, 2010, p. 34-45.
-
[65]
Marci McDonald, Le facteur Armageddon. La montée de la droite chrétienne au Canada, Montréal, Stanké, 2011.
-
[66]
Donald E. Abelson, Do Think tanks Matter ?…, op. cit.
-
[67]
Evert A. Lindquist, « Behind the Myth of Think tanks : The Organization and Relevance of Canadian Policy Institutes », Thèse de doctorat, University of California, 1989.
-
[68]
Frédéric Boily, « Un néoconservatisme à la canadienne ? Stephen Harper et l’École de Calgary », dans Linda Cardinal et Jean-Michel Lacroix (dir.), Le conservatisme : le Canada et le Québec en contexte, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2009, p. 35-49.
-
[69]
Jason Stahl, Right Moves : The Conservative Think tank in American Political Culture since 1945, Chapel Hill, UNC Press Books, 2016.
-
[70]
Thomas Medvetz, « The Strength of Weekly Ties : Relations of Material and Symbolic Exchange in the Conservative Movement », Politics & Society, vol. 34, no 3, septembre 2006, p. 343-368.
-
[71]
Donald E. Abelson, Northern Lights…, op. cit.
-
[72]
John McLevey, « Think tanks, Funding, and the Politics of Policy Knowledge in Canada », Canadian Review of Sociology/Revue Canadienne de Sociologie, vol. 51, no 1, 2014, p. 54-75.
-
[73]
Peter A. Hall, « Policy Paradigms, Social Learning, and the State : The Case of Economic Policymaking in Britain », Comparative Politics, vol. 25, no 3, avril 1993, p. 275-296.
-
[74]
Gil Eyal, « Plugging into the Body of the Leviathan : Proposal for a New Sociology of Public Interventions », Middle East - Topics & Arguments, no 1, 2013, p. 13-24.
-
[75]
Sergio Sismondo, « Post-Truth ? », Social Studies of Science, vol. 47, no 1, février 2017, p. 3-6 ; Tom Nichols, The Death of Expertise : The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters, New York, Oxford University Press, 2017 ; Daniel W. Drezner, The Ideas Industry, New York, Oxford University Press, 2017.
-
[76]
Irvin Studin, « Revisiting the Democratic Deficit : The Case for Political Party Think tanks », Policy Options / Options Politiques, 1er février 2008, p. 62-67.