Abstracts
Résumé
Dans cet article, nous discutons des éléments structurants de la théorie de la forme urbaine et des méthodologies servant à mesurer la qualité de vie et la qualité des environnements naturels et construits des espaces urbains. Nous tentons ainsi d’approcher, d’une manière commune, les dimensions socio-économiques, urbanistiques et environnementales qui caractérisent les espaces urbains et ce, en retenant les variables clés pour un test appliqué à la région métropolitaine de Montréal. La proposition vise à développer un modèle synthétique d’analyse conçu à partir d’un nombre restreint d’indicateurs. Nos résultats, issus d’une analyse factorielle, démontrent la grande stabilité des structures spatiales héritées de la métropole industrielle.
Mots-clés:
- qualité de vie,
- indicateurs,
- environnements naturels et construits,
- test de mesure,
- Montréal
Abstract
In this paper, we discuss the basic elements of urban form theory and the approaches used to measure both the quality of life and that of the built and natural environments found in urban space. We try combining the socio-economic, morphologic and environmental aspects of urban space in order to choose the key variables needed to put the Montréal metropolitan area to a test. The goal of this proposal is to develop a synthetic analytical model based on a limited number of indicators. Stemming from a factorial analysis, our results show the lasting stability of the spatial structures inherited from the industrial metropolis.
Keywords:
- quality of life,
- indicators,
- built and natural environments,
- measurement test,
- Montreal
Article body
Les sociétés occidentales se préoccupent de plus en plus de la qualité de vie. Les administrations publiques élaborent sans relâche, avec une efficacité toute relative, des programmes et des politiques destinés à améliorer la qualité de vie de leurs citoyens, soit de manière générale, soit en faveur d’un segment particulier de la population. Parallèlement, on a assisté à la formation d’un domaine d’étude, notamment en études urbaines, dans lequel des chercheurs s’emploient à circonscrire la portée du concept de qualité de vie et, plus encore, à proposer des champs d’application et des outils de mesure permettant d’évaluer différents niveaux de qualité de vie (Schmandt et Bloomberg, 1969; Urban Affairs Annuel Review, 1969; Liu, 1976; Smith, 1973; Bailly, 1981; Davies et Herbert, 1993; Canadian Journal of Urban Research, 2001; Urban Quality Indicators 1996-2003; Noll, 2003). En fait, le concept de qualité de vie en milieu urbain a eu un tel succès que le terme fait désormais partie de la culture populaire. Polysémique par définition, il renvoie à différents aspects de la vie urbaine, comme les conditions matérielles d’existence, les disparités socio-économiques, l’organisation des activités dans l’agglomération, l’accès à des services et à des équipements de toutes sortes, voire au fait que chacun atteigne ses aspirations. La qualité de vie en milieu urbain serait ainsi conditionnée à la fois par des facteurs objectifs, comme les aspects physico-morphologiques et socio-économiques du milieu urbain, mais aussi par des dimensions subjectives qui relèvent des valeurs, des perceptions et des aspirations de chacun.
La définition première de la qualité de vie, appliquée au fait urbain, se rapporte aux conditions matérielles d’existence. Il s’agit d’une préoccupation qui remonte aux courants hygiénistes de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, alors que des conditions sanitaires et de logement très difficiles affectaient les populations des villes industrielles. De telles conditions de l’environnement urbain, touchant à l’eau et à l’air notamment, sont toujours tenues pour essentielles à une bonne qualité de vie. Ces courants hygiénistes ont eu un grand impact dans la vie municipale, tant aux États-Unis qu’au Canada (Germain, 1984), autorisant l’essor du génie civil et des grands travaux d’infrastructure et d’assainissement, avant de se prolonger dans les études environnementales contemporaines.
Une autre question est celle de la richesse relative de la population et de son égale distribution dans l’espace et le temps. Les facteurs socio-économiques ont été considérés, en effet, comme l’un des déterminants principaux de la qualité de vie ou du bien-être des gens, pour reprendre cette expression, depuis la période des Trente glorieuses jusqu’à aujourd’hui, alors que développement et prospérité se conjuguent avec le processus d’urbanisation. On comprend que le bien-être, ici, relève du statut socio-économique, essentiellement du revenu pourrait-on dire, et d’indicateurs matériels qui renvoient à l’espace vécu par les gens, notamment la structure résidentielle et l’organisation spatiale des services de base dans l’optique d’en évaluer l’accessibilité (Bailly, 1984). Il n’empêche que les inégalités sociales ont subsisté dans les espaces urbains, au point de susciter la curiosité et de mobiliser nombre de chercheurs. L’observation des variations du niveau de revenu, d’un milieu à l’autre ou d’une époque à l’autre, a occupé de nombreux chercheurs du domaine de la géographie sociale et des études urbaines depuis près de cinquante ans. L’organisation sociale des villes s’appuierait, selon cette perspective de recherche, sur des structures de ségrégation et de défavorisation qui, croit-on depuis que les politiques publiques existent en ce domaine, peuvent être compensées par un niveau de services publics adéquats. C’est pourquoi il semble si important de mesurer l’accès aux services. L’accessibilité est d’abord spatiale: les équipements et les services doivent être situés à proximité des espaces résidentiels des usagers. La notion de structure d’opportunités est alors proposée pour décrire les avantages et les désavantages dont disposent les ménages pour répondre à leurs besoins et ce, en tenant compte de leur position sociale et de l’accessibilité à des services, des équipements et des lieux d’emploi (Blumenfeld, 1969; Perloff, 1969; Dansereau et Wexler, 1989; Murdie et al., 1992; Galster et Killen, 1995; Townshend, 2001). Cette notion valorise la proximité et, par le fait même, la densité de l’urbanisation, puisque le fait d’être à courte distance d’un hôpital, d’un équipement sportif, d’un parc ou de tout autre équipement ou service serait susceptible d’améliorer le bien-être des gens et, par le fait même, leur qualité de vie. La seconde façon de concevoir l’accessibilité aux équipements et services est de tenir compte des coûts d’usage. La fréquence de l’utilisation de tel service ou de tel équipement reflète la capacité de payer des résidents. Ceux-ci devraient ainsi avoir accès à une grande diversité de lieux (travail, services, équipements, consommation, loisir) qui ponctuent leur vie de tous les jours sans que les facteurs de distance et de coût les contraignent. En somme, le principe des trois D est proposé: design, densité et diversité. Le design urbain devrait refléter une certaine densité, tant sociodémographique qu’urbanistique. Il faut mentionner que le terme structure d’opportunités a souvent été utilisé dans les études portant sur les quartiers en crise, marqués par la défavorisation et fortement ségrégués, dans lesquelles la question du logement était tenue pour essentielle (Abramson, Tobin et Vandergoot, 1995; Galster et Killen, 1995).
On en est venu à penser que l’organisation des activités, les modes d’utilisation du sol, voire la composition des lieux, influent sur la qualité de vie de chacun. La discussion sur la bonne forme urbaine est relativement ancienne. Les contributions de Kevin Lynch (1960) et de Jane Jacobs (1961) identifient, chacune à leur manière, les éléments qui conditionnent la vie quotidienne des gens, qu’il s’agisse des formes d’habitat ou des modes de déplacement des personnes, de même que de la vie sociale et de la perception que chacun se forme au contact des espaces et des lieux fréquentés. Cette idée d’une bonne forme urbaine, comme l’entend Lynch (1981), a eu une influence considérable. Les études actuelles en environnement urbain lui font écho en posant les conditions de l’habiter en relation avec la conservation des ressources et des milieux naturels. Une bonne forme urbaine favoriserait les économies d’énergie et de ressources, autant qu’elle permettrait un bon accès à la nature comme aux services, aux équipements et aux autres aménités urbaines (Murdie et al., 1992; Dansereau, 1977). La qualité de vie et la qualité de l’environnement urbain y sont présentées, dans la plupart des cas, comme deux dimensions indissociables. Ainsi est apparue l’idée que le bien-être de la population et la qualité des environnements naturels et construits forment les deux dimensions structurantes de la qualité de vie, lesquelles interagissent l’une sur l’autre de manière plus réciproque que causale. La série des fascicules réalisés par le groupe Urban Quality Communications (1996-2002) est emblématique à cet égard. Ce sont des portraits de villes américaines auscultées à travers des outils de mesure, sans cesse discutés et critiqués, associant les questions socio-économiques, environnementales et de gouvernance politique. S’y trouvent les tentatives entreprises dans les villes américaines pour développer des indicateurs destinés à mesurer la qualité des unités de voisinage, des services publics, des réseaux piétonniers des villes ou des avancées du développement durable urbain, pour ne citer que ces exemples.
Penser la qualité de vie en milieu urbain ne se limite toutefois pas à circonscrire les besoins fondamentaux des gens, puisqu’elle peut comprendre des aspects plus subjectifs, comme l’atteinte des aspirations individuelles (Bailly, 1984). La qualité de vie serait, dans cette optique, une affaire personnelle, correspondant aux valeurs et aux perceptions de chacun. Mais il est bien difficile de s’entendre sur les valeurs et les aspirations pouvant être tenues comme nécessaires à la qualité de vie et être reconnues comme communes à l’ensemble des sociétés urbaines (Murdie et al., 1992). Certaines études misent plutôt sur la satisfaction vis-à-vis du logement ainsi que sur les composantes du cadre de vie et de l’environnement social (Campbell et al., 1976; Townshend, 2001). Elles recourent généralement aux sondages d’opinion pour établir des niveaux de satisfaction (Boyer et Savageau, 1986), sans pour autant expliquer les raisons des variations de la satisfaction d’un endroit à l’autre, ni parvenir à justifier totalement le choix des objets à l’étude et sur lesquels les répondants aux questionnaires doivent se prononcer: êtes-vous satisfait de la desserte du transport en commun dans votre quartier? de votre logement? des écoles secondaires de votre quartier? de la qualité des restaurants du centre-ville? De telles questions comportent, par leur nature même, des biais méthodologiques et, forcément, s’appuient sur la subjectivité des sujets interrogés.
Il s’agira, dans le cadre de cet article, de retrouver le fil qui relie ces deux dimensions à l’intérieur des approches d’évaluation et de mesure, commencées depuis une cinquantaine d’années et qui ne s’épuisent toujours pas. À ce propos, la théorie sur l’organisation des activités et des fonctions dans l’espace métropolitain sera mise à contribution afin de comprendre les rapports d’influences réciproques entre la forme urbaine, l’environnement et la qualité de vie. Une telle démarche conduira, enfin, à proposer un cadre méthodologique permettant l’évaluation de la qualité de vie à l’aide d’un appareil normatif d’indicateurs de mesure. Le but est de tester une approche permettant de mesurer la qualité de vie à l’intérieur d’une agglomération métropolitaine, soit celle de Montréal (figure 1), à partir d’un choix restreint d’indicateurs. Ce test répond à deux objectifs. Le premier est de proposer une approche qui évite de reproduire le syndrome de la boîte noire exigeant des moyens techniques considérables et le recours à un très grand nombre de variables environnementales dont la disponibilité et la fiabilité ne sont pas toujours au rendez-vous. Le second objectif vise (dans un test qui paraîtra peut-être modeste aux yeux de certains) à croiser les aspects socio-économiques et environnementaux reconnus comme centraux dans la littérature, à savoir la compacité urbaine (l’intensité de l’urbanisation reflétée dans le cadre bâti), le niveau de richesse, l’accessibilité au lieu d’emploi et la distribution de la végétation dans la ville. Dans cette optique, le test utilisera un nombre réduit de variables afin de s’assurer que des corrélations unissent bel et bien de tels aspects. Il sera possible de vérifier au passage la stabilité des structures urbaines héritées de la période industrielle, qui a vu Montréal devenir une grande métropole.
Figure 1
Région de Montréal: unités d’analyse
La mesure de la qualité de vie en milieu urbain: un bref rappel
On reconnaît généralement que la définition de la qualité de vie en milieu urbain repose sur un certain nombre de problématiques bien identifiées: la densité et la diversité du cadre de vie, l’équité sociale, la relative égalité dans l’allocation des services et des équipements, et l’accessibilité à un logement décent et abordable. Ces problématiques sont prétextes à questionner les modèles de forme urbaine développés à l’intérieur de disciplines comme la géographie sociale ou la sociologie urbaine. Les grands jalons menant à la construction de tels modèles méritent d’être rappelés.
On peut remonter aux analyses écologiques de l’école de sociologie urbaine de Chicago, pour trouver une représentation des distributions des aires naturelles (sociales) ou des phénomènes sociaux, comme la criminalité, dans l’agglomération (Grefmeyer et Joseph, 1984). Le fameux modèle de Burgess proposait, en 1925, l’hypothèse zonale et radiale, dans laquelle des trajectoires partent du loop vers la périphérie, marquant ainsi une transition entre les aires naturelles ou ethniques du centre vers la banlieue typique du style de vie «américain». De même, la criminalité s’affirmerait au centre et diminuerait vers la périphérie, avec des pointes près des zones industrielles (Cefaï, 2003: 512). Dans la même veine, les premières enquêtes urbaines en France, conduites après le second conflit mondial, comme celles de Chombart de Lauwe (1952), cherchaient à établir le rapport entre l’organisation du cadre urbain, les structures sociales et le bien-être des gens.
Aux États-Unis, à la même époque, le recours aux méthodes qualitatives sophistiquées, qui prolongeaient les tableaux statistiques des premières études écologiques, annonçait le courant de la new geography. Les études de Bell et Shevsky (1955), qui exercèrent une grande influence sur le développement de la géographie urbaine quantitativiste, proposaient une analyse de l’espace social urbain en s’appuyant sur les données de recensement afin de construire des indices de différenciation sociale qui recoupaient le statut socio-économique, le statut familial et la structure résidentielle (Murdie, 1969: 17). Appliquée à un grand nombre de villes, cette approche se déclinait à travers un ensemble de problématiques spécifiques, notamment la criminalité, les comportements électoraux ou la demande de transport intra-urbain (ibid.). L’explication des différenciations spatiales, notamment des espaces résidentiels, se trouverait, selon cette optique, dans l’intensification des relations sociales de nature économique et dans la différenciation fonctionnelle à l’intérieur de la société urbaine. Les structures sociales se reflèteraient aussi dans l’organisation du sol, les styles de vie et l’inégale qualité des espaces résidentiels, ce qui apparaît être de la ségrégation (Murdie, 1969: 21-24). Les analyses multivariées ont été d’ailleurs développées précisément pour décrire les relations entre les variables ou les attributs à l’intérieur d’une population vivant sur un territoire donné, cherchant ainsi de manière empirique à dévoiler les schémas spatiaux de l’organisation du cadre urbain et des formes de ségrégation socio-spatiales (Berry 1965; Simmons, 1965; Murdie, 1969).
En 1966, Bauer proposa la notion d’indicateurs sociaux, pour observer l’état des conditions de vie de la population à l’aide des données de recensement, et ainsi analyser leur évolution dans le temps. Une des études des années 1970 souvent citées, celle de Smith (1973), identifiait, à ce propos, les dimensions convenues et acceptées depuis comme pertinentes pour saisir les dimensions objectives de la qualité de vie en milieu urbain, soit le niveau de richesse (le revenu ou l’emploi), le milieu de vie (l’état du logement et les caractéristiques du quartier), la santé (les services offerts et les équipements disponibles), l’instruction (le niveau de scolarité), la sécurité (la criminalité), le lien social (les types de famille, la vie sociale et la démocratie) ainsi que les services de loisir et de consommation de masse. Ces études sur la qualité de vie cherchaient à couvrir un très grand nombre de variables, ainsi l’étude de Palys (1973), réalisée pour l’ancien Ministère des affaires urbaines du Canada, mais elles étaient confinées aux données de recensement. Elles tentaient d’établir la corrélation entre des éléments personnels d’ordre familial (le cycle des ménages), économique (la situation financière) et environnemental (l’habitat et l’offre de services et de loisir) (Bailly, 1981). Tous ces aspects contribuent, en effet, à distinguer les caractéristiques des différentes communautés, ou secteurs de la ville, et permettent de les comparer entre elles. On parvient ainsi à considérer simultanément la morphologie urbaine, les interactions sociales et la structure des ménages (Davies et Herbert, 1993).
Dans la même veine, l’étude réalisée par Murdie et al. (1992), pour le compte du Centre d’études prospectives sur l’habitation et le cadre de vie, retenait trois composantes générales de l’analyse de la qualité de vie en milieu urbain, pour constituer le Modèle d’orientation communautaire de l’environnement habité (MOCEH): la vitalité économique, le mieux-être social et l’intégrité environnementale. Ce modèle proposait, dans une démarche systématique, une liste d’indicateurs et de mesures spécifiques pour chacune de ces composantes. Une première phase a permis de compiler et de résumer les principales études sur la qualité de vie, tout en relevant les principales critiques adressées aux essais antérieurs, notamment celles concernant les modèles de régression ou la sommation des scores synthétiques. La seconde a consisté à identifier les sources de données disponibles afin de s’assurer que le modèle puisse être utilisé dans les milieux municipaux et ce, directement par les professionnels municipaux. La dernière phase consistait à tester le modèle dans différentes municipalités canadiennes. L’expérience a surtout permis d’envisager l’applicabilité d’un modèle à portée limitée, modeste mais réaliste, peu novateur sur le plan méthodologique, mais accessible aux utilisateurs les plus divers (Murdie et al.,1992). Dans la même intention d’offrir un outil aux professionnels municipaux, le rapport de la Fédération canadienne des municipalités (2001) proposait de mesurer la qualité de vie des collectivités à l’aide de différents indices renvoyant aux notions de capital humain (démographie et migration), de niveau de vie (revenu et coût de la vie), de qualité de l’emploi, de logement, de santé et de sécurité collective, de tension sociale et de sécurité communautaire.
Les autres dimensions soulevées dans les études sur la qualité de vie sont celles de l’environnement physique, et son pendant, la qualité de l’environnement urbain (eau, air et sol), que Perloff (1969) et Blumenfield (1969) ont identifiées, il y a plus de trente ans, comme primordiales. Ceux-ci s’interrogeaient sur les grands problèmes de la ville industrielle, la pollution, la congestion de la circulation automobile et l’insécurité des voies de circulation construites pour les déplacements motorisés. Dans cette optique, la réduction des stress environnementaux, une densité relativement élevée des espaces résidentiels et leur proximité des lieux d’emploi, de consommation et de services étaient comprises comme étant favorables à une vie urbaine de qualité. Qui plus est, le fait de pouvoir circuler à pied pour les déplacements les plus courants, comme aller au travail ou faire des courses, était tenu pour un facteur de bien-être.
On a aussi établi des corrélations entre l’organisation de l’espace (l’utilisation du sol, les infrastructures de transport, etc.) et le degré de pollution, autant à l’échelle de l’agglomération qu’à celle des différents quartiers (Berry, 1974). Plusieurs autres aspects s’y ajoutaient, parmi lesquels la conservation des milieux naturels ainsi que des considérations paysagères. Ces dimensions physiques, Gertler et Crowley (1978) ont cherché à les mettre en relation avec des paramètres économiques (la structure des revenus) et sociaux (sécurité, scolarité, accès aux services de santé, participation civique), sans omettre les conditions de logement et les institutions culturelles. Par contre, le lien entre les dimensions biophysiques et sociales a toujours souffert d’un déficit technique: les données environnementales ne sont pas toujours organisées à la même échelle que les données socio-économiques et, il faut en convenir, pas toujours constituées, non plus, avec le même niveau de raffinement. C’est ainsi que, dans le cas du MOCEH développé par Murdie, Rhyne et Bates (1992), la composante «intégrité environnementale» était traitée sommairement, se résumant à la densité résidentielle et aux dépenses d’énergie affectées au chauffage et au transport.
Dans la foulée, les tentatives d’élaboration d’indicateurs de durabilité urbaine ont visé à établir un système normatif pour évaluer les progressions de l’étalement urbain, de la consommation des ressources et des stress environnementaux (Maclaren, 1996a; 1996b; Van Wijngaarden, 2001). Les modèles développés à travers l’expérience canadienne ont surtout ciblé la mesure de l’étalement urbain et de l’utilisation des ressources, ce que certains nomment le «capital nature». Ils s’appuyaient sur des indicateurs d’état, mais aussi de résultat. L’élaboration de programmes de développement durable urbain implique le choix de grands objectifs environnementaux à atteindre. Ceux-ci peuvent être fixés à l’intérieur de processus de concertation ou de participation civique qui font une place aux groupes sociaux et aux citoyens. Ils visent plus particulièrement la mise en place de pratiques sociales à incidence environnementale, comme l’accroissement de la proportion des matières résiduelles destinées au recyclage ou l’utilisation du transport en commun, ainsi que la participation communautaire à la vie démocratique ou la densité des réseaux sociaux. Le monitoring de ces processus sociaux, ainsi que la vérification de l’atteinte, ou non, de ces objectifs constituent des manières d’évaluer le capital social ou la qualité de l’environnement d’un territoire ou d’une ville (Mclaren, 1996a; 1996b).
Parmi les dimensions longtemps oubliées, mais actuellement en émergence, il faut citer celles de la vitalité culturelle et de la diversité de l’offre de loisirs. Elles ont trouvé place depuis longtemps dans les palmarès supposés des meilleures villes (Boyer et Savageau, 1986). Les institutions et les lieux constituant la vitalité culturelle d’une ville seraient devenues des landmarks, voire des facteurs d’attractivité, à tel point que Knox (1994) n’hésite pas à identifier les hauts lieux culturels, notamment les stades urbains, les vieux ports et autres espaces de consommation culturelle, comme des facteurs de développement et de localisation d’activités économiques. La diversité sociale constituerait également un facteur de développement et de concentration d’activités économiques, de même qu’une contribution au bien-être collectif. C’est du moins l’optique défendue par Richard Florida (2001), qui tient pour un facteur décisif de croissance et de qualité de vie la présence des gays, des artistes et des personnes nées à l’extérieur des États-Unis, car ceux-ci agiraient comme des agents de tolérance, d’innovation et de croissance des nouvelles technologies. Souvent proposés, toujours critiqués, de tels aspects s’inscrivent dans le droit fil des conceptions favorables à la concentration des activités stratégiques et ludiques à l’intérieur du cadre urbain.
De cette revue brève et partielle de la littérature, il ressort que les études sur la qualité de vie posent d’emblée les facteurs socio-économiques et, au premier chef, le revenu comme centraux dans la compréhension des inégalités sociales. Le facteur de la distance est également considéré comme important. Les approches de la qualité de vie en milieu urbain valorisent ainsi un agencement de l’organisation des activités urbaines qui facilite l’accès aux ressources offertes par le milieu urbain. On note aussi l’importance accordée à la densité résidentielle et à la compacité du cadre bâti, puisque ces facteurs auraient justement une incidence sur la proximité et l’accessibilité aux aménités et services urbains. Les études soutiennent, de plus, que la qualité de l’environnement est une condition de la qualité de vie, en insistant sur la réduction des stress et sur la conservation de la nature. Elles soulignent également la nécessité de considérer les ambiances urbaines, notamment les facteurs qui contribuent à la lisibilité des lieux par les passants, aux déplacements à pied, à la qualité des espaces publics et à toutes autres choses qui rendraient les villes plus agréables à vivre. Force est de reconnaître, toutefois, que ces derniers aspects ne seront pas toujours pris en compte dans les modèles de mesure de la qualité de vie en milieu urbain. À cela, un autre aspect, et pas des moindres, a été énoncé dans les écrits se rapportant au concept de développement durable: l’équité sociale et intergénérationnelle.
La bonne forme urbaine et la qualité de vie: les clés de la théorie urbaine
Le corpus des études sur la qualité de l’environnement urbain identifie l’étalement comme le coeur du problème, ne serait-ce que parce que les problèmes de pollution, d’émission de gaz à effet de serre et d’érosion des espaces naturels en découlent directement (Sénécal et Hamel, 2001). C’est un truisme de prétendre que les niveaux de densité résidentielle et de compacité du bâti apparaissent comme deux des clés de l’analyse morphologique, notamment dans les approches issues des études environnementales. La thèse de l’empreinte écologique, par exemple, établit un lien entre les impacts environnementaux et les superficies du sol urbanisé (Rees et Roseland, 1991; Rees et Wackernagel 1994; Simmons, 1998). Par le fait même, la mobilité intramétropolitaine et la qualité de l’environnement physique, qui interagissent avec les faits de densité et de compacité, sont tenues pour importantes à l’intérieur de ce courant des études environnementales. Les tenants de la durabilité urbaine considèrent donc que la forme compacte serait plus durable, parce qu’elle réduirait les distances de déplacement, faciliterait et rentabiliserait le transport en commun, tout en permettant la conservation des milieux naturels et agricoles. Un indice synthétique de ces trois composantes ne serait-il pas de mesurer la distance des déplacements entre les espaces résidentiels et les lieux d’emploi, puisqu’il rend compte de la densité résidentielle et de la compacité du bâti tout en donnant un aperçu de la bonne prise en compte de la dépense d’énergie selon les modes de transport?
Cette forme idéale compacte n’est pas sans rappeler les modèles issus des manuels de géographie urbaine. La théorie classique de l’espace urbain est construite sur le principe de la grande valorisation du centre. Elle relève de l’idée de la concurrence entre les modes d’utilisation du sol et le système de rente. On conçoit que le gradient de la rente foncière évolue non seulement spatialement, mais aussi hiérarchiquement, selon les types d’activités et, pour les zones résidentielles, selon la différentiation sociale. Les différents modèles de la structure urbaine reconnaissent ainsi, d’une part, que la croissance des densités urbaines est tributaire de la distance à partir du centre-ville (Berry, 1965), comme l’illustre le graphique désormais classique de la distribution des valeurs foncières à Topeka au Kansas (Knos, 1962; Haggett, 1972) et, d’autre part, qu’elle est le reflet des inégalités socio-économiques (Harvey, 1973). Ces modèles reposent aussi sur l’idée qu’à la mobilité sociale correspond une mobilité spatiale: la croissance urbaine encourage le choix de localisations résidentielles en zone d’extension, comme le sous-entendait déjà la théorie des cercles concentriques de Burgess (1925). Dans sa lignée, la théorie des secteurs de Hoyt (1933) insiste sur la qualité de certains secteurs ainsi que sur leur accessibilité. La critique de ses travaux ont conduit Harris et Ullman (1945) à reformuler sa théorie en misant sur le concept des noyaux multiples.
Trois constats s’imposent alors à l’analyse spatiale en géographie urbaine dans le contexte nord-américain. En premier lieu, le gradient de densité épouse celui du coût du sol et soutient les structures écologiques de la ville: les hautes valeurs foncières du centre-ville sont révélées par l’extrême compacité du bâti et la grande accessibilité des espaces centraux (Haggett, 1972). En second lieu, la typologie résidentielle évolue également en fonction de ce gradient centre-périphérie, partant des immeubles résidentiels collectifs jusqu’aux banlieues pavillonnaires de très faible densité (Clawson, Held et Stoddart, 1960). Enfin, en troisième lieu, cette structuration dépend aussi des images de la ville (valeurs, sens, significations) et des formes constituantes du paysage urbain, parmi lesquelles on tient pour essentielle la présence de la nature (Lynch, 1981: 255-260). Les rives des plans d’eau et les hauts lieux, comme le mont Royal à Montréal, sont appropriés par les couches sociales supérieures et forment des paysages urbains fortement valorisés. Ces clés de la théorie en géographie urbaine, tenues désormais pour communes, partent de l’hypothèse que les localisations résidentielles centrales doivent s’accommoder de la grande densité du bâti et de la faible présence de la nature, tout en trouvant une compensation dans la proximité ou l’accessibilité aux lieux d’emploi et de services. A contrario, l’éloignement du centre est à son tour compensé par une accessibilité accrue à la propriété d’une maison individuelle et à de grands terrains, donc à un habitat de faible densité, sans compter la possibilité de jouir d’une nature plus accessible, encore que cette dimension ne soit pas toujours au rendez-vous de la vie de banlieue.
Ces clés de la théorie urbaine sont, comme nous l’avons souligné plus haut, sans cesse rediscutées et renouvelées, surtout depuis le troisième mouvement de périurbanisation, dans lequel les activités spécifiques se décentralisent à leur tour, après les fonctions résidentielles et commerciales. Pôles secondaires d’activités, edge cities ou banlieues majeures deviennent les dénominations d’un phénomène qui remet en question le modèle classique. Parmi les modèles d’agglomérations soumises à la discussion, la forme polycentrique revêt l’apparence d’un modèle alternatif à l’hypercentralité ainsi qu’à l’étalement urbain; elle serait susceptible de réduire les navettes, ainsi que de diminuer les émissions polluantes de même que la pression foncière sur les milieux naturels (Ewing, 1997; Sénécal et al. 2002). Le modèle d’urbanisation est aussi le reflet des choix de localisation résidentielle des ménages et de l’accessibilité aux lieux d’emploi (Levine, 1998).
Les gains environnementaux découlant d’un tel équilibre emploi-résidence ne paraissent pas évidents à Gordon et Richardson (1997), qui minimisent les gains économiques et environnementaux de la compacité. Leur objection tient surtout au fait que les emplois demeurent passablement dispersés dans les villes nord-américaines. Jusqu’à quel point les pôles d’emplois, que ce soit le centre-ville ou les pôles secondaires, accaparent-ils une forte proportion des emplois? Pour Montréal, les travaux de Coffey et al. démontrent que les pôles d’emplois, pôles primaires et secondaires confondus, ne concentrent que 37% de l’emploi métropolitain (1999: 8). En outre, ce mouvement de périurbanisation est loin d’épuiser l’évolution morphologique de l’agglomération urbaine métropolitaine, puisque la diffusion élargie des nouvelles technologies de l’information pourrait atténuer de beaucoup l’avantage comparatif de la proximité: le courrier électronique et Internet, comme le télétravail ou le téléachat, remettraient en cause la raison d’être de la ville centralisée. Rien n’est moins sûr, dans la mesure où ces modes de travail sont encore marginaux (Bussières et Lewis, 2002). Castells a tenté de faire le point sur cette question, pour conclure à la reproduction des tendances anciennes, soit à «la simultanéité de la dispersion et de la concentration spatiales sous l’effet des technologies de l’information» (1998: 448).
L’espace des flux s’inscrit dans un cadre urbain préexistant et en changement: il est le fait des mobilités et des localisations qui confortent ou bouleversent la morphologie urbaine. Les localisations résidentielles suivent des logiques de proximité et d’effet de rente, mais elles relèvent aussi de la qualité des environnements naturels et construits. Et, dans le contexte de l’étalement urbain, une interprétation courante consiste à prétendre que le centre de l’agglomération présente une bonne accessibilité aux lieux d’emplois et de services ainsi qu’aux équipements, alors que les espaces périurbains offrent une meilleure qualité de vie, notamment en raison d’une nature de proximité. Ces clichés perdurent dans les discours et les représentations collectives sur la ville, comme le montrait un sondage du journal La Presse de l’été 2000, alors que 31% des Montréalais et 50% des banlieusards déclaraient rêver de s’établir à la campagne (Pratte, 2000). Le bonheur est dans le pré, pour reprendre le titre du film d’Étienne Chatiliez, mais un écart ne subsiste-il pas entre les perceptions et la réalité?
En définitive, le défi est d’arriver à choisir les éléments fondamentaux sur lesquels fonder une analyse de la qualité de vie en milieu urbain, afin de révéler la structure de l’espace métropolitain et d’identifier les différences observables par secteurs, à micro-échelle.
Les indicateurs sociaux et environnementaux
Comment mesurer? Comment comparer? Il faut rappeler que les premières études sur la qualité de vie en milieu urbain ont davantage insisté sur l’accès aux services et aux aménités, en départageant les avantages et les inconvénients offerts par un milieu donné (Smith, 1973). En d’autres termes, on se demandait comment mesurer «un cumul d’avantages ou de désavantages sur plusieurs dimensions du cadre de vie (accessibilité, qualité visuelle des sites, services publics locaux, traitement architectural des bâtiments, etc.)» (Dansereau et Wexler, 1989: 1). Deux difficultés étaient alors identifiées. La première consistait à disposer simultanément d’informations de nature objective et subjective qui tiennent compte autant de la réalité physique d’un phénomène et de sa perception, que des dimensions qui relèvent des domaines du sensible ou de la valorisation (Greer-Wooten et Velidis, 1983; Beesley et Russwurm, 1989). Ainsi, la satisfaction en ce qui concerne le logement échappe à toute tentative de réduction aux seules conditions objectives. De la même façon, si on peut mesurer correctement la pauvreté ou l’insécurité à l’aide d’indices de défavorisation et de criminalité, il en va autrement de la perception de l’insécurité ou de la pauvreté. La perception et la valorisation se traduisent difficilement en degré, en seuil ou en niveau. Il est donc difficile de considérer des aspects dits subjectifs, généralement de nature individuelle, puis de les projeter dans une structure écologique et prétendre ainsi qu’ils reflètent un état de la collectivité. C’est pourquoi la tentation est forte de se replier sur l’analyse des conditions objectives et de s’en tenir à une analyse locale, sans chercher à lui donner une portée générale. La deuxième difficulté, qui est particulièrement abordée dans cet article, consiste à mettre en parallèle des dimensions socio-économiques et des aspects relevant de l’environnement physique, tout en sachant que, si les variables socio-économiques permettent de décrire des conditions de vie assez identifiables, comme c’est le cas pour le revenu ou le niveau de scolarité, des notions comme la compacité ou l’intégrité environnementale sont beaucoup plus floues et difficilement saisissables de manière empirique.
Les indicateurs de qualité de vie, d’environnement urbain ou de développement durable urbain, quel que soit le nom qu’on leur donne, soulèvent ainsi un intérêt renouvelé, autant parmi la communauté scientifique que dans les administrations publiques. L’indicateur est ici compris comme étant une échelle de mesure permettant de situer un état, une condition ou une tendance, en prenant appui sur un critère, un paramètre, une norme, un niveau de référence ou un objectif fixé au préalable. Il est d’abord une simplification de phénomènes complexes, construit afin d’éclairer une structure d’interactions entre les différentes composantes d’un système ou d’un écosystème. À ce propos, la mesure de l’état de l’environnement urbain fait l’objet d’une littérature déclinée tant aux échelles mondiale (OCDE, 1991; Hammond et al. 1995; United Nations, 1996) que canadienne (Dilks, 1996; Maclaren, 1996a) ou française (Levarlet et al., 1999; Rechatin et Theys, 1997). Elle tente d’établir une passerelle entre les approches normatives, évaluatives et procédurales, juxtaposant des portraits statistiques, des études d’impacts et des évaluations de l’atteinte des grands objectifs sociaux ou environnementaux.
Figure 2
La qualité de vie dans la région de Montréal.
Elle est donc vaste la littérature sur les indicateurs environnementaux, comprenant différents types d’approches, notamment celles conçues dans l’optique des bilans environnementaux, dits d’état, de rendement, d’outputs ou de progrès. Toutes ces variantes posent les mêmes limites et présentent les mêmes difficultés méthodologiques, en particulier quand vient le temps de comprendre et d’observer le fait urbain dans toute sa complexité, notamment de rendre compte des dynamiques d’acteurs et des interactions sociales qui ne manquent pas d’interférer sur l’évolution de la structure métropolitaine (Sénécal et Hamel, 1996; 2001). La première difficulté est de mesurer les formes concrètes de l’environnement, celles qui sont vécues à l’échelle du sujet, notamment à celle de l’unité de voisinage. La seconde est de définir les composantes significatives de la qualité des environnements naturels et construits à l’intérieur d’un cadre d’analyse qui soit synthétique, susceptible d’être reproduit et n’exigeant pas, pour les opérateurs de modèles d’analyse, de ressources démesurées par rapport aux moyens disponibles.
Les modèles de mesure de la qualité de vie et de l’environnement exigent, pour intégrer toutes les composantes de l’écologie, de l’économie et du social, de rassembler des informations encore éparses, dont celles de type socio-économique issues des recensements nationaux, généralement accessibles et souvent de grande qualité. Il arrive aussi que, s’agissant de mesurer l’état de l’eau, de l’air ou du sol, des informations disponibles permettent de documenter relativement bien la situation de telle ou telle ville. Il en va de même de la densité de la population (nombre d’habitants au km2) ou des superficies des espaces verts (le ratio des espaces verts par habitant). D’autres dimensions ne sont pas aussi faciles à documenter. Les informations disponibles restent fragmentaires et ne sont pas toujours construites de manière systématique, la première de celles-ci étant certainement le paysage, notamment les formes architecturales (Eberhard, 1996); la seconde concerne la place de la nature dans la ville, dont l’aménagement des espaces libres et des aires de conservation (Weber et Hirsh, 1992); sont aussi mentionnés avec insistance les effets des densités ou des compacités du cadre bâti sur l’environnement (Newman et Kenworthy, 1999; Lesaffre et al., 1999; Fouchier, 1997; Durbiano et de Reparez, 1993). Par contre, pour comprendre de manière globale l’organisation et la morphologie urbaine, l’utilisation de l’imagerie satellitaire permet de tenir compte des formes de l’habitat, de la densité, de la distribution des activités, ainsi que de la répartition des espaces libres (Chesnais et al., 1992; Hathout et Romanowski, 1993; Buckley et Mookherjee, 1999). Ce rapport entre les discontinuités morphologiques et la distribution de la végétation sous-tend la typologie des quartiers, en termes urbanistiques ou énergétiques (Eberhard, 1996; Chesnais et al. 1992).
Après avoir passé en revue les écrits sur la qualité de vie et la forme urbaine, en cherchant à repérer tous les aspects soulevés (d’ailleurs beaucoup trop nombreux pour qu’on puisse les intégrer aisément dans un modèle synthétique de mesure), nous souhaitons revenir à nos objectifs initiaux, qui étaient justement de proposer une approche synthétique pouvant être mise en opération relativement facilement, en ne recourant qu’à un nombre limité d’indicateurs, ne retenant que ceux qui apparaissent comme centraux. Quatre aspects se dégagent ainsi des écrits cités précédemment, qui forment en quelque sorte les éléments fondamentaux de la forme urbaine: (a) l’intensité de l’urbanisation mesurée en termes de densité ou de compacité (l’organisation du bâti); (b) les discontinuités dans l’utilisation du sol permettant l’intrusion de la nature dans la ville, dont les espaces verts sont le cas de figure; (c) la typologie résidentielle en fonction de la valeur foncière; et enfin (d), l’accessibilité exprimée par la mobilité personnelle dans les déplacements intra-urbains, notamment la distance des déplacements résidence-travail, dont un certain nombre se font vers les pôles d’emplois comme celui du centre-ville. Mis en commun dans une démarche intégrée, ces quatre aspects paraissent rendre compte, de manière générique, de la forme urbaine dans l’optique de la mesure de la qualité de vie et de l’environnement. Ils complètent les variables socio-économiques et d’habitat disponibles dans le recensement canadien. Ils seront utilisés dans le cadre d’un exercice qui consiste à dresser une esquisse typologique des espaces urbains.
Esquisse typologique des espaces urbains: la région métropolitaine de Montréal
Notre démarche recourt aux variables de base de la qualité des environnements urbains, notamment celles concernant le rapport végétal-minéral, le gabarit du bâti, la distance par rapport au centre-ville, la localisation de l’emploi, la valeur foncière et le statut socio-économique. Les variables retenues proviennent du recensement canadien, de l’imagerie satellitaire et de l’enquête origine-destination de la région métropolitaine de Montréal (MTQ-AMT). Les données sont compilées par secteur de recensement (SR). La méthodologie utilisée consiste d’abord en une analyse factorielle qui, en regroupant les variables en présence autour d’axes ou de facteurs communs, sert à dégager une structure non apparente. Ainsi, des sous-ensembles de variables mesurent, soit en s’opposant, soit en pointant dans le même sens, une dimension particulière d’une réalité complexe que l’on cherche à représenter. Des scores sont ensuite calculés pour refléter la contribution de chaque variable aux facteurs ou dimensions identifiés. Sur la base de ces scores, chaque unité, les secteurs de recensement en l’occurrence, reçoit à son tour un score pour chacun des facteurs. Une analyse de classification hiérarchique est ensuite réalisée sur les secteurs afin de les regrouper selon un critère de similarité, c’est-à-dire en fonction de leur proximité dans l’espace engendré par les dimensions précédemment identifiées. Ainsi les secteurs présentant un profil semblable, basé sur les scores obtenus sur les différents facteurs, forment des classes qui peuvent ensuite être associées à divers degrés à ces mêmes facteurs. Le nombre idéal de classes n’existe pas: s’il est trop grand, il fournit certes des classes plus homogènes, mais trop nombreuses pour qu’il soit possible d’y voir clair et d’y discerner un quelconque principe d’organisation; s’il est trop petit, les classes seront très hétérogènes et difficiles à caractériser ou à qualifier. Il faut donc accepter de perdre une partie de la richesse des informations pour y voir clair et discerner un principe d’organisation. En rassemblant des secteurs relativement similaires, on perd une bonne partie de la richesse des informations et on épure l’image qu’on se fabrique, la représentation qu’on se donne de la réalité; mais on troque cette perte d’information pour un gain de clarté. C’est finalement là une démarche très banale en recherche, en géographie comme ailleurs: sacrifier les détails pour clarifier la visibilité des structures et des régularités et faire apparaître ce qui est estimé, par hypothèse, intéressant.
L’approche synthétique met ainsi en scène un nombre limité de variables correspondant aux aspects sociaux, morphologiques et environnementaux du cadre urbain (tableau 1). Leur mise en commun offre une approche accessible, reproductible et donnant une représentation fidèle de la structure métropolitaine.
Tableau 1
Les neuf variables utilisées dans l’analyse factorielle
Il est également nécessaire de tenir compte de l’organisation générale de l’espace montréalais, en considérant sa relative concentration des activités et de l’espace résidentiel à l’intérieur d’un noyau central, malgré son caractère étalé. Les cinq pôles d’emplois (Coffey et Drolet, 1994) et le centre de l’agglomération se situent dans un rayon de 15 kilomètres partant de la place Ville-Marie, définie comme le haut-lieu, ne serait-ce que symbolique, du centre des affaires (figure 2a). La notion de centre de l’agglomération reflète l’intensité de l’urbanisation qu’exprime la distribution des indices de compacité résidentielle, de compacité industrielle, commerciale et institutionnelle (ICI), ainsi que de végétation (figures 2b, 2c et 2d). Nous utilisons ainsi, d’une part, des indices construits de manière standard, à l’aide de la télédétection, comme l’indice de végétation (Bonn, 1992; 1996) ou les indices de compacité résidentielle et de compacité non résidentielle (incluant les formes associées aux fonctions industrielle, commerciale et institutionnelle) découlant d’une classification des utilisations du sol. La forme urbaine ne se rapporte-elle pas également à l’organisation du bâti résidentiel, industriel, commercial et institutionnel qui structure le paysage urbain? Il est connu que les densités résidentielles peuvent donner une impression déformée de cette réalité: ainsi un espace résidentiel très compact jouxtant une zone industrielle inhabitée ou un grand parc pourra être compris comme étant de faible densité du simple fait d’amalgamer les deux entités. Afin de mieux apprécier l’organisation du cadre urbain, on recourt à un indice de compacité qui tient uniquement compte du bâti. Cet indice est construit à partir d’une classification du sol réalisée à l’aide d’une image satellitaire, qui différencie l’urbanisation forte et faible en tenant compte des gabarits d’édifice et du rapport entre l’espace construit et les espaces libres[1]. Un tel indice donne un bon aperçu de l’organisation du bâti et finalement de sa capacité à créer de la proximité entre les lieux de résidence et d’activités, contribuant ainsi à la diminution des distances parcourues en automobile.
S’il s’agit de mettre en évidence la structure de la région métropolitaine, cet essai synthétique capitalise sur les données accessibles et disponibles, agrégées à l’échelle des secteurs de recensement, soit de 773 unités de base du recensement canadien[2], renvoyant aux trois aspects cités précédemment. La méthodologie suivie permet, en effet, de dresser une esquisse de typologie des plus synthétiques des espaces urbains selon les aspects morphologiques, économiques et environnementaux. Elle décompose les informations en trois dimensions: l’intensité urbaine, la localisation de la richesse et la répartition des activités ICI. On observe ainsi les zones associées aux quartiers péricentraux denses et compacts du centre de l’agglomération, ainsi que la vaste couronne des nouveaux espaces résidentiels de faible densité, avec un fort pourcentage de propriétaires; il en ressort une localisation de la richesse à partir du revenu des ménages qui va de pair avec les valeurs foncières et locatives élevées; enfin la répartition des activités suit la compacité industrielle, commerciale et institutionnelle (ICI) qui attirent d’ailleurs un grand nombre de travailleurs.
Trois axes se trouvent ainsi structurés et situent les différentes observations (ici les secteurs de recensement) les uns par rapport aux autres (figure 3). Le premier, celui de l’intensité urbaine, met en perspective les quartiers péricentraux et anciens de Montréal, denses, proches du centre-ville, dont la typologie résidentielle est associée à un fort taux de locataires et, à l’opposé, les espaces des banlieues de faible densité ou de faible compacité résidentielle, localisés à bonne distance du centre-ville, où dominent les propriétaires de maisons récentes, organisés dans un environnement marqué par un indice de végétation fort, rappelant ainsi que 60% de l’espace métropolitain est encore libre, vert ou agricole. Le second correspond à la localisation de la richesse qui se projette sur les espaces résidentiels cossus, avec des scores élevés pour les hauts revenus et les loyers chers, et un niveau de propriétaires relativement élevé. Il est intéressant de constater que ces secteurs n’apparaissent ni éloignés du centre-ville ni de très faible densité, et qu’ils attirent un certain nombre d’emplois. Cela s’explique par le fait que ces quartiers cossus se trouvent pour la plupart sur le pourtour de la montagne et correspondent à Westmount, Outremont et Mont-Royal, ainsi qu’à la Cité du Havre (les immeubles résidentiels situés sur une partie du port de Montréal, dont le fameux Habitat 67), à courte distance du centre-ville. Il faut ajouter les anciennes banlieues-jardins du West Island (ouest de l’île de Montréal) et de rares banlieues cossues accrochées à des sites naturels de qualité, comme les monts Saint-Hilaire et Saint-Bruno sur la Rive-Sud, ou la municipalité de Lorraine en couronne Nord. Est-ce à dire que les riches continuent de loger à proximité du centre-ville et qu’ils ont peu tendance à se regrouper dans les banlieues plus récentes? À l’exception de l’extrême ouest de l’île, une telle affirmation semble se vérifier. Le troisième met en scène les pôles d’activités, à forte compacité ICI et à grande capacité d’attraction pour l’emploi.
Figure 3
Caractérisation des trois facteurs
Reportée sur la carte (figure 2e, 2f), l’analyse offre une image qui concorde avec nos connaissances intuitives de la ville tout en nuançant certaines idées formulées a priori. Elle fait ressortir une image assez nette de l’agglomération, reflétant le poids respectif des héritages anciens et des tendances récentes de l’urbanisation. Par ailleurs, le facteur ICI, qui correspond aux pôles d’emplois déjà bien identifiés dans les études spécialisées sur la question, met en évidence le rôle du pôle de Saint-Laurent dans le secteur manufacturier (Coffey et Drolet, 1994; Coffey et al. 1999) et le rôle des équipements portuaires, du canal de Lachine, des zones industrielles du complexe pétrochimique de l’est de l’île, ainsi que du pourtour de l’aéroport de Dorval, tandis que le pôle d’emploi de la Rive-Sud de Montréal, qui accueille une proportion significative d’emplois, ne s’illustre pas par de grandes surfaces de type ICI. Les espaces d’urbanisation intense ont par contre gagné la Rive-Sud et l’île de Laval où un espace compact de type ICI a pris place. La vaste ceinture périurbaine ne se démarque pas autrement que par sa dominante résidentielle de faible densité, comme terre d’accueil de la classe moyenne. Elle apparaît plus verte qu’elle ne l’est vraiment, formant des entrelacs entre la banlieue et la zone agricole.
Conclusion
Le but de ce test était d’approcher, par une représentation synthétique, la forme de l’agglomération montréalaise dans une optique de mesure de la qualité des environnements naturels et construits, à l’échelle des secteurs de recensement et ce, à partir de variables, certes en nombre limité, mais représentatives de certaines des réalités vécues à l’échelle de l’individu: le revenu, l’accès à la propriété, les distances parcourues vers le centre-ville et la proximité des lieux de travail, ainsi que la présence du couvert végétal et la forme du bâti. À cet égard, ce test, qui consistait à utiliser un nombre limité de variables, mêlant les données socio-économiques et environnementales, apparaît comme réussi, même s’il faut reconnaître son caractère limité.
Chemin faisant, l’exercice a permis de revoir les clés de la théorie urbaine et d’évaluer leur pertinence actuelle. Il faut reconnaître le maintien d’une structure spatiale construite sur le système de rente et le poids dominant du centre, bien que la localisation de l’emploi rende compte de pôles secondaires intercalés dans une structure étalée. Force est d’admettre qu’avec son centre-ville encore dominant, ses quartiers riches autour du mont Royal, l’importance des équipements portuaires et aéroportuaires et les deux grands espaces industriels de Saint-Laurent et de Dorval ainsi que de Montréal-Est, la région métropolitaine de Montréal reste largement tributaire des formes anciennes. Elle l’est également vis-à-vis des trois constats classiques de la théorie urbaine; le gradient de densité épouse encore celui de la rente foncière, tout en structurant la typologie résidentielle et en tenant compte des grandes images de la cité, entre autres des hauts lieux de nature, dans ce cas le mont Royal et le fleuve Saint-Laurent. L’exercice démontre que la polarisation centre/banlieue typique des métropoles héritées de l’âge industriel tient toujours, même si l’émergence d’une certaine polycentricité vient modifier l’ordre des choses, mais de manière plus modeste que prévue, puisque les pôles secondaires demeurent relativement proches du centre-ville. Enfin, les banlieues logées à l’extérieur du halo central de l’agglomération offrent l’image d’une trompeuse homogénéité. L’approche synthétique utilisée ne permet pas de faire ressortir les caractéristiques originales des banlieues de la deuxième couronne. Celles-ci résistent finalement à une analyse ne retenant que certaines des clés des études urbaines qui, faut-il le rappeler, ont été construites pour comprendre l’organisation de la ville industrielle de type classique. Elles se démarquent par cet habitat de faible densité qui, largement occupé par la classe moyenne, se situe au contact de la frange agricole. Il faudra compléter ultérieurement l’analyse et l’ouvrir à de nouvelles dimensions afin de saisir les caractéristiques et les différences qui distinguent les banlieues les unes des autres. Les analyses de morphologie urbaine n’épuisent donc pas tout le potentiel de la dynamique urbaine.
La question posée par cet article concernait la mesure de la qualité de vie et de l’environnement. L’exercice a permis de croiser des variables socio-économiques, urbanistiques et environnementales, pour délimiter des espaces sociaux de richesse et de proximité. Il a aussi reconnu les banlieues de faible densité, sans toutefois parvenir à les caractériser autrement que par l’accès à la propriété et une relative proximité de la nature.
Une dernière précision s’impose concernant les modèles de la structure métropolitaine développés en études urbaines. Il a été constaté que la forme de l’agglomération demeure relativement stable, et que le développement urbain a conduit à une sorte de dilution des espaces résidentiels et des activités, ce qui est le propre de la forme étalée, mais sans dévitaliser le centre et souvent au profit de pôles secondaires placés aux marges du halo central. Faut-il interpréter une telle constante comme la confirmation des modèles explicatifs de la structure métropolitaine et des localisations spécifiques? Il faut nuancer cette interprétation, car si les effets de rente semblent toujours fonctionner, il est bien difficile d’expliquer, par exemple, les phénomènes de concentration et de dispersion qui paraissent curieusement coexister, peut-être en interdépendance, dans le développement d’une métropole postindustrielle comme Montréal. L’importance du centre-ville de Montréal dans l’organisation des activités n’est-elle pas attribuable, du moins en bonne partie, aux legs du passé et, peut-être encore davantage, aux interventions soutenues des pouvoirs publics qui, tous niveaux confondus, ont voulu en perpétuer le poids relatif?
Appendices
Remerciements
Les auteurs remercient Jean Boivin pour sa contribution à l’analyse satellitaire ainsi que Julie Archambault, géocartographe à l’INRS-UCS, pour la réalisation des cartes. Gilles Sénécal est redevable au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) pour sa contribution financière.
Notes
-
[1]
L’indice de compacité résidentielle est calculé, pour chacun des secteurs de recensement, à partir de la classification des utilisations du sol (classes urbain fort et urbain faible) de la manière suivante: urbain fort + urbain faible / surface totale. Le calcul de la compacité industrielle suit le même procédé: classe industrie / surface totale.
-
[2]
Nous n’avons utilisé que 759 des 773 secteurs de recensement, puisque les 24 autres présentaient des valeurs manquantes.
Bibliographie
- ABRAMSON, Allan J., TOBIN, Mitchell S. et VANDERGOOT, Matthew R. (1995) The Changing Geography of Metropolitan Opportunity: The Segregation of the Poor. Housing Policy Debate, no 6, pp.45-72.
- BAILLY, Antoine (1981) Géographie du bien-être. Paris, Presses universitaires de France.
- BAILLY, Antoine (1984) La géographie des représentations: espaces perçus, espaces vécus. Dans Antoine Bailly (dir.) Les concepts de la géographie humaine, Paris, Masson, pp. 133-138.
- BAUER, Raymond A. (1966) Social Indicators. Cambridge, MIT Press.
- BEESLEY, Kenneth B. et RUSSWURM, Lorne H. (1989) Social Indicators and Quality of Life Research: Toward Synthesis. Environments, vol. 20, no 1, pp. 21-39.
- BELL, William et SHEVSKY, Eshref (1955) Social Area Analysis: Theory, Illustrative Application and Computational Procedures. Stanford, Stanford University Press.
- BERRY, Brian J. L. (1965) Internal structure of the City. Law Contemporary Problems, vol. 30, no 1, pp. 111-119.
- BERRY, Brian J. L. (dir.) (1974) Land Use, Urban Form and Environmental Quality. Research Paper no 155, University of Chicago, Department of Geography.
- BLUMENFELD, Hans (1969) Criteria for Judging the Quality of the Urban Environment. Urban Affairs Annual Reviews, pp. 137-164.
- BONN, Ferdinand (1992) Précis de télédétection, volume 1: Principes et méthodes. Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec.
- BONN, Ferdinand (1996) Précis de télédétection, volume 2: Applications. Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec.
- BOYER, Richard et SAVAGEAU, David (1986) Places Rated Almanac: Your Guide to Finding the Best Places to Live in America. New York, Rand McNally.
- BUCKLEY, Patrick H. et MOOKHERJEE, Debnath (1999) Non-metric conceptual clustering: a new tool for investigating urban quality of life. Cybergeo, no 109.
- BUSSIÈRE, Yves et LEWIS, Paul (2002) Impact of telework and flexitime on reducing future urban travel demand: the case of Montreal and Québec (Canada), 1996-2016. Dans Lance J. Sucharov et al. (dir.) Urban Transport VIII. Transport and The Environment in the XXIst Century, Wessex, WIT Press, pp. 279-298.
- CAMPBELL, Angus, CONVERSE, Philip et RODGERS, Willard L. (1976) The Quality of American Life. New York, Russell Sage Foundation.
- Canadian Journal of Urban Research (2001) Urban Quality of Life. Vol. 10, no 2.
- CASTELLS, Manuel (1998) La société en réseaux. L’ère de l’information. Paris, Fayard.
- CEFAï, Daniel (2003) L’enquête de terrain. Paris, La Découverte.
- CHESNAIS, Michel, CANTAT, Olivier et HAMEL, Philippe (1992) Le district urbain de Caen à travers l’imagerie satellitaire. Norois, vol. 39, no 155, pp. 349-359.
- CHOMBART de LAUWE, Paul-Henri et al. (1952) Paris et l’agglomération parisienne. Paris, Presses universitaires de France.
- CLAWSON, Marion, HELD, R. Burnell et STODDART, Charles H. (1960) Land for the future. Baltimore, Johns Hopkins Press.
- COFFEY, William et DROLET, Réjean (1994) La décentralisation intramétropolitaine des activités économiques dans la région de Montréal, 1981-1991. Cahiers de géographie du Québec, vol. 38, no 105, pp. 371-394.
- COFFEY, William, MANZAGOL, Claude et SHEARMUR, Richard (1999) La répartition spatiale de l’emploi dans la région métropolitaine de Montréal, 1996. Montréal, Ministère des Affaires municipales et de la Métropole.
- DANSEREAU, Francine et WEXLER, Martin (1989) Nouveaux espaces résidentiels. Types d’espaces et indicateurs de qualité. Rapport de recherche, Montréal, INRS-Urbanisation.
- DANSEREAU, Pierre (1977) Un cadre écologique pour les aménités de la ville. Diogène, no 98, pp. 3-28.
- DAVIES, Wayne K.D. and HERBERT, David T. (1993) Communities within Cities: An Urban Social Geography. Londres, Bethoven Press.
- DILKS, David (1996) Atelier sur les indicateurs au Canada, compte-rendu de l’atelier. Ottawa, Direction générale de l’état de l’environnement, Environnement Canada.
- DURBIANO, Claudine et REPARAZ, André de (1993) Les espaces flous des franges périurbaines de la Basse Provence. Méditerranée, nos 1-2, pp. 25-30.
- EBERHARD, Jean-Michel (1996) Typologie de quartiers urbains établie à partir d’une méthode de description systématique des paysages. L’Espace géographique, no 1, pp. 76-87.
- EWING, Reed (1997) Is Los Angeles-Style Sprawl Desirable? Journal of the American Planning Association, vol. 63, no 1, pp. 107-126.
- Fédérations canadiennes des municipalités (2001) La qualité de vie dans les agglomérations canadiennes. Deuxième rapport, Ottawa.
- FLORIDA, Richard (2001) Technology and Tolerance: The Importance of Diversity to High-Technology Growth. Washington, The Brookings Institution.
- FOUCHIER, Vincent (1997) Les densités urbaines et le développement durable. Le cas de l’Ile-de-France et des villes nouvelles. Paris, Éditions du Secrétariat général du Groupe central des villes nouvelles.
- GALSTER, George C. et KILLEN, Sean (1995) A Geography of Metropolitan Opportunity: A Reconnaissance and Structural Framework. Housing Policy Debate, no 6, pp. 7-43.
- GERMAIN, Annick (1984) Les courants de réforme urbaine à Montréal au tournant du siècle. Les cahiers du CIDAR, Département de sociologie, Université de Montréal.
- GERTLER, Len O. et CROWLEY, Ron W. (1978) L’évolution des villes du Canada d’ici l’an 2000. Ottawa, Ministère des Affaires urbaines.
- GORDON, Peter et RICHARDSON, Harry W. (1997) Are Compact Cities a Desirable Planning Goal? Journal of the American Planning Association, vol. 63, no 1, pp. 95-106.
- GREER-WOOTEN, Bryn et VELIDIS, Stavros (1983) The Relationships Between Objective and Subjective Indicators of the Quality of Residential Environments. Ottawa, Société canadienne d’hypothèques et de logement.
- GREFMEYER, Yves et JOSEPH, Isaac (dir.) (1984) L’école de Chicago, naissance de l’écologie urbaine. Paris, Aubier.
- HAGGETT, Peter (1972) Geography. A Modern Synthesis. New York, Harper Row.
- HAMMOND, Allan, ADRIAANSE, Albert, RODENBERG, Eric, BRYANT, David et WOODWORD, Richard (1995) Environmental indicators: A Systematic Approach to Measuring and Reporting on the Environment in the Context of Sustainable Development. Washington, World Resources Institute.
- HARRIS, Chauncy D. et ULLMAN, Edward L. (1959) The Nature of Cities. Dans Harold M. Mayer et Clyde F. Kohn (dir.) Readings in Urban Geography, Chicago, The University of Chicago Press, pp. 277-286.
- HARVEY, David (1973) Social Justice and the City. Londres, Arnold.
- HATHOUT, Salah et ROMANOWSKI, J. (1993). Strategies for an environmental zonal evaluation of the city of Winnipeg. University of Winnipeg, Institute of Urban Studies, Urban Research no 3.
- HOYT, Homer (1933) One hundred years of land values in Chicago. The relationship of the growth of Chicago to the rise in its land values, 1930-1933. Chicago, The University of Chicago Press.
- JACOBS, Jane (1961) The Death and Life of Great American Cities. New York, Vintage Books.
- KNOS, Duane S. (1962) Distribution of Land Values in Topeka Kansas. University of Kansas, Center for Research in Business.
- KNOX, Paul (1994) Urbanization. An Introduction to Urban Geography. Englewood Cliff (N.J.), Prentice Hall.
- LESAFFRE, Benoît et al. (1999) Ville, densités urbaines et développement durable. Paris, Ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement.
- LEVARLET, François (1999) Les indicateurs de développement durable. Méthodes et perspectives. Paris, Institut français de l’environnement.
- LEVINE, Jonathan (1998) Rethinking Accessibility and Job-Housing Balance. Journal of the American Planning Association, vol. 64, no 2, pp. 133-149.
- LIU, Ben-Chieh (1976) Quality of life indicators in U.S. metropolitan areas: a statistical analysis. New york, Praeger.
- LYNCH, Kevin (1960) L’image de la cité. Paris, Dunod.
- LYNCH, Kevin (1981) Good City Form. Cambridge, MIT Press.
- MACLAREN, Virginia (1996a) Élaboration d’indicateurs de durabilité urbaine: gros plan sur l’expérience canadienne. Toronto, Centre intergouvernemental de recherches urbaines et régionales.
- MACLAREN, Virginia (1996b) Urban Sustainability Reporting. Journal of the American Planning Association, vol. 62, no 2, pp. 184-201.
- MURDIE, Robert A. (1969) Factorial Ecology of Metropolitan Toronto, 1951-1961. University of Chicago, Research papers, Department of Geography.
- MURDIE, Robert A., RHYNE, Darla et BATES, Judy (1992) Modélisation des indicateurs sur la qualité de vie au Canada: une étude de faisabilité. Ottawa, Centre d’études prospectives sur l’habitation et le cadre de vie.
- NEWMAN, Peter et KENWORTHY, Jeffrey (1999) Sustainability and Cities. Overcoming Automobile Dependence. Washington, Island Press.
- NOLL, Heinz-Herbert (2003) Social Indicators and Social Reporting: the International Experience. [En ligne]. http://www.ccsd.ca/noll1.html
- OCDE (1991) Indicateurs d’environnements urbains. Paris, Organisation pour la coopération et le développement économique.
- PALYS, Ted S. (1973) Social indicators of quality of life in Canada: A practical/theoretical report. Ottawa, Ministère des Affaires urbaines.
- PERLOFF, Harvey S. (1969) The Quality of the Urban Environment. Baltimore, Johns Hopkins Press.
- PRATTE, André (2000) Un rêve: habiter à la campagne. La Presse, 11 juin, pp. A1-A2.
- RECHATIN, Catherine, THEYS, Jacques et al. (1997) Indicateurs de développement durable: bilan des travaux étrangers et éléments de réflexion. Paris, Institut français de l’environnement.
- REES, William E. et ROSELAND, Mark (1991) Sustainable Communities: Planning for the XXIst century. Plan Canada, vol. 31, no 3, pp. 15-26.
- REES, William E. et WACKERNAGEL, Mathis (1994) Our Ecological Footprint. Gabriola Island (B.C.), New Society Publishers.
- SCHMANDT, Harry et BLOOMBERG, Warner (1969) The Quality of Urban Life. Beverly Hill, Sage Publications.
- SÉNÉCAL, Gilles et HAMEL, Pierre J. (1996) L’écologie humaine et le développement durable, la dialectique des écosystèmes et des systèmes sociaux. Environments, vol. 24, no 2, pp. 43-64.
- SÉNÉCAL, Gilles et HAMEL, Pierre J. (2001) Ville compacte et qualité de vie: discussions autour de l’approche canadienne des indicateurs de durabilité. Le Géographe Canadien, vol. 45, no 2, pp. 306-318.
- SÉNÉCAL, Gilles, HAF, Rémi, HAMEL, Pierre J., POITRAS, Claire et VACHON, Nathalie (2002) La forme urbaine polycentrique et la réduction des gaz à effet de serre: étude sur Montréal. Revue Canadienne de Sciences Régionales, vol. 25 no 2, pp. 135-152.
- SIMMONS, James W. (1965) Descriptive Models of Urban Land Uses. The Canadian Geographer, vol. 9, no 3, pp. 170-174.
- SIMMONS, Craig (1998) The Environmental Footprint. Urban Quality Indicators, vol. 10, pp. 1-3.
- SMITH, David M. (1973) The Geography of Social Well-Being in the United States. An Introduction to Territorial Social Indicators. New York, McGraw-Hill.
- TOWNSHEND, Ivan J. (2001) The Contribution of Social and Experiential Community Structures to the Intra-Urban Ecology of Well-Being. Canadian Journal of Urban Research, vol. 10, no 2, pp. 175-215.
- United Nations (1996) Indicators of Sustainable Development. Framework and Methodologies. New York.
- Urban Affairs Annual Review (1969) The Quality of Urban Life. Londres, Sage Publications.
- Urban Quality Communications (1996-2002) Urban Quality Indicators. Ann Arbour (MI).
- Van WIJNGAARDEN, Thomas (2001) Indicators of Sustainable Development. Dans Dimitri Devuyst (dir.) How Green is the City? New York, Columbia University Press, pp. 251-274.
- WEBER, Christine et HIRSH, Jacky (1992) Some urban measurements from SPOT data: urban life quality indices. International Journal Remote Sensing, vol. 13, no 17, pp. 3251-3261.
List of figures
Figure 1
Région de Montréal: unités d’analyse
Figure 2
La qualité de vie dans la région de Montréal.
Figure 3
Caractérisation des trois facteurs
List of tables
Tableau 1
Les neuf variables utilisées dans l’analyse factorielle



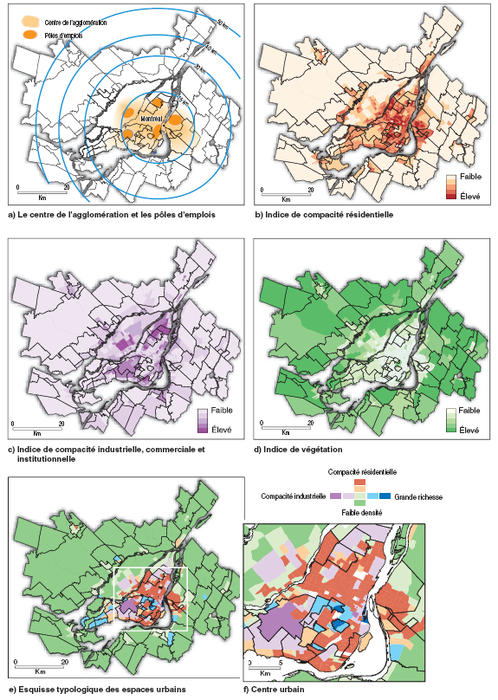
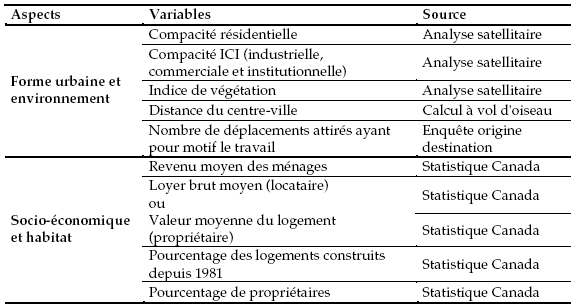
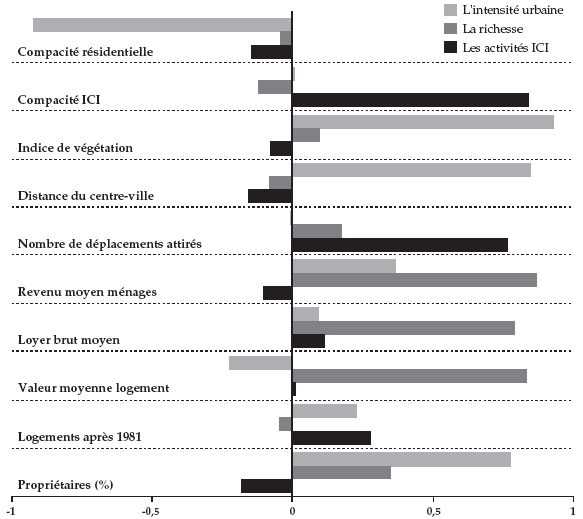
 10.7202/022455ar
10.7202/022455ar