Abstracts
Résumé
Le travail social est une profession qui s’est grandement transformée au cours des dernières décennies, modulée par les diverses transformations sociales, politiques et organisationnelles de la société dans laquelle elle évolue. Or, on retrouve aujourd’hui des recherches de plus en plus diversifiées, où plusieurs visions du travail social coexistent. Ces visions multiples s’accompagnent de valeurs et de principes, mais également d’idéologies tantôt dominantes, tantôt marginales. Les peuples autochtones sont l’un des groupes les plus marginalisés et leurs visions du monde le sont tout autant au sein de la profession. Aujourd’hui, il semble y avoir une volonté de reconnaître la pluralité des savoirs en travail social. Le présent article poursuit cet objectif en présentant le paradigme autochtone en recherche. Il s’agit d’une réflexion théorique qui s’articule autour du contexte historique menant à la création du paradigme, une description de ce qui le compose de même qu’une présentation de quelques exemples de son utilisation par des chercheurs en travail social. Enfin, l’article met en lumière certains enjeux persistants quant à la reconnaissance du paradigme autochtone au sein de la profession.
Mots-clés :
- paradigme autochtone,
- recherche,
- travail social,
- épistémologies,
- méthodologies
Abstract
Social work as a profession has undergone significant change in recent decades, modulated by the various social, political, and organizational transformations of the society in which it evolves. Today, there is increasingly diversified research encompassing a number of coexisting visions of social work. These multiple visions come hand in hand with values, principles, as well as ideologies, some of which are dominant, and others that are marginal. Indigenous peoples are among the most marginalized groups in society and so are Indigenous worldviews within the profession. Currently, there seems to be a willingness to recognize the plurality of knowledge in the area of social work. In line with this objective, the purpose of this article is to present the Indigenous research paradigm. This is a theoretical contemplation centred around the historical context that led to the paradigm’s creation, a description of what it consists of, as well as a presentation of a few examples of its use by social work researchers. Finally, the paper brings up certain persistent issues related to the recognition of the Indigenous paradigm within the profession.
Keywords:
- Indigenous paradigm,
- research,
- social work,
- epistemologies,
- methodologies
Article body
Depuis les dernières décennies, il est reconnu que les sciences sociales sont marquées par des inégalités importantes en matière de ressources, de reconnaissances et d’autorité, les institutions de recherche en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord occupant une position centrale d’influence et de prestige (Connell, Beigel et Ouédraogo, 2017). Évidemment, les paradigmes, méthodologies et objets d’étude sont le reflet de la position sociale des chercheurs et crée une certaine hégémonie scientifique au sein des disciplines du « social ». À cet égard, plusieurs auteurs soulignent l’urgence de reconnaître la diversité épistémique en travail social, une profession qui prône l’importance du respect, de l’autodétermination et qui souhaite mettre de l’avant la pluralité des savoirs (Connell et coll., 2017; Dominelli et Ioakimidis, 2016; Smith, 2012). Les efforts de différents chercheurs pour contrer l’impérialisme scientifique (Cajete, 2000; Little Bear, 2000) se sont traduits par le développement d’un nouveau paradigme de recherche : le paradigme autochtone. Bien que plusieurs auteurs fassent état de ce paradigme émergent, il existe encore peu d’écrits abordant l’ontologie, l’épistémologie et la méthodologie qui le constitue. La posture du chercheur et les principes éthiques qui sous-tendent ce paradigme sont abordés par certains écrits (Hart, 2010; Wilson, 2008), mais de façon parcimonieuse et éclatée. La littérature francophone sur le sujet est également quasi inexistante. Or, c’est l’étude des paradigmes qui prépare chaque chercheur à « devenir membre d’un groupe scientifique particulier » (Kuhn, 1972, p. 25). La connaissance des paradigmes émergents a alors des implications pour toutes les disciplines de recherche, notamment celle du travail social. Le présent article vise ainsi à contribuer à la littérature naissante et porte spécifiquement sur le paradigme autochtone en recherche, le contexte historique menant à son apparition, ce qui le compose de même que les enjeux persistants quant à sa reconnaissance au sein du travail social. À cet égard, nous nous appuierons sur la littérature canadienne et internationale provenant majoritairement de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis, du Mexique et de l’Afrique.
Définition des termes
Paradigme
Avant de mettre en exergue le paradigme autochtone, il convient de revenir à la définition d’un paradigme telle qu’elle a été développée par Kuhn (1983). Pour ce physicien et historien des sciences, ce concept renvoie notamment à « l’ensemble de croyances, de valeurs reconnues et de techniques qui sont communes aux membres d’un groupe donné » (Kuhn, 1983, p. 238). En ce sens, un paradigme est une vision du monde qui guide le chercheur non seulement pour le choix d’une approche méthodologique, mais également en ce qui a trait aux aspects ontologiques, épistémologiques et éthiques de sa recherche. Généralement, l’utilisation de la notion de paradigme est employée pour distinguer des écoles de pensée qui ne reposent pas sur les mêmes postulats ou qui, en d’autres termes, « n’habitent pas le même monde » (Lien Do, 2003, p. 55).
Autochtone
Il apparaît fondamental de définir le terme Autochtone, puisqu’il est directement en lien avec les notions de pouvoir et de savoir dont découle l’émergence du paradigme présenté dans cet article. Effectivement, la « classification » des Autochtones en tant que groupe différencié est d’abord vue comme une stratégie des non autochtones pour souligner la différence de race et, du même coup, utiliser leur pouvoir sur des populations opprimées (Rigney, 1997). Pour plusieurs Autochtones, le fait d’être différencié a maintenant des implications politiques, culturelles et sociales qu’il faut souligner et mettre en valeur (Wilson, 2008). Le terme Autochtone désigne les descendants des peuples qui habitaient un territoire au moment où d’autres s’y sont installés, instaurant un rapport de domination. Les peuples autochtones se distinguent de la culture dominante par leurs langues, leurs traditions et leurs coutumes. Ce terme désigne également les individus qui se définissent comme tels, peu importe où ils se situent dans le monde. Il sera aussi employé en tant qu’adjectif, pour désigner les savoirs et les visions du monde qui découlent de réflexions effectuées par des chercheurs autochtones. Nous reconnaissons toutefois qu’il s’agit d’un terme général qui ne représente pas toute la diversité et l’hétérogénéité des nations et cultures.
Contexte historique de l’apparition du paradigme autochtone
Les savoirs autochtones existent depuis des centaines d’années sur l’ensemble des continents. Malgré leur présence historique, ils ne se sont toutefois articulés dans ce qui est nommé le paradigme autochtone que dans les dernières décennies. À cet égard, une analyse chronologique appuyée par la division historique de Martin (2003) s’avère fondamentale pour comprendre le contexte dans lequel s’inscrit ce nouveau paradigme, qui a pris naissance à travers des relations de pouvoir et des dynamiques d’oppression (Wilson, 2003).
La phase Terra Nullius (1770-1900)
Au cours de la période appelée Terra Nullius, Martin (2003) met en exergue la prise de contrôle des peuples occidentaux des territoires, qu’ils considéraient « sans maître ». Bien que les Autochtones étaient déjà présents sur ces terres, ils étaient souvent considérés avec indifférence (Allen, 1988). À cette époque, la recherche était faite sur le territoire (la faune et la flore), ou sur les Autochtones. Les décisions prises à l’égard des peuples autochtones lors de cette période étaient basées sur des théories et des croyances selon lesquelles les Européens étaient supérieurs, donc les modes de connaissances autochtones avaient peu de valeur (Henderson-Youngblood, 2000).
La phase traditionaliste (1900-1940)
La phase dite traditionaliste a ensuite suivi, où les Autochtones sont dépeints comme des entraves aux progrès scientifiques, territoriaux et économiques (Martin, 2003). Les méthodes scientifiques ont alors été considérées comme largement supérieures à l’utilisation du monde spirituel, des plantes médicinales et des rites autochtones comme modes de connaissances. Pendant cette période, la collecte de données (expérimentale et empirique), par des « mesures » de l’intelligence autochtone, était répandue et acceptable (Wilson, 2008). Des spécimens de restes humains étaient étudiés et les scientifiques de l’époque obligeaient des Autochtones à se nourrir d’aliments avariés ou à contracter certaines maladies afin qu’on puisse en étudier les conséquences physiques (Kidd, 1994). Ces pratiques avaient une double visée de pouvoir et de savoir : la manipulation des corps et l’accroissement des connaissances sur les peuples autochtones engendraient un savoir permettant de détruire plus facilement les « mauvaises habitudes » et de transformer les personnes en les assujettissant à des nouvelles règles, ordres et coutumes (Foucault, 1975). La quantification des caractéristiques physiques et intellectuelles propres aux Autochtones avait aussi pour but de façonner la science comme une activité visant la généralisation et l’universel. Cette prépondérance vers les données quantitatives pourrait être perçue comme une stratégie ; une alliance entre les scientifiques et l’État (Porter, 1995) afin de mettre éventuellement fin au « problème autochtone ».
Parallèlement, l’arrivée des anthropologues a aussi mené à une traditionalisation des Autochtones, soit l’idée qu’ils sont un groupe homogène avec des caractéristiques physiologiques et culturelles similaires. Les recherches proposaient notamment de recueillir des informations sur des peuples et des cultures qui étaient portés à disparaître. Des typologies ont été créées pendant cette période, où le « sauvage noble » était celui qui avait réussi à être assimilé en laissant de côté ses croyances (Martin, 2003). La hiérarchisation des savoirs et la dégradation des connaissances autochtones se sont perpétuées pendant des décennies, si bien qu’elles sont devenues ancrées dans les pratiques scientifiques, politiques, étatiques et religieuses subséquentes.
La phase assimilationniste (1940-1990)
En continuité avec les phases historiques précédentes, celle qui prime dans les années 1940 à 1990 avait pour visée d’examiner les structures sociales autochtones et les mythologies, dans le but d’éradiquer complètement les modes de connaissance autochtones. Selon plusieurs auteurs, cette période était largement caractérisée par de multiples injustices : économique, politique, culturelle et épistémique (Baskin, 2006; Martin, 2003). Cette dernière forme survient lorsque les concepts, catégories ou visions du monde grâce auxquels un peuple comprend son univers sont remplacés ou grandement affectés par les concepts employés par les colonisateurs (Bhargava, 2013). Des chercheurs et des missionnaires non autochtones se disaient alors experts sur les Autochtones, qui étaient d’ailleurs l’un des groupes les plus étudiés au monde pendant cette période (Smith, 1999). À cet effet, Beckett (1994) affirme que les peuples autochtones ont été réduits au silence, alors que des experts parlaient d’eux ou pour eux. La recherche scientifique de cette phase, telle que perçue par les Autochtones, est mise en lumière par Wilson (2008):
Elle a continué, inévitablement, à percevoir, interpréter, et représenter les terres et les peuples autochtones, leurs visions du monde, leurs cultures, leurs expériences et leurs connaissances par le biais de la perspective du monde occidental dont le discours de recherche unique et dominant est teinté d’une optique coloniale
p. 50 – traduction libre
La phase récente (1990-2000)
Le paradigme autochtone en recherche est apparu dans les années 1990, suivant une succession de quatre périodes charnières (Steinhauer, 2001). Dans la première (années 1990), les chercheurs autochtones s’inscrivent à l’intérieur de paradigmes occidentaux sans les remettre en cause. Puis, la deuxième (fin des années 90) est marquée par des réflexions accrues: des chercheurs autochtones affirment ouvertement que certains paradigmes sont en contradiction avec leurs visions du monde. Toutefois, ils choisissent pour la plupart d’y inscrire leurs recherches par peur d’être marginalisés par la communauté scientifique: « ils étaient peu disposés à admettre, ni à eux-mêmes ni au public, que leurs compatriotes ‘non-lettrés’, refoulés au bas de l’échelle sociale, étaient en fait des sources de connaissances et de savoirs précieux » (Emeagwali et Dei, 2014, p. 3 – traduction libre). Les groupes dominés se contraignent alors à privilégier une certaine tradition épistémologique et méthodologique au détriment de leurs propres visions du monde.
Un changement de cap est ensuite survenu, marqué par de nombreux rapports d’enquête, de multiples résistances et des événements politiques (Wilson, 2003). La troisième phase (début des années 2000) se décrit alors comme une période marquée par le désir de décolonisation de la recherche, les chercheurs autochtones s’opposant à l’hégémonie idéologique et intellectuelle en évoquant qu’un changement est nécessaire (Emeagwali et Dei, 2014). Il y a alors une « mobilisation épistémique » (Beauclair, 2015, p. 68) : plusieurs chercheurs autochtones dénoncent formellement les préjudices causés par certains paradigmes de recherche, qui ont mis de côté les systèmes de croyances et les visions du monde autochtones en s’appuyant sur le fait qu’ils étaient dépourvus de base scientifique (Smith, 2012).
La quatrième phase (années 2000) est marquée par la création d’un paradigme, présenté par les chercheurs comme le résultat de l’oppression vécue, des résistances et d’une tentative de rééquilibrer le pouvoir, afin que la recherche soit faite par et pour eux (Wilson, 2008). Les notions de pluralisme épistémologique et de respect de toutes les formes de savoirs (Feyerabend, 1975) trouvent écho dans les visées des chercheurs autochtones. Aujourd’hui, plusieurs d’entre eux évoquent le paradigme autochtone dans le cadre de leurs recherches. Certains soulignent toutefois que le colonialisme est loin d’être une entreprise terminée, puisque l’universalisme et l’uniformisation prônés dans les paradigmes de recherche sont, selon eux, encore présents (Smith, 2012). Les notions de résistance, d’oppression et de colonialité du pouvoir (Quijano et Wallerstein, 1992) ont donc ponctué l’ensemble des périodes historiques et se perpétuent encore aujourd’hui dans le domaine de la recherche, où le paradigme autochtone n’est d’ailleurs pas encore formellement reconnu par les tenants des autres paradigmes. Autrement dit, les structures coloniales continuent à marginaliser les peuples autochtones « tant du point de vue socioéconomique qu’épistémologique et subjectif; on peut donc parler non seulement de colonialité du pouvoir, mais aussi de colonialité du savoir et de l’être » (Beauclair, 2015, p.68).
Le paradigme autochtone
Si l’historique permet de comprendre le contexte d’émergence du paradigme autochtone, il apparaît essentiel d’exposer les différents paramètres qui le constituent. En outre, les chercheurs l’inscrivent dans des contextes sociaux spécifiques, en utilisant des expressions de leur langue autochtone[1]. Par exemple, Ghel (2017) utilise le terme anishinaabe Debwewin, qui pourrait se traduire par « a personal truth that is rooted in one’s heart » « une vérité personnelle enracinée dans son coeur » (p. 54 - traduction libre). Thompson (2008), quant à elle, utilise les termes Hede kehe’hotzi’kahidi’ pour décrire le paradigme de la nation Tahltan, qu’elle traduit par « Je suis en voie de connaître et cela fait du sens pour moi » (p. 24 – traduction libre). Étant donné l’hétérogénéité des cultures des chercheurs, des ancrages historico-politiques des territoires où ils se situent et des langues utilisées, il est possible de constater des influences diverses dans la description du paradigme autochtone. Comme à l’intérieur de tout paradigme, les tenants peuvent se situer sur un continuum, où certains peuvent se rapprocher de certains autres paradigmes existants alors que d’autres s’en éloignent davantage. Cependant, comme l’indique Kuhn (1983), ils partagent des préconceptions et des épistémologies similaires, qui seront détaillées dans les sections qui suivent.
Une ontologie holistique, relationnelle, écocentrique et spirituelle
D’abord, le paradigme autochtone a une ontologie qui lui est propre, partagée par de nombreux chercheurs (Gill, 2002; Rice, 2005). Ce terme renvoie à la nature de la réalité (Lincoln et Guba, 2000), divisée en principes d’importance égale (Hart, 2010; Simpson, 2000a).
Pour certains auteurs, au coeur du paradigme autochtone se trouve un pragmatisme relationnel, basé sur l’hypothèse que le monde est un système composé d’éléments interconnectés (Ruwhiu et Cathro, 2014). La connaissance n’est pas une représentation linéaire des faits, mais plutôt une représentation circulaire où il existe des relations entre les structures objectives et les constructions subjectives. L’objectivité, selon des chercheurs maoris, n’est pas vue comme une seule réalité ou des faits vérifiables, mais plutôt comme le monde visible (que l’on peut voir, toucher et entendre) nécessairement influencé des constructions subjectives et invisibles (de l’intuition, des sentiments, de la spiritualité et des énergies) (Ruwhiu et Cathro, 2014). Il s’agit là d’une vision du monde holistique, inclusive, tenant compte des aspects spirituels, physiques, émotionnels et mentaux (Weber-Pillwax, 2001; Martin, 2003).
Si la connaissance est holistique, elle est également relationnelle (Owusu-Ansah et Mji, 2013; Wilson, 2008). Elle ne peut donc pas appartenir à une seule personne (le chercheur, par exemple) puisqu’elle est partagée avec tout ce que le Créateur a mis sur terre (Cajete, 2000). Cette vision du monde diffère grandement de celle des sociétés occidentales en général. Selon Descola (2005), les Occidentaux adoptent une ontologie dite naturaliste, qui sépare la société (composée d’humains) et la nature, en accordant une supériorité à la première. A contrario, les tenants du paradigme autochtone n’ont pas opéré à une telle division où la nature est dominée par l’humain (Keewatin, 2002) et leur ontologie pourrait être qualifiée d’écocentrique (Smith, 1999). Ce terme signifie qu’ils conçoivent l’individu comme faisant partie d’un écosystème, partagé avec les autres formes de vie où rien n’est au sommet d’une hiérarchie quelconque. Plusieurs peuples autochtones décrivent d’ailleurs les animaux comme des personnes autres qu’humaines (Feit, 2000) et les peuples des Andes décrivent les montagnes comme des « entités comparables aux humains, même dans leur construction physique » (Beauclair, 2015, p. 70). Les réalités sont ainsi plurielles et englobent des relations multiples, qu’elles soient interpersonnelles, environnementales ou spirituelles (Wilson, 2008). Les connaissances autochtones sont uniques aux cultures, aux localités et aux sociétés, acquises par les populations locales à travers l’expérience quotidienne (Dei, Hall et Rosenberg, 2000).
Plus encore, le territoire est vu comme étant sacré et les relations entre le chercheur et son environnement sont d’une importance capitale pour les tenants du paradigme autochtone (Keewatin, 2002). L’ancrage au territoire permet de rester connecté au présent et au futur, de même qu’avec les énergies et les esprits des ancêtres qui y habitent (Cajete, 2000). L’auteur maya Carlos Cordero (1995) résume ces conceptions du monde en indiquant que le savoir autochtone est contextuel et englobe les questions esthétiques et spirituelles ; la science autochtone n’ayant pas à être séparée de l’art ou de la religion (au sens large du terme). Cette ontologie rejoint les propos de Feyerabend (1975) qui souligne que la science est nécessairement appréhendée de manière subjective, avec « les jugements esthétiques, les jugements de goût, les préjugés métaphysiques, les désirs religieux » (p. 320). Dans le même ordre d’idées, Latour (1991) souligne que les tentatives de séparation opérées par la modernité occidentale entre les domaines du social (régi notamment par le politique), de la nature (régi par la « science ») et du spirituel sont un échec, puisque de nombreux phénomènes chevauchent l’ensemble de ces sphères.
Une épistémologie relationnelle ancrée dans les cultures
L’épistémologie réfère à une manière d’étudier la nature de la connaissance. Elle permet également de découvrir la nature de la relation entre le chercheur et ce qu’il peut connaître. Chaque paradigme en recherche revêt ainsi une épistémologie qui lui est propre (Lincoln et Guba, 2000), ce qui est également le cas pour le paradigme autochtone.
Selon les tenants de ce paradigme, les systèmes épistémologiques sont socialement construits et influencés par les contextes sociopolitiques, économiques et historiques (Ruwhiu et Cathro, 2014). L’épistémologie autochtone est aussi caractérisée comme un effort réactionnel (ou de résistance) à l’hégémonie des épistémologies occidentales et est vue comme une conversation continuelle entre le conflit et le changement, façonnée par la dualité entre les structures (qui influencent les opportunités) et l’agentivité (qui est la capacité des personnes à agir de façon indépendante et de faire des choix libres) (Gegeo et Watson-Gegeo, 2001). La construction des connaissances se fonderait ainsi sur des influences structurelles et des expériences individuelles. Pour Baskin (2006), l’épistémologie autochtone, tout comme son ontologie, est liée à l’introspection du chercheur. La prière, le jeûne, l’interprétation des rêves, les cérémonies et le silence sont vus comme des stratégies introspectives, uniques à chaque individu. La connaissance n’est alors jamais neutre et l’identité du chercheur joue un rôle important. En ce sens, l’épistémologie est intrinsèquement idéologique et subjective et il ne peut y avoir de détachement entre « celui qui perçoit et ce qu’il perçoit » (Gegeo et Watson-Gegeo, 2001, p. 62 - traduction libre).
Plus encore, l’épistémologie autochtone émerge des langues traditionnelles (Hart, 2010). Plusieurs auteurs soulignent l’importance des mots en langues autochtones, qui reflètent leurs visions du monde et qui n’ont souvent pas d’équivalents lorsqu’ils sont traduits. Par exemple, Ermine (1995) rapporte qu’une épistémologie autochtone est un processus subjectif décrit par le terme cri mamatowisin, qui pourrait se traduire par « la capacité d’exploiter les forces créatrices de la vie par l’utilisation de toutes les facultés qui constituent notre être en exerçant une intériorité » (p. 104 - traduction libre). Dans le même ordre d’idées, Wilson (2008) indique que la connaissance est directement liée aux manières d’être et de faire, aux façons de penser et de ressentir. Baskin (2006) et Wilson (2008) parlent ainsi d’une épistémologie relationnelle, où les réalités sont les relations avec les idées, avec le monde visible et invisible, avec l’environnement et le Cosmos.
Une méthodologie relationnelle, participative et pragmatique
Tout comme c’est le cas pour l’ontologie et l’épistémologie, chaque paradigme de recherche a également une méthodologie qui lui est propre. Ce terme fait référence à la manière dont la connaissance est acquise (Lincoln et Guba, 2000). Le point de vue du chercheur sur ce qu’est la réalité (ontologie) et comment il peut arriver à connaître cette réalité (épistémologie) aura un impact sur les façons d’acquérir des connaissances sur cette réalité (méthodologie). Si la méthodologie peut englober à la fois le système de connaissances et les méthodes, le but de la recherche peut illustrer l’unification de ces aspects (Kovach, 2015).
Métaphoriquement, Wilson (2008) considère la recherche comme une cérémonie ou un cheminement vers des apprentissages, dans lesquels la méthodologie est le moyen de transport. Dans ce processus, le chercheur est impliqué activement et est d’ailleurs considéré comme l’un des participants (Weber-Pillwax, 2001). Il doit décrire clairement ses motivations, les personnes l’ayant influencé dans son processus ainsi que ses inspirations (Kovach, 2009).
Pour les tenants du paradigme autochtone, la méthodologie doit être relationnelle et il faut nécessairement opter pour des recherches dites participatives. La méthodologie peut alors se moduler afin de s’adapter au contexte, aux personnes et aux milieux (Chilisa, 2011). Cette manière de faire sous-tend le principe que la recherche n’est pas sur un phénomène ou des personnes, mais plutôt pour quelque chose. En ce sens, l’objectif du chercheur doit s’inscrire dans une action sociale qui se veut libératoire et émancipatrice pour les peuples autochtones (Owusu-Ansah et Mji, 2013). La recherche a une finalité pragmatique et ne doit donc se faire qu’avec l’optique de donner de l’espoir, de promouvoir la transformation et le changement social auprès des peuples autochtones qui sont historiquement, politiquement et socialement opprimés (Hart, 2010; Wilson, 2008).
Pour Ruwhiu et Cathro (2014), les méthodologies autochtones ne concernent pas tant les méthodes en soi, mais sont plutôt une prise de position philosophique à l’endroit des participants à la recherche qui inclut des protocoles culturels. C’est pourquoi les méthodes normalement utilisées comprennent des rêves faits par le chercheur, de même que des cercles de partage, des récits et des stratégies d’observation (Baskin, 2006; Ghel, 2017). Pour Kovach (2009), l’utilisation d’une approche dite narrative et d’autoréflexion, qui s’inscrit dans l’épistémologie autochtone qui honore plusieurs vérités (ou réalités), est en conjoncture avec le paradigme nisitohtamowin (un mot cri qui désigne « compréhension avec les autres »). De plus, les méthodologies autochtones doivent tenir compte du contexte politique et historique, dans une perspective décolonisatrice : « Dorénavant, les peuples autochtones veulent que la recherche et ses concepts contribuent à l’autodétermination et aux luttes de libération telles que définies et contrôlées par leurs communautés » (Rigney, 1997, p. 1 - traduction libre). Cette décolonisation passe, entre autres, par la reconnaissance historique du fait qu’il est légitime de définir des méthodologies distinctes pour les études qui touchent les Autochtones (Baskin, 2006).
Par ailleurs, certains chercheurs ont conceptualisé des théories et des modèles autochtones qui s’enracinent dans leurs visions du monde. Par exemple, Wenger-Nabigon (2010), une chercheure en travail social, propose d’inclure une position écologique reliant les enjeux de la guérison à une vision holistique du développement humain, à travers la Roue de médecine crie. Jiménez Estrada (2005), un chercheur autochtone d’origine maya, utilise le Ceiba, ou arbre de vie, comme cadre conceptuel de recherche. Cette représentation honore à la fois la cosmologie maya et donne une forme visuelle à la pensée derrière la conception de la recherche. Kovach (2009), quant à elle, place l’épistémologie crie au centre de sa méthodologie, où elle en présente les composantes de façon circulaire. Celles-ci comprennent la préparation du chercheur et de la recherche, l’éthique et la perspective décolonisatrice, les moyens de recueillir la connaissance (gathering) et d’en donner un sens (making meaning), puis la manière de redonner ces connaissances (giving back). Des auteurs autochtones africains (Mkabela, 2005; Owusu-Ansah et Mji, 2013) illustrent ces étapes en parlant d’une méthodologie en spirale, où les participants (ici, ce terme inclut les membres de la communauté, les chercheurs et les décideurs) sont impliqués du début à la fin et interagissent en synergie et de manière bidirectionnelle.
D’autres auteurs ont intégré les principales dimensions des systèmes de pensée autochtones dans des modèles théoriques qualifiés d’éclectiques (Guay, 2017). C’est le cas de l’approche écospirituelle autochtone mise de l’avant par Coates et ses collaborateurs (2006) en travail social, qui renferme à la fois des idées issues d’approches occidentales et d’approches autochtones. Ils soulignent l’importance d’une vision holistique et spirituelle, tout en incluant les théories anti-oppressives et systémiques à leurs travaux. Kovach (2009) mentionne à cet égard que ce ne sont peut-être pas toutes les recherches qui nécessiteraient une méthodologie purement « autochtone » : ce choix dépendrait de l’objet de la recherche et du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Une axiologie basée sur le respect, la réciprocité et la responsabilité
Comme dans tout autre paradigme de recherche, le paradigme autochtone renferme une axiologie. Ce terme renvoie à l’éthique qui guide la recherche de la connaissance (Lincoln et Guba, 2000). Il est difficile de déterminer comment une axiologie autochtone informe et guide spécifiquement ce paradigme, car il y a une multitude de valeurs, d’éthiques et de principes qui ont été identifiés par des chercheurs qui situent leurs travaux dans d’autres paradigmes. Certains éléments méritent toutefois, selon nous, une attention particulière.
D’abord, l’éthique doit se baser sur des principes de non-ingérence et de non-directivité (Wilson, 2008). Cela signifie de respecter le rythme des participants et de ne pas insister sur une direction à suivre (Guay, 2017). De nombreux chercheurs mettent l’accent sur les trois R, qui s’avèrent des incontournables : le respect, la réciprocité et la responsabilité (Weber-Pillwax, 2001; Wilson, 2008). Par exemple, la recherche ne doit pas seulement prendre, mais elle doit aussi redonner. Les offrandes (de tabac ou de sauge, notamment) font partie de ce processus respectueux des cultures et croyances autochtones (Keewatin, 2002). L’égo du chercheur ne peut pas être impliqué, étant donné que les actions de donner et de recevoir sont considérées comme étant égales (Cajete, 2000). La recherche est ainsi perçue comme une co-construction, où le chercheur est responsable de maintenir des relations tout au long de la recherche (incluant lors de l’analyse, de l’interprétation ou de la dissémination des résultats). Les tenants du paradigme autochtone ne sont pas seulement écocentriques (comme susmentionné), mais également cosmocentriques (Beauclair, 2015). En effet, la réciprocité et le respect transcendent les relations humaines, l’environnement et les entités non humaines. Cela renvoie encore une fois au principe d’une relationalité globale (Wilson, 2008). Des chercheurs autochtones africains vont ainsi parler d’une éthique collective et interdépendante (Mkabela, 2005; Owusu-Ansah et Mji, 2013). Le respect implique également une éthique différente par rapport à la confidentialité lors de la participation à la recherche. Par exemple, il est vu comme étant respectueux de nommer, si elles le désirent, les personnes impliquées afin de les positionner clairement comme les détentrices de savoirs : « nous devons respecter les liens qu’ils ont avec les connaissances qu’ils partagent avec nous lorsque que nous les énonçons dans nos recherches. Ainsi, nous n’en revendiquons pas la propriété » (Wilson, 2008, p. 115 - traduction libre).
Par ailleurs, des protocoles destinés spécifiquement aux recherches menées avec des Autochtones ont été développés et des principes directeurs sont regroupés sous l’acronyme PCAP® (Propriété, Contrôle, Accès et Possession). Cela signifie que les chercheurs doivent reconnaître que les Autochtones détiennent la propriété collective des résultats, qu’ils peuvent exercer un contrôle sur la recherche, qu’ils peuvent avoir accès aux données et que ces dernières n’appartiennent pas aux chercheurs, mais aux communautés elles-mêmes (Centre des Premières Nations, 2007).
Comparer le paradigme autochtone avec les autres paradigmes : un exercice utile ?
Afin d’éclairer davantage les chercheurs en travail social qui souhaitent inscrire leurs travaux au sein du paradigme autochtone, nous souhaitions d’emblée faire une comparaison exhaustive avec les autres paradigmes existants. Toutefois, plusieurs auteurs ne s’entendent pas à savoir si cet effort comparatif est réellement utile et nécessaire. D’une part, certains réitèrent l’importance de mettre les paradigmes en opposition (Hampton, 2000), puisque le chercheur doit faire un choix paradigmatique en considérant toutes les dimensions qui le sous-tendent : « décider de rejeter un paradigme est toujours simultanément décider d’en accepter un autre, et le jugement qui aboutit à cette décision implique une comparaison des deux paradigmes » (Kuhn, 1983, p. 115). De surcroît, de nombreux chercheurs ont réitéré l’importance que la recherche auprès des peuples autochtones soit fondée sur leurs visions du monde et leurs propres systèmes de connaissances (Sinclair, Hart et Bruyere, 2009; Smith, 2005). L’effort comparatif pourrait alors être vu comme une manière de rééquilibrer le pouvoir, dans une optique d’harmonie éventuelle dans le monde de la recherche de façon globale.
D’autre part, certains chercheurs affirment que les comparaisons ou l’opposition de deux schèmes de pensée reviennent à tenter de prouver que le paradigme autochtone est légitime, ce qui serait superflu et lui enlèverait même un certain pouvoir (Singh et Major, 2017). À cet effet, Wilson (2008) mentionne: « critiquer d’autres paradigmes de recherche ou justifier le mien en citant les autres, constituerait une reconnaissance de leur juridiction sur la recherche autochtone. Ainsi, je cèderais le pouvoir » (p. 42 - traduction libre). Plus encore, le fait de critiquer les autres paradigmes comme stratégie pour promouvoir le paradigme autochtone éroderait les croyances sous-jacentes sur lesquelles il est établi: le fait que tout soit vu sur le même pied d’égalité rend les comparaisons inutiles (Wilson, 2008). Ainsi, plusieurs auteurs autochtones cherchent plutôt à montrer une coexistence de systèmes de pensée différents, au lieu de perpétuer la confrontation ou l’opposition entre eux. Il semble s’agir ici d’un dilemme cornélien : justifier ou comparer le paradigme peut laisser entrapercevoir une relation subalterne par rapport aux paradigmes dominants, mais ne pas le faire peut isoler la recherche effectuée au sein du paradigme autochtone des relations intrinsèques entretenues au sein de la science.
Si l’effort comparatif ne fait pas l’unanimité, il serait toutefois possible de faire certains constats quant aux points de convergence avec certains paradigmes dominants. Par exemple, Kovach (2009) et Wilson (2008) soulignent que les paradigmes constructiviste et autochtone mettent tous deux l’emphase sur les multiples réalités, qui sont socialement construites. Plus encore, une quantité croissante de littérature par des chercheurs autochtones atteste de la nature interprétative, subjective, relationnelle et participative des connaissances autochtones (Hart, 2010; Kovach, 2009; Little Bear, 2000), qui peuvent trouver écho dans les paradigmes constructiviste, critique et participatif. Le paradigme autochtone semble avoir d’autres points de convergence avec le paradigme critique, soulignant tous deux que les réalités sont influencées par les contextes sociaux, politiques, culturels et économiques. Les notions de résistance, de décolonisation, de luttes et d’émancipation sont également au coeur de ces deux paradigmes (Lincoln et Guba, 2000). Des chercheurs autochtones remercient d’ailleurs l’arrivée du paradigme critique qui a permis de remettre en question l’hégémonie idéologique de la science et certains mentionnent même que les recherches féministes et anti-oppressives ont inspiré le développement du paradigme autochtone (Ghel, 2017).
Par ailleurs, les multiples interactions entre les personnes et le Cosmos (le visible et l’invisible, le vivant et le non-vivant) de même que les aspects relationnels et holistiques, au coeur du paradigme autochtone, semblent se retrouver, dans une certaine mesure, au sein du paradigme participatif. Il faut aussi souligner que certains chercheurs autochtones (Ghel, 2017; Kovach, 2009) reconnaissent les apports des recherches qualitatives de façon générale, développées par les courants occidentaux, puisqu’elles ont contribué à créer un espace pour les méthodologies relationnelles et narratives dans lesquelles s’inscrivent en partie les méthodologies autochtones.
Évidemment, ces points de convergence mettent également en lumière les divergences fondamentales du paradigme autochtone avec d’autres. Le paradigme positiviste y serait à l’opposé, puisqu’il cherche à généraliser des expériences et à en dégager des vérités universelles qui minimisent les différences (Thomas et Bellefeuille, 2006). Le fait de considérer les réalités objectives comme étant supérieures aux idées subjectives est contesté par divers tenants du paradigme autochtone (Keewatin, 2002; Hart, 2010). Dans la même lignée, Tafoya (1995) explique que les recherches positivistes et post-positivistes encouragent les chercheurs à amputer une partie d’eux-mêmes (leurs intuitions, rêves, émotions) pour s’inscrire dans un cadre rigide qui refuse la fiabilité ou la validité des connaissances acquises par des moyens non objectifs ou non vérifiables (telles que la spiritualité et le monde invisible). D’ailleurs, Simpson (2000) soutient que dans la majorité des paradigmes de recherche, le savoir spirituel n’est pas reconnu et traité comme le fondement des savoirs. Si les méthodologies autochtones peuvent parfois se rapprocher des méthodologies qualitatives, certains chercheurs mentionnent ainsi, à la lumière des différences présentées, qu’elles sont des méthodologies uniques, avec une base épistémologique (relationnelle et spirituelle) distincte (Kovach, 2009; Saini, 2012).
Le paradigme autochtone en travail social : des enjeux à surmonter
La création du paradigme autochtone en recherche a permis aux chercheurs d’avoir une voix et d’affirmer la valeur des savoirs autochtones, longtemps (et encore) marginalisés. Des disciplines telles que le travail social, ayant joué un rôle majeur dans l’élaboration des perceptions générales du « problème autochtone » (Blackstock, 2009), sont maintenant remises en question par des universitaires et praticiens qui en appellent à une décolonisation tant de la recherche que de la pratique. Effectivement, le travail social est largement influencé par la culture et les idéologies dominantes (Hugman, 2009). Il y a 20 ans, les questions autochtones étaient quasi absentes des programmes universitaires en travail social au Québec (Guay, 2017). Bien que les épistémologies et les approches autochtones soient de plus en plus « acceptées » au sein de la profession (ACFTS, 2014), elles demeurent toutefois « marginalisées ou vues comme étant subalternes aux stratégies et techniques qui émergent du paradigme dominant » (McKenzie et Morissette, 2002, p. 262 - traduction libre). Les universités continuent d’enseigner des paradigmes essentiellement occidentaux, ce qui s’explique par le fait que l’espace pédagogique n’est pas culturellement, politiquement et idéologiquement neutre. Pour plusieurs, le travail social agit toujours comme un agent de colonisation, en tentant d’appliquer des modèles théoriques et pratiques inappropriés (Baskin 2006; Gray, Coates, Yellow Bird et Hetherington, 2013). Cela contribue non seulement à la colonisation intellectuelle, mais aussi à la dévalorisation et à la marginalisation du paradigme autochtone en recherche.
Il s’avère alors essentiel de dépasser cette influence occidentale persistante au sein de la profession en y incluant les théories, les modèles et les épistémologies autochtones. Pour ce faire, celle-ci doit d’abord reconnaître sa complicité dans le projet colonial, collaborer avec les peuples autochtones et leur faire une place pour qu’ils puissent mettre en valeur leurs connaissances et leurs manières d’appréhender la recherche (Blagg et coll., 2018). Les chercheurs et praticiens non autochtones doivent apprendre à travailler dans une nouvelle relation avec les Autochtones, où ces derniers conservent la liberté de déterminer leurs propres paradigmes, théories et approches, de même que la manière dont ils souhaitent institutionnaliser (ou non) ces savoirs (Baskin, 2006).
Étant donné la création assez récente du paradigme autochtone et son caractère encore « marginal », peu de recherches en travail social s’y inscrivent à ce jour. Certains chercheurs autochtones sont néanmoins des pionniers au sein de la profession, tels que Kovach (2006) et Absolon (2011). Ces auteures ont mené des recherches en utilisant le paradigme autochtone pour aller à la rencontre de doctorants autochtones, notamment en travail social, qui inscrivent leurs travaux au coeur de ce même paradigme et qui utilisent les visions du monde autochtones dans leur quête de savoirs. Ces recherches ont pour objectifs clairs de mettre en valeur le paradigme et les méthodologies autochtones, de les rendre visibles (Absolon, 2011) tout en mettant en exergue les nombreux défis vécus par les étudiants lorsqu’ils mènent leurs recherches. Sinclair (2009), quant à elle, s’inspire de ses travaux sur l’adoption transraciale vécue par les enfants autochtones pour suggérer des approches culturellement sécuritaires en travail social (Baskin et Sinclair, 2015). Cela témoigne du caractère pragmatique et émancipatoire des études s’inscrivant au sein du paradigme autochtone. D’autres chercheurs tels que Hart (2010) et Wenger-Nabigon (2010) ont, pour leur part, conceptualisé des théories en travail social qui s’enracinent dans leurs visions du monde autochtone, qui s’inspirent de leurs traditions et qui fonctionnent en complémentarité avec les théories occidentales en travail social. Cette opérationnalisation des perspectives autochtones découle de leur volonté d’affirmer leur autonomie en remettant en question le pouvoir de la société dominante, tant en recherche que dans la pratique.
Ainsi, le travail social contemporain se retrouve devant des défis de taille et ne doit pas se contenter d’une simple « adaptation culturelle », comme le souligne Blackstock (2009): « la profession du travail social doit cesser de croire qu’elle offre des services culturellement appropriés aux Autochtones simplement parce qu’elle adapte le modèle, les valeurs, les croyances et les standards conventionnels du travail social » (p. 202 - traduction libre). La Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA) rappelait en 1996 que le respect des savoirs et des visions du monde autochtones ne doit pas s’insérer exclusivement dans un projet ou un programme « spécial », mais doit faire partie des responsabilités principales des institutions éducatives. Le fait de promouvoir l’existence du paradigme autochtone dans les établissements d’enseignement (par l’entremise de chercheurs autochtones, par exemple) serait l’une des premières étapes afin de reconfigurer la profession et y intégrer des visions du monde différentes de la pensée occidentale, mais tout aussi légitimes. Ces efforts permettraient d’actualiser les valeurs du travail social que sont l’autodétermination, la justice sociale et le respect des diversités culturelles. De nombreux programmes universitaires en travail social (au Québec particulièrement) sont encore loin de cet objectif, n’ayant pas d’enseignants autochtones et aucun cours obligatoire sur les réalités des peuples autochtones ni sur les épistémologies qui leur sont propres.
Conclusion
Le présent article a permis de mieux saisir le contexte historique dans lequel a émergé le paradigme autochtone en recherche. Les chercheurs qui s’y inscrivent mettent en lumière que la pensée occidentale, notamment en travail social, a dominé le développement des idées, des recherches et des épistémologies par l’intermédiaire d’un pouvoir colonial oppressif. À cet égard, certains chercheurs autochtones ont choisi de rejeter les paradigmes existants et d’en souligner les divergences; d’autres s’en sont plutôt inspirés et ont développé leur propre paradigme. La venue de manières alternatives de penser et de faire la science permet de la faire avancer d’un pas : les différentes perspectives, quelques fois incompatibles, se forcent mutuellement à une plus grande articulation de leurs idées et contribuent aux réflexions et au développement de nouvelles connaissances. Plusieurs tenants du paradigme autochtone en appellent à une pluralité épistémologique, où des cadres de pensée différents coexistent. Cela rappelle les principes qui se retrouvent dans les ceintures de wampum : deux rangées représentent les canots des Iroquois et les navires des Européens, qui naviguent en parallèle en respectant les lois, les coutumes, les traditions et l’indépendance de l’autre (Guay, 2017). Ces deux rangées sont souvent séparées de lignes blanches, signifiant l’amitié, la paix et le respect, pour illustrer la manière dont deux nations distinctes sont continuellement en relation (Anderson et Neumann, 2012). La recherche en travail social et les valeurs inhérentes de la profession sont bien placées pour réconcilier ces deux mondes, en accordant une place et une légitimité au paradigme autochtone. Comme le mentionne Keewatin (2002), « pour qu’il s’effectue un changement d’orientation dans la façon d’être de notre société, il faut d’abord comprendre qu’il existe d’autres manières de percevoir le monde et qu’ouvrir le coeur pourra nous aider à ouvrir l’esprit » (p. 82 - traduction libre).
Appendices
Note biographique
Lisa Ellington est étudiante au doctorat en travail social, à l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval et lauréate d’une bourse Vanier. Le présent article est arrivé au premier rang des soumissions en français au Concours étudiant 2018 de la revue.
Note
-
[1]
Il faut souligner que la très grande majorité des écrits recensés est en langue anglaise, avec une insertion de mots ou d’expressions autochtones. Il pourrait s’agir ici d’une stratégie employée par les chercheurs afin de rendre leurs travaux accessibles aux lecteurs internationaux, tout en tentant de préserver les aspects symboliques, culturels et spirituels de leurs recherches. Smith (1999) appellerait cela des concessions stratégiques qui permettent à deux mondes différents (occidental et autochtone) d’entrer en relation.
Bibliographie
- Absolon, K. E. (2011). Kaandossiwin : How we come to know. Halifax, Nouvelle-Écosse : Ferwood Publishing.
- ACFTS (2014). Normes d’agrément [En ligne]. Repéré à https://caswe-acfts.ca/wp-content/uploads/2013/04/CASWE-ACFTS.NormesDagrement.pdf
- Allen, H. (1988). History matters : A commentary on divergent interpretations of Australian history. Australian Aboriginal Studies, 2, 79-89.
- Anderson, M. S. et Neumann, I. B. (2012). Practices as models: A methodology with an illustration concerning Wampum diplomacy. Millenium: Journal of International Studies, 40(3), 457-481.
- Baskin, C. (2006). Aboriginal world views as challenges and possibilities in social work education. Critical Social Work, 7(2), 1-16.
- Baskin, C. et Sinclair, R. (2015). Social work and Indigenous Peoples in Canada. Encyclopedia of Social Work [En ligne]. Repéré à http://socialwork.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199975839.001.0001/acrefore-9780199975839-e-953
- Beauclair, N. (2015). Épistémologies autochtones et décolonialité: Réflexions autour de la philosophie interculturelle latino-américaine. Recherches amérindiennes au Québec, 45(2), 67–76.
- Beckett, J. (1994). Aboriginal histories, aboriginal myths: An introduction. Oceania, 65(2), 97-115.
- Bhargava, R. (2013). Pour en finir avec l’injustice épistémique du colonialisme. Penser global, 1, 41-75.
- Blackstock, C. (2009). The occasional evil of angels: Learning from the experiences of aboriginal peoples and social work. First Peoples Child and Family Review, 4(1), 28-37.
- Blagg, H., Williams, E., Cummings, E. Hovane, V., Torres, M. et Nangala Woodley, K. (2018). Innovative models in addressing violence against Indigenous women: Final report. Australia’s National Research Organisation for Women’s Safety (ANROWS), Australia: University of Western Australia.
- Cajete, G. (2000). Native science: Natural laws of interdependence. New Mexico, États-Unis: Clear Light Publishing.
- Centre des Premières Nations (2007). PCAP : propriété, contrôle, accès et possession. Approuvé par le Comité de gouvernance sur l’information des Premières Nations, Assemblée des Premières Nations. Ottawa, ON : Organisation nationale de la santé autochtone.
- Chilisa, B. (2011). Indigenous research methodologies. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Coates, J., Gray, M. et Hetherington, T. (2006). An ‘ecospiritual’ perspective: Finally, a place for Indigenous approaches. British Journal of Social Work, 36, 381-399.
- Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA) (1996). Vers un ressourcement, Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, vol.3. Ottawa, ON: Ministère des Approvisionnements et Services Canada.
- Connell, R., Beigel, F. et Ouédraogo, J.-B. (2017). Building knowledge from fractured epistemologies. African Review of Social Sciences Methodology, 2(1-2), 5-13.
- Cordero, C. (1995). A Working and Evolving Definition of Culture. Canadian Journal of Native Education, 21, 28-41.
- Dei, G. J., Hall, B. et Rosenberg, D. G. (2000). Indigenous knowledges in global contexts: Multiple readings of our world. Toronto, ON: University of Toronto Press.
- Descola, P. (2005). Par-delà nature et culture. Paris, France: Gallimard.
- Dominelli, L., Ioakimidis, V. (2016). The challenges of realising social justice in 21st century social work. International Social Work, 59(6), 693-696.
- Dumbrill, G. C. et Green, J. (2008). Indigenous knowledge in the social work academy. Social Work Education, 27(5), 489-503.
- Emeagwali, G. et Dei, G. J. (2014). Anti-colonial educational perspectives for transformative change. African Indigenous knowledges and the disciplines. Rotterdam, Hollande : Sense Publishers.
- Ermine, W. (1995). Aboriginal Epistemology. Dans M. Battiste et J. Barman, (dirs.), First Nations education in Canada: The circle unfolds (pp.101-112). Vancouver, CB : UBC Press.
- Estrada, J. V. M. (2005). The tree of life as a research methodology. Australian Journal of Indigenous Education, 34, 44–52.
- Feit, H. (2000). Les animaux comme partenaires de chasse : réciprocité chez les Cris de la Baie James. Terrain, 34, 123-142.
- Feyerabend, P. (1975). Against method. Third Edition. New York, États-Unis : Verso.
- Foucault, M. (1975). Surveiller et punir : naissance de la prison. Paris, France: Éditions Gallimard.
- Gegeo, D. W. et Watson-Gegeo, K. A. (2001). “How we know”: Kwara’ae rural villagers doing Indigenous epistemology. The Contemporary Pacific, 13(1), 55-88.
- Ghel, L. (2017). Claiming Anishinaabe. Decolonizing the human spirit. Regina, SK : University of Regina Press.
- Gill, J. H. (2002). Native American worldviews: An introduction. New York, États-Unis : Humanity Press.
- Gray, M., Coates, J., Yellow Bird, M. et Hetherington, T. (2013). Decolonizing social work. New York, Etats-Unis : Routledge.
- Guay, C. (2017). Le savoir autochtone dans tous ses états. Regards sur la pratique singulière des intervenants sociaux innus de Uashat mak Mani-Utenam. Québec, QC : Presses de l’Université du Québec.
- Hampton, E. (1995). Towards a redefinition of indian education. Dans M. Battiste & J. Barman (dirs.), First Nations education in Canada: The circle unfolds (pp. 5–46). Vancouver, CB : UBC Press.
- Hart, M. A. (2010). Indigenous worldviews, knowledge, and research: The development of an Indigenous research paradigm. Journal of Indigenous Voices in Social Work, 1(1), 1-16.
- Henderson-Youngblood, J. S. (2000). Aboriginal tenure in the constitution of Canada. Ontario: Carswell.
- Hugman (2009). But is it social work? Some reflections on mistaken identities. British Journal of Social Work, 39, 1138-1153.
- Keewatin, A. (2002). Balanced research: Understanding an Indigenous paradigm. Thèse de doctorat, Intercultural Education, Department of Educational Policy Studies, University of Alberta.
- Kidd, R. (1994). Regulating bodies: Administrations and aborigines in Queensland 1840-1988. Thèse de doctorat, Griffith University, Australie.
- Kovach, M. (2006). Searching for arrowheads: An inquiry into approaches to Indigenous research using a tribal methodology with a Nêhiýaw Kiskêýihtamowin worldview. Thèse doctorale en études interdisciplinaires (travail social et études autochtones), Université de Victoria.
- Kovach, M. (2009). Indigenous methodologies: Characteristics, conversations and contexts. Toronto, ON : University of Toronto Press.
- Kovach, M. (2015). Emerging from the margins: Indigenous methodologies. Dans S. Strega & L. Brown (dirs.), Research as resistance: Revisiting critical, Indigenous, and anti-oppressive approaches (2e ed., pp. 43–64). Toronto, ON : Canadian Scholars’ Press / Women’s Press.
- Kuhn, T. (1983). La structure des révolutions scientifiques. Paris, France : Flammarion.
- Latour, B. (1991). Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique. Paris, France : La Découverte.
- Lien Do, K. (2003). L’exploration du dialogue de Bohm comme approche d’apprentissage : une recherche collaborative. Thèse de doctorat en technologie de l’enseignement, Faculté des sciences de l’éducation, Université Laval. Repéré à https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/QQLA/TC-QQLA-20640.pdf
- Lincoln, Y. S. et Guba, E. G. (2000). Paradigmatic controversies, contradictions and emerging confluences. Dans N. K. Denzin et Y. S. Lincoln (2e ed.), Handbook of qualitative research (pp. 168-172), Londres, Angleterre : Sage.
- Little Bear, L. (2000). Jagged worldviews colliding. Dans M. Battiste (dir.), Reclaiming Indigenous voice and vision (pp.77-86). Vancouver, CB : UBC Press.
- Martin, K. (2003). Aboriginal people, aboriginal lands and indigenist research: A discussion of research pasts and neo-colonial research futures. Mémoire de maîtrise, School of Indigenous Studies, James Cook University, Townsville.
- McKenzie, B. et Morrisette, V. (2003). Social work practice with Canadians of aboriginal background : Guidelines for respectful social work. Dans A. AlKrenawi et J. R. Graham (dirs.), Multicultural Social Work in Canada: Working with Diverse Ethno-Racial Communities (pp. 251-279). Toronto, Ontario: Oxford University Press.
- Mkabela, Q. (2005). Using the Afrocentric method in researching Indigenous african culture. The Qualitative Report, 10(1), 178–189.
- Owusuh-Ansah, F. et Mji, G. (2013). African Indigenous knowledge and research. African Journal of Disability, 2(1), 1-5.
- Quijano, A., et Wallerstein, I. (1992). La americanidad como concepto, o América en el moderno sistema mundial. Revista Internacional de Ciencias Sociales, 134, 583-591.
- Porter, T. M. (1995). Trust in numbers. The pursuit of objectivity in science and public life. New Jersey, États-Unis : Princeton University Press.
- Rice, B. (2005). Seeing the world with Aboriginal eyes: A four dimensional perspective on human and non-human values, cultures and relationships on Turtle Island. Winnipeg, MB : Aboriginal Issues Press.
- Rigney, L. (1997). Internationalisation of an Indigenous anti-colonial cultural critique of research methodologies: A guide to indigenist research methodology and its principles. Wicazo Sa Review, 14(2), 109-121.
- Ruwhiu, D. et Cathro, V. (2014). ‘Eyes-wide-shut,’ Insights from an Indigenous research methodology. Emergence, Complexity & Organisation, 16(4), 1-11.
- Saini, M. (2012). Revue systématique des modèles de recherche occidentaux et autochtones : évaluation de la validation croisée pour l’exploration de la compatibilité et de la convergence. Prince George, CB : Centre de collaboration nationale de la santé autochtone.
- Simpson, L. (2000a). Anishinaabe ways of knowing. Dans J. Oakes, R. Riew, S. Koolage, L. Simpson, & N. Schuster (dirs.), Aboriginal health, identity and resources (pp. 165-185). Winnipeg, MB : Native Studies Press.
- Simpson, L. (2000b). Stories, dreams, and ceremonies - Anishinaabe ways of learning. Tribal College Journal, 11(4), 1-7.
- Sinclair, R. (2009). Identity or racism? Aboriginal transracial adoption. Dans R. Sinclair, M. Hart et G. Bruyere (dirs.), Wicihitowin: Aboriginal social work in Canada (pp. 89-113). Winnipeg, MB: Fernwood Publishing.
- Singh, M. et Major, J. (2017). Conducting Indigenous research in western knowledge spaces: Aligning theory and methodology. The Australian Association for Research in Education, 44(1), 5-19.
- Smith, L. T., (1999). Decolonizing methodologies: Research and Indigenous Peoples. New York, États-Unis : Zed Books.
- Smith, L. T. (2012). Decolonizing methodologies: Research and Indigenous Peoples (2eedition). Londres, UK : Zed Books.
- Steinhauer, P. (2001). Situating myself in research. Canadian Journal of Native Education, 26, 69-81.
- Tafoya, T. (1995). Finding harmony: Balancing traditional values with western science in therapy. Canadian Journal of Native Education, 21, 7-27.
- Thomas, W. et Bellefeuille, G. (2006). An evidence-based formative evaluation of a cross-cultural Aboriginal mental health program in Canada. Australian e-Journal for the Advancement of Mental Health, 5(3), 1446-7984.
- Thompson, J. (2008). Hede kehe’hotzi’kahidi’: My journey to a Tahlatan research paradigm. Canadian Journal of Native Education, 31(1) 24-39.
- Weber-Pillwax, C. (2001). What is Indigenous research? Canadian Journal of Native Education, 25(2), 166-174.
- Wenger-Nabigon, A. (2010). The Cree medicine wheel as an organizing paradigm of theories of human development. Native Social Work Journal, 7(1), 139-161.
- Wilson, S. (2003). Processing toward an Indigenous research paradigm in Canada and Australia. Canadian Journal of Native Education, 27(2), 161-178.
- Wilson, S. (2008). Research is ceremony. Indigenous research methods. Halifax, NÉ : Fernwood Publishing.


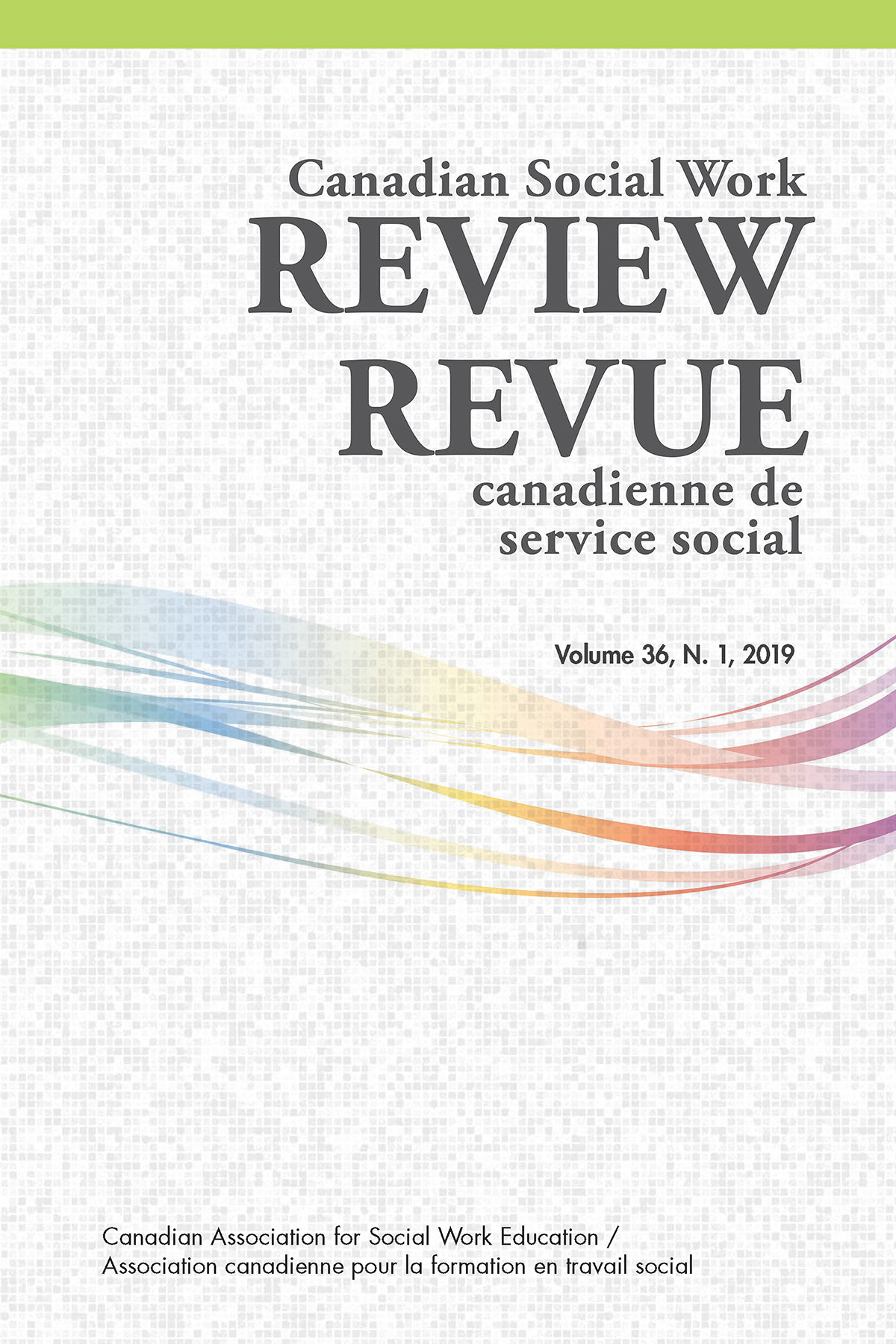
 10.7202/1038042ar
10.7202/1038042ar