Article body
Introduction
Pendant longtemps au Québec, les préoccupations linguistiques étaient inséparables des préoccupations ethniques. Parler des francophones revenait à toute fin pratique à parler des Canadiens français tant au Québec qu’ailleurs au Canada. La question centrale tournait autour d’une notion vague d’équilibre démo-ethnique consacrée dans le recensement de 1871 partageant la société québécoise en trois groupes ethniques : les Français (78%), les Britanniques (20%) et les Autres (2%). Alors que les Canadiens français hors-Québec étaient aux prises avec une assimilation continuelle, vérifiée à chaque dix ans grâce à la question sur l’origine ethnique des recensements depuis 1871, le Québec, jusqu’aux années 1970, expérimentait une relative stabilité dans sa composition ethnique, la proportion des Français demeurant autour de 80%, pourcentage jugé politiquement acceptable (ou en tout cas non alarmiste). Et même si les « Autres » s’assimilaient aux Britanniques, la croissance démographique plus élevée des Canadiens français maintenait leur importance démographique. Ce n’est qu’avec la chute de la natalité et les projections démographiques « alarmistes » des années 1970 (voir par exemple Charbonneau, Heripin et Légaré, 1970) que les Allogènes, transformés en Allophones, devenaient un enjeu politique pour les gouvernements québécois.
Tant et aussi longtemps que les préoccupations demeuraient ethniques et que la question francophone se confondait avec la question ethnique, les indicateurs basés sur l’origine ethnique remplissaient leur fonction sociale et politique de suivi (monitoring) de l’évolution de l’assimilation. Deux brèches vont affaiblir ce consensus quasiment séculaire. La première apparaît au cours des années 1960-1970 avec le projet de modernisation du Québec porté par de nouvelles classes dirigeantes, projet qui, par ses visées universalistes, s’accommode mal de la référence ethnique. Toutefois, même si la nation canadienne française devient québécoise francophone dans le discours nationaliste, plusieurs analystes continuent à voir dans cette nouvelle catégorie une référence au groupe canadien-français (Salée, 2001; Robin, 1996). La deuxième brèche viendra avec l’émergence du pluralisme et la nécessité de redéfinir le « nous québécois » pour tenir compte de la diversité croissante de la société québécoise, produit de l’immigration des trente dernières années (Piché, 2002). Plusieurs voix se font alors entendre en préconisant la nécessité de dépasser le nationalisme ethnique par une approche plus civique de la citoyenneté.[2]
En lien avec ce débat politique, les catégories ethniques issues des recensements deviennent de moins en moins pertinentes[3]. D’une part, avec l’auto-identification, l’origine ethnique devient plus subjective et fluide. De plus, l’apparition de la catégorie « canadien » rend quasiment impossible l’utilisation de cette question pour les analyses des groupes ethniques. Enfin, la possibilité d’enregistrer des origines ethniques multiples à partir de 1986 rend de plus en plus difficile la comparabilité des catégories avec les recensements antérieurs. D’une certaine façon, cela ne crée pas de remous important dans la mesure où de toute façon, à partir des années 1970, les catégories ethniques sont de plus en plus remplacées par les catégories linguistiques dans le discours nationaliste. Dorénavant, le « monitoring » porte sur l’état du français au Québec et plusieurs indicateurs linguistiques ont été proposés pour suivre l’évolution de l’utilisation du français. On passe donc d’une phase ethnique à une phase linguistique dans le développement des indicateurs. Dans cette deuxième phase, deux indicateurs vont dominer les débats démo-linguistiques : ceux basés sur la langue maternelle et sur la langue d’usage (langue la plus souvent parlée à la maison). À partir des années 1990, une troisième phase voit le jour : avec une nouvelle politique d’immigration et d’intégration mettant l’accent sur la francisation dans la sphère publique surgissent de nouveaux besoins en matière d’indicateurs.
En effet, les indicateurs linguistiques utilisés jusqu’à maintenant relevaient davantage de la sphère privée et mesuraient en fait le processus d’assimilation linguistique à travers la notion de transfert linguistique (passer d’une langue maternelle « X » à une langue d’usage « Y »). Tout en reconnaissant l’intérêt sociologique d’étudier l’assimilation linguistique ainsi définie, plusieurs critiques ont tenté d’introduire de nouveaux indicateurs plus en lien avec la politique d’intégration du Québec. C’est dans ce contexte qu’il faut situer les débats actuels sur les indicateurs linguistiques, débats qui donnent l’impression qu’il s’agit d’une guerre de chiffres entre spécialistes[4]. Dans ce texte, nous voulons montrer que les enjeux ne portent pas sur les chiffres eux-mêmes (ou les méthodes de calcul) mais sur le choix des indicateurs et sur leur interprétation.
Le présent texte vise à examiner les divers indicateurs, les mettre dans leur contexte politique et historique, les critiquer et enfin à proposer une nouvelle approche qui constituerait en quelque sorte une quatrième phase dans le développement d’indicateurs pertinents. En effet, nous argumenterons que même centrés sur la sphère publique les indicateurs actuels sont insuffisants pour rendre compte de la complexité du processus d’intégration linguistique. En particulier, leur caractère unidirectionnel met tout le poids de l’intégration sur les épaules des immigrants et des immigrantes et ignore la dynamique bidirectionnelle du processus d’intégration impliquant les immigrants et la société d’accueil.[5] Ce faisant, nous chercherons en fait à sortir d’une comptabilité purement démolinguistique et nous montrerons que les choix linguistiques des immigrants et des immigrantes, et en fait de tout le monde, se font dans un contexte qui parfois facilite, parfois restreint, l’utilisation du français comme langue de communication dans la sphère publique.
I. Pertinence des indicateurs : quels indicateurs pour quels objectifs?
L’évolution démolinguistique est au coeur de la question de l’avenir du français au Québec. D’emblée, le document de consultation de la Commission des États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec pose la question des transferts linguistiques. Le premier mandat de la commission est d’ailleurs exprimé comme suit :
Préciser et analyser les plusimportants facteurs qui influencent la situation et l’avenir de la langue française au Québec en fonction de l’évolution des principaux indicateurs, en particulier celui du taux de transferts linguistiques…
Gouvernement du Québec, 2000 : 5
Le taux de transferts linguistiques est donc « en particulier » présenté comme un des indicateurs les plus importants. Si tel est le cas, se pose alors la question du choix des critères linguistiques, choix qui reposent sur des modèles concurrents d’intégration linguistique. Raymond Breton (1994) a bien montré qu’il existe plusieurs types d’indicateurs d’intégration selon que l’on poursuive des objectifs d’acculturation, de conversion, d’adaptation ou encore d’accommodement. Il faut donc dans un premier temps rendre explicite le modèle pertinent dans le contexte politique québécois. Or, de ce point de vue, les critères de pertinence ne peuvent que découler des objectifs politiques poursuivis.
Quels sont ces objectifs? Ceux-ci ont été d’abord définis dans le cadre de la Charte de la langue française en 1978 et précisés par la suite de façon claire et limpide dans l’Énoncé de la politique d’immigration et d’intégration du Québec adopté en 1992. En gros, les objectifs définissent deux orientations fondamentales : une première qui adopte un modèle d’intégration pluraliste et non assimilationniste, et une deuxième qui vise la francisation des immigrants et des immigrantes dans la sphère publique. C’est à travers ce prisme que nous devons examiner les divers indicateurs linguistiques en usage au Québec actuellement. Nous en retenons cinq : langue maternelle, langue d’usage au foyer, connaissance des langues officielles, première langue officielle parlée et langue d’usage public.[6]
Langue maternelle : c’est la première langue apprise et encore comprise. Par exemple, au Québec, le pourcentage de la population dont la langue maternelle est le français était de 80,7% en 1971 et de 80,9 en 2001. Pour Montréal, nous pouvons retenir, soit le Montréal métropolitain où l’indicateur passe de 66,2% en 1971 à 67,3% en 2001, soit l’île de Montréal seulement où les indicateurs sont plus faibles et où la baisse des francophones est plus marquée (61% en 1971 versus 52,8% en 1996). Étant donné la faible fécondité au Québec, cet indicateur est très sensible à la migration internationale de sorte qu’en période où l’immigration est importante, les proportions de francophones, comme d’anglophones d’ailleurs, seront nécessairement plus faibles là où l’immigration se concentre, c’est-à-dire à Montréal.
Langue d’usage au foyer : c’est la langue la plus souvent parlée au foyer. Pour plusieurs personnes, la langue d’usage et la langue maternelle sont la même. Pour le Québec comme pour le Montréal métropolitain, on observe une légère augmentation de la proportion de la population parlant le français à la maison entre 1971 et 2001 (de 80,8% à 82,3% et de 66,3% à 69,4% respectivement). Par contre sur l’île de Montréal, elle est en baisse, du moins entre 1971 et 1996 (les données pour 2001 ne sont pas encore disponibles pour cette unité géographique). La différence entre les « deux Montréal » tient au phénomène de l’étalement urbain, la proportion des francophones ayant quitté l’île pour la banlieue étant plus élevée que celle des autres groupes. Ici aussi la mathématique joue : l’exode des francophones va automatiquement faire augmenter la proportion des allophones sur l’île de Montréal. De plus, comme pour la langue maternelle, l’immigration contribue à faire augmenter la proportion des personnes parlant leur langue d’origine à la maison, et par le fait même à faire diminuer la proportion de francophones surtout sur l’île de Montréal où se concentre le gros de l’immigration.
Nous touchons ici un autre objet fondamental du débat linguistique, à savoir la pertinence de la langue d’usage à la maison comme indicateur (et par le fait même la pertinence de la notion de transfert linguistique d’une langue maternelle à une autre langue d’usage à la maison). D’une part, selon certains, cet indicateur capte mal le plurilinguisme croissant au sein de la population immigrante. D’autre part, dans la mesure où la politique de francisation vise explicitement les communications dans le domaine public, la langue d’usage, qui relève de la vie privée, ne peut pas constituer un indicateur pertinent de suivi de la situation du français. Il faut pour cela un indicateur de la langue publique. Nous y reviendrons.
Connaissance des languesofficielles : à partir de ce critère, on peut définir les francophones comme les personnes qui connaissent le français seulement ou le français et l’anglais (les bilingues). Selon cet indicateur, 93,8% des personnes recensées au Québec en 1996 et 94,6% en 2001 connaissent le français; les pourcentages respectifs pour le Montréal métropolitain sont de 89,5 et 91,0. C’est l’indicateur qui donne le plus haut pourcentage de francophones. Pour plusieurs, il s’agit d’un indicateur difficile à interpréter dans la mesure où ce sont les personnes qui auto-évaluent leur connaissance des langues et que cette auto-évaluation peut varier d’une personne à une autre. Néanmoins, l’intérêt de cet indicateur est de fournir des « taux de bilinguisme » : en 2001 par exemple, ce taux est de 40,8% pour le Québec et de 53,0% pour le Montréal métropolitain.
Première langue officielleparlée : c’est en recoupant plusieurs informations sur les langues dans les recensements que Statistique Canada a mesuré cet indicateur. Il indique pour le Québec et pour le Montréal métropolitain une augmentation importante des francophones, soit de 82,6% à 86,3% pour le Québec et de 69,8% à 76,4% pour le Montréal métropolitain. Sur l’île de Montréal, c’est le seul indicateur qui indique une relative stabilité de la proportion des francophones autour de 66%.
Langue d’usage public : en 1997, le Conseil de la langue française a proposé un nouvel indicateur calculé à partir d’une série de questions (enquête par échantillon) sur l’utilisation de la langue dans divers domaines de la vie publique. En excluant les deux indicateurs sur les langues officielles présentés ci-haut, c’est l’indicateur qui donne le plus haut pourcentage de francophones tant au Québec (87%) qu’à Montréal (78% pour la RMR et 71% pour l’île). Encore une fois, cela n’est pas surprenant dans la mesure où les deux premiers indicateurs (langue maternelle et langue d’usage) ne permettent pas de savoir quelle langue utilisent les allophones à l’extérieur du foyer. La sous-estimation des francophones sur l’île est particulièrement frappante, surtout avec les deux premiers indicateurs. Malheureusement, ce type d’indicateur a été calculé pour une seule année et les recensements antérieurs à 2001 ne fournissent pas d’informations sur l’utilisation de la langue en dehors du foyer. Ce n’est qu’en 2001 que certaines questions sur la langue de travail ont été introduites, questions qui permettront avec les recensements subséquents de suivre l’évolution du français sur le marché du travail. Pour 2001, notons que 89% des travailleurs dont le lieu de travail est la Communauté urbaine de Montréal utilisent le plus souvent le français comme langue de travail.
Outre ces indicateurs, il faut souligner que les démographes utilisent également deux autres « outils » fondamentaux : le calcul des transferts linguistiques et les projections des groupes linguistiques. Pour calculer les transferts, il s’agit par exemple de croiser la langue maternelle avec l’un ou l’autre des indicateurs, soit la langue d’usage à la maison, la connaissance des deux langues officielles ou la langue publique. Il est évident que les mêmes débats soulignés plus haut ont également cours au sujet des transferts linguistiques. En effet, comme le croisement de la langue maternelle avec la langue parlée à la maison donne une estimation des transferts vers le français inférieure à celle obtenue par le croisement de la langue maternelle avec soit la connaissance des langues officielles, soit la langue publique, le diagnostic variera selon le choix du croisement que l’on fera. Il en va de même pour les projections démolinguistiques : l’image du futur dépendra du choix des indicateurs (et aussi bien sûr du fait de choisir le Montréal métropolitain ou l’île de Montréal). En plus, s’ajoute ici un autre débat sur l’importance des transferts linguistiques dans les projections et donc de l’avenir du français au Québec.
Bref, quel que soit l’outil démographique utilisé (indicateur, transfert ou projection), la question du choix de l’indicateur (et de sa pertinence) demeure au coeur des débats. Aucun indicateurn’est en soi supérieur à unautre, tout dépend des objectifspoursuivis. Si on veut mesurer l’assimilation linguistique, le premier croisement (langue maternelle par langue d’usage privé) est le meilleur indicateur. Si par contre on veut mesurer l’atteinte des objectifs de la loi 101 et de la politique d’immigration qui porte sur la langue commune publique, c’est plutôt l’indicateur de la langue d’usage public qui doit être retenu. En effet, seuls les indicateurs linguistiques qui font référence au français comme langue publique commune sont pertinents pour faire le suivi de l’évolution des transferts linguistiques.
II. La signification des indicateurs linguistiques
Le développement d’indicateurs de langue publique est donc un impératif incontournable compte tenu des options politiques actuelles du Québec. Mais cela ne suffit pas. Les indicateurs de langue publique, comme tout indicateur d’ailleurs, ne sont pas interprétables sans un minimum de mise en contexte. En effet, les choix linguistiques sont complexes et multidimensionnels; en langage statistique on dirait « multivariés ». Ainsi, un indicateur linguistique tel que la proportion des personnes parlant le français dans la sphère publique est de nature univariée et, par lui-même ou isolé, décrit très imparfaitement les choix linguistiques. En d’autres mots, un niveau X peut paraître minimum ou maximum selon le contexte externe aux individus qui ont à faire des choix. Par exemple, comment interpréter un indicateur qui donne le pourcentage de la main-d’oeuvre selon le temps de travail en français dans le secteur privé à Montréal ? En 1989, on obtient, pour les allophones (langue maternelle) un pourcentage de 37% qui travaillent surtout en anglais (Conseil de la langue française, 1996 : Graphique 3.3, p. 287). Est-ce faible ou fort? Cela dépend du contexte. Le Québec par exemple a fait un choix politique explicite de faire de Montréal un lieu privilégié du développement de la haute technologie. Or on sait que ce secteur est très intégré dans l’économie mondiale et que l’anglais y est souvent la langue dominante. Dans ce cas, l’indicateur d’usage de la langue française sur le marché de l’emploi révélerait davantage l’état du marché et de son évolution que les choix linguistiques des immigrants (et de l’ensemble de la population d’ailleurs).
Il faut donc contextualiser les indicateurs. Quatre types de facteurs d’intégration linguistique sont retenus ici (Piché et Bélanger, 1995) :
les facteurs liés aux caractéristiques des immigrantes et immigrants
les facteurs liés au contexte québécois
les facteurs liés au contexte d’origine
les facteurs liés au contexte mondial
1. Facteurs liés aux caractéristiques des immigrantes et immigrants
Les facteurs liés aux caractéristiques individuelles sont nombreux. À titre d’exemple, deux sont retenus ici : la durée de résidence et l’âge à l’arrivée.
Durée de résidence
Dans tous les modèles théoriques, la durée de résidence constitue la pierre angulaire de toute analyse systématique de l’intégration, y compris l’intégration linguistique (Goldlust et Richmond, 1974). Cela n’est pas surprenant dans la mesure où l’intégration est un processus dynamique qui évolue dans le temps, processus d’ailleurs que les indicateurs linguistiques transversaux usuels ne captent qu’imparfaitement. Il faut ou bien disposer de données longitudinales ou alors, au minimum, tenir compte de la durée de résidence au Québec, ce qui est rarement fait. Les résultats de l’Enquête longitudinale sur l’établissement des immigrants (ÉNI) apportent à ce titre un éclairage inédit, voire parfois contraire aux idées reçues, sur les processus d’intégration linguistique vus dans une perspective longitudinale (Renaud et al., 2001).[7]
Âge à l’arrivée
Plusieurs travaux ont montré que le fait d’être jeune facilite l’intégration linguistique. La « rupture » du comportement linguistique semble s’effectuer dans le groupe d’âge 15-19 ans et s’expliquerait par l’ampleur des contacts des plus jeunes avec la culture environnante par le biais de l’école et des loisirs. De plus, l’impact de la scolarisation des jeunes dépasse leur propre intégration linguistique dans la mesure où les enfants introduisent le bilinguisme auprès de leurs compatriotes et des membres de leur famille (Dorais et al, 1984; Veltman et Panneton, 1989). Évidemment, la variable de l’âge interfère avec la période d’arrivée de sorte qu’il est parfois difficile de distinguer dans les études l’effet d’âge de l’effet de génération. Néanmoins, les recherches indiquent que les jeunes d’il y a près de 25 ans (juste un peu avant la loi 101) ont eu des comportements linguistiques différents de celui des mêmes groupes d’âge aujourd’hui. Par exemple, les jeunes arrivés entre 1976 et 1991 sont plus nombreux à maîtriser le français que l’anglais (Monnier, 1993).
2. Facteurs liés au contexte québécois
D’autres facteurs, indépendants de la volonté des immigrants, interviennent dans les choix linguistiques, facteurs qui peuvent même être plus déterminants que les facteurs individuels. Deux facteurs viennent immédiatement à l’esprit : la politique linguistique et le marché du travail.
Politique linguistique et période d’immigration
Compte tenu de la situation particulière du Québec, on ne peut pas parler des indicateurs linguistiques sans les placer dans leur contexte législatif et sans tenir compte au minimum des deux périodes : avant et après la loi 101. Nous avons déjà fait allusion à l’importance de ce facteur. Les études sur la francisation indiquent clairement que les transferts linguistiques se sont inversés sous l’effet de la loi 101 (Baillargeon et Benjamin, 1990; Monnier, 1993).
Marché du travail
Tout le monde s’accorde pour dire que le milieu de travail influence de façon déterminante les conditions d’insertion dans les diverses sphères de la société québécoise. Il constitue souvent le lieu privilégié de contacts avec les Québécois francophones (Deschamps, 1985). Dans la mesure où certains secteurs de travail exigent la connaissance du français et/ou de l’anglais au départ, cela confère au milieu de travail une influence considérable sur l’orientation linguistique des immigrants (Deschamps, 1985; Béland, 1991).
D’autres facteurs reliés au contexte de la société d’accueil ont été relevés dans les travaux de recherche sur le Québec (pour plus de détails, voir Piché et Bélanger, 1995). Mentionnons les plus fréquemment cités :
la dualité linguistique de Montréal (qui en fait se transforme rapidement en plurilinguisme);
la politique interculturelle dans le milieu scolaire;
l’efficacité (ou non) des programmes d’équité en emploi;
l’existence (ou l’insuffisance) des cours de francisation tant pour les jeunes que pour les adultes;
l’accessibilité (ou non) aux emplois dans le secteur public et parapublic pour les immigrants et immigrantes;
l’existence du racisme et de la discrimination;
le degré de réceptivité sociale (nous reviendrons sur ce point).
3. Les facteurs liés au contexte d’origine
Même s’ils sont littéralement absents dans les travaux québécois sur l’intégration linguistique, je les mentionne néanmoins ici, ne serait-ce que pour suggérer leur pertinence. En effet, compte tenu du fait que la politique d’immigration canadienne et québécoise est de plus en plus axée sur les qualifications socioprofessionnelles, les expériences de travail dans les milieux d’origine pourraient avoir de plus en plus d’impact sur les connaissances linguistiques à l’arrivée. En lien avec la mondialisation des marchés du travail, la connaissance de l’anglais devient partout dans le monde un outil parfois indispensable de promotion sociale et économique. Voilà une autre contrainte à la francisation qui est indépendante de la volonté des immigrants et elle est bien exprimée dans le rapport de la Commission sur la langue française au Québec (2001).
4. Les facteurs liés au contexte mondial ou à la mondialisation
Dès le premier paragraphe du document de la Commission des États généraux concernant les tendances lourdes qui influent sur l’attraction du français, l’impact de la mondialisation est noté immédiatement après le contexte démographique. Malheureusement, on sait peu de choses sur cette question dans la mesure où elle est rarement abordée dans les travaux sur les facteurs d’intégration linguistique. Néanmoins, certaines pistes de réflexion fort pertinentes ont été suggérées lors du séminaire Langue nationale etmondialisation : enjeux et défispour le français (Conseil de la langue française, 1994) et certaines stratégies mériteraient d’être approfondies, comme par exemple celles qui, dans le cadre de l’ALENA, consisteraient à promouvoir le plurilinguisme, à favoriser une concertation multilatérale et éventuellement à élaborer une « Charte des langues et cultures nord-américaines » (Labrie, 1994). Une conclusion importante de ce séminaire est qu’il y a une certaine urgence à entamer une réorientation des institutions devant la reconstruction générale du système mondial (Rondeau, 1994 : 29). Plus récemment, dans la publication du Conseil de la langue française, intitulée Le français au Québec : 400ans d’histoire et de vie, une étude note que la progression accélérée de l’anglais dans les espaces économiques continental et mondial remet le dossier de la langue à l’ordre du jour (Bélanger, 2000 : 414). Et la même étude de conclure : « Par ailleurs, le ‘modèle québécois’ n’a pas encore démontré qu’il pouvait concilier les contraintes inhérentes au marché global et les intérêts de la collectivité québécoise ».
Mais la mondialisation n’est pas qu’économique. D’autres facteurs au niveau mondial influencent les politiques d’immigration et d’intégration. En particulier, la constitution de grands ensembles, qui semble être à l’ordre du jour dans toutes les régions du monde, pose la question de la souveraineté des états nations dans la gestion des flux migratoires et du pluralisme (Hollifield, 1997). On ne peut pas sous-estimer le rôle de plus en plus stratégique des idéologies « mondiales » favorisant l’antiracisme, le pluralisme normatif et le respect des minorités. Mais tout reste ouvert sur ce plan, en particulier avec la montée des mouvements d’extrême droite et anti-immigration un peu partout dans le monde, y compris tout récemment au Canada.
En somme, l’analyse des facteurs d’intégration linguistique nous suggère que les indicateurs linguistiques n’ont pas beaucoup de signification à l’état brut, ou, pour prendre un langage statistique, si on ne les situe pas dans un modèle « multivarié » qui calculerait les effets nets de l’ensemble des facteurs. Certains facteurs constituent des contraintes objectives qui limitent la francisation au-delà de la volonté non seulement des immigrants mais de l’ensemble de la population, en particulier la population de Montréal. Si on tient compte de l’ensemble des facteurs mentionnés ici, il se pourrait que les indicateurs du français comme langue publique aient en fait atteint leur limite supérieure.
III. La réceptivité sociale
Au-delà du caractère « univarié » des indicateurs usuels, ceux-ci souffrent d’une autre limite fondamentale : ils ne concernent que l’effort individuel des immigrants et immigrantes et ne tiennent pas compte de la contrepartie sociétale impliquée dans le processus d’intégration. On peut faire l’hypothèse que les choix linguistiques des immigrants seront facilités d’autant plus que la société d’accueil sera ouverte et accueillante (Juteau et McAndrew, 1992). Par réceptivité sociale, il faut entendre essentiellement ici les attitudes de la population québécoise face à l’immigration et aux relations interculturelles. À ce sujet, il y a seulement deux sondages importants au Québec qui ont traité de l’opinion publique québécoise à l’égard de l’immigration et des relations raciales et interculturelles (Joly et Dorval, 1993; Joly, 1996). Malgré toutes les critiques que l’on peut faire à ce genre de questions (fluidité des réponses, ambiguïté des questions et des réponses, etc.), faute de mieux, ces indicateurs permettent une certaine évaluation des atteintes d’un des objectifs importants de la politique d’intégration. De toute façon, ce sont pour le moment les seuls indicateurs à notre disposition.
Les résultats des deux sondages semblent indiquer une certaine amélioration dans les indicateurs de réceptivité sociale (Joly, 1996). Ceci dit, il reste certains aspects qui méritent réflexion parce qu’ils dénotent une réticence certaine à l’immigration. En voici quelques-uns à titre d’exemple :
15% des personnes interrogées disent qu’il est désagréable d’avoir comme voisins des membres des minorités visibles (basé sur un échantillon de 2203 personnes représentatif de l’ensemble de la population du Québec);
22% répondent que cela les dérangerait de voir un membre de leur famille avec un conjoint issu d’une minorité visible;
45% sont d’accord que la société québécoise accepte mal les immigrants;
34% pensent qu’il y a trop d’immigrants au Québec.
Le tableau le plus inquiétant demeure celui qui concerne le sentiment d’être à l’aise en présence d’individus de différents groupes culturels (Joly, 1996 : tableau 4.20). En effet, 30% de l’échantillon ne serait pas à l’aise en présence de « Noirs antillais anglophones », 32% en présence d’Arabes, 29% en présence d’Indo-Pakistanais. Ceci dit, il ne faut pas penser que le Québec est particulier sur ce point : un sondage canadien récent indique au contraire que le Québec aurait des attitudes plus positives à l’égard de l’immigration que la plupart des autres provinces (Palmer, 1999). En tout cas, ce que ces chiffres nous disent au minimum, c’est qu’il y a là matière à intervention de la part des pouvoirs publics et que des programmes de sensibilisation sont nécessaires.
Conclusion
La production d’indicateurs est intimement liée au contexte politique et en cela répond à une demande sociale formulée selon des problématiques historiques. Au Québec, on a suggéré quatre phases dans la production d’indicateurs ethnolinguistiques. La première phase, la plus longue, fait écho à la problématique de la dualité ethnique au Canada qui a monopolisé les relations ethniques tout au long du 19e et une partie du 20e siècle. Les indicateurs servent alors à suivre l’évolution des deux peuples fondateurs et mesurent en particulier l’assimilation des Canadiens français hors du Québec. C’est l’âge d’or de la statistique ethnique basée sur la question de l’origine ethnique issue des recensements. Avec l’avènement du projet moderniste et universaliste mis en marche au cours de la deuxième moitié du 20e siècle, une deuxième phase voit le jour avec cette fois le besoin d’indicateurs linguistiques. Le Canadien français devient le Québécois francophone et la recherche de l’équilibre linguistique passe par la nécessité de suivre l’évolution du français comme langue nationale. Pendant cette période, les indicateurs, tout en étant linguistiques, demeurent fortement entachés d’ethnicisme par leur recours à des critères de langue maternelle et celle parlée au foyer. Mais la diversité croissante de la société québécoise rend ces critères de moins en moins légitimes par leur visée assimilationniste. En effet, changer de langue maternelle ou adopter le français à la maison implique un degré d’assimilation relativement avancé. La politique d’intégration québécoise visant le domaine public (commerce, école, marché du travail, etc.), ce sont de nouveaux indicateurs qu’il faut produire. Apparaissent alors – et c’est la troisième phase – de nouveaux indicateurs d’utilisation du français comme langue publique. Le dernier recensement (2001) fait écho à cette demande sociale et introduit pour la première fois des questions sur la langue de travail. Dans le présent texte, nous avons proposé la nécessité de passer à une quatrième phase qui tiendrait davantage compte de l’aspect dynamique de l’intégration. Entre autres, les nouveaux indicateurs doivent mesurer le degré de réceptivité sociale qui constitue l’envers de la médaille des choix linguistiques des immigrants et des immigrantes.
En bref, il est temps de sortir du carcan liant de façon trop exclusive la problématique de la survie de la langue française à celle de l’immigration. Ce n’est pas uniquement du côté de l’immigration ou du côté des immigrants qu’il faut chercher des solutions à la question linguistique mais aussi du côté de la société québécoise prise globalement. Le défi linguistique est global et concerne toute la population. En particulier, les deux plus grands défis touchent celui du français dans les milieux de travail compte tenu des pressions de la mondialisation et celui du type d’accueil que la société réserve à ses nouveaux membres. A ce titre, il faut travailler à développer de véritables indicateurs de réceptivité sociale. De tels indicateurs sont d’autant plus nécessaires que les recherches récentes sur l’intégration économique font référence explicitement à ce type d’explication pour rendre compte de la disparition des écarts entre groupes d’immigrants après dix ans de vie au Québec (Piché et Renaud, 2002; Renaud, Piché et Godin, 2002). On peut faire le pari que le degré d’ouverture pourrait également avoir un impact important sur l’adoption du français non seulement comme langue fonctionnelle ou langue de communication publique mais, à long terme, comme langue identitaire.
Appendices
Notes
-
[1]
Une partie de ce texte à été présentée au colloque « Les enjeux démographiques et l’intégration des immigrants », organisé par l’Institut national de la recherche scientifique et l’Université de Montréal (CIED), le CEETUM et Immigration et Métropoles dans le cadre des États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec, Université de Montréal, 25-26 janvier 2001.
-
[2]
Voir Bibeau, 2000 et Bouchard, 2001.
-
[3]
Pour une analyse critique des catégories ethniques provenant des recensements, voir Rallu, Piché et Simon, 2003.
-
[4]
Par exemple, dans La Presse du 26 janvier 2001, on pouvait lire le titre suivant : « Des démographes se contredisent aux états généraux sur la langue » (p.A7).
-
[5]
Ce modèle dynamique est d’ailleurs à la base de l’Énoncé de politique d’immigration et d’intégration (Gouvernement du Québec, 1990).
-
[6]
Nous reprenons ici les analyses, mises à jour, présentées dans Piché (2001a et 2001b).
-
[7]
A ce sujet, La Presse du 24 janvier 2001 ( p. A1) titrait : « Des néo-Québécois presque pure laine – Une nouvelle étude ébranle plusieurs mythes sur les immigrants ».
Bibliographie
- Baillargeon, M. et Benjamin, C., 1990. Caractéristiques linguistiques de la population immigrée recensée au Québec en 1986, Montréal, Gouvernement du Québec, Ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, tableau 2.
- Béland, P., 1991. L’usage du français au travail : situation et tendances, Québec, Conseil de la langue française.
- Bélanger, Y. , 2000. « Le pouvoir économique francophone », dans Plourde, M., Duval, H. et Georgeault, G. (dir.), Le français au Québec : 400 ans d’histoire et de vie, chapitre 56, pp. 411-414.
- Bibeau, G., 2000. « Qui a peur des ethnies? Questions (subversives) aux politologues canadiens et québécois », dans Mikhael ELBAZ et Denise HELLY, éd. Mondialisation, citoyenneté et multiculturalisme, Sainte-Foy (Québec) et Paris, Les Presses de l’Université Laval et L’Harmattan, collection « Prisme », pp. 171-210.
- Bouchard, G. , 2001. « Ouvrir le cercle de la nation. Activer la cohésion sociale. Réflexions sur le Québec et la diversité », dans Michel Sarra-Bournet et Jocelyn Saint-Pierre (dir.) Les nationalismes au Québec, du XIXe au XXIesiècle, Québec, Les Presses de l’Université Laval, collection « Prisme », pp. 307-328.
- Breton, R., 1994. « L’appartenance progressive à une société : perspectives sur l’intégration socioculturelle des immigrants », dans Actes du Séminaire sur les indicateurs d’intégration des immigrants, Centre d’études ethniques de l’Université de Montréal et Gouvernement du Québec, Ministère des Affaires internationales, de l’immigration et des Communautés culturelles, pp. 239-252.
- Charbonneau, H., Henripin, J. et Légaré, J., 1970. « L’avenir démographique des francophones au Québec et à Montréal, en l’absence de politiques adéquates », Revue de Géographie de Montréal, vol. XXIV, no 2, pp. 199-202.
- Commission des États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec, 2001. L’avenir du français au Québec : une nouvelle approche pour de nouvelles réalités, Forum national, 5-6 juin 2001.
- Conseil de la langue française, 1994. Actes du Séminaire « Langue nationale et mondialisation : enjeux et défis pour le français ».
- Conseil de la langue française, 1996. Le français langue commune : enjeu de la société québécoise, Rapport du comité interministériel sur la situation de la langue française.
- Deschamps, G., 1985. Étude longitudinale sur l’adaptation socio-économique des réfugiés indochinois au Québec : la deuxième année de séjour, Québec, Ministère des Communautés culturelles et de l’immigration, Cahier no 3.
- Dorais, L.-J., Pilon-Lê, L., Quy Bong, N. et Kaley, R., 1984. Les Vietnamiens du Québec, Québec, Centre international de recherche sur le bilinguisme.
- Goldlust, J. et Richmond, A., 1974. « A Multivariate Model of Immigrants Adaptation », International Migration Review, vol. VIII, no 2, pp. 193-225.
- Gouvernement du Québec, 1990. Au Québec pour bâtir ensemble. Énoncé de politique en matière d’immigration et d’intégration, Ministère des Communautés culturelles et de l’immigration du Québec.
- Gouvernement du Québec, 2000. Le français, parlons-en, Commission des États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec, documentation de consultation et démarche de la commission.
- Hollifield, J. F., 1997. L’immigration et l’État-nation à la recherche d’un modèle national, Paris, L’Harmattan.
- Joly J., 1996. Sondage d’opinion publique québécoise sur l’immigration et les relations interculturelles, Rapport présenté à la Direction des études et de la recherche, Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, Les Services à la recherche J.T.D. inc.
- Joly, J. et Dorval, M., 1993. Sondage sur l’opinion publique québécoise à l’égard des relations raciales et interculturelles, Rapport présenté au Ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration (mars).
- Juteau, D. et Mc Andrew, M., 1992. « Projet national, immigration et intégration dans un Québec souverain », Sociologie et sociétés, vol. XXIV, no 2, pp. 161-180.
- Labrie, N., 1994. « Les enjeux linguistiques nord-américains de l’Accord de libre-échange entre le Canada, le Mexique et les Etats-Unis : quelles stratégies mettre au point face à l’anglais lingua franca de fait? », dans Actes du Séminaire « Langue nationale et mondialisation : enjeux et défis pour le français », Conseil de la langue française.
- Monnier, D., 1993. Les choix linguistiques des travailleurs immigrants et allophones, Conseil de la langue française.
- Palmer, D.L., 1999. Executive Summary : Canadian Attitudes and Perceptions Regarding Immigration, Citizenship and Immigration : Relations with Regional Per Capita Immigration and Other Contextual Factors, Citizenship and Immigration Canada, Strategic Policy, Planning and Research (August).
- Piché, V., 2001a. « Démographie et langue : pour sortir de la guerre des chiffres », La Presse, 3 février.
- Piché, V., 2001b, « Immigration et intégration linguistique : une crise qui n’a pas eu lieu », dans Québec 2002, sous la dir. de Roch Côté, Montréal, Fidès.
- Piché, V., 2002. « Immigration, diversity and ethnic relations in Quebec », Canadian Ethnic Studies, vol. 34, no 3, pp. 5-27.
- Piché, V. et Renaud, J., 2002. « Immigration et intégration économique : peut-on mesurer la discrimination ? », dans Côté, Rock et Venne, Michel (dir.), L’annuaire du Québec 2003, Montréal, Fidès, pp. 146-152.
- Piché, V. et Bélanger, L., 1995. Une revue des études québécoises sur les facteurs d’intégration des immigrants, Gouvernement du Québec, Ministère des Affaires internationales, de l’immigration et des Communautés culturelles, Notes et Documents no 5.
- Rallu, J.-L., Piché, V. et Simon, P. 2003. « Démographie et ethnicité », dans Caselli, G., Vallin, J. et Wunsch, G. (dir.), Démographie : analyse et synthèse. Volume 6 : Conséquences des changements démographiques, Paris, INED (sous presse).
- Renaud, J., 1992. « Un an au Québec. La compétence linguistique et l’accès à un premier emploi », Sociologie et sociétés, vol. XXIV, no 2, pp. 131-142.
- Renaud, J., Piché, V. et Godin, J.-F., 2002. « Emploi : établissement différent des immigrants arabes ou musulmans? », dans Renaud, Jean, Pietrantonio, Linda et Bourgeault, Guy (dir.), Les relations ethniques en question. Ce qui a changé depuis le 11 septembre 2001, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, pp. 177-198.
- Renaud, J., Gingras, L., Vachon, S., Blaser, C., Godin, J.-F. et Gagné, B., 2001. Ils sont maintenant d’ici! Les dix premières années au Québec des immigrants admis en 1989, Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, Collection Études, recherches et statistiques, Montréal.
- Robin, R., 1996. « L’impossible Québec pluriel : la fascination de la « souche » », dans Elbaz, Mikhaël, Fortin, Andrée et Laforest, Guy (dir.), 1996, Les frontières de l’identité. Modernité et postmodernisme au Québec, Sainte-Foy et Paris, Les Presses de l’Université Laval et L’Harmattan, pp. 295-310.
- Rondeau, J.-C., 1994. « L’État québécois et l’aménagement linguistique face à la mondialisation : barricades ou coopération », dans Actes du Séminaire « Langue nationale et mondialisation : enjeux et défis pour le français », Conseil de la langue française.
- Salée, D., 2001. « De l’avenir de l’identité nationale québécoise », dans Maclure, Jocelyn et Gagnon, Alain-G. (éds). Repères en mutation : identité, diversité et citoyenneté dans le Québec contemporain. Montréal, Éditions Québec/Amérique, collection « Débats », no 7, pp. 133-164.
- Veltman, C. et Panneton, C., 1989. « L’intégration linguistique des immigrants allophones de la région métropolitaine de Montréal », Actes du Séminaire scientifique sur les tendances migratoires actuelles et l’insertion des migrants dans les pays de la francophonie, Québec, Les Publications du Québec, pp. 319-334.

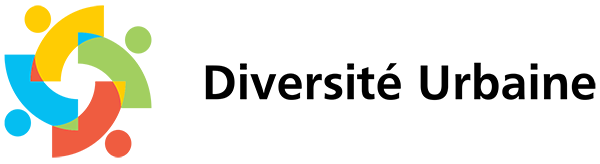
 10.7202/001370ar
10.7202/001370ar