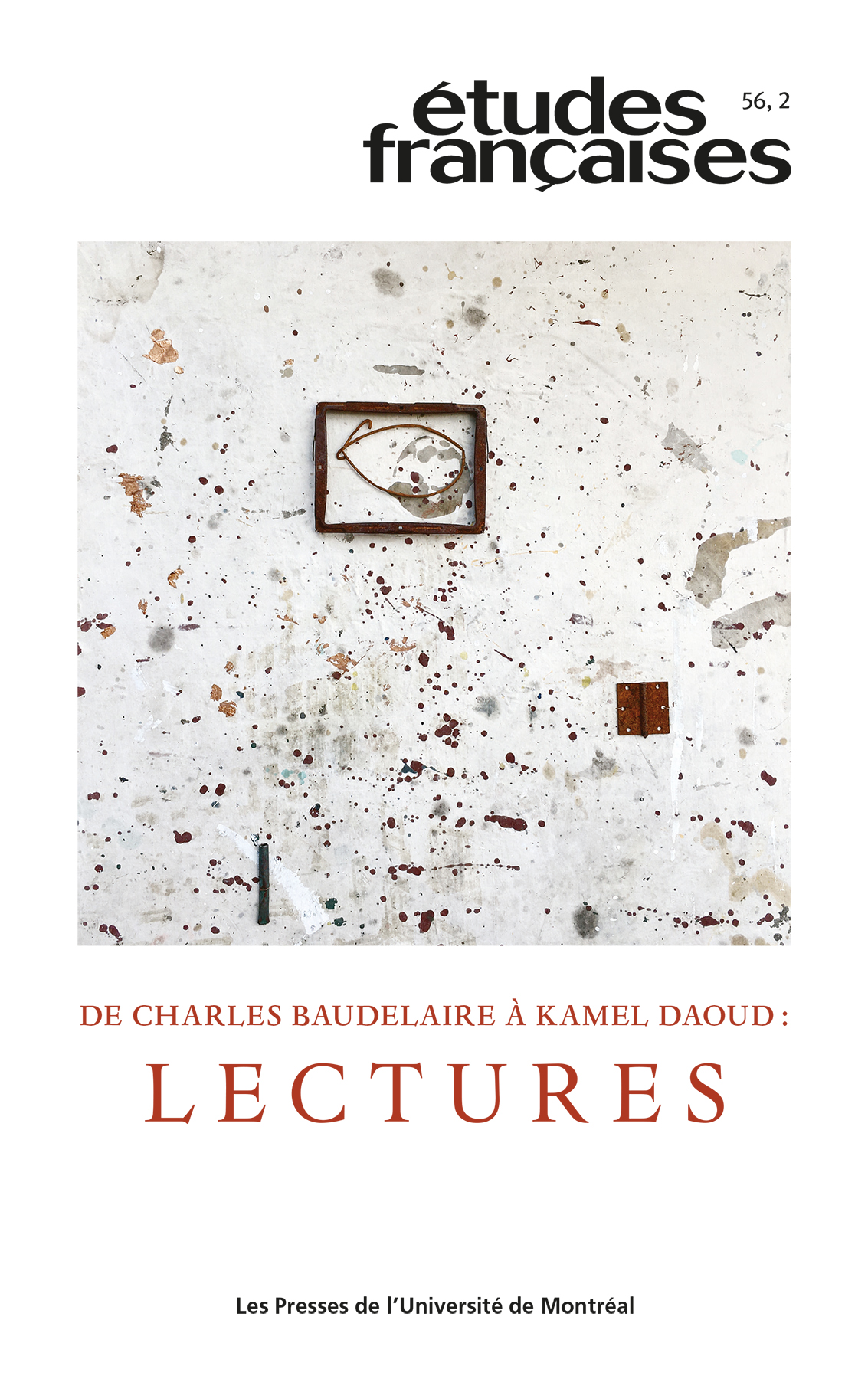Abstracts
Résumé
« Aucun des personnages du roman ne possède les mots pour exprimer la souffrance [de sa] vie », écrivent les auteurs de L’histoire de la littérature québécoise à propos des personnages de La Scouine d’Albert Laberge (M. Biron, F. Dumont, É. Nardout-Lafarge, Boréal, 2007, p. 208). L’ignorance de la langue est une thématique privilégiée dans la littérature québécoise, qui s’est prolongée de différentes manières au fil du xxe siècle, notamment grâce à une abondance de narrateurs enfants engendrant leur propre langage, rêvant d’union incestueuse ou de retour au paradis perdu de l’enfance. Cette insistante thématique est souvent considérée comme le signe d’une immaturité nationale à dépasser. Nous défendons la thèse inverse : le désir littéraire de révéler les origines du langage n’est pas synonyme d’immaturité lorsqu’il est assumé par une complexe élaboration poétique. Il relève alors d’un savoir-faire, ce que La Scouine d’Albert Laberge nous permet de démontrer. Nous proposons une hypothèse nouvelle sur la signification du titre de ce classique de la littérature québécoise. Cette analyse de la poétique du roman engage également une réflexion sur le nom propre et les rapports du sujet au langage qui a pour cadre le savoir de la psychanalyse.
Abstract
“None of the characters in the novel owns the word to express his life’s suffering,” state the authors of L’histoire de la littérature québécoise about La Scouine by Albert Laberge (M. Biron, F. Dumont, É. Nardout-Lafarge, Boréal, 2007, p. 208). Ignorance of language is a privileged thematic in Quebec’s literature. It persisted throughout the 20th century, thanks in particular to an abundance of children narrators generating their own language and dreaming of incestuous unions or of returns to the lost paradise of childhood. This insistent thematic is often considered as the sign of a national immaturity to be overcome. We support the opposite thesis: the literary desire to reveal the language’s origins is not a synonym of immaturity when it is assumed by a complex poetic elaboration. It is then a matter of skill, as La Scouine allows us to demonstrate. We propose a new hypothesis concerning the meaning of the title of this classic of Quebec’s literature. This analysis of the poetics of the novel also involves a reflection on proper names and the relations between subject and language in the context of the knowledge of psychoanalysis.
Article body
Au pays de Québec l’orthographe des noms et leur application sont devenues des choses incertaines. Une population dispersée dans un vaste pays demi-sauvage, illettrée pour la majeure part et n’ayant pour conseillers que ses prêtres, s’est accoutumée à ne considérer des noms que leur son, sans s’embarrasser de ce que peut être leur aspect écrit ou leur genre. Naturellement la prononciation a varié de bouche en bouche et de famille en famille, et lorsqu’une circonstance solennelle force enfin à avoir recours à l’écriture, chacun prétend épeler son nom de baptême à sa manière, sans admettre un seul instant qu’il puisse y avoir pour chacun de ces noms un canon impérieux.
Louis Hémon[1]
Dans la littérature du terroir, le Québec a souvent été présenté ainsi comme une nation naissante constituée d’individus qui parlent depuis une langue transmise à moitié ; des individus analphabètes qui portent des noms dont ils connaissent le son, mais dont ils ignorent l’origine, le « canon impérieux ». C’est bien ce que donne à lire cet extrait de Maria Chapdelaine placé en exergue. Le roman d’Albert Laberge n’hésite pas quant à lui à dépeindre la portée tragique de cette ignorance de la langue en lui donnant pour cadre le quotidien de personnages vivant sur la terre. « Aucun des personnages du roman ne possède les mots pour exprimer la souffrance [de sa] vie[2] », écrivent les auteurs de l’Histoire de la littérature québécoise. « L’objet de ses peintures, ce sont surtout les gens de la campagne, qu’il a voulus ignares, primitifs, grossiers et balourds, empêtrés dans les soucis matériels, juste bons pour engendrer des enfants[3] », écrivait le critique Paul Guay, ne voyant dans ce projet que méchanceté. « Albert Laberge ? Un homme qui refoulait ses sanglots en s’en moquant…[4] » L’ignorance de la langue est pour ainsi dire une thématique privilégiée dans la littérature québécoise, qui s’est prolongée de différentes manières au courant du xxe siècle, notamment par une abondance de narrateurs enfants qui engendrent leur propre langage, qui rêvent d’union incestueuse ou de retour au paradis perdu de l’enfance : Réjean Ducharme, Marie-Claire Blais, Anne Hébert, Victor-Lévy Beaulieu, Gilbert La Rocque, Gaétan Soucy, la liste des auteurs qui travaillent à partir de ces enjeux est longue. On a souvent reconnu dans cette insistante thématique le signe d’une immaturité nationale à dépasser [5]. Notre article entend plutôt défendre la thèse inverse : le désir littéraire de révéler les origines du langage n’est pas synonyme d’immaturité lorsqu’il est assumé par une complexe élaboration poétique ; il relève alors d’un savoir-faire – c’est du moins ce que La Scouine d’Albert Laberge nous offre l’occasion de démontrer. Il s’agira de défendre une hypothèse nouvelle sur la signification du titre de ce classique de la littérature québécoise. Cette analyse de la poétique du roman engagera également une réflexion sur le nom propre et les rapports du sujet au langage qui aura pour cadre le savoir de la psychanalyse.
Régression et savoir-faire
Posons d’abord que la faculté de symboliser[6] est une aptitude humaine qui s’acquiert dans l’enfance : « [C]ette capacité représentative d’essence symbolique qui est à la base des fonctions conceptuelles n’apparaît que chez l’homme. Elle s’éveille très tôt chez l’enfant, avant le langage, à l’aube de sa vie consciente. Mais elle fait défaut chez l’animal[7]. » Dans Enfance et histoire, Giorgio Agamben se demande si on peut retrouver l’expérience pure et muette de l’enfance, cette expérience originaire dont le langage marquerait la limite : « [Y] a-t-il quelque chose comme une en-fance de l’homme ? Comment l’en-fance est-elle possible en tant que fait humain ? Et, si elle est possible, quel est son lieu ?[8] » L’enfance
ne peut être simplement quelque chose qui précède chronologiquement le langage et qui cesse d’exister à un moment donné pour accéder à la parole ; il ne s’agit pas d’un paradis que nous quitterions définitivement un jour pour nous mettre à parler ; elle coexiste originellement avec le langage, ou plutôt elle se constitue dans le mouvement même du langage qui l’expulse pour produire à chaque fois l’homme comme sujet[9].
Formulée de cette manière, la proposition du philosophe nous permet de concevoir l’enfance comme façonnant constamment le langage du sujet, dans un mouvement perpétuel de surgissement et d’expulsion[10]. Autrement dit, le sujet parlant – le parlêtre, pour utiliser un néologisme lacanien – expulse de lui son enfance, elle est sa face cachée, à la fois présente et absente, qui peut trouver dans la littérature un lieu d’élaboration poétique. La psychanalyse considère quant à elle l’accession au langage comme une aliénation nécessaire et constitutive du sujet. En accédant au langage, le sujet « advient » ; il renonce à un état de complétude premier, celui du nourrisson qui fait un avec le monde. « Ainsi le symbole se manifeste d’abord comme meurtre de la chose, et cette mort constitue dans le sujet l’éternisation de son désir[11]. » Cette phrase de Lacan signifie qu’en permettant au sujet de faire apparaître une chose en son absence, le langage crée un écart entre le monde et lui : le voilà incomplet, et donc désirant. Chercher à révéler sur quelle base le langage se forme, son origine ou son au-dehors, ne constitue pas une régression, mais une reconnaissance de ce qu’est l’acte même de parler. En ce sens, l’intérêt que des auteurs portent aux premiers temps de la symbolisation ne va pas dans le seul sens de raconter leur enfance ou de représenter des personnages en train d’apprendre à parler. En élaborant une poétique de l’a-parole, le roman d’Albert Laberge exprime un désir de révéler ce qui reste, ce qui insiste ou ce qui fait retour de l’enfance.
Scouine : un mot « sans signification aucune » ?
Avec son titre, La Scouine d’Albert Laberge prétend évoquer les « origines premières du langage ». C’est ainsi que la narration justifie le surnom de Paulima dans le quatrième chapitre du roman, lequel tient en un paragraphe déterminant :
Paulima pissait au lit. Chaque nuit, il lui arrivait un accident. Au matin, sa chemise et ses draps étaient tous mouillés. Après le départ des bessonnes pour la classe, Mâço, l’été, faisait sécher la paillasse au soleil, sur le four […]. À l’école, à cause de l’odeur qu’elle répandait, ses camarades avaient donné à Paulima le surnom de Scouine, mot sans signification aucune, interjection vague qui nous ramène aux origines premières du langage[12].
Si ce surnom est « sans signification aucune », on peut se demander le sens qu’il y a à mentionner qu’on l’a attribué à Paulima « à cause de » son odeur. L’énoncé paraît moins obscur si l’on signale qu’« aux origines premières du langage », il y a effectivement de la pisse. Dresser le corps de l’enfant consiste précisément à lui apprendre la propreté : c’est un impératif culturel auquel il se plie alors qu’il acquiert le langage. Comme un nourrisson, Paulima ne contrôle pas sa vessie : on lui donne un surnom qui évoquerait cet état, un nom « qui nous ramène aux origines premières du langage ». Ce nom, Scouine, nous faisons ici l’hypothèse qu’il a bien une signification. Dans le Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec, Gilles Dorion rapproche le nom Scouine du mot « sagouin » en évoquant le roman Le Sagouin de François Mauriac et la pièce La Sagouine d’Antonine Maillet, parus respectivement en 1951 et en 1971 ; le lien apparaît en cela ténu[13]. Plus convaincant est le rapprochement avec « le mot anglais “skunk” [mouffette], animal dont les propriétés particulièrement “odoriférantes” ne sont pas sans rappeler celles de Paulima, qui “pissait au lit”[14] ». Nous soutenons plutôt que « Scouine » renvoie au mot « couine », comme dans « elle couine », du verbe « couiner ».
« Couiner » consiste à émettre un son aigu, plaintif. On utilise précisément ce verbe pour désigner les bruits des enfants qui ne parlent pas encore ou ceux de petits animaux (qui ne parleront jamais). Le couinement est peut-être une plainte, une demande, un signal, mais il s’agit d’un son qui ne relève pas d’un langage articulé. Selon le Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey, le terme couiner provient de l’onomatopée « couin » « pour évoquer le cri du porc […] et celui du canard[15] », c’est donc un mot qui coïncide avec le son qu’il désigne. « Le mot se dit d’un animal (lièvre, lapin, porc, souris) qui pousse des cris aigus et brefs. Il s’est répandu dans la langue familière au sens de “pleurer”, “grincer”, en parlant des humains[16]. » Il a la même racine que le mot « coasser » provenant de l’onomatopée « couac » qui imite le son du crapaud, et du verbe « croasser » provenant de l’onomatopée « kroa » qui imite le son du corbeau – des sons également présents dans le roman et dont nous suivrons le mouvement. Bref, « couiner », « coasser », « croasser » sont des mots qui rejoignent phonétiquement les cris qu’ils désignent ; des signifiants qui collent à leur signifié, des sons qui nous ramènent effectivement « aux origines premières du langage ». Le couinement de l’enfant exprime un état de déplaisir qui ne peut être formulé dans un langage intelligible, il s’agit d’un son émis alors que l’enfant ne reconnaît pas encore son image et son nom ; c’est le son de l’infans, de celui qui ne parle pas.
Le nom propre a ceci de particulier qu’il est un signifiant dont il faut accepter, comme sujet, d’être le signifié. Le nom propre est un terme qui nous désigne, mais qui ne nous décrit pas, car il nous précède : notre prénom a été choisi par d’autres avant notre naissance et le patronyme nous inscrit dans une chaîne dont on ne constitue qu’un maillon. Cette verticalité du nom propre n’est pas assurée dans La Scouine. Pensons par exemple au « Vieux Pauvre » qui a eu la vie si dure « qu’il a oublié le nom de ceux qui furent ses fils » (S, 48). Le premier chapitre de La Scouine se termine sur la transcription de la page de garde d’un livre de messe (un « paroissien ») où le père Deschamps inscrit justement le nom et la date de naissance de Paulima : « Marie Rose Paulima est éné le 29 sectembre 1853 et a été batisé le 2 octobre » (S, 15). Les fautes d’orthographe du père donnent à penser que l’insertion de Paulima dans le langage se fait sur des bases fragiles. D’ailleurs la narration n’hésite pas à extirper Paulima de son nom dès le cinquième chapitre en faisant le choix (mesquin, dirait-on) de désigner la jeune fille non par son prénom, encore moins par son patronyme (qu’elle ne porte jamais, même dans le paroissien), mais par « la Scouine », ce « sobriquet » (S, 22) que des enfants lui ont attribué et qui découle apparemment de son odeur.
Ce procédé ne concerne pas seulement Paulima, il s’étend à la plupart des personnages, dont le nom (ou le surnom coché d’une majuscule) coïncide souvent avec le sort, l’occupation ou la condition de leur corps. À la suite d’un accident qui le rend infirme, le frère de la Scouine, Charlot, se fait appeler « Le Cassé ». Baptiste Bagon, dont le métier est de châtrer des bêtes, est désigné « Le Coupeur ». Le vieil homme pauvre qui visite la Scouine est nommé « Vieux Pauvre », tandis que la rue dans laquelle s’est trouvé un espion « porte depuis, le nom de Rue des Espions, et personne n’y passe » (S, 39). Dès la première page, on dit du père Deschamps qu’il est un travailleur « des champs[17] ». « Son patronyme montre l’identification totale entre l’homme et son travail[18] », remarque Jean-Pierre Boucher. Ce nom, qui joint un déterminant (« des ») et un espace naturel (« champs ») n’est pas sans rappeler le patronyme de l’auteur lui-même (La / berge). Bref, dans La Scouine, à la manière des contes pour enfants, le nom propre est bien souvent un nom commun, il n’est jamais arbitraire puisqu’il décrit et désigne du même coup. Il semble dès lors cohérent que la Scouine couine : la jeune fille entre en effet dans son nom – c’est ce que nous allons maintenant démontrer – à la manière du père Deschamps des champs, du Cassé cassé et du Coupeur coupeur.
La Scouine couine
« I paraît qu’elle donne de longs devoirs » (S, 32) : c’est sur ces mots que Paulima médit à l’endroit de la nouvelle institutrice, Mlle Léveillé, avant même de la connaître. Dans le roman, l’éducation se présente comme une torture, un étouffement dont Paulima se libère sur l’heure du dîner : « Comprimée, étouffée pendant trois heures, cette jeunesse reprenait enfin ses droits » (S, 17). Les peurs de Paulima à l’égard de l’institutrice en viennent à se concrétiser : « La Scouine apprit avec terreur qu’elle devrait étudier la grammaire et l’histoire du Canada. […] Non bien sûr, qu’elle n’apprendrait pas tout ça. Jamais de la vie » (S, 32). À la demande de Mlle Léveillé, Paulima doit réciter une leçon particulière. Résistante, elle choisit d’abord de se taire : « La Scouine n’ouvrit pas la bouche » (S, 33), « la Scouine resta muette » (S, 33), « la Scouine n’articula pas une parole » (S, 33). Elle répond finalement : « C’est pas dans mon livre » (S, 33). La page est effectivement arrachée. Irritée, l’institutrice lui donne une autre leçon pour le jour suivant, celle d’apprendre la manière dont on forme le pluriel dans les noms. La même réponse lui est offerte : « C’est pas dans mon livre » (S, 33). Même si cela n’est pas révélé dans le roman, il est permis de penser que Paulima déchire systématiquement les leçons choisies par Mlle Léveillé. L’histoire se répète donc une troisième fois, et l’institutrice décide de punir la Scouine en lui infligeant des coups de règle sur les doigts. La peur[19] éprouvée par Paulima au moment de recevoir ces coups la mène à pousser de hauts cris qui alertent les voisins, les passants et les travailleurs des alentours :
la Scouine se mit à crier et à gémir comme si on l’eut martyrisée.
[…] C’était une plainte aiguë qui s’envolait par les fenêtres. […]
Au troisième coup, la Scouine s’élança hors de la maison, jetant des cris encore plus perçants[, …] faisant entendre des lamentations terrifiantes. Elle hurlait comme si on eut cherché à l’assassiner.
La fille à Mâço courait de toutes ses forces, levant les talons jusqu’aux fesses et s’éloignant avec des cris de cochon que l’on saigne.
S, 35 ; nous soulignons
Prétendant « que la maîtresse lui avait donné douze coups de martinet sur chaque main » (S, 36), la Scouine réussit à faire renvoyer Mlle Léveillé. Le chapitre se termine sur ce constat : « Et voilà pourquoi la Scouine n’a jamais appris la règle du pluriel dans les noms » (S, 36). Dans cette scène, le cri de la Scouine coïncide avec le cri d’un « cochon que l’on saigne », c’est-à-dire un couinement. Si émettre un tel cri, c’est déjà faire une utilisation « infantile » du langage, notons que la profération de ce cri est dramatisée au sein d’une histoire où se manifeste un refus d’apprendre une des règles les plus élémentaires de la langue française, la règle du pluriel. La Scouine désire rester « aux origines premières du langage », en deçà de l’apprentissage de la grammaire et de l’histoire, et pour cela, elle couine. Cette association entre enfance et couinement, en tant qu’elle déborde le seul personnage de Paulima et contamine l’ensemble du texte, s’érige en véritable ressort poétique dont il s’agit maintenant de dégager la logique. Le couinement, qui devient aussi coassement et croassement, s’arrime à ce motif d’écriture qui consiste à évoquer les origines du langage, les premiers temps de la symbolisation.
Les différents lieux de l’enfance
Charlot a le projet d’aller se faire rembourser deux cents dollars que lui doit un homme vivant sur le rang du Quatre, à quelques heures de chez lui. Il s’y rend dans une charrette tirée par un poulain, avec sa soeur, la Scouine, mais aussi son voisin Baptiste Bagon. Bagon veut depuis longtemps visiter le rang du Trois qui se trouve sur le chemin de Charlot, endroit où il a passé les deux premières années de sa vie – avant d’acquérir le langage, donc. À deux ans, Bagon a été confié à des membres éloignés de sa famille, « si éloignés qu’ils étaient pour ainsi dire des étrangers » (S, 95), car ses deux parents sont morts du choléra. Il veut par ce voyage retourner sur les lieux de cette époque, les lieux oubliés de son « origine », ceux où « il avait commencé son existence de paria, jeté sa première plainte » (S, 96). Le chapitre qui raconte ce périple est construit de telle sorte que la narration nous donne accès aux pensées de Bagon à qui l’enfance miséreuse revient en mémoire au fur et à mesure qu’il s’approche du lieu en question, comme si le film de sa vie se déroulait devant ses yeux « dans une vision rapide, sombre comme un purgatoire » (S, 95). Ce récit de souvenirs est entrecoupé de nombreux détails concernant ce qui ressemble à un « couinement », un bruit aigu qui les accompagne tout au long du voyage :
Juste à ce moment, l’une des roues que Charlot avait négligé de graisser, commença à crier. Ce ne fut d’abord qu’un léger grincement, court et sourd. Peu à peu, cependant, il s’accentua, grandit, devint aigu, tourna à une plainte monotone, sans fin, lugubre comme un hurlement de chien dans la nuit. C’était, semblait-il, un viol du silence. La voiture traversait une campagne morne et plate, indéfiniment. Des vols noirs de corneilles croassantes passaient au-dessus du feuillage jaune des arbres et allaient s’abattre sur les clôtures.
S, 94 ; nous soulignons
Le récit de l’enfance miséreuse[20] se poursuit, et le bruit aigu[21] est évoqué à nouveau : « Et la roue criait lamentablement, gémissait comme une âme en détresse, faisant entendre une plainte aiguë, sans fin, comme quelqu’un qui aurait eu une peine inconsolable » (S, 95). Suivant la même alternance, le grincement de la roue est évoqué à de multiples reprises : « Et toujours la roue criait, gémissait, comme quelqu’un que l’on torture… » (S, 96), « la roue chantait toujours sa complainte » (S, 96). Finalement, le bruit s’interrompt lorsque la roue est graissée avec l’huile d’un « biberon » (S, 94) emprunté à un habitant croisé sur leur route. On fait taire le cri de la roue avec un biberon comme on ferait taire la plainte d’un enfant. Le cri s’arrête, mais le souvenir du cri, prégnant, demeure dans l’esprit des personnages : « Ils avaient encore dans l’oreille le grincement de la roue et les éclats de rire des gamins à leur passage » (S, 97). Le couinement est ainsi associé à un retour sur les lieux géographiques et imaginaires de l’enfance de Baptiste Bagon[22].
À titre de deuxième exemple, c’est sous « la note aiguë des criquets » (S, 128) et sous le bruit des « corneilles [qui] s’abattaient en croassant sur les branches d’un frêne sec » (S, 128) qu’Urgèle Deschamps attend la mort en régressant dans l’enfance. À la fin de sa vie, il devient « une ruine lamentable » (S, 129), « comme un animal qu’on vient de châtrer » (S, 128) ; à l’instar de la Scouine, il n’arrive plus à retenir son urine : « Le vieux devenait gâteux, malpropre. Il souillait maintenant son pantalon comme enfant il avait sali ses langes, et presque chaque jour, les deux femmes avaient la tâche répugnante de le nettoyer » (S, 129 ; nous soulignons). Une fois le père mort, le cri resurgit dans toute sa connotation animale : « Des meuglements de vaches par moments déchiraient le silence, appel obscur et incompréhensible jeté dans le vague des ténèbres. / Et, le coassement monotone des grenouilles dans les fossés, petite note grêle et métallique, d’une infinie tristesse, montait comme une plainte vers les lointaines étoiles » (S, 131). Ainsi on peut remarquer que le cri ne nous met pas seulement sur la piste de l’enfance comme moment ou période définie dans le passé. Ce qui est visé, c’est aussi ce qui excède le langage, ce qui vient après, lorsque le langage quitte le sujet mourant, ou encore ce qui est hors du langage en lui étant toutefois lié (l’animalité et la jouissance, nous y reviendrons). Entre les couinements qui encadrent la scène du trépas du père Deschamps, on signale justement la présence d’un tissu noir étampé sur sa porte la nuit de sa mort (un « long crêpe » ; S, 130) qui peine à signifier, ou dont la signification serait donnée à voir sans personne pour la lire : « Ses plis mystérieux, immobiles par moments, et tantôt légèrement remués par le vent, semblaient contenir des destinées obscures, offrir un sens comme les caractères d’une langue inconnue tracés par une main invisible. Cette loque sinistre flottant dans la nuit, prenait un aspect redoutable et terrifiant, semblait lancer des appels silencieux, recevoir des messages muets » (S, 130-131). Ce « long crêpe », c’est bien un signifiant sans signifié, à la manière d’un mot qui ne désignerait rien, un signe sans signification. On pense aussi au visage de la Scouine, indéchiffrable pour l’institutrice : « Mlle Léveillé regarda longuement l’enfant, mais il n’y avait rien à lire sur cette figure » (S, 33). Le texte de Laberge s’intéresse à l’indicible, non pas seulement à ce qu’un personnage donné serait trop ignorant pour comprendre, mais à ce qui est à la limite de la signification.
Quitter le langage
La Scouine qui veut rester une enfant ; Deschamps qui en redevient un ; Bagon qui retourne sur les lieux de son enfance : la noirceur du roman réside en partie dans cette tendance des personnages à se laisser tirer vers le néant d’où ils proviennent, comme s’ils étaient habités par une pulsion de mort que la narration désirait mettre au jour. Même vivant, le père Deschamps semble attendre sa mort : « Par moments, lorsqu’il était en avance sur son travail, il s’étendait au bord de l’amoncèlement [de blé] et savourait la sensation d’être entraîné vers l’abîme, de sentir le vide se faire sous sa poitrine. D’autres fois, il laissait son poing reposer inerte à la surface et il le regardait s’enfoncer graduellement, disparaître avec le froment » (S, 55)[23]. L’homme revient à la terre dont il semble ne jamais s’être véritablement extrait. On sent ici l’influence de Zola, qui était un écrivain particulièrement apprécié par Laberge[24]. Pour Zola, la vérité de l’homme – cette « bête humaine » dont il faisait un sombre portrait dans son entreprise romanesque – réside dans son animalité latente. À Jules Lemaître, il écrivait ceci : « Vous mettez l’homme dans le cerveau, je le mets dans tous ses organes. Vous isolez l’homme de la nature, je ne le vois pas sans la terre, d’où il sort et où il rentre. L’âme que vous enfermez dans un être, je la sens épandue partout, dans l’être et hors de l’être, dans l’animal dont il est le frère, dans la plante, dans le caillou[25]. » Jacques Pelletier suggère que le statut de l’animalité dans La Scouine constitue le signe le plus clair de la parenté de Laberge avec Zola : « Pour Zola, on le sait, l’homme est une bête que la civilisation n’a jamais véritablement réussi à dompter : sous son image policée, sous le vernis de ses bonnes manières, il demeure une brute et il suffit qu’une occasion se présente pour que sa vraie nature se manifeste[26]. »
C’est dans une scène qui convoque sa jouissance sexuelle que Charlot semble à son tour revenir au « rien » de l’origine, hors du langage et dans l’animalité. La psychanalyse conçoit bien sûr la jouissance comme un état prélangagier, un état que l’on quitte en devenant sujet, vers lequel on ne cesse jamais de tendre, mais dans lequel on est appelé à s’abolir. Pour le dire avec Christiane Lacôte-Destribats :
Du fait [que le sujet] parle, du fait que “l’inconscient est structuré comme un langage”, comme le démontre Lacan, la jouissance ne peut être conçue comme satisfaction d’un besoin apportée par un objet qui le comblerait. [… La jouissance] est interdite, non pas au sens facile où elle serait barrée par des censeurs, elle est inter-dite, c’est-à-dire qu’elle est faite de l’étoffe même du langage où le désir trouve son impact et ses règles[27].
« Réel » est le nom que Lacan attribue à ce qui, dans le rapport du sujet parlant au monde, relève de l’inaccessible ; c’est « l’expulsé du sens[28] », « c’est en deçà et au-delà des possibilités même du langage. Quand on y touche, ça laisse “sans voix”, en panne de mots pour dire[29]. » Parler depuis le lieu de sa jouissance (le réel) est une impossibilité logique, car la jouissance est un espace hors du langage dans lequel « je » ne suis pas. Dans la jouissance sexuelle, le sujet éprouve quelque chose qui peut évoquer le moment premier de complétude qui précède son entrée dans le langage. Si l’association entre la jouissance et l’origine trouve ici un appui conceptuel, elle est toutefois clairement tracée par le roman lui-même. Une Irlandaise s’approche de Charlot qui se voit animé « de luxurieux et lancinants désirs » (S, 78) :
Cet homme qui jamais n’avait connu la femme, sentait sourdre en lui d’impérieux et hurlants appétits qu’il fallait assouvir. Toute la meute des rêves mauvais, des visions lubriques, l’assiégeait, l’envahissait.
Une solitude immense et des ténèbres profondes, épaisses comme celles qui durent exister avant la création du soleil et des autres mondes stellaires, enveloppaient les deux êtres. La pluie battait la couverture de la grange, chantant sa complainte monotone, et la sempiternelle et lugubre plainte des grenouilles s’entendait comme un appel désespéré.
Alors Charlot se rua.
Et le geste des races s’accomplit.
Ce fut sa seule aventure d’amour.
S, 78 ; nous soulignons
La jouissance comme aboutissement d’un désir « hurlant » est ici mise en rapport avec le coassement des grenouilles, mais aussi avec ce qui précède le commencement du monde, « la création du soleil et des autres mondes stellaires ». Charlot accomplit dans cette scène « le geste des races », moyen de signaler que la jouissance rime ici avec l’animalité, qu’elle est hors du langage et de la culture.
« On parlait sans se comprendre »
Ces différentes scènes qui associent le cri animal – le couinement, le coassement, le croassement – aux premiers temps de la symbolisation nous rappellent que le langage n’est pas seulement un moyen de communication, mais une matière, une matière dans laquelle le sujet se forme et se déforme, de laquelle il émerge, à laquelle il se plie[30]. Il y a d’ailleurs peu de communication dans La Scouine. « On parlait sans se comprendre » (S, 87) est-il mentionné à l’occasion d’une fête. Dans un acte de communication « réussi », l’énonciation est généralement « oubliée », c’est-à-dire que la signification d’un énoncé retient l’attention des sujets dans leurs échanges. Lacan met cette donnée en évidence avec sa formule « Le dire est justement ce qui reste oublié derrière ce qui est dit dans ce qu’on entend[31] ». Dans l’échec de la communication, le « dire » n’est justement pas oublié, il insiste à se montrer comme « chose vocale », pour citer le titre d’un recueil de poésie de Michael Delisle[32]. « Pour dire comme on dit[33] » est d’ailleurs « la phrase avec laquelle Deschamps abordait tout le monde » (S, 66). Autrement dit, la phrase qu’il se plaît à répéter pour entrer en contact avec autrui en est une où la parole se présente comme parole, une phrase où l’énonciation est l’énoncé. C’est dans l’accumulation de tels passages que cette caractéristique du langage – sa texture – prend son importance dans l’économie du texte. Lorsque la Scouine médit sur Mlle Léveillée, on dit qu’elle parle parfois pour parler, « pour dire quelque chose » (S, 32). Le premier discours rapporté du roman – il s’agit de Mâço sur le point d’accoucher, qui dit : « Mon vieux, j’cré ben que j’vas être malade » (S, 12) – est d’ailleurs précédé par le syntagme « Elle parla ». « La rupture de son silence n’en prend que plus de relief : “Elle parla”, et non pas “elle dit”, pour bien souligner l’extraordinaire de la chose[34] […]. » La parole est dans La Scouine une chose qui se fait voir et entendre dans son statut de parole ; cela, le texte ne cesse d’en montrer la portée tragique. Le Vieux Pauvre « est avare de ses paroles comme les riches de leurs biens » (S, 49). Quant à Jérémie Deschamps, « [s]es paroles semblent passer par un obscur, tortueux et glacial souterrain avant d’arriver à ses auditeurs » (S, 126-127). La parole est parfois difficile à proférer ; le cordonnier « parlait lentement, comme si chaque parole lui eut coûté un pénible effort » (S, 112). Le drame, pour les personnages, n’est pas seulement d’échouer à entrer en communication avec autrui, mais de voir les signifiants les hanter, sans possibilité de les mettre à distance : « Dans les têtes grises des deux vieux [les Deschamps], passaient des idées tristes, si tristes que leurs lèvres pâlies n’avaient pas de mots pour les dire, et se continuaient la nuit en cauchemars dans le grand lit qui craque » (S, 124). Entre autres échecs de la communication, on compte un passage où Charlot parle à son cheval « sans s’en rendre compte » : « Charlot de sa voix aiguë, lançait à son cheval un commandement inintelligible » (S, 80). Si l’animalité est si présente dans le roman, c’est justement parce qu’elle incarne la part non domestiquée du sujet, celle qui s’oppose à l’ordre du langage dans lequel il est pris.
Scouine et rescouine
Le roman de Laberge est travaillé par le signifiant « scouine », qui devient couinement, coassement, croassement, avec lequel le texte nous fait miroiter les débuts ou l’au-dehors du langage, qui sont animalité, cri, plainte aiguë, gémissement, réminiscence, jouissance. Ce motif récurrent dans La Scouine – qui ne se trouve pas dans les nouvelles de Laberge – donne au roman une unité de ton qui nous permet de contredire l’idée répandue chez les critiques voulant que La Scouine soit moins un « roman » qu’un ensemble de scènes disparates unies par « un lien lâche »[35]. Cette poétique de l’a-parole donne étonnamment lieu à un texte jalon de l’histoire littéraire québécoise, le premier qui représenterait fidèlement la réalité sans l’idéaliser[36]. Il a pour cela subi un sort bien particulier dans l’histoire littéraire, rejeté par les autorités cléricales de l’époque, redécouvert dans les années 1960 grâce à l’Anthologie préparée par Gérard Bessette. L’histoire littéraire a rétroactivement identifié Laberge comme celui qui présentait dans ses écrits une vérité inaudible pour son époque. On a conséquemment dit de La Scouine qu’il s’agissait du premier roman naturaliste au Québec[37], « le seul texte dans lequel se fait sentir de manière directe et immédiate l’influence de Zola[38] », et c’est bien pour signaler, entre autres, que l’écriture arrive à maîtriser la réalité par la description – une description parfois si crue que Laberge a été traité de « pornographe »[39]. Paradoxalement, on a là un texte qui pointe ou appelle les premiers temps de la symbolisation, ceux où le langage n’intervient pas entre le mot et la chose, un texte qui s’intéresse finalement à ce qui précède ou excède la capacité même de se représenter le monde. À ce titre, des lectures contemporaines de Laberge remettent en question les étiquettes qui ont été apposées à ce roman depuis un siècle. Disons, avec Yannick Roy, que « [p]ersonne à tout le moins n’a été “réaliste” de cette manière […]. Et d’ailleurs, à bien y penser, il n’est pas certain que son parti pris puisse être qualifié de réaliste. […] Laberge n’est pas un observateur, mais un étrange et sombre visionnaire. On referme ses livres comme on se réveillerait d’un cauchemar ; on y a vu l’humanité sous son jour le plus abject[40]. »
Il convient de dire quelques mots, en guise de conclusion, du roman de Gabriel Marcoux-Chabot audacieusement titré La Scouine, paru cent ans après l’original[41]. Réécrivant et inventant des épisodes du classique de Laberge, Marcoux-Chabot propose un roman modelé par une contrainte formelle[42] additionnée d’une dimension psychologique absente du texte original. En proposant une psychologie aux personnages, en montrant (inventant) des motivations à leurs actes, Marcoux-Chabot en vient justement à tenir un discours sur ce qui, dans le premier texte, relevait de l’irreprésentable, du hors-sens. Ainsi Charlot éprouve-t-il ici un désir homosexuel qui le projette « aux frontières de l’innommé[43] », en deçà du langage : « [I]l songe à l’étranger qui dort au grenier et le coassement des grenouilles résonne dans son esprit comme une réponse claire à une question qu’il ne s’est jamais posée[44]. » Dans la jouissance, il « cesse d’exister[45] », « il voudrait à présent que le Taon puisse combler la distance qui les sépare, investir le silence qui les unit[46] ». La richesse de ce texte est de rester près du projet original, non pas en reprenant telles quelles les scènes du roman ou la chronologie de l’histoire racontée, mais en respectant et prolongeant ce que nous avons nommé poétique de l’a-parole où le couinement est mis en rapport avec l’animalité et la jouissance. Il s’agit d’« un déplacement dans l’identique[47] » pour citer David Bélanger, qui fait « moins ressembler la nouvelle Scouine à un remake qu’à une restauration[48] ». Dans cette version, la Scouine éprouve un désir incestueux pour son frère Charlot ainsi qu’un désir sensuel pour un veau. Elle retrouve dans la compagnie de l’animal un état de complétude qui rend le langage futile :
Dans ces moments privilégiés, elle a l’impression de voir enfin s’abolir la frontière qui l’isole en permanence des êtres qui l’entourent. Son corps, soudain, n’est plus un obstacle à l’échange, mais un lieu de contact, un point de rencontre. Son verbiage même devient inutile et c’est le plus souvent sans prononcer un seul mot qu’elle prend soin d’elle en même temps que de ses animaux[49].
C’est dans la compagnie de l’animal que Paulima trouve ici à s’apaiser, se retirant du langage et jouissant de son corps. Si Laberge fait « couiner » la Scouine à une seule occasion – lorsqu’elle fuit les coups de Mlle Léveillée –, Marcoux-Chabot compare explicitement Paulima et sa soeur à des « souriceaux à l’épiderme rose et dépourvu de poils que son père écrase à grands coups de botte lorsqu’il a le malheur de tomber sur leur nid dans un obscur recoin de la grange[50] ». Les jumelles ont ici l’allure de souris, cet animal qui couine, et on signale qu’elles sont hors de l’ordre du langage, incapable de communiquer ; ce sont des « [c]réatures fragiles, anodines, incertaines, geignant et grimaçant sous l’impulsion de quelque instinct primaire, elles éploient vainement leurs membres dérisoires, inaptes, dirait-on, à entrer en relation avec le monde qui les entoure[51] ». Dans ce texte en forme d’hommage et d’exercice de style – qui méritera certainement d’être étudié en lui-même –, Marcoux-Chabot achève le travail de Laberge et enfonce définitivement la Scouine dans son nom.
Appendices
Note biographique
Louis-Daniel Godin est professeur régulier au département d’Études littéraires de l’Université du Québec à Montréal. Privilégiant une approche psychanalytique, sa thèse de doctorat intitulée Les père-mutations du sujet : écriture totémique et enfant totem (Hervé Bouchard et Michael Delisle) s’intéresse notamment aux fonctions du nom propre au sein d’oeuvres littéraires québécoises contemporaines et aux rapports entre l’écriture et la subjectivation. Il vient de codiriger, avec Michel Nareau, un dossier de la revue Voix et images consacré à l’oeuvre de Lise Tremblay (vol. XLV, no 3, printemps-été 2020). Il collabore régulièrement aux cahiers critiques des revues Liberté et Spirale.
Notes
-
[1]
Maria Chapdelaine (1921), Montréal, Boréal, 1988, p. 42-43.
-
[2]
Michel Biron, François Dumont et Élisabeth Nardout-Lafarge, avec la participation de Martine-Emmanuelle Lapointe, Histoire de la littérature québécoise, Montréal, Boréal, 2007, p. 208.
-
[3]
Paul Guay, « Gérard Bessette : Anthologie d’Albert Laberge », Lectures, nouv. série, vol. 9, no 9, mai 1963, p. 231 col. 1.
-
[4]
Ibid., col. 2.
-
[5]
Les critiques ont appréhendé ce motif d’écriture de manière ambivalente (reconnaissance et suspicion) selon différentes perspectives théoriques ou idéologiques (psychanalytique, psychocritique, féministe, sociohistorique, mythocritique, nationaliste) au sein de différents lieux (thèses, articles, essais, chroniques, fictions). Nous étudions cette ambivalence dans l’introduction de notre thèse de doctorat : « L’enfant, “totem” d’une communauté interprétative », dans Les père-mutations du sujet : écriture totémique et enfant totem (Hervé Bouchard et Michael Delisle), département d’Études littéraires de l’Université du Québec à Montréal, 2018, p. 1-42.
-
[6]
« Entendons par là, très largement, la faculté de représenter le réel par un “signe” et de comprendre le “signe” comme représentant le réel, donc d’établir un rapport de “signification” entre quelque chose et quelque chose d’autre » (Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale 1, Paris, Gallimard, « Tel », 1976 [1966], p. 26).
-
[7]
Ibid.
-
[8]
Giorgio Agamben, Enfance et histoire. Destruction de l’expérience et origine de l’histoire, traduit de l’italien par Yves Hersant, Paris, Payot & Rivages, « Petite bibliothèque Payot », 2002 [1978], p. 87.
-
[9]
Ibid., p. 89. Nous soulignons.
-
[10]
Dans On tue un enfant (Paris, Seuil, « Le champ freudien », 1975), Serge Leclaire conçoit justement le renoncement au narcissisme primaire – renoncement sans lequel il n’y a pas de sujet possible – comme un meurtre (métaphorique) du représentant inconscient de l’enfant en soi.
-
[11]
Jacques Lacan, « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse », dans Écrits I, Paris, Seuil, « Points », 1971 [1966], p. 204.
-
[12]
Albert Laberge, La Scouine (1918), Montréal, Bibliothèque québécoise, 2013, p. 22 (nous soulignons). Désormais abrégé S suivi du numéro de la page.
-
[13]
Gilles Dorion, « La Scouine » dans Maurice Lemire (dir.), Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec, t. II : 1900 à 1939, Montréal, Fides, p. 995 col. 2.
-
[14]
Ibid., p. 995 col. 2-996 col. 1.
-
[15]
Alain Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 1994 [1992], t. I, p. 510 col. 2.
-
[16]
Ibid.
-
[17]
« Une chandelle posée dans une soucoupe de faïence ébréchée, mettait un rayonnement à sa figure barbue et fruste de travailleur des champs » (S, 11).
-
[18]
Jean-Pierre Boucher, Instantanés de la condition québécoise, Montréal, Hurtubise HMH, « Cahiers du Québec / Littérature », 1976, p. 31.
-
[19]
Il semble que ce soit davantage la peur que la douleur qui provoque les cris, car le texte signale que les deux premiers coups n’ont rencontré « que le vide » (S, 32). Une ambiguïté persiste quant au troisième coup.
-
[20]
« Et soudain, apparut à Bagon, dans une vision rapide, sombre comme un purgatoire, les mille misères endurées depuis son enfance… Tout lui revenait à cette heure en tableaux nets et distincts. Orphelin à deux ans, recueilli par des parents si éloignés qu’ils étaient pour ainsi dire des étrangers, des gens qui, pendant trois ans, l’avaient fait coucher sur la pierre froide et nue du foyer. Trois ans pendant lesquels il n’avait eu d’autre chose à manger que du pain dur et du lait écrémé, d’autre vêtement qu’une petite robe de coton… / […] / Bagon se voyait tout jeune, condamné à faire des ouvrages trop durs pour son âge et ses forces. Mal nourri, mal vêtu, il était forcé de travailler quand même. Lorsqu’il avait eu la picote à deux ans, il avait passé deux mois avec la même chemise, sans personne pour s’occuper de lui, pour le soigner. La maladie lui avait coûté la perte d’un oeil. S’il n’avait pas crevé alors, c’est que la mort évite les pauvres, les gueux, les mangeurs de misère… Et toute sa vie s’était écoulée semblable, presque la même, toujours » (S, 95-96).
-
[21]
Même la voix de Charlot devient aiguë dans ce passage : « De temps à autre, Charlot lançait de sa voix aigre et pointue un : / – Avance din ! Avance din ! à son poulain, accentuant le commandement d’un cinglement de sa hart » (S, 94).
-
[22]
Rappelons que le métier de Bagon est de châtrer des bêtes : « [D]e par son métier, il avait supprimé des milliers de vies possibles » (S, 96). Cet homme qui porte le baptême dans son prénom a pour métier d’empêcher la vie.
-
[23]
Notons qu’un grincement est mentionné lors de cette scène : Deschamps « tournait sa manivelle, et la pièce s’emplissait du dur grincement des roues à engrenage, du monotone bourdonnement de l’éventail » (S, 55).
-
[24]
« “Ça fait quinze ans que je pioche Marcel Proust”, me déclarait un jour un camarade du journal. Mais voilà que depuis deux ans, il est condamné au repos. Comme moi, il aurait dû employer son temps à lire Renan, Guyan, Anatole France, Maupassant, Pierre Louÿs, Zola, Loti, Daudet, Jules Renard, Mirbeau, etc. » (Albert Laberge, dans Gérard Bessette, Anthologie d’Albert Laberge, Montréal, Cercle du livre de France, 1962, p. 270).
-
[25]
Émile Zola, lettre du 14 mars 1885 à Jules Lemaître, Correspondance, publiée sous la dir. de B. H. Bakker, t. V : 1884-1886, Paris / Montréal, éd. du CNRS / Presses de l’Université de Montréal, 1985, p. 245.
-
[26]
Jacques Pelletier, « La Scouine, avatar québécois du naturalisme », Les cahiers naturalistes, no 51, 1977, p. 93.
-
[27]
Christiane Lacôte-Destribats, « Jouissance », dans Roland Chemama et Bernard Vandermersch (dir.), Dictionnaire de la psychanalyse, Paris, Larousse, « In extenso », 2003 [1998], p. 295.
-
[28]
« Le Réel, faut concevoir que : – c’est l’expulsé du sens. – C’est l’impossible comme tel. – C’est l’aversion […] du sens », propose Lacan dans la leçon du 11 mars 1975 de son vingt-deuxième séminaire (R.S.I. 1974-75, p. 130). Lacan ajoute : « Le Réel, c’est le “sens en blanc”, autrement dit : le sens blanc par quoi le corps fait semblant. Semblant dont se fonde tout discours » (ibid., p. 142). Inédit d’après les enregistrements de Patrick Valas (disponible en ligne : www.valas.fr/Jacques-Lacan-RSI-1974-1975,288, page consultée le 31 juillet 2020).
-
[29]
Jean-Pierre Leblanc, « Le réel, la jouissance, le hors-discours. Quelques réflexions sur le dispositif dit d’“analyse de pratique” », Psychanalyse, no 18 (« Le symptôme encore. Extase. Ségrégation »), 2010-2, p. 102. Autre publication dans La lettre de l’enfance et de l’adolescence, nos 85-86 (« Penser, travailler ensemble. Désir d’équipe, désir d’éthique »), 2011-2, p. 159.
-
[30]
Benveniste insiste sur cette donnée. Le langage n’est pas un outil mis à la disposition de l’homme, il le constitue : « Nous n’atteignons jamais l’homme séparé du langage et nous ne le voyons jamais l’inventant. […] C’est dans et par le langage que l’homme se constitue comme sujet ; parce que le langage seul fonde en réalité, dans sa réalité qui est celle de l’être, le concept d’“égo” » (op. cit., p. 259).
-
[31]
Nous préférons ici la formulation originale que l’on peut retrouver notamment dans un enregistrement audio du vingtième séminaire de Lacan, Le séminaire. Encore (1972-1973), séance du 19 décembre 1972 (disponible en ligne : www.valas.fr/IMG/mp3/03_encore-72-12-19.mp3, page consultée le 31 juillet 2020). Dans la version publiée, Jacques-Alain Miller choisit de reformuler ainsi : « Qu’on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s’entend » (Jacques Lacan, Le Séminaire. Encore. Livre XX (1972-1973), Paris, Seuil, « Le champ freudien », 1975, p. 20).
-
[32]
Michael Delisle, Chose vocale, Montréal, les Herbes rouges, 1990.
-
[33]
La phrase complète, dont le sens nous échappe, est la suivante : « Pour dire comme on dit, su’t’en bâtisse » (S, 66).
-
[34]
Jean-Pierre Boucher, op. cit., p. 32.
-
[35]
Voir Gilles Dorion : « En effet, la lecture révèle trente-quatre chapitres déroulant un groupe de tableaux réalistes à la façon des naturalistes français Zola, Maupassant… Un lien assez lâche les unit l’un à l’autre, d’une façon linéaire, au fil de la vie de la Scouine, qui forme pour ainsi dire la trame de l’ouvrage » (op. cit., p. 995 col. 1). Gilles Dorion va jusqu’à dire qu’« on remarque la structure très lâche de ce roman à tiroirs, où la place des divers éléments ou anecdotes se combine d’une façon aléatoire selon les caprices du rédacteur. Le romancier procède sciemment par tableaux séparés, par tranches de vie ou par scènes précises, en les raccordant par quelques artifices de vocabulaire ou par des notations sommaires de temps » (ibid., p. 996 col. 1).
-
[36]
Il s’agit là d’une affirmation qui ne fait pas consensus. Gilles Dorion avance : « S’il s’acharne à présenter un véritable défilé de monstres, il ne faudrait pas croire que ce réalisme brutal reflète fidèlement la réalité québécoise des dernières décennies du xixe siècle. […] Le fatalisme de l’auteur déteint partout. Ses excès nuisent même à la thèse » (ibid, p. 996 col. 2). Annie Alexandre montre, quant à elle, que le portrait n’est peut-être pas aussi sombre que les critiques littéraires l’on prétendu, ce qu’elle arrive à repérer par le motif de l’ombre et de la lumière dans le roman ; elle cherche ainsi à « découvrir un Laberge moins noir, moins révolutionnaire, que la réception contemporaine ne décèle plus » (« Albert Laberge : aux bords de l’ombre vague », Voix et images, vol. 10, no 3, printemps 1985, p. 101).
-
[37]
Gilles Marcotte parle de « l’arrivée du naturalisme dans nos lettres : un naturalisme brutal, hargneux, corrosif, qui faisait un violent contraste avec l’idéalisation terrienne alors en vogue » (« Connaissez-vous Albert Laberge ?… », La Presse, 2 mars 1963, supplément « Arts et Lettres », p. 8, cité par Gilles Dorion, op. cit., p. 997 col. 2). La couverture de la première réédition officielle de La Scouine, aux éditions l’Actuelle en 1972, mentionne d’ailleurs qu’il s’agit du « premier roman réaliste au Québec ».
-
[38]
Jacques Pelletier ajoute : « ce qui ne veut pas dire […] que Laberge se soit avéré un bon disciple » (loc. cit., p. 96).
-
[39]
À l’occasion de la publication d’un chapitre de La Scouine dans le périodique La Semaine, l’archevêque Paul Bruchési réagit : « Un conte, annoncé et recommandé dans le sommaire du journal, outrage indignement les moeurs. C’est de l’ignoble pornographie, et nous nous demandons ce que l’on se propose en mettant des élucubrations de ce genre sous les yeux des lecteurs. C’en est trop : il faut couper le mal dans sa racine » (« Interdiction de la “Semaine” », La Vérité, no 4, samedi 7 août 1909, p. 27, cité par Charlotte Biron, « Les sillons du journal et du livre chez Albert Laberge et Damase Potvin », Mémoires du livre, vol. 8, no 2, printemps 2017 [« Le livre et le journal : croisements, prolongements et transformations »], p. 4).
-
[40]
Yannick Roy, « Un pessimisme fondamental », L’Inconvénient, no 46 (« Les romans de la Grande Noirceur »), 2011, p. 25.
-
[41]
Gabriel Marcoux-Chabot, La Scouine, Chicoutimi, la Peuplade, 2018.
-
[42]
Tous les chapitres du roman – à l’exception des deux derniers – tiennent en quarante-neuf lignes, distribuées sur deux pages pleines.
-
[43]
Gabriel Marcoux-Chabot, op. cit., p. 18.
-
[44]
Ibid., p. 106.
-
[45]
Ibid., p. 42.
-
[46]
Ibid., p. 46.
-
[47]
David Bélanger, « Gabriel Marcoux-Chabot, auteur de La Scouine », Spirale, 25 avril 2018 (disponible en ligne : www.spiralemagazine.com/article-dune-publication/gabriel-marcoux-chabot-auteur-de-la-scouine, page consultée le 31 juillet 2020).
-
[48]
Ibid.
-
[49]
Gabriel Marcoux-Chabot, op. cit., p. 58.
-
[50]
Ibid., p. 12.
-
[51]
Ibid.