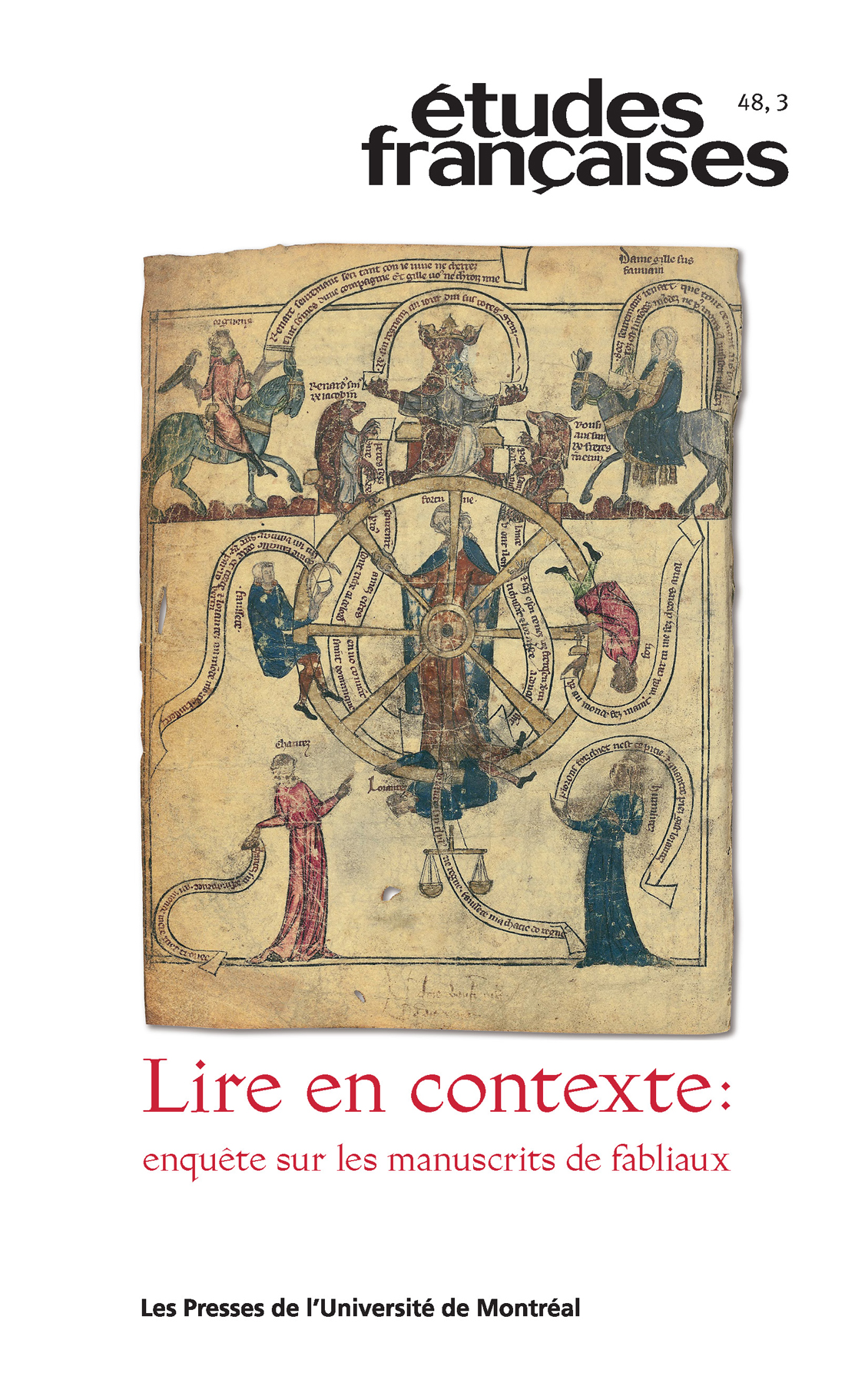Abstracts
Résumé
Cet article porte sur les dimensions narrative et poétique de l’œuvre Ici de Nathalie Sarraute. Problématisant fortement l’instance narrative et l’objet de la représentation, Ici semble refuser toute référentialité et le développement d’une fiction narrative ; travaillant le langage, elle appelle plutôt le genre poétique. L’étude montre une mise à l’épreuve de la représentation et une diffraction narrative propres à figurer la conscience humaine à traversles événements que le langage et elle génèrent.
Abstract
This article examines the narrative and poetic aspects of Nathalie Sarraute’s work Ici. Focusing directly on issues inherent to the narrative aspect and the object of the representation, Ici appears to forego any referentiality or development of a narrative fiction, instead working the language to elicit the poetic genre. The study affirms the representation and a narrative diffraction that presents human consciousness through the events it generates along with language.
Article body
« ces objets incongrus, ces bêtes étranges, qu’il en dispose comme bon lui semble… »
Nathalie Sarraute, Ici[1]
L’art de la représentation, problématisé à différentes époques, objet de remises en question diversement motivées, balise néanmoins toujours l’appréhension du monde opérée par les artistes. Enjeu capital autant dans les arts visuels qu’en littérature, la représentation constitue, depuis Aristote, un trait caractéristique de l’agir humain — avec celui, corollaire, de trouver du plaisir à ces représentations. Placée au coeur de nombreuses propositions visant à cadrer et à expliquer la référence au monde, cette notion persiste à s’imposer comme approche du discours littéraire, nonobstant de vives objections replaçant la littérature sous d’autres paradigmes (ici dans un rapport autoréflexif, là à référence prétendue nulle).
Nathalie Sarraute nous a prévenus, dès les années 1950, de notre entrée dans une ère du soupçon : « selon toute apparence, non seulement le romancier ne croit plus guère à ses personnages, mais le lecteur, de son côté, n’arrive plus à y croire[2] ». Cet avertissement, aussi péremptoire fut-il, référait évidemment à la pratique romanesque en elle-même, comme si, en quelque sorte, la bienveillance à l’égard de la fiction, cette willing suspension of disbelief, quittait l’acte de communication complexe que constitue l’oeuvre littéraire transmise d’un auteur à son lecteur. En fait, c’est bien à l’insuffisance du roman dans sa conception canonique que s’attaquait Sarraute, prônant en échange une entrée dans le domaine invisible du langage lui-même. Avec ses Tropismes (1939), elle explorait déjà le monde intérieur, celui des sous-conversations. Toutefois, en raison de la visée que nous perpétuons à associer à la pratique littéraire, notamment à travers la notion de mimèsis, il serait fallacieux de prétendre que par son travail sur la forme romanesque, Nathalie Sarraute sanctionne sa sortie hors du domaine de la représentation.
Placée sous la figure tutélaire d’Arcimboldo, l’une des dernières oeuvres de Nathalie Sarraute, Ici, réactive le débat qu’ont suscité les Tropismes un demi-siècle plus tôt, les lecteurs ne sachant trop comment aborder de tels petits textes à la référentialité problématique. L’affirmation du narrateur d’Ici (placée en exergue) à propos des composantes et de la matière picturale du peintre maniériste pourrait bien s’adresser au lecteur sarrautien. Le(s) sens, tels des organismes vivants embarrassants, ou plutôt dérangeants, tributaires de cet agrégat de vingt parties qu’est Ici, semble(nt) fourmiller : si certains considèrent Ici comme une représentation de l’allégorie de l’Air telle que décrite par Platon[3], on y perçoit tout autant l’évolution des conditions sociales qui a libéré la communication de l’emprise d’une interprétation dominante[4] qu’une écriture comme instrument permettant de réaliser le rêve de l’androgyne[5]. L’oeuvre de Sarraute, nul ne s’en étonnera, constitue un objet d’analyse éminemment ouvert : la réception critique atteste d’un malaise tant à propos de sa catégorisation générique, de la description de ce qui fait l’objet de la représentation, que de ses dimensions poétique et discursive. Ainsi les textes d’Ici ont-ils été qualifiés de « texte[s] inclassable[s][6] », de « microdrames[7] », de « recueil » aux « chapitres décousus[8] », de « poèmes en prose[9] », de « microrécits » et de « poésie[10] », puis comparés à la « poésie lyrique[11] ». La forte problématisation de l’instance narrative et de l’objet de la représentation, les images, les métaphores, les jeux de sonorité employés par cette même instance, le caractère allusif du langage d’Ici : autant d’indices, de procédés qui nuisent à la saisie du caractère narratif et représentatif de l’oeuvre, et qui peuvent ainsi inciter à son classement dans la catégorie du discours poétique.
Il faut toutefois prendre conscience que cette dernière classification implique de rejeter pour un tel discours toute possibilité de référentialité, de même qu’elle ne peut prendre en charge des composantes garantes du projet de la représentation narrative (voire de la représentation des tropismes ou des soubresauts de la conscience). Restreindre Ici à la poésie, ce serait donc refuser de rendre compte de cette fiction, tout aussi singulière soit-elle, qui élabore un portrait de la conscience humaine. Il semble capital, à la lecture de cette oeuvre, de favoriser une extension large de la notion de représentation, d’autant que fourmillent les projets artistiques qui la modulent — à l’instar d’un Arcimboldo à la lumière de la peinture de la Haute Renaissance. Le sens d’Ici s’élaborerait ainsi selon une double modalité discursive, ses deux volets étant chacun travaillés de l’intérieur. Intervient d’abord le narratif : l’oeuvre revendique une forme de narrativité, certes problématique du point de vue énonciatif (puisqu’elle n’est pas constituée d’actions et d’agents anthropomorphes), mais qui repose sur une événementialité irréductible quoique diffractée ; de manière concomitante, le poétique est mobilisé, évoquant le caractère autoréflexif du langage dans une dynamique associative, répétitive et figurative troublant la représentation et sa lecture. Le récit transiterait par le poétique afin d’être garant du projet de la représentation — celui d’un imaginaire, d’un portrait de la conscience.
La représentation mise à l’épreuve : énonciation et événementialité
Il va revenir, il n’a pas disparu pour toujours, c’est impossible, il était là depuis si longtemps… c’est cette silhouette frêle, légèrement voûtée… presque effacée… c’est elle qui l’avait amené ici pour la première fois, il était arrivé porté par elle et il était resté ici plus solidement implanté qu’elle. Il y avait en lui quelque chose d’insolite, de frappant qui l’avait fait s’incruster ici plus fortement, n’en plus bouger… Et voilà que tout à coup là où il était, où c’était sûr qu’il se trouverait, cette béance, ce trou… « Un trou de mémoire » comme on dit négligemment, insouciamment, sans vouloir s’y attarder davantage… Si ce n’est pas indispensable, à quoi bon se fatiguer, s’abrutir à s’efforcer de le remplir, ce trou, pourquoi perdre son temps ? Mais ici ce qu’il a laissé derrière lui, cette ouverture, cette rupture disjoint, disloque, fait chanceler… il faut absolument la colmater […].
Ici, 11
L’énonciation problématique visible dans l’incipit du texte I est représentative de la mise en discours de l’oeuvre entière. Ce brouillage identitaire qui émane de ces « il » et « elle » réfléchit, tel un miroir, le flou de l’entité prenant en charge le discours. Anne-Marie Paillet a su démontrer le paradoxe qui relève d’une situation jamais vraiment explicitée conférant au sujet et à la situation vécue un surcroît de présence : ce brouillage des pronoms effectué par l’instance narrative au fil des textes révèle moins une indétermination, entraîne moins une fragilisation des identités représentées qu’il ne dévoile une proximité, une intimité partagée entre le narrateur et un ancrage « flottant », une « deixis anonyme[12] ». Il ne s’agit pas pour nous de reprendre la démonstration de Paillet et ses considérations linguistiques, mais de souligner que l’occultation du sujet-locuteur par la deixis (puisque celui-ci se constitue essentiellement par cette dernière) attribue au déictique « ici » un rôle de représentation par défaut de la source énonciative, et qu’à cette présence implicite d’un locuteur se juxtapose une prolifération de la localisation[13]. À l’énonciation problématique répondrait donc la représentation d’un lieu d’où parle, d’où raconte le texte : un « ici » réitéré, une vingtaine de fois, nous proposerait l’aventure d’un espace particulier.
Selon une perspective non plus strictement linguistique mais narrative, une telle déroute de l’instance énonciative appelle une lecture attentive des usages du langage, où pourrait être perceptible une continuité, une régularité révélatrice d’un énonciateur unique, premier élément confirmant la présence d’un récit dont l’ampleur recouvrirait celle de l’oeuvre. C’est qu’il ne faut pas négliger l’incidence de la segmentation interne d’Ici sur notre lecture. La multiplicité de « chapitres », de textes distincts laisse planer un doute sur leur autonomie respective, sur leur statut : fragments d’un seul texte ou textes indépendants réunis pour former le livre ? Devant une telle ambiguïté, il ne peut être tenu pour acquis qu’une seule instance soit à l’origine du discours — et l’approche de l’oeuvre par le lecteur rappelle inévitablement une enquête, accumulant les indices convergeant vers une hypothèse ou l’autre (un texte d’un seul tenant, donc un seul récit, ou un recueil juxtaposant des anecdotes). Dans Ici, le style des phrases et la récurrence d’un champ lexical relatif à la guerre concourent à l’uniformisation du locuteur implicite. D’une part, l’identité de l’instance narrative est notamment perçue dans le recours constant aux phrases syncopées et aux points de suspension : « Après un moment de désarroi… mais que se passe-t-il ? mais où va-t-on ?… La conversation s’ébranle et doucement repart… un parcours inconnu qui conduit à des lieux où jusqu’ici jamais… C’est si futile, c’est si vulgaire… de ces lieux de plaisir où l’on serait gêné d’être vu… » (Ici, 107). D’autre part, la mobilisation, dans tous les textes, d’un champ lexical spécifique contribue à renforcer l’idée qu’une même entité énonciative se trouve chargée du discours : état d’alerte (I), service d’ordre (III), affrontements, traité de paix, reddition (IV), rafale de balles (V), guerre, révolution, résistance (VIII), armés, prisonniers (XI), victimes, exterminations, fortifications (XII), abri bien bétonné (XIII), conquérant, violence (XIV), objet piégé, désamorcé, arsenal étranger, persécutions (XVII), mort (XIX), supplice (XX) — pour ne donner que ces quelques exemples. La narration se révèle omnisciente et elle est en quelque sorte placée sous le signe d’une menace constante où tout événement perturbateur peut survenir ; de la sorte, la polytextualité de l’oeuvre se trouve compensée par une telle stabilité discursive.
Néanmoins, la narration se prête au jeu de la focalisation multiple et brouille les sujets représentés : tantôt un homme, tantôt une femme, mais le plus souvent une conscience anonyme, une deixis indéterminée. Plus encore, l’hypothèse d’une adéquation sujet-narrateur-auteur sera éventuellement déboutée par la présence, à la sixième partie, d’un homme n’ayant « jamais écrit aucun livre » (Ici, 52). Une tension vive se déploie à la lecture de l’oeuvre : alors que l’éclatement textuel est atténué par une énonciation conciliante, les objets conventionnellement représentés dans un récit semblent s’évanouir devant nos yeux.
Ici problématise l’art de la représentation par le déplacement opéré sur l’ancrage de la voix narrative. Aussi les trois premiers textes préparent-ils le lecteur à un tel glissement. Si ces parties présentent l’aventure d’un trou de mémoire, exposent trois variantes sur un même thème, avec, à terme, une résolution positive puisque l’être parvient à retrouver le fameux mot perdu — respectivement le nom d’une ville (I), d’une sorte d’arbre (II), d’un peintre (III) —, le discours entraîne ensuite le lecteur dans d’autres avenues, soit, par exemple, la formation d’un stéréotype dans l’imaginaire (X) ou bien la sensation de malaise éprouvée lorsque des gens « vous pompent l’air » (XIX ; Ici, 185). De sorte qu’à des personnages et des actions appartenant au discours narratif traditionnel sont substitués une conscience et ses soubresauts. L’événementialité typiquement associée à la narrativité peut dès lors paraître problématique[14]. D’aucuns la qualifient d’ailleurs de non-événement (notamment Paillet[15]) puisqu’elle siège au coeur même d’une intériorité, mais celle-ci a tôt fait de se révéler comme lieu d’action des mouvements préconscients. Ici nous « raconterait » bel et bien quelque chose : la parole circonscrirait un espace ontologique singulier, qui est celui des tropismes.
Dans L’ère du soupçon, Sarraute explique son investigation tropismique en ces termes :
[Les tropismes] sont des mouvements indéfinissables, qui glissent très rapidement aux limites de notre conscience ; ils sont à l’origine de nos gestes, de nos paroles, des sentiments que nous manifestons, que nous croyons éprouver et qu’il est possible de définir. […] Comme, tandis que nous accomplissons ces mouvements, aucun mot — pas même les mots du monologue intérieur — ne les exprime, car ils se développent en nous et s’évanouissent avec une rapidité extrême, sans que nous percevions clairement ce qu’ils sont, produisant en nous des sensations souvent très intenses, mais brèves, il n’était possible de les communiquer au lecteur que par des images qui en donnent des équivalents et lui fassent éprouver des sensations analogues. […] À ces mouvements qui existent chez tout le monde et peuvent à tout moment se déployer chez n’importe qui, des personnages anonymes, à peine visibles, devaient servir de simple support[16].
S’il y a effectivement glissement de la voix narrative, c’est ainsi pour mieux cerner les tropismes, se situer au plus près de la sensation, exactement dans le « ici » de la conscience. D’où la nécessité d’opérer, si l’objet à figurer le requiert, une transition du « je » au « ici »[17]. Comme le mentionne Yves Baudelle, les tropismes « constituent tout un monde d’actions ; mais il s’agit d’actions intérieures et, partant, souterraines, cachées, voire invisibles, par opposition aux actions extérieures, à tous ces faits et gestes des personnages qui fondent traditionnellement la dynamique narrative du roman[18] ». En réalité, l’oeuvre ne serait pas tant le théâtre d’actions que, plus vraisemblablement, celui de certains événements. En effet, ces mouvements souterrains sont non agentifs, c’est-à-dire qu’ils ne relèvent pas d’une intentionnalité mais de forces indépendantes — sorte de puissances extérieures provoquant des réactions intérieures involontaires qui fondent l’objet problématique de la représentation[19]. À titre d’exemple, alors que se manifeste un élément perturbateur (une phrase d’autrui), un mécanisme de défense surgit dans l’esprit humain, le tumulte de l’inconscient où des mots ne sortiront plus, avec pour issue un repli sur soi (XVIII). C’est dans cette perspective, dans cette fiction du for intérieur, que s’opère un déplacement au niveau du personnage : la parole, siège et moteur de la conscience humaine, supplée ainsi à l’être de papier (Valéry), le traditionnel opérateur d’actions :
Tout d’un coup, dans cet espace autour de la chaîne des propos, où ne cesse d’aller et venir ce qui privé de mots ne peut pas, ne doit pas se montrer, un vent a soufflé… tout se soulève, s’envole… là, à cette place où ça se trouvait toujours, il y a un vide… […] mais non, peut-être pas, pas encore, des mots accourent pour appeler au secours, impossible de les arrêter, il est seulement possible un bref instant d’essayer de préparer leur entrée, de leur donner un air plus présentable, plus décent…
Ici, 104
Prenant acte du caractère inapproprié d’une technique narrative convenue (le monologue intérieur) pour expliciter cette « réalité nouvelle[20] », ces tropismes qui l’intéressent, Sarraute explore les extensions du discours narratif à travers une événementialité granulaire, qui refuse le personnage et son agir au profit d’occurrences des actions intérieures de la conscience.
Diffraction et narrativité : représenter la conscience
La granularité du discours se déploie sous de multiples volets dans Ici. Une telle poétique du morcellement intervient autant sur le plan textuel que sur le plan de l’énonciation, de la temporalité et de la spatialité (le lieu dit « ici » renvoie à une spatialité non conventionnelle, originale et originaire et, conséquemment, sans frontière). Si l’incarnation de la narrativité repose sur cette diffraction des événements (dans leurs manifestations spatiales, temporelles et actantielles), l’incidence de cette diffraction sur le continu du récit est manifeste. Un brouillage narratif se trouve alimenté par le jeu des blancs typographiques : les temps de pause octroyés au lecteur et les ellipses narratives imposées par les espaces typographiques délimitant les nombreux paragraphes (d’une à quatre lignes) entravent le geste interprétatif. L’assujettissement des personnages à des rôles de second plan dans la mise en scène des tropismes, par ailleurs, bouscule les attentes narratives assez fortement balisées par une expérience longue et somme toute cohérente du récit chez la majorité des lecteurs. Pourtant, comme en témoignent notamment les critiques du livre (à défaut d’une réelle enquête de terrain), Ici ne serait pas une oeuvre illisible. Une fois dépassée la charge déstabilisatrice des tropismes, le lecteur tend à retrouver une forme de cohésion interne à ce récit.
Devant cet éclatement, il joue un rôle prédominant dans l’élaboration de la représentation — son réflexe commun étant de chercher à syntagmatiser ce qui est juxtaposé[21]. Ainsi se sert-il de ces bribes diffractées (fragments textuels, événements localisés, instances actantielles évanescentes). Comparées entre elles au fil de la lecture, elles permettent au lecteur de relativiser l’ellipse et d’apprivoiser la discontinuité textuelle et narrative. La dynamique narrative de l’oeuvre s’inscrit d’abord et avant tout dans ce jeu de tension entre l’un et le multiple. Ici étant un lieu éminemment ouvert, le lecteur détient un rôle primordial dans l’élaboration de cette fiction narrative où chaque partie se rejoue dans la représentation d’un tout mouvant, flottant, voire virtuel — l’espace de la conscience étant, en outre, infini. Donc, dans une logique d’accumulation, les vingt parties habilitent le lecteur à acquérir une certaine expérience du texte (à laquelle peut s’ajouter celle des oeuvres sarrautiennes antérieures). C’est également dire que, de manière concomitante, le projet fictionnel englobant, celui de la mise en scène des tropismes, cautionne l’oeuvre — la fiction agissant comme balise interprétative de cette dernière[22].
Une fois accepté ce projet fictionnel comme balise interprétative de l’oeuvre, la lecture des vingt parties met au jour le caractère faiblement tensif de chacune de ces vignettes consacrées aux soubresauts de la conscience. Évoquant les textes représentant des trous de mémoire, Valérie Minogue mentionne que ce sont des « séquences si familières dont nous connaissons bien la profonde banalité mais aussi l’intensité[23] ». Cette observation peut facilement être généralisée : lorsqu’on examine attentivement l’objet de la représentation, on ne peut que confirmer telle profonde banalité des mouvements de la conscience : l’émergence d’un stéréotype dans l’esprit humain (X), le repli sur soi (XVIII), des trous de mémoire colmatés (I, II, III), un esprit qui saute du coq-à-l’âne (XI), une expérience d’atrophie lorsque des gens « vous pompent l’air » (XIX), un moment d’émerveillement (XIII). Si leur familiarité entraîne de facto l’adhésion du lecteur, elle n’est pas sans questionner la pertinence du propos : que lui amène cet exercice de représentation de la conscience, alors que tous les mouvements décrits ne suscitent pas d’émotion en retour, qu’ils ne se fondent pas sur une étrangeté à éclaircir ?
D’un point de vue narratif, le discours sarrautien présente des mouvements généraux, des séquences organisées de mouvements préconscients s’apparentant aux « scripts » tels que définis par les cognitivistes Schank et Abelson[24] ; les scripts s’avèrent des suites d’actions culturellement admises, ou des séquences organisées d’actions routinières (par exemple, prendre le train ou aller au restaurant). Un discours doit généralement transgresser les scripts dans le but de générer une tension narrative — c’est-à-dire qu’il éveille la curiosité du lecteur en lui racontant des événements pertinents, voire exceptionnels[25]. Dans cette perspective, si les mouvements présentés dans Ici sont banals, ils sont certes difficiles à rendre signifiants — notamment en raison de l’évacuation d’une instance narrative, d’une temporalité[26] et d’une spatialité conventionnelles. C’est seulement dans une logique de l’accumulation que le lecteur parvient à apprivoiser la discontinuité textuelle et narrative, à acquérir une certaine expérience du texte. Les scripts tropismiques, lorsqu’on les résume à leur plus simple expression, apparaissent ordinaires et plats — tout comme les fruits, les légumes et diverses autres composantes appartenant au quotidien utilisé par le peintre Arcimboldo. Or, c’est la combinaison, l’organisation, le geste de rassemblement qui produit une représentation hors du commun. Ce qu’il y a d’exceptionnel dans Ici, c’est le projet même de la représentation, un défi posé spécifiquement à la littérature : la tension du récit relève alors moins d’une narrativité fondée sur une événementialité problématique que de l’entreprise même d’investigation d’une nouvelle réalité.
La singularité du projet définissant Ici repose entièrement sur des enjeux liés à la poétique formelle du livre. La question de l’unité intrinsèque de l’oeuvre, appelée par la discussion autour de la fragmentation en chapitres ou du statut de recueil, reste jusqu’à un certain point anecdotique ; il s’agit plutôt de considérer la performance associée à cette incarnation du texte de Sarraute. Depuis le même Arcimboldo, Roland Barthes cernait bien l’idée de la distance à maintenir par rapport à l’objet observé pour prendre conscience de la façon dont l’assemblage construit le sens :
Arcimboldo fait du fantastique avec du très connu : la somme est d’un autre effet que l’addition des parties : on dirait qu’elle en est le reste. Il faut comprendre ces mathématiques bizarres : ce sont des mathématiques de l’analogie, si l’on veut bien se rappeler qu’étymologiquement analogia veut dire proportion : le sens dépend du niveau auquel vous vous placez. Si vous regardez l’image de près, vous ne voyez que des fruits et des légumes ; si vous vous éloignez, vous ne voyez plus qu’un homme à l’oeil terrible, au pourpoint côtelé, à la fraise hérissée (l’Été) : l’éloignement, la proximité sont fondateurs de sens[27].
C’est sans nul doute cette même gestion de la distance qui permet de donner une portée signifiante aux scripts peu tensifs d’Ici et à son éclatement. À échelle réduite, l’événementialité des mouvements de la conscience apparaît dans sa granularité ; dans une perspective distante, c’est le portrait chaotique de l’esprit humain, nouvel élément de la réalité représenté, qui émerge des fragments de texte. Cette posture du lecteur est rendue nécessaire pour apprécier l’efficace du dispositif mis en place par Sarraute — aussi déstabilisant que les toiles d’Arcimboldo soit-il, mais sans sacrifier le plaisir de sa lecture, de leur contemplation. Au sens strict, la narrativité problématique des mouvements préconscients correspond bien à l’insignifiance qu’attribue Barthes aux fruits et légumes tant qu’aux phonèmes : « Le sens naît d’une combinatoire d’éléments insignifiants (les phonèmes, les lignes) ; mais il ne suffit pas de combiner ces éléments à un premier degré pour épuiser la création du sens : ce qui a été combiné forme des agrégats qui peuvent de nouveau se combiner entre eux, une seconde, une troisième fois[28]. » La combinaison, chez Sarraute, joue à plusieurs niveaux — phrases, paragraphes, parties — pour générer un foisonnement interprétatif ; ce travail de l’analogia n’est toutefois pas spécifique, appelant également en appui celui de l’analogon propre à une dimension poétique du langage.
Le paradoxe du langage dans la narrativité d’Ici : épuisement et fonction poétique
Saisir les soubresauts qui précèdent la parole à l’aide de cette dernière constitue une entreprise paradoxale. Si l’objet représenté apparaît comme problématique — superbement ouvert dans la mesure où l’on peut y associer nombre d’hypothèses référentielles, comme nous avons pu le constater précédemment —, c’est notamment en raison de la méthode retenue par l’écrivaine, qui consiste à puiser à l’amont de cet objet. C’est comme chercher la main de l’enfant dans celle de l’adulte : c’est possible de le faire, le projet est possible, Sarraute l’affirme dans L’ère du soupçon, toutefois, peut-être risque-t-on de n’y trouver que la trace. L’exercice engage ainsi à une vision modulée du rôle de la voix narrative autant qu’à une mobilisation de la fonction poétique au sein même de la dynamique du récit mis en place.
La fiction sarrautienne peut s’inscrire dans un singulier phénomène de monstration de la voix narrative que Rabaté a interrogé dans Vers une littérature de l’épuisement. Ce que Rabaté nomme les « fictions de voix » sont des oeuvres où l’instance narrative travaille à saisir la mise en scène de sa propre production et, se prenant elle-même pour objet, elle questionne et explore ses traces, effectue un retour sur et contre elle-même : « La voix narrative cherche à se rejoindre. L’expérience du lecteur double ainsi celle de l’écrivain : elle est une quête tangentielle du point où la voix pourrait idéalement se confondre avec elle-même, un chemin vers le centre dérobé de son surgissement [le silence][29]. » Du coup, Ici pourrait s’apparenter à ces fictions de la voix, à l’exception près qu’il n’est pas rédigé à la première personne[30]. La littérature de l’épuisement, telle que définie par Rabaté, procède d’une quête vers une révélation qui ne se produit pas, elle tend vers ce qui la fonde sans jamais retrouver son point d’origine. Il semblerait bien que ce qui clôt Ici soit cette « illusion de la fin[31] », avec laquelle l’énergie narrative ne peut que jouer — et non la rejoindre véritablement, tel un mirage : « Et on y est arrivé. On s’y trouve. On est où il n’y a plus rien. Nulle part. Rien. Rien. Rien. Jamais. À jamais. À-ja-mais. Rien » (XX ; Ici, 198). Et la voix narrative de continuer à gloser — car comment représenter l’avant-vie « avec les mots de la vie » (XX ; Ici, 189) ? L’entreprise sarrautienne est à cet égard paradoxale, se trouvant en route vers une sorte d’épuisement, d’épurement. Toutefois, en accueillant le déplacement du lieu d’où parle le texte, le glissement de l’instance narrative, force est de constater que la voix narrative ne déborde pas du cadre de la fiction[32], mais qu’elle en a seulement déplacé, problématisé le paradigme. Il s’agirait donc moins, pour Ici, de tendre vers la voix qui fonde la conscience que d’en représenter les multiples mouvements qui la sillonnent, ces événements potentiellement infinis :
Arcimboldo. Tout ici est à lui. Ici est l’espace dont il a besoin pour prendre ses aises… répandre aussi loin qu’il le voudra ses ondes… Déployer sa désinvolture. Son outrecuidance. Qu’il fasse venir ici cela et encore cela, tout ce qui lui chante, ces fleurs, ces légumes, ces fruits, ces objets incongrus, ces bêtes étranges, qu’il en dispose comme bon lui semble… Arcimboldo, l’assurance même. L’affirmation. Le défi. Arcimboldo. Tout ici n’est que lui. Arcimboldo.
Ici, 199
En tenant un discours autoréflexif sur le multiple et le geste de rassemblement, par le biais de la figure tutélaire d’Arcimboldo, l’instance narrative, dans ce dernier passage d’Ici, problématise l’objet de la représentation tout en orientant la lecture du texte : la clôture narrative met l’accent sur le projet éclaté accompli et, en même temps, celui à venir, celui d’un projet qui est à la fois affirmation et défi. Bref, l’oeuvre projette une oeuvre à venir, incomplète, virtuellement inépuisable dans sa composition. Ici tend vers l’épuisement, s’en nourrit.
Ce même extrait clôturant l’oeuvre est étonnamment utilisé comme quatrième de couverture de l’édition dans la collection Folio. De ce fait, la conclusion d’un récit traditionnel (corollaire de l’opération configurationnelle de la mise en intrigue) nous apparaît court-circuitée : un potentiel suspens narratif se trouverait escamoté, un noeud narratif serait déjà dénoué. C’est toutefois faire abstraction de la dynamique propre de l’oeuvre, qui n’est pas fondée sur le seul respect de la téléologie de l’action. À la tension narrative conventionnelle se substitue un suspense qui relève du projet même de la représentation[33] ; au glissement de l’instance narrative traditionnelle correspond un déplacement de la tension narrative vers une autre logique tensionnelle, qui est celle de l’entreprise paradoxale, le « défi » d’élaboration d’une fiction de la conscience.
Pour être garant de ce projet fictionnel, le discours s’élabore selon une double modalité discursive. Le mode narratif, où la narrativité est fondée sur une événementialité problématique, doit transiter par le poétique, dans une dynamique répétitive, figurative et associative jouant sur la représentation et sur sa lecture. Afin d’épouser les mouvements tropismiques au plus près de la source, l’oeuvre a substitué au monologue intérieur une deixis anonyme. La représentation d’une subjectivité, du siège même de la mémoire, ne peut faire l’économie du mode poétique et de sa mécanique associative et figurative dans la mesure où cette même dynamique est conforme à la fonction fondamentale de la mémoire. De fait, la conscience s’aventure à relier les informations, les images entre elles, selon une logique qui lui est propre :
C’est là de nouveau, ça emplit tout… ça se tient là immobile, immuable, aucun changement d’une fois à l’autre… le pan de mur en plein soleil, les larges pavés arrondis, l’herbe entre eux d’un vert grisâtre, l’épaisse pierre patinée du vieux banc et au-dessus les branches couvertes de fleurs roses qui montent du mince tronc rugueux en touffes duveteuses… Et voici dans cette immobilité parfaite, dans ce silence… il semblait qu’il ne pouvait y avoir ici aucune présence… brusquement ces mots : « Comment il s’appelle déjà, cet arbre ? »…
II ; Ici, 17
[…] il faut l’examiner de très près, c’est cela seul qui le distingue de tous les autres arbres, ce sont là des signes particuliers… ces branches de fleurs rose pâle… duveteuses, vaporeuses… elles flottent autour de lui… elles l’entourent d’une brume légère… Quelque chose se condense, va sourdre… qu’est-ce que c’est ? C’est quelque chose de joyeux, oui, de rieur… des rires… des ris… ris… Tamaris… […]
II ; Ici, 19
L’aventure d’un « trou de mémoire » (I ; Ici, 11) se résorbe par le biais d’images analogiques et de jeux de sonorité — ce qui évoque le rire dans « tamaris », tout comme l’allitération du « t » dans « tronc », « touffes duveteuses », « immobilité » participe du mouvement mémoriel. Le caractère allusif du langage et les jeux de sonorité se révèlent ainsi, dans une logique de la répétition, à même de mimer la vie du for intérieur[34].
Du coup, le mode poétique, par le biais de sa compétence analogique, permet d’épouser le mouvement de l’événement figural, qui est représentatif à la fois du monde et du langage[35] — par exemple, l’émergence du « vieux mur gris » comme figuration d’un silence primordial (XV ; Ici, 153). La prolifération de la localisation, la réitération d’« ici », a comme corollaire la multiplication des images : « Il en vient sans cesse de partout… un mouvement incessant… le défilé silencieux d’âmes en peine… » (XI ; Ici, 102). Donc, dans Ici, la fonction poétique, celle qui attire notre attention sur la forme même du message, cohabite avec la fonction référentielle et l’appuie tout à la fois, dans un même projet de représentation, celui d’un univers fictionnel singulier. Et dans ce lieu, l’image poétique détient un rôle fondamental parce qu’elle possède un potentiel mimétique des fonctions de la mémoire : « Lieu du désir et de la perte, l’image condense chaque fois une parcelle de notre identité et de notre relation au monde. Car l’image est à la fois sensation, perception, pensée, désir et mémoire. Elle est la trame même de notre vie intérieure[36]. » La force du langage, dans Ici, réside ainsi dans sa capacité à s’autoproblématiser, à se mettre en examen, sans pour autant déclencher l’anéantissement de son projet de représentation — lequel profite plutôt largement des possibilités d’expression paradigmatique rattachées à la fonction poétique de la communication.
Intriguée par l’en deçà du langage, Nathalie Sarraute s’est consacrée à la tâche de rendre compte de cette transformation des mouvements de l’esprit en mots, en syntagmes. Ici en témoigne avec force : constituée non d’actions mais d’événements à échelle réduite, cette oeuvre bâtit une représentation narrative de ces surgissements préconscients, mouvements non agentifs qui pourtant déterminent et déclenchent le langage, le geste et l’agir en général. Impossible selon elle d’en proposer un portrait unique ni même construit : la vision diffractée de l’esprit qui nous est proposée est conséquente de ses errements, mais néanmoins fidèle au projet de la mettre en scène, de la fictionnaliser. C’est donc dans une vision à distance variable que s’échafaude ce récit, donnant à voir le grain de la pensée en action et le langage en position paradoxale, réfléchissant le suspens créé par une recherche figurale propre à rendre efficacement le passage de cette pensée en mots. En ce sens, l’oeuvre convoque conjointement les dimensions narrative et poétique du langage, entendues ici comme des modalités d’expression. Son hybridité n’est donc pas d’ordre générique (l’oeuvre ne répond pas à diverses attentes ou configurations génériques), mais plutôt modale[37], les dimensions pragmatiques du langage étant magistralement investies dans Ici.
Appendices
Notes biographiques
René Audet
René Audet est professeur titulaire au Département des littératures de l’Université Laval, chercheur au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en littérature contemporaine. Ses travaux portent sur les poétiques narratives actuelles, la théorie du récit, la diffraction et la culture numérique. Il dirige la revue savante numérique Temps zéro et la collection « Contemporanéités » aux Éditions Nota bene.
Josée Marcotte
Josée Marcotte a complété un mémoire de maîtrise sur la narrativité éclatée et l’humour chez Éric Chevillard en 2010 (Université Laval). Elle est adjointe aux ventes et à la diffusion chez De Marque, L’Entrepôt du livre numérique et l’auteure d’un roman (Les amazones, Québec, L’instant même, 2012) et d’une suite poétique ayant mérité le 2e Prix Piché de poésie (« Les mots sont verbe », Poèmes du lendemain 21, Trois-Rivières, Écrits desForges, 2012). Elle a fait paraître, chez Publie.net./Publie. papier, La petite Apocalypse illustrée (2012) et Marge (2012 [2010]).
Notes
-
[1]
Nathalie Sarraute, Ici, Paris, Gallimard, coll. « Folio », no 2994, 1995, p. 199. Toutes les citations d’Ici seront tirées de cette édition.
-
[2]
Nathalie Sarraute, L’ère du soupçon, Paris, Gallimard, coll. « Idées », no 42, 1972 [1956], p. 71.
-
[3]
Rennie Yotova, « L’espace monadelphe d’Ici », dans Jeux de constructions. Poétique de la géométrie dans le Nouveau Roman, Paris, L’Harmattan, coll. « Critiques littéraires », 2006, p. 135-152.
-
[4]
Ben Cope, « La communauté en question : lire Sarraute avec Deleuze et Guattari », dans Pascale Foutrier (dir.), Éthiques du tropisme. Nathalie Sarraute, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 201-211.
-
[5]
Dominique Rabaté, « Le dedans et le dehors », dans Joëlle Gleize et Anne Leoni (dir.), Nathalie Sarraute, un écrivain dans le siècle, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 2000, p. 47-60.
-
[6]
Rennie Yotova, art. cit.
-
[7]
Ben Cope, art. cit.
-
[8]
Anne-Marie Paillet, « Ici et maintenant : la deixis “anonyme” chez Nathalie Sarraute », dans Agnès Fontvielle et Philippe Wahl (dir.), Nathalie Sarraute : du tropisme à la phrase, Lyon, Presses universitaires de Lyon, coll. « Textes et langue », 2003, p. 41-57.
-
[9]
Valérie Minogue, « L’“Ici” de Nathalie Sarraute : Arcimboldo et la dépersonnalisation du texte », dans Joëlle Gleize et Anne Leoni (dir.), op. cit., p. 37-46.
-
[10]
Sabine Raffy, « Soupçons. Et comment s’en débarrasser », dans Joëlle Gleize et Anne Leoni (dir.), op. cit., p. 117-125.
-
[11]
Joëlle Gleize, « Le lecteur opiniâtre de Nathalie Sarraute », dans Joëlle Gleize et Anne Leoni (dir.), op. cit., p. 105-115.
-
[12]
Anne-Marie Paillet, art. cit., p. 41.
-
[13]
Ibid., p. 42.
-
[14]
Sur la notion d’événement, voir Claude Romano, L’événement et le monde, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Épiméthée », 1999, et René Audet, « La narrativité est affaire d’événement », dans René Audet, Claude Romano, Laurence Dreyfus et collab., Jeux et enjeux de la narrativité dans les pratiques contemporaines, Paris, Éditions Dis Voir, coll. « Arts visuels/essais », 2006, p. 7-35.
-
[15]
Anne-Marie, Paillet, art. cit., p. 47.
-
[16]
Nathalie Sarraute, L’ère du soupçon, p. 8-9.
-
[17]
Les premiers romans de Sarraute étaient écrits à la première personne du singulier. En fin de carrière, elle fait paraître Tu ne t’aimes pas, qui est écrit au « nous » (1989) ; dans Ici (1995), c’est « ici » qui est le lieu de la parole ; et finalement Ouvrez (1997) incarne un véritable théâtre de la parole dans la mesure où les mots parlent, les mouvements intérieurs s’expriment sous forme dialoguée.
-
[18]
Yves Baudelle, « Les tropismes : de “véritables drames” », dans Monique Gosselin-Noat et Arnaud Rykner (dir.), Nathalie Sarraute et la représentation, Lille, Roman 20-50, coll. « Actes », 2005, p. 51.
-
[19]
Jean Molino et Raphaël Lafhail-Molino, Homo Fabulator. Théorie et analyse du récit, Montréal, Leméac ; Arles, Actes Sud, 2003, p. 27.
-
[20]
Nathalie Sarraute, L’ère du soupçon, p. 92.
-
[21]
André Carpentier et Denis Sauvé, « Le recueil de nouvelles », dans François Gallays et Robert Vigneault (dir.), La nouvelle au Québec, Montréal, Fides, coll. « Archives des lettres canadiennes », no IX, 1996, p. 11-36.
-
[22]
« Alors que l’oeuvre représente la fiction des soubresauts de la conscience, de la constitution de la parole, c’est constamment à ce projet de représentation, à ce projet fictionnel que l’on se reporte pour baliser la lecture des textes. Ce projet est le garant de l’oeuvre, il est la caution qui empêche l’éclatement, la dispersion du sens de cette oeuvre. En cadrant les textes, en les inscrivant dans une démarche globale, cette fiction permet de les englober. La particularité d’Ici réside dans le fait que ce projet est à la fois implicite et tonitruant : implicite, parce qu’on ne peut le construire qu’au fil de la lecture ; tonitruant, parce que c’est un donné, un déjà-là, par la pratique connue des tropismes chez Sarraute, avec les attentes qui lui sont rattachées. » René Audet, « L’autorité de la fiction dans les oeuvres polytextuelles », dans Emmanuel Bouju (dir.), L’autorité en littérature, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 2010, p. 140.
-
[23]
Valérie Minogue, art. cit., p. 44.
-
[24]
Roger C. Schank et Robert P. Abelson, Scripts, Plans, Goals, and Understanding : An Enquiry into Human Knowledge Structures, Hillsdale, Lawrence Erlbaum, 1977.
-
[25]
Jean Molino et Raphaël Lafhail-Molino, op. cit.
-
[26]
Pour une étude de la temporalité dans Ici de Sarraute, voir Anne-Marie Paillet, art. cit.
-
[27]
Roland Barthes, « Arcimboldo ou rhétoriqueur et magicien », L’obvie et l’obtus. Essais critiques III, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points essais », no 239, 1992, p. 132.
-
[28]
Ibid.
-
[29]
Dominique Rabaté, Vers une littérature de l’épuisement, Paris, José Corti, 1991, p. 8.
-
[30]
Ibid.
-
[31]
Ibid., p. 11.
-
[32]
Ibid., p. 8.
-
[33]
On pourrait établir une parenté avec le suspense que Raphaël Baroni qualifie de « moyen », dans le cadre duquel il y a « anticipation claire du dénouement détournant l’intérêt de l’issue vers les circonstances qui mèneront au dénouement attendu ». Raphaël Baroni, La tension narrative. Suspense, curiosité et surprise, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 2007, p. 278.
-
[34]
Pour une étude sur l’importance des métaphores et des images chez Sarraute, voir Monique Gosselin-Noat, « Souvenirs, images, métaphores : le statut de l’image dans les récits de fiction de Nathalie Sarraute », dans Monique Gosselin-Noat et Arnaud Rykner (dir.), Nathalie Sarraute et la représentation, p. 213-229.
-
[35]
« Le figural est donc doublement “représentatif”. Il représente (imitativement) quelque chose du monde en re-présentant (en présentant à neuf) la forme de la langue. » Laurent Jenny, La parole singulière, Paris, Éditions Belin, coll. « L’extrême contemporain », 1990, p. 26.
-
[36]
Monique Gosselin-Noat, art. cit., p. 229.
-
[37]
On peut l’entendre au sens de Gérard Genette, dans son « Introduction à l’architexte », où il donne à la notion de « mode », dans le sillage de la Poétique d’Aristote, le sens d’un repère générique entièrement fondé sur la situation d’énonciation (dans une approche relevant de la linguistique de l’énonciation). De façon plus souple, cette idée de mode renvoie également aux modalités possibles du discours, aux différents types discursifs communs dans le langage. Gérard Genette, « Introduction à l’architexte », dans Gérard Genette et collab., Théorie des genres, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points essais », 1986 [1979], p. 89-159.