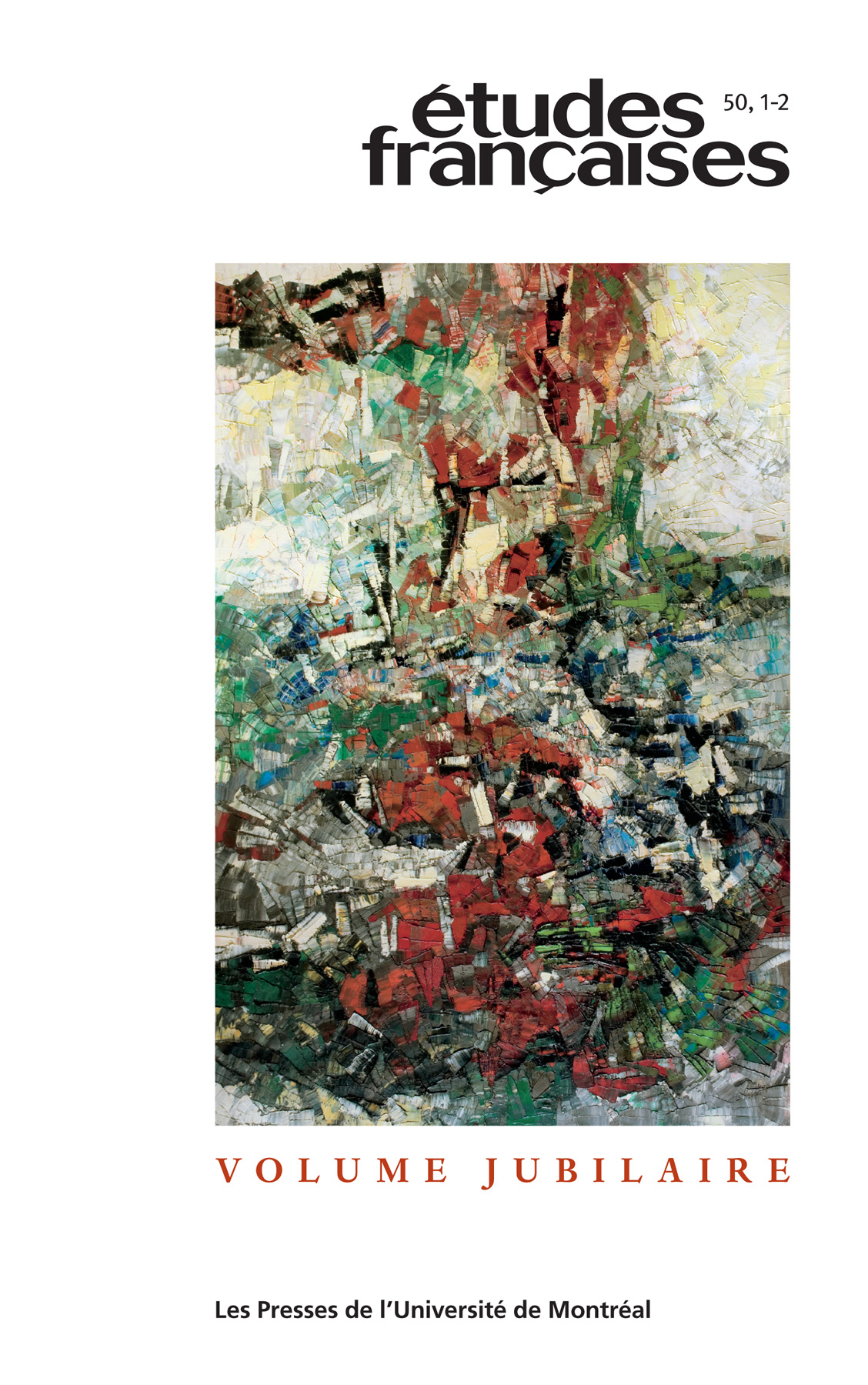Article body
Le passé est-il toujours le meilleur juge du présent ? Dans son Éloge de Dürer, un essai recueilli dans ses Fantaisies sur l’art, l’écrivain romantique Wilhelm Heinrich Wackenroder porte sur la peinture de son temps le regard désabusé de tout moderne sur ce qui lui semble l’érosion irréversible de la beauté ancienne. Le modèle du grand Dürer est certes exalté, mais c’est d’abord pour retirer toute légitimité à un art facile, divertissant, léger, cet art du xviiie siècle confiné dans la sphère du plaisant. Que représente donc Dürer à ses yeux, sinon la figure austère d’un artiste que tout sépare de la frivolité ? À l’inverse de ces artistes friands de succès, le grand maître offre l’exemple d’un peintre sanctifié par son art et désireux de glorifier la source divine de la nature. Ce qu’il dit des peintres, Wackenroder ne cesse de le répéter pour les musiciens, oublieux de la fonction sacrée de leur art. Comment peuvent-ils faire passer le plaisir des sens devant le rappel de l’absolu divin, seul capable d’élever l’esprit humain à la sublimité de l’au-delà[1] ?
Le rappel de cet idéal de sublimité caractérise toute l’esthétique romantique et quand nous le retrouvons sous la plume de Glenn Gould, la référence à cette hiérarchie spirituelle des oeuvres n’en est que plus marquée. Même si Gould a toujours affirmé qu’il n’était pas romantique, et qu’il avait des affinités plus profondes avec un certain puritanisme — ce que l’ensemble de son travail de pianiste vient confirmer —, l’énoncé de son esthétique renoue avec la spiritualité promue par le romantisme allemand :
La fin de l’art n’est pas la libération d’une sécrétion momentanée d’adrénaline, elle constitue plutôt l’édification progressive, au cours d’une vie entière, d’un état d’émerveillement et de sérénité. Grâce au ministère de la radio et du phonographe, nous apprenons rapidement, et il est bien qu’il en soit ainsi, à apprécier les éléments du narcissisme esthétique — et j’emploie ce terme dans son sens le plus élevé — et nous prenons conscience du défi pour chaque homme de créer par la contemplation sa propre divinité[2].
Cette phrase a été beaucoup citée et sa portée est universelle : elle s’adresse en effet autant à l’écriture dans l’histoire de la musique, où la recherche de la contemplation règle le jugement esthétique, qu’au rapport de chacun avec ce qu’il attend de la musique dans l’expérience quotidienne. Parler d’édification rapproche déjà des idéaux de penseurs comme Wackenroder et Novalis, pour qui la musique constituait l’art suprême en raison de cette capacité unique à élever, à édifier. Gould n’a cessé d’évoquer ce principe et on peut se surprendre qu’il n’en ait pas reconnu l’origine romantique. Pour lui comme pour Wackenroder, ce conflit entre le sublime et le léger s’établit sur le fond d’une métaphysique de l’émotion esthétique. Ne sommes-nous émus que par l’accès à une origine qui transparaît dans le sensible et qui, dès lors que nous y accédons, disqualifie tous les chemins et tous les supports qui nous ont permis d’y parvenir ? Sur cette échelle de Jacob, l’art ne serait dès lors que la forme transitoire et fugace d’une mystique abstraite, au sein de laquelle le sentiment aurait le statut d’une illusion.
Cette pensée peut atteindre des limites insoupçonnées. Glenn Gould n’affirmait-il pas qu’un véritable amour de la musique peut se passer de l’exécution de l’oeuvre, celle-ci reposant d’abord sur une figure séparée et quasi transcendantale ? L’oeuvre écrite n’aurait rien en commun avec l’émotion sensible qu’elle suscite, elle ne partagerait qu’accidentellement la réalité du sentiment : elle serait d’abord une architecture admirée pour son travail de construction et révélatrice de la perfection de la raison qui la constitue. En musique, Jean-Sébastien Bach répond ainsi à Dürer, autant par la sainteté des objets que par la puissance du contrepoint. Par comparaison, le sentiment provoqué par le concert et l’exécution semble relever d’une pathologie blâmable : la beauté musicale ne saurait être réduite à un simple « ébranlement nerveux », elle est un acte de l’esprit, une activité de la pensée que Gould identifie à une forme de contemplation pure et de sanctification. Cette création par chacun de « sa propre divinité » se présente comme l’écho de la contemplation romantique de l’infini dans la musique. N’est-elle pas le seul art capable de se rapprocher du divin et de révéler l’infini ? Parvenus au sommet de cette édification, l’échelle peut être abandonnée.
Ce romantisme de l’idée, que tout oppose au romantisme du sentiment, nous aide à comprendre comment Gould a proposé une critique de l’émotion, fondée sur l’idée d’un subjectivisme incompréhensible : pourquoi serions-nous en effet plus émus par Mozart que par Haydn ou Bach ? Sa préférence pour le contrepoint pur lui aura permis de dépasser ces oppositions jugées stériles et de construire une histoire de l’esthétique musicale qui valorise d’abord l’écriture. Revoir cette histoire, c’est aller à la rencontre d’un jugement au regard duquel les facilités matérielles du sentiment sont toujours dénoncées par la position d’un absolu transcendant. Sur ce registre, la pensée de Gould rejoint donc non seulement le romantisme de Wackenroder, ou même de E. T. A. Hoffmann dans son roman Kreisleriana, mais aussi les positions de ces théoriciens modernes de l’esthétique musicale qui, dans la foulée de la pensée de Eduard Hanslick, ont fait l’éloge d’un art absolu, d’une musique posée au-delà de tout support sensible. S’adressant à l’histoire de la musique tonale, Hanslick plaidait déjà pour une approche concentrée sur l’écriture et le style. Souvent qualifiée de « formalisme », sa pensée est en fait une critique du sentiment considéré comme illusion subjective du romantisme européen. Ironisant sur les sentiments de Bettina von Arnim dans ses lettres à Goethe, Hanslick se révèle le prédécesseur de Gould quand il écrit : « Le nombre de ceux qui écoutent ou plutôt sentent ainsi la musique est considérable. Subissant passivement l’action des éléments premiers de la musique, ils entrent dans une excitation vague qui à la fois dépend des sens et les transcende, et n’est déterminée que par le caractère général de l’oeuvre. Leur comportement envers la musique n’est pas contemplatif, mais pathologique […][3]. »
Ce nouveau romantisme de l’idée garde-t-il des traces des idéaux de Wackenroder ? N’est-il pas lui aussi une idéalisation de la musique considérée pour elle-même ? Malgré qu’il se détache de la position d’une référence divine transcendante, et qu’il conduise ainsi à la notion d’une oeuvre parfaite isolée de toute perspective métaphysique sur l’origine, la pensée de Hanslick se caractérise néanmoins par une fascination pour la pureté. En quel sens cette fascination conserve les traits de l’extase romantique, la pensée de Gould n’a cessé d’en donner l’exemple. On n’abandonne pas si facilement en effet la recherche de l’extase, dût-elle résider dans un éloignement absolu des sens. Déjà dans le Kreisleriana de Hoffmann, la source de l’émotion musicale est interrogée à partir du temps musical lui-même : comme le roman qui en présente l’intrigue, Johannes Kreisler, le héros musicien de Hoffmann, voit dans la musique une structure d’attentes, de répétitions, de catastrophes, un ensemble de moments par rapport auxquels le rythme et la tonalité ne sont que des ornements non essentiels. Ces moments peuvent être très structurés, par exemple en respectant les règles d’une forme qui prescrit la reprise et la répétition, mais rien ne permet de penser une émotion qui se dégagerait entièrement du temps. La musique pure, si elle existe, ne saurait vaincre le temps et pourtant elle doit sans faillir l’espérer.
En accordant au contrepoint le privilège que l’on sait, Gould reproduit l’exigence romantique d’un dépassement du support et il en intègre entièrement la recherche de pureté formelle. Le style classique, s’il faut donner un exemple, impose un type de temps déterminé par la forme au sein duquel l’émotion jaillit du caractère prévisible de la structure : elle naît en effet de la reconnaissance et de la confirmation d’un temps prescrit et achevé. Le style classique qui prescrit l’achèvement n’est pourtant pas le seul où la force du temps suffit à expliquer l’émotion. Une écriture moins soumise au canon d’une forme limitée, comme celle de Schubert, propose une linéarité où l’inachèvement devient la règle du développement. L’émotion surgit alors moins de la reconnaissance que d’une attente à jamais insatisfaite et qui donne au sujet l’horizon d’une fin impossible. Le temps de Schubert appartient en effet à cet horizon imprescriptible, où la pureté attendue est toujours une pureté espérée, promise, mais jamais atteinte. N’existe-t-il pas enfin des oeuvres entièrement déstructurées, proposant un temps fragmenté, non saisissable selon la figure d’un récit ?
Glenn Gould professait ne pas aimer le romantisme, ni celui du sentiment exacerbé ni celui de la forme infinie : il n’a jamais joué Schubert et il n’a pas davantage commenté l’oeuvre fragmentée qui était pourtant celle de son temps. Dans cette nébuleuse du romantisme musical, le seul compositeur qui trouvait grâce à ses yeux était Richard Strauss, un musicien qui lui-même considérait avoir rompu avec le canon de ses devanciers. Le romantisme de l’idée révèle ici la force de ses présupposés : pour maintenir l’oeuvre musicale, lui permettre de subsister dans l’univers de perfection où l’écriture la dégage des contraintes du sensible et de la subjectivité, il faut respecter la règle minimale d’une forme temporelle. Le chiffre idéalisé de l’harmonie serait dès lors la condition première d’une esthétique fidèle à ces prémisses. Ce serait en effet la première exigence d’une esthétique de la musique pure, apprécier l’accès à la temporalité à travers un langage parfait. L’expérience de l’émotion musicale est donc la pure expérience du temps, dans tous ses aspects phénoménologiques : durée, finitude et même contingence, dans la mesure où l’émotion pure d’une temporalité récursive, si importante dans le contrepoint, conduit à l’expérience de la nécessité et peut accepter, dans une forme ouverte, d’accueillir l’échec de cette nécessité comme expression d’une transcendance déchue. De Bach à Mozart, et de Beethoven à Schubert et Schumann, ces lignes de temps ont dessiné l’espace d’une esthétique différenciée.
C’est en ce sens que Hanslick parle de l’arabesque : « Représentons-nous l’arabesque vivante comme le rayonnement actif d’un esprit artiste, qui inlassablement répand son imagination surabondante dans les artères de ce mouvement : l’impression ressentie ne sera-t-elle pas bien voisine de celle de la musique[4] ? » Que penserait Gould de cette image en apparence si proche d’un idéal abstrait de l’écriture ? Il lui reprocherait l’illusion d’une liberté non contrainte par des formes pures et reposant sur la spontanéité de son propre développement. Mais il lui reconnaîtrait néanmoins un mérite, celui de privilégier la ligne du temps sur les sensations, les timbres, et en général sur l’expression chromatique. Et il se montrerait ainsi fidèle à son esthétique fondamentale, car à bien des égards, et en dépit des contraintes formelles de l’écriture contrapuntique, l’arabesque se rapproche de la fugue de Bach. Tensions et paradoxes ne peuvent certes manquer de se manifester devant cette requête de la perfection formelle, si la question du temps se révèle à son tour habitée par une pensée de la liberté, mais le privilège de la forme domine ici tout le territoire du jugement sur l’émotion : celle-ci ne saurait être authentique que si elle émarge d’abord à l’idée.
À cette considération sur le temps, il faut aussitôt ajouter la réflexion sur le rapport au monde. Rien ne décrit mieux le romantisme de Wackenroder, et en général la pensée des romantiques sur la musique, que cette exigence d’un rapport purifié. Par-delà les facilités de l’identification légère, la musique veut conquérir cette autonomie qui va la séparer de la littérature de la manière la plus radicale. En elle, en effet, ne subsiste aucune trace de cette extériorité à laquelle on cherchait vainement à la rapporter. Tout comme la peinture de Dürer ne conserve du monde que ce qui peut construire l’échelle de Jacob qui permettra de s’en détacher, la musique véritable est musique pure, c’est-à-dire musique dégagée entièrement de tout rapport à la mondanité des objets, de la nature, du monde en général. La philosophie romantique se met ici au service d’une esthétique de la séparation : si le sentiment doit être authentique, il ne saurait surgir du lien avec le monde, mais au contraire d’un éloignement. Le rapport structuré fortement par ce lien établi entre le compositeur/musicien et le monde ne peut que se désintégrer en atteignant la sublimité de l’ineffable, jusqu’à disparaître entièrement[5]. Wackenroder a présenté cette éthique de la séparation dans un conte d’inspiration orientale, le Merveilleux conte oriental du saint homme nu[6]. Prisonnier du cycle éternel du temps, le saint trouve dans la musique le seul moyen de la libération. Livré au « désir dévorant de beautés inconnues », il traverse l’épreuve d’une détresse insondable et retrouve la sérénité par la musique. Cette libération reproduit celle de l’autre héros de Wackenroder, le compositeur Berglinger[7], libéré lui aussi par l’écriture d’une « Passion » rédemptrice. L’un et l’autre connaissent par la musique une forme de transfiguration.
Sur ce registre, on ne peut que noter la profonde convergence de la pensée de Gould avec ce romantisme de l’idée. On lit par exemple dans le roman Kreisleriana de E. T. A. Hoffmann le récit des « souffrances musicales » de son héros, le musicien Johannes Kreisler[8], confronté aux enthousiasmes artificiels de ses contemporains. Penché sur sa partition des Variations Goldberg de Bach, il médite sur la substance de l’oeuvre musicale :
Que la musique est donc chose admirable, et pourtant que l’homme est peu capable d’en pénétrer les profonds secrets ! Mais ne réside-t-elle pas dans le coeur même de l’homme, ne remplit-elle pas son âme de gracieuses images, si bien que l’esprit se donne à elle tout entier, et qu’ici-bas déjà une vie nouvelle, transfigurée, l’arrache à la contrainte, aux tourments accablants de l’existence terrestre ? Oui, une force divine l’envahit et, s’abandonnant avec une piété enfantine à ce que l’esprit suscite en lui, il se met à parler la langue de ce royaume mystérieux[9].
À ses contemporains, le héros de Hoffmann reproche donc de franchir sans réfléchir l’abîme à ses yeux infranchissable qui sépare le monde et la musique. S’il existe un monde auquel donne accès la musique, ce ne saurait être celui des êtres naturels, des forêts, des tempêtes, des animaux, ni même celui de l’homme. Toute cette rhétorique de l’émotion musicale rend un son creux, elle est vide de sens, car elle évite de considérer le coeur divin, la spiritualité de ce qui doit jaillir dans l’écriture. Au-delà donc de la reconnaissance du monde, c’est bien plutôt l’exaltation de ce qui le transcende qui constitue la musique. Aucune analogie avec le monde ne peut en effet gravir les échelons de cette nouvelle échelle, et toute l’esthétique romantique ne cesse de le répéter. En évoquant cette « vie nouvelle, transfigurée », Hoffmann rend hommage non seulement aux musiciens de la sublimité dont son héros Kreisler se fait le porte-parole, mais aussi à toute la pensée romantique de la musique, pénétrée de cet idéal d’élévation.
La discussion sur ces questions fait intervenir un concept de représentation, dont il s’agit de savoir s’il est indispensable à la compréhension de l’émotion musicale. Être ému, est-ce se représenter quelque chose ? Hoffmann, comme Wackenroder, n’a de cesse de dénoncer cette association de l’émotion, même inconsciente, à quelque scène où la musique nous convoquerait comme à un banquet secret. Par exemple, si je peux me représenter comme le promeneur surpris par la tempête dans la Symphonie pastorale, je peux sans doute expliquer la qualité de l’émotion qui en émane et la sérénité qui fait ensuite l’objet de mon attente. Beethoven m’attend sur ce chemin de campagne, il accompagne mon effroi et ensuite me rassure. Cette intrigue paraît en effet irréfutable, n’est-elle pas le noyau qui permet la reconnaissance du temps, c’est-à-dire la traversée de l’épreuve et l’arrivée dans le monde de l’après ? À cette question, la réponse romantique demeure sans équivoque : la mise en scène d’une représentation appartient encore au drame, elle demeure en deçà du seuil mystérieux du langage musical car elle demeure poétique. Hoffmann aime le comparer aux mystères d’Isis et il en parle comme du sanskrit de la nature. Si la nature devait avoir un langage, ce ne pourrait être qu’une grammaire indéchiffrable selon les lois d’une représentation. Dans les pages qu’il consacre à la musique instrumentale de Beethoven, on croit entendre Glenn Gould :
La musique instrumentale, lorsqu’elle doit produire un effet purement musical, et non par exemple s’asservir à un but dramatique, évite les jeux frivoles et les lazzi. Pour exprimer la joie qui, plus belle et plus pure que dans notre monde resserré, vient d’un pays inconnu et allume en nous une vie intérieure toute de délices, le sentiment profond cherche une expression supérieure à celle que peuvent lui donner les mots étroits, appropriés seulement au plaisir limité de ce monde[10].
Wackenroder ne dit pas autre chose, lui qui désirait tant être musicien et qui comparait le langage musical à la langue hiéroglyphique naturelle. On retrouve chez lui en effet un refus radical de considérer la musique comme une description du sentiment : ce que le langage musical donne dans l’accès à la source divine, il l’est par essence. Royaume perdu de l’enfance, innocence sans cesse recherchée, son domaine demeure ineffable.
Ainsi se trouve replacé au centre de l’esthétique le privilège de la forme pure, celui-là même que Gould associait au contrepoint de Bach et qu’il a isolé comme le critère suprême, voire unique, d’un regard critique sur l’histoire de la musique. Que ce critère ait été aussi celui des romantiques dans leurs réflexions sur la musique de leur temps ne peut que nous intéresser : ce choix montre en effet que dans la tradition du romantisme, l’accent mis sur l’émotion subjective, si celle-ci se fonde sur la reconnaissance du monde et la répétition d’un drame, ne s’accorde pas avec l’esthétique profonde du romantisme, qui pose le contraire. On se trouve dès lors en présence d’une forme de paradoxe : seule la musique peut rétablir l’harmonie perdue, mais seule encore elle ouvre la possibilité d’une souffrance idéalisée.
Un autre trait qui rapproche ce romantisme des penseurs de la musique pure et de Gould qui est pour ainsi dire leur compagnon essentiel est la place de la figure du musicien. Dans tous ces écrits, le compositeur héroïque est montré souffrant, mais il ne souffre que des compromis de ses contemporains, et non de ce qui serait le tourment personnel dont jaillirait sa musique. Ni Kreisler ni Berglinger ne sont des artistes souffrants au sens ordinaire où on entend ce mot dans l’esthétique traditionnelle du romantisme. Quand on évoque par exemple la figure de Beethoven, seul et subissant une surdité qui le dévaste, ou celle de Schubert, lui aussi atteint par la maladie, ou encore celle de Robert Schumann s’enfonçant dans la démence qui va l’emporter, ou même plus près de nous la figure de l’artiste persécuté par un régime totalitaire, comme Dimitri Chostakovitch, on s’engage sur le chemin d’une interprétation de l’émotion musicale comme identification au drame personnel de l’artiste. Au regard de Gould, que cette perspective remplissait d’effroi, comme dans les écrits de Hoffmann et Wackenroder, le romantisme est tout sauf cet abandon à l’émotion de la proximité. C’est plutôt à l’artiste entièrement présent dans son écriture, mais purifié de son drame par elle, que Gould voudrait s’identifier : Bach, d’abord, mais ensuite Webern, Schönberg et tous ceux qui ont adopté cette figure du retrait, du retranchement.
Un tel retrait conduit à poser la question de l’ineffabilité. Parler de ce qui ne peut pas se dire, est-ce possible ? Bach, et Gould après lui, pensaient que la lecture de la musique comme harmonie parfaite nous renvoyait à l’harmonie des sphères : pour eux, il n’y a aucune ineffabilité, seulement une mystique du lieu transcendant de la musique, transparent et lisible. Cette idée a des racines très profondes dans l’histoire de l’esthétique musicale, par exemple chez Boèce et saint Augustin, mais personne n’en a mieux signalé l’importance que les romantiques allemands, et parmi eux Wackenroder et Hoffmann. Chez eux, le lyrisme de l’infini inexprimable se soutient de cette idée d’une grammaire céleste. Les poètes qui comme Goethe, mais aussi Heine, déclament cet infini sur tous les registres n’ont de cesse d’en rapporter l’exigence à l’idéal d’une émotion musicale purifiée. Que nous apprend cette source littéraire sur la recherche d’un absolu musical ? Les poètes décrivent l’épreuve, le trajet d’un héros soumis aux vicissitudes du présent. Leur quête de sérénité et d’immortalité ne trouve que dans la musique l’exaucement de leur voeu profond, se dégager de la contingence de l’expérience et accéder à la source divine du temps et de la nature. Le romantisme impose donc le thème de cet ineffable, il en fait la définition même du langage musical. En son point extrême, cette ineffabilité mystérieuse rejoint la nécessité des formes parfaites, reflétant les grandes harmonies cosmiques et mathématiques du contrepoint inlassablement poursuivies dans la musique de Bach. Faut-il rappeler que ce sont les romantiques qui ont retrouvé la musique de Bach et en ont exprimé les principes qu’ils jugeaient convergents avec leur esthétique ? Il faut de nouveau citer Hanslick : « Il existe dans la musique un sens et une logique, mais de nature musicale ; elle est une langue que nous comprenons et parlons, mais qu’il est impossible de traduire[11]. »
Que signifie dès lors une ineffabilité aussi radicale ? Comme Gould et d’autres l’ont signalé, ce contrepoint devait reproduire des structures célestes, en reproduisant des harmonies si parfaites qu’elles ne pouvaient qu’imiter le mouvement des astres, le système des écliptiques, la récession des planètes, et en général, selon les timbres et les hauteurs, la représentation du rapport du monde fini au monde infini. Cela a été théorisé bien avant la période classique et baroque par des penseurs comme saint Augustin, réfléchissant sur la mémoire et l’anticipation. Pour eux, le temps musical était très différent du temps de l’expérience, puisqu’il avait précisément pour devoir d’ouvrir l’accès à un autre temps, le temps de Dieu. Quand nous retrouvons ces pensées dans les écrits des romantiques, qu’il s’agisse de Wackenroder ou de Hoffmann, nous sommes en présence de la postérité la plus affirmée de ce modèle de l’échelle de Jacob. Wackenroder n’a-t-il pas intitulé l’un des essais recueillis dans ses Fantaisies sur l’art d’un titre qui veut tout récapituler : « L’essence intime et particulière de la musique et la psychologie de la musique instrumentale actuelle » ? Quelle est donc cette leçon, sinon cette mystique de l’art nourrie aux sources spirituelles les plus hautes ? Wackenroder décrit cette mystique comme ce qui donne accès au « sanctuaire de l’art », chacun étant invité à « adorer la sainteté profonde et inaltérable qui s’y trouve[12] ». Glenn Gould ne l’aurait pas dit autrement.
Appendices
Notes
-
[1]
W. H. Wackenroder, « Éloge de notre maître vénérable Albert Dürer ». Ce texte fut publié d’abord par Reichardt dans la revue Deutschland en 1796 et repris dans le recueil posthume des essais de Wackenroder, publié anonymement par Ludwig Tieck en 1799, Phantasien über die Kunst (Fantaisies sur l’art, introduction et traduction de Jean Boyer, Paris, Éditions Montaigne, 1945 et plus récemment, Épanchements d’un moine, suivi de Fantaisies sur l’art, traduction de l’allemand, introduction et notes par Charles Le Blanc et Olivier Schefer, Paris, José Corti, coll. « Domaine romantique », 2009).
-
[2]
Glenn Gould, « Let’s ban applause », dans The Glenn Gould Reader (présentation et édition de Tim Page), Toronto, Lester & Orpen Dennys, 1984, p. 246. Ma traduction.
-
[3]
Eduard Hanslick, Du beau dans la musique. Essai de réforme de l’esthétique musicale [1854], (traduction de Charles Bannelier, revue par Georges Pucher. Introduction de Jean-Jacques Nattiez), Paris, Christian Bourgois, coll. « Musique, passé, présent », 1986, p. 133.
-
[4]
Eduard Hanslick, op. cit., p. 94.
-
[5]
Les études sur Wackenroder ne sont pas si nombreuses qu’on puisse passer sous silence le livre ancien, mais toujours utile, de Marcel Brion, L’Allemagne romantique, Paris, Albin Michel, 1962. Voir sur la musique, p. 208 et suivantes.
-
[6]
Ce conte est recueilli dans les Fantaisies sur l’art. Outre la traduction déjà citée de Jean Boyer, on peut lire celle d’André Coeuroy, dans Maxime Alexandre (dir.), Les romantiques allemands, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1963, vol. I, p. 1542, ainsi que celle de Charles Le Blanc et Olivier Schefer, op. cit., p. 205-209.
-
[7]
« La remarquable vie musicale du compositeur Joseph Berglinger » (traduction d’André Coeuroy), dans Maxime Alexandre (dir.), Les romantiques allemands, vol. I, p. 1530. Ce texte fait partie de la seule oeuvre publiée de l’auteur, Herzensergiessungen eines kunstliebenden Klosterbruders (Les épanchements du coeur d’un moine ami des arts), publiée anonymement par Ludwig Tieck en 1797. Le personnage de Berglinger est un héros imaginaire, sorte de figure autobiographique de Wackenroder lui-même. On trouvera dans la nouvelle traduction de Charles Le Blanc et Olivier Schefer une excellente introduction (« Wackenroder et la musique », op. cit., p. 9), voir Wilhelm Wackenroder, Les épanchements du coeur d’un moine ami des arts, Paris, José Corti, 2009. Ce livre contient également la traduction des Fantaisies sur l’art.
-
[8]
Comme le Berglinger de Wackenroder, Kreisler est le porteur des idées de Hoffmann. Le roman a été publié en deux parties, en 1814 et 1815, dans les Fantaisies à la manière de Callot ; voir E. T. A. Hoffmann, Keisleriana (traduction d’Albert Béguin), dans Maxime Alexandre (dir.), Les romantiques allemands, vol. I, p. 890.
-
[9]
E. T. A. Hoffmann, Keisleriana, p. 890.
-
[10]
E. T. A. Hoffmann, Kreisleriana, p. 906.
-
[11]
Eduard Hanslick, op. cit., p. 94. Voir sur ce point l’étude de Jean-Jacques Nattiez, « La signification musicale », dans Jean-Jacques Nattiez (dir.), Musiques. Une encyclopédie pour le xxie siècle, vol. 2. Les savoirs musicaux, Paris, Actes Sud/Cité de la musique, 2004, p. 263.
-
[12]
Wilhelm Heinrich Wackenroder, Fantaisies sur l’art, trad. Charles Le Blanc et Olivier Schefer, p. 228.