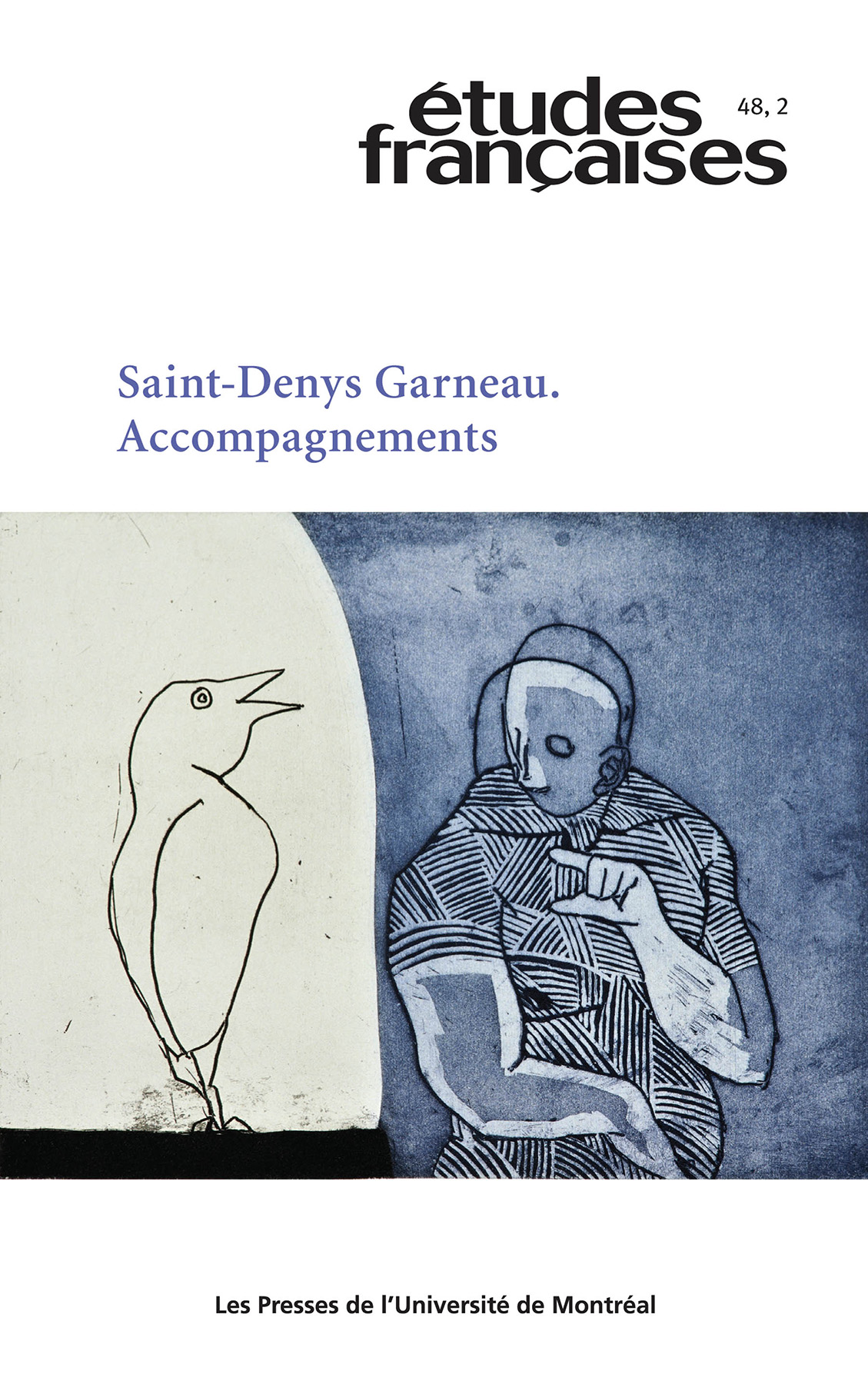Abstracts
Résumé
De 1929 à 1939 (et peut-être au-delà), Hector de Saint-Denys Garneau a tenu ce qu’il appelait son « journal ». Le présent article aborde le parcours de Garneau en tentant de caractériser les formes qu’il a expérimentées dans les cahiers qui nous sont parvenus, de l’examen de conscience à la fiction, en passant par la lettre, les méditations sur l’art et le poème. Sont ensuite considérés les rapports qui s’établissent entre ces diverses formes. Il ressort de cet examen que Garneau a progressivement mis en relation le discours réflexif avec les ouvertures qu’offraient la poésie et la fiction : une dynamique se développe entre le bilan et l’esquisse, pour aboutir à une forme d’écriture qui intègre divers aspects du journal, notamment dans « Le mauvais pauvre va parmi vous avec son regard en dessous ». Cette pratique du journal, associant la délibération et l’expérimentation, est atypique dans la littérature québécoise, mais en plaçant les écrits de Garneau dans le contexte de la littérature française, plusieurs parentés apparaissent avec les oeuvres de Michel de Montaigne, de Joseph Joubert, de Paul Valéry et de Philippe Jaccottet, notamment. Ces oeuvres illustrent des dimensions de l’écriture du cahier qui transforment les visées habituelles du journal intime. De ce point de vue, les cahiers de Garneau s’inscrivent dans le « grand contexte » d’une forme erratique et heuristique qui est sans doute plus proche de l’essai tel que l’entendait Montaigne que de ce que le mot « essai » a fini par désigner aujourd’hui.
Abstract
From 1920 to 1939 (and perhaps beyond these years), Hector de Saint-Denys Garneau wrote what he called his “Journal.” This article deals with Garneau’s poetic evolution by attempting to characterize the forms with which he experimented in the surviving notebooks: critical introspection, fiction, letters, as well as reflections on art and poetry. I then examine the interactions between these forms. The analysis shows that Garneau progressively aligns reflexive discourse and the possibilities of fiction and poetry: this dynamic relationship between critical reports and sketches results in a form of writing that incorporates various aspects of the journal, as in “Le mauvais pauvre va parmi vous avec son regard en dessous.” If Garneau’s practice of the journal form, which couples reflection with experimentation, is unusual in Québécois literature, it shows similarities with the works of writers like Michel de Montaigne, Joseph Joubert, Paul Valéry, and Philippe Jaccottet in the context of French literature. All these writers explore aspects of notebook writing that alter the traditional aims of the journal. From this perspective, Garneau’s notebooks take their place in the “broad context” of an erratic and heuristic form that is certainly more akin to what Montaigne called “essai” than to what this word designates today.
Article body
À l’exception du recueil Regards et jeux dans l’espace qu’il fit paraître à compte d’auteur en 1937, le journal est le seul ensemble de textes sur lequel a travaillé Saint-Denys Garneau. Encore faut-il préciser que cet ensemble n’était pas destiné à la publication (du moins tel quel), et que le travail en question, si l’on exclut les annotations rétrospectives, fut plutôt de l’ordre de l’accumulation et de la réorientation d’un projet que Garneau poursuivit pendant au moins une dizaine d’années, de 1929 à 1939. L’ensemble du journal, tel qu’il fut reconstitué dans l’édition critique de Jacques Brault et Benoît Lacroix, puis dans celle de Giselle Huot, comporte huit cahiers. À vrai dire, le premier, le seul à ne pas comporter l’appellation « journal », constitue plutôt un recueil de textes de jeunesse, de sorte que le journal proprement dit s’étend sur sept cahiers, de longueur très inégale, auxquels s’ajoute un certain nombre de feuilles volantes, où Garneau avait inscrit la mention « journal », sans doute dans des circonstances où il n’avait pas son cahier sous la main.
Il faut noter que le texte fut amputé de plusieurs pages et passages par la mère de Garneau avant qu’elle ne le remette aux premiers éditeurs ; par ailleurs, son ami Jean Le Moyne affirmait que Garneau avait continué de tenir un journal après 1939[1]. Au caractère lacunaire du journal s’ajoute la nature particulière de l’histoire de son édition. Depuis la première édition jusqu’à la plus récente[2], on n’a jamais intégré les poèmes au journal, comme si le vers devait a priori en être exclu (inversement, on n’a jamais intégré les poèmes en prose figurant dans le journal à son oeuvre poétique). Les lettres transcrites par Garneau dans son journal ont elles aussi toujours été retranchées. La diffusion du journal souleva divers obstacles : le problème de l’oeuvre non voulue comme telle ; la censure morale de la mère ; la volonté des amis d’élaguer et de classer les textes selon leurs principes esthétiques ; le rôle documentaire souvent attribué au texte au détriment de sa nature littéraire ; la volonté de mise en ordre des éditions critiques qui ont classé les textes selon diverses catégories (jeunesse et maturité, textes publiés et inédits, genres littéraires). En fragmentant et en classant les textes du journal au nom de la morale, de la poétique ou de la taxinomie, on s’est constamment opposé au désordre du texte de Garneau.
Ce désordre, Garneau le désirait pourtant, dès le début de son projet. Le 21 février 1929, il écrit en effet :
j’ai bien l’intention d’écrire mon journal. Robert Helmont m’en a donné l’idée mais je ne lui emprunterai aucunement le plan ni le genre. Ce que j’ai l’intention d’écrire n’est pas, non plus, un de ces comptes rendus des événements de la journée, si banals et si monotones. Ce sera une étude, une analyse, un conte, des pages disparates ou une petite histoire continue, suivie, selon ma disposition journalière […] enfin quelque chose de personnel et que je tenterai de rendre original. Le but de ce travail est de me mieux connaître et ainsi de me perfectionner dans l’ordre moral et intellectuel. C’est à ces fins que j’y ferai figurer des analyses de mes états d’âme et d’esprit ! chaque fois que j’en aurai d’intéressants ; et des études sur des pensées ou des opinions afin d’acquérir de nouvelles idées : car les idées viennent souvent à l’improviste quand on écrit et provoquent d’autres réflexions et d’autres idées encore.
Oe, 597
Le projet s’inspire donc de la lecture d’un roman (d’Alphonse Daudet) et se définit d’abord par ce qu’il ne sera pas (planification, genre romanesque, compte rendu des événements de la journée). Le versant positif qui en ferait l’originalité est son caractère disparate (études, analyses, contes, histoires) et ses principales fonctions seraient de « se mieux connaître » et d’« acquérir de nouvelles idées » par la pratique soutenue de l’écriture. Garneau combine dans ce programme les traits habituels du journal intime (transcrire ses « états d’âme et d’esprit ») et une visée littéraire dominée par les vertus accordées à l’hétérogène et à la fonction heuristique de l’écriture. Lorsqu’il écrit ces lignes, Garneau est âgé de seize ans et il décrit un projet qui, à l’exception notable de l’écriture poétique, rend très bien compte de ce qu’il écrira au cours des dix années suivantes dans ses cahiers.
Le relais des formes
Curieusement, le premier texte qui suit la définition de ce programme s’intitule « Mes Mémoires ». L’objectif du jeune homme est de « mettre en vue la base d’où l’édifice […] monte » (Oe, 598). Cette fonction de bilan accordée au journal reviendra périodiquement par la suite, avec une gravité croissante à mesure que la « base » sera remise en question et fragilisée par l’entreprise qui devait au départ la consolider. Contrairement à ce qu’il annonçait, Garneau structure un plan précis (Oe, 595), où se côtoient les événements familiaux (naissances, décès), son parcours scolaire chaotique (plusieurs changements d’institution, en raison d’une santé fragile), les vacances et la grande histoire (la Grande Guerre). Mais lorsqu’il passe du plan à l’écriture, c’est le village de Sainte-Catherine qui le retient longuement : plusieurs pages ressemblent à des esquisses d’un romancier (par exemple celles de Zola dans ses carnets) qui chercherait à s’imprégner du lieu où il développera sa fiction. Le bilan tend ainsi vers l’esquisse, qui est une autre fonction dominante du journal de Garneau. En combinant le bilan et l’esquisse, il s’agit sans doute de se préparer à devenir écrivain, mais le trait le plus caractéristique de l’esquisse chez Garneau est de tendre vers l’amélioration de l’existence plutôt que vers une oeuvre ; en ce sens, le journal sera une constante médiation entre la vie et l’art, une sorte d’entre-deux qui fait du poème une introspection et d’une toile une expérience existentielle.
Après l’entreprise initiale des mémoires, le journal prend un tour plus fragmentaire, mais cette fragmentation témoigne aussi d’une unification, car l’écriture de Garneau se met à converger résolument vers ses cahiers, où, à partir de 1930, il transcrit de nombreuses lettres. L’exemple d’une lettre à Françoise Charest est assez éloquent : Garneau transcrit la lettre, mais envoie le brouillon avec ses ratures pour conserver la copie mise au net et intégrer ces feuilles à son journal (Oe, 1253)… L’« équivoque épistolaire » dont parle Vincent Kaufmann, c’est-à-dire la distance d’avec le destinataire entretenue par la correspondance, est constante chez Garneau, qui se parle devant ses destinataires autant qu’il s’adresse à eux : il demande d’ailleurs à plusieurs correspondants de conserver les lettres qu’il leur écrit pour les verser dans son journal, mais n’y inclut aucune lettre reçue. Tout se passe comme si le destinataire était un prétexte d’écriture, et, comme l’écrit Kaufmann au sujet de Flaubert, par ses lettres, Garneau « entre en distance, comme on dit entrer dans les ordres[3] ». Les lettres paraissent destinées à confirmer la « vocation du désert » (Oe, 550) et à explorer les possibilités qu’offre cette position en retrait. Comme le journal est un entre-deux entre la vie et l’art, le commerce épistolaire, écrit Michel Biron, « permet d’échapper tout à la fois à l’impersonnalité de la sphère publique et au silence littéraire proprement dit[4] ». En s’intégrant au journal, la correspondance fait entrer la société des amis, qui sont souvent à l’origine de questions dont Garneau mesure l’étrangeté dans l’univers tout intérieur de ses méditations. C’est par exemple à partir d’une question soulevée par son ami Robert Charbonneau que Garneau développe le plus longuement la question du nationalisme (Oe, 550-554). Les brouillons pour La Relève jouent le même rôle d’ouverture, mais celle-ci reste épisodique et de plus en plus rare à mesure que le journal se développe.
En effet, s’il s’adresse au début du journal à un lecteur imaginaire, et plus tard à des amis ou aux lecteurs de La Relève, Garneau ne tarde pas à se parler quasi exclusivement à lui-même. La forme qui correspond le plus exactement à ce soliloque est sans doute l’examen de conscience, car il s’agit très souvent de se situer en regard des principes de la religion catholique. Même si la distance de Dieu reste angoissante, la religion constitue pour Garneau une exigence radicale et une bonne part du journal consiste en une évaluation de son comportement en regard de la morale du christianisme. C’est le rôle que joue notamment la lecture de L’imitation de Jésus-Christ. Quelques jours après avoir fait un bilan particulièrement sévère de son journal en octobre 1937, il s’émerveille de la simplicité du texte de Thomas a Kempis, puis, se tournant vers lui-même, s’admoneste :
Il me semble bien que, au fond, le jeu est fini pour moi, l’attitude du « spectateur » contre laquelle parle aussi Gabriel Marcel dans Être et Avoir. Les problèmes se posent pour moi d’une façon vitale, et je suis forcé de leur trouver une solution pratique qui devient de plus en plus exigeante : question de vie ou de mort ; je ne puis plus en sortir. Fini le temps des solutions théoriques. Il me faut m’engager, et jusqu’aux os. À vrai dire il ne me reste plus que les os. Je n’ai pas eu la sincérité de m’engager librement quand j’aurais pu y porter un coeur encore vivant. J’ai usé en vanité toute la chair autour des os, en vains feux d’artifice toute la chaleur de la chair. Maintenant que je suis forcé, je dois, sans chaleur, engager la carcasse. Tout le reste est déjà contre moi, moi la carcasse. Il faut m’engager.
Oe, 539
Ce passage fait directement écho à une esquisse de poème que Garneau avait écrite dans son journal quelques jours auparavant :
Oe, 173Quand on est réduit à ses os
Assis sur ses os
Couché en ses os
Avec la nuit devant soi.
Dans d’autres poèmes de la même période, l’examen de conscience concerne aussi le « nous ». Le vers « Qui est-ce qui a mangé notre joie parmi nous » (Oe, 189), par exemple, déplace l’introspection sur une scène plus vaste. Le poème tend ainsi à augmenter l’amplitude d’un exercice qui au départ concerne l’individu Garneau lui-même. Inversement, la condensation du poème est relayée par de nouvelles remises en question de soi. On pourrait considérer que l’alliance de l’examen de conscience et de la poésie est issue de la fréquentation des poètes catholiques contemporains, auxquels Garneau accorde une grande attention et de qui il cherche à se rapprocher. Comme chez Patrice de La Tour du Pin, poète français de sa génération qui intéresse particulièrement Garneau, le religieux et le poétique se prolongent mutuellement, jusqu’à se confondre parfois dans la prière (Oe, 188), de sorte qu’« il n’est pas simple, observe Frédérique Bernier, de déceler lequel des axes détermine l’autre[5] ». La conception de la poésie comme élargissement de l’examen de conscience n’est toutefois pas l’apanage des poètes religieux. Elle est aussi présente chez les surréalistes de l’époque. Paul Éluard, par exemple, écrit dans Donner à voir, paru en 1939 :
On a pu penser que l’écriture automatique rendait les poèmes inutiles. Non : elle augmente, développe seulement le champ de l’examen de conscience poétique, en l’enrichissant. Si la conscience est parfaite, les éléments que l’écriture automatique extrait du monde intérieur et les éléments du monde extérieur s’équilibrent. Réduits alors à l’égalité, ils s’entremêlent, se confondent pour former l’unité poétique[6].
Dans le journal de Garneau, les poèmes apparaissent comme un contrepoint des méditations en prose. La première occurrence d’écriture ou de transcription de poème dans le journal, si l’on excepte le rassemblement des textes de jeunesse avant le début du journal proprement dit, se présente en 1935, à la fin d’un cahier. Après ce quatrain isolé (Oe, 153), Garneau intègre de plus en plus souvent des vers à son journal. Le deuxième poème du journal, intitulé « Lassitude » dans une table des matières qui figure en fin de cahier, se termine par cette question :
Oe, 154Quelle voix pourra se glisser, très doucement, sans me briser,
dans mon silence intérieur ?
Le poème situe son cadre, celui du « silence intérieur », et définit l’altérité comme une menace que la poésie pourrait dépasser par sa portée plus large. Plus loin, au milieu d’une série de poèmes, Garneau note : « Parfois, quand j’écris, l’impression que ces choses sont vraies, mais non pas immédiatement ; qu’elles sont vraies ailleurs dans ma vie » (Oe, 425).
Le relais de la prose par la poésie s’applique aussi à la forme même du journal. L’expérience du journal est en effet transposée, notamment par la figure du dédoublement[7]. Celle-ci correspond à l’expérience de tout diariste : la distinction entre le je narrant et le je narré, dont l’écriture du journal accuse la différence. Garneau exprime cela très explicitement au début d’une entrée de 1935 : « Bonsoir moi-même, vieux moi-même tout remâché. Te revoici en face de moi, comme d’habitude, vieil ennemi, et tu me dis encore : “À nous deux” » (Oe, 408). On retrouve cette opposition dans un poème de la même période :
Oe, 156Parole sur ma lèvre déjà prends ton vol,
tu n’es plus à moi
Va-t’en extérieure, puisque tu l’es déjà
ennemie,
Parmi toutes ces portes fermées.
[…]
Garneau reprend plus loin le même motif dans le poème « Accompagnement », qui deviendra le poème de conclusion de Regards et jeux dans l’espace :
Oe, 34[…]
Je marche à côté de moi en joie
J’entends mon pas en joie qui marche à côté de moi
Mais je ne puis changer de place sur le trottoir
Je ne puis pas mettre mes pas dans ces pas-là
et dire voilà c’est moi
[…]
Ce poème inverse en quelque sorte le propos antérieur, puisqu’il converge vers une transposition dans l’« étranger » plutôt que vers une lutte perpétuelle contre le « vieil ennemi ». Mais la poésie, chez Garneau, n’a pas uniquement comme visée de dégager une ouverture ; elle exaspère aussi les difficultés, comme on le voit dans « Un bon coup de guillotine » :
Oe, 202Un bon coup de guillotine
Pour accentuer les distances
Je place ma tête sur la cheminée
Et le reste vaque à ses affaires
[…]
La décapitation radicalise le sentiment d’étrangeté du moi à l’égard de son double, et le poème déplace ensuite le motif du dédoublement du côté d’une sorte d’indifférence (qui se double d’une forte ironie, ainsi que le souligne Robert Melançon[8]), comme si la question était examinée de l’extérieur, en « accentuant les distances ». La variété des orientations de la poésie reconduit donc la multiplicité des formes qui sont mises à l’essai dans le journal et qui continuent d’une autre façon les mêmes questions. Cette extension est aussi présente dans les nombreuses notes sur des oeuvres picturales ou musicales, qui, comme les descriptions de paysages, se prolongent dans des considérations sur les fondements de la perception et de l’art[9].
Une grande unité traverse ainsi la diversité des formes que Garneau met à l’essai. Les perceptions sont reprises sous l’angle de l’esthétique, l’approche de l’art conduit à l’examen de conscience, la caractérisation d’impressions devient poème. Dans les dernières années de la pratique du journal, Garneau multiplie les déplacements, par exemple en réalisant des ébauches de romans, puis il réunit les diverses formes expérimentées dans des textes qui relèvent à la fois du bilan, de la délibération, de l’étude, de la poésie et de la fiction. C’est notamment le cas du texte « Le mauvais pauvre va parmi vous avec son regard en dessous ».
Dans ce texte fameux (Oe, 570-575), comme dans plusieurs autres[10], Garneau substitue le « il » au « je », ce qui, encore une fois, « accentue les distances ». Il reprend par ailleurs plusieurs éléments de passages antérieurs du journal : les figures du regard, de la pauvreté, de l’étranger, du jeu, de la joie, de l’imposteur, de l’exigence, des os, de l’ébranchement, de la désolation, de la soif. Ces figures étaient présentes dans les poèmes ou dans les proses du journal, dont ce texte apparaît comme une sorte de synthèse thématique. Il correspond à l’esprit du bilan qui apparaît périodiquement dans le journal, et Garneau inclut même, dans sa caractérisation du « mauvais pauvre », les « rôles » qu’il a tenus dans ses cahiers, « d’ami, de collaborateur, de correspondant » (Oe, 571). Garneau opère ainsi une intégration des thèmes, mais aussi des différentes formes qu’il a mises à l’essai depuis le début de sa pratique du cahier[11]. Non seulement la distinction entre prose et poésie est-elle abolie, comme dans les poèmes en prose de Baudelaire dont Garneau s’est manifestement inspiré (en particulier « Les yeux des pauvres »), mais il n’y a plus de frontière entre les différentes fonctions et les différentes formes du cahier. Au bout de son cheminement, Garneau arrive à se dégager des conventions littéraires pour trouver une forme totalisante (et pourtant toujours fragmentaire : le texte se termine par « Etc. ») par laquelle poésie et fiction sont liées à l’existence.
Généalogie des cahiers
La diversité des formes pratiquées par Garneau et la dimension littéraire de plusieurs d’entre elles font que le mot « journal », choisi par Garneau, ne rend pas compte de sa nature particulière. Sous certains aspects, il s’agit bien d’un « journal intime » dans sa forme la plus classique, mais c’est le « cahier » ou le « carnet » qui définit le mieux l’entreprise, me semble-t-il. Dans son étude sur le journal intime, Alain Girard exclut carrément la forme du cahier ou du carnet, en raison de la mise à distance de l’intimisme, alors que Béatrice Didier en fait un cas particulier[12]. L’exemple de Garneau montre que l’on peut inverser la perspective, c’est-à-dire faire du journal intime l’une des formes du cahier. Le « journal intime », Garneau le pratique en effet parmi d’autres formes, tout en conservant le principe d’une « succession chronologique datée », qui serait, écrit Béatrice Didier, la « pierre de touche » du journal[13].
L’écriture du cahier telle que la pratique Garneau reste marginale dans la littérature québécoise. On peut penser aux journaux plus tardifs d’Hubert Aquin ou d’André Major, mais ces cas restent exceptionnels. Dans une perspective élargie, les cahiers de Garneau s’inscrivent toutefois dans une lignée importante de la littérature universelle. Je me limiterai ici à quelques exemples du côté de la littérature française.
Le journal en tant que « structure englobante[14] », comme on le voit chez Garneau, rappelle d’abord les Essais de Montaigne. Dans le contexte québécois, le genre de l’essai est le plus souvent associé à des écrivains comme Jean Le Moyne, Pierre Vadeboncoeur ou André Belleau. Or ce qui domine dans cette tradition est la prise de parole de l’essayiste sur la scène publique, notamment dans le cadre de revues d’idées. Tel n’est pas le cas pour Garneau, qui s’est très peu exposé sur la scène publique. De ce point de vue, Garneau n’est pas un essayiste dans le même sens que ses compatriotes. Mais il faut aussi mesurer ce qui distingue l’exemple de Montaigne de ceux de Le Moyne, Vadeboncoeur ou Belleau. S’il s’agit bien, dans tous les cas, de la mise au premier plan du sujet de l’énonciation, d’autres caractéristiques de l’oeuvre de Montaigne y sont beaucoup moins présentes, notamment le fait que l’essai, chez Montaigne, est une forme en cours d’élaboration, à la fois erratique et heuristique. Il écrit en effet : « C’est icy purement l’essay de mes facultez naturelles […]. À mesme que mes resveries se presentent, je les entasse : tantost elles se pressent en foule, tantost elles se trainent à la file. Je veux qu’on voye mon pas naturel et ordinaire ainsi detraqué qu’il est. Je me laisse aller comme je me trouve[15]. » C’est bien cette orientation et ce mouvement qu’on observe chez Garneau, qui le rapprochent, tout comme Montaigne, bien davantage des auteurs de cahiers ou carnets que des essayistes au sens que ce terme a fini par signifier aujourd’hui.
L’« indifférence à l’égard de la communication publique », que Jacques Brault et Benoît Lacroix considèrent comme l’un des traits caractéristiques de la majeure partie de l’écriture de Garneau (Oe, xiii), le rapproche aussi de Joseph Joubert. Celui-ci, plus retiré encore que Montaigne, cultive de la même façon l’écriture erratique et heuristique, et l’inscrit comme Garneau dans la succession des jours. La visée de Joubert telle que la décrit Maurice Blanchot correspond très exactement à l’évolution de Garneau, d’où également une parenté de forme, bien que celle de Joubert soit souvent plus concise. Ce que cherchait Joubert, écrit Blanchot,
cette source de l’écriture, cet espace où écrire, cette lumière à circonscrire dans l’espace, exigea de lui, affirma en lui des dispositions qui le rendirent impropre à tout travail littéraire ordinaire ou le firent s’en détourner. Il a été, par là, l’un des premiers écrivains tout modernes, préférant le centre à la sphère, sacrifiant les résultats à la découverte de leurs conditions […][16].
« Sacrifier les résultats à la découverte de leurs conditions », cela caractérise aussi une écriture par ailleurs très différente, celle de Paul Valéry dans ses cahiers. Garneau étudie Valéry dans son journal (Oe, 428-429), et d’une façon systématique qui rappelle fortement la manière de l’auteur des Cahiers. Dans ceux-ci, la forme, comme chez Montaigne et chez Joubert, relève d’abord d’une expérimentation donnée pour elle-même. Le lecteur n’est pas devant un résultat, mais devant un processus. De plus, comme chez Garneau, les cahiers de Valéry accueillent aussi bien des réflexions que de la poésie, des « petits poèmes abstraits », des passages de « poésie brute » ou « poésie perdue », ainsi que les dénomme Valéry, qui produisent de semblables effets de rupture et de transposition[17].
Même s’il évoque Montaigne et Valéry dans ses cahiers, Garneau ne s’en réclame pas. En fait, il se démarque de Montaigne lorsqu’il en parle, en citant la fameuse condamnation de Pascal (Oe, 330), et il ne semble pas avoir eu connaissance de la pratique des cahiers par Valéry, ni des écrits de Joubert, à l’exception d’une « pensée » (Oe, 722) glanée dans sa jeunesse. Garneau découvre en écrivant une dynamique textuelle particulière, faite de reprises, de déplacements ou d’extensions de registres ; de cette expérience naissent des motifs récurrents tels que le dédoublement et ultimement la forme fictionnelle singulière du « mauvais pauvre ». Comme chez Montaigne, chez Joubert et chez Valéry dans ses cahiers, l’écriture reste toujours dans un entre-deux qui met en relation les fondements de l’écriture et des résultats toujours partiels et provisoires.
Dans la littérature française contemporaine, Philippe Jaccottet est sans doute l’un des continuateurs les plus marquants de la pratique des cahiers et carnets pour eux-mêmes et non en tant que discours marginal ou avant-textes. À ma connaissance, il n’a jamais parlé de Garneau et il ne l’a sans doute pas lu, tant la présence de Garneau dans le « grand contexte » fut discrète et épisodique. Mais l’oeuvre de Jaccottet présente de grandes similitudes avec celle de Garneau. En plus de nombreux recueils de poèmes, d’un récit, d’essais critiques et de plusieurs traductions, Jaccottet publie, à partir de 1963, la série La semaison, très proche de l’esprit et de la forme du journal de Garneau, à la différence que Jaccottet a lui-même décidé de la publication de ces textes. L’auteur a fortement élagué ses carnets, mais on y trouve malgré tout le même désordre que chez Garneau, le même côtoiement des méditations en prose et des vers, ainsi que la même attention aux paysages, la même attitude critique à l’égard de ses propres écrits et le même intérêt pour les autres arts. Jaccottet prend davantage de distance à l’égard du journal intime classique, puisqu’il s’agit d’abord de sortir de soi, et il se situe bien sûr par rapport à d’autres esthétiques lorsqu’il évoque la littérature contemporaine. Mais on observe dans La semaison, comme dans les cahiers de Garneau, la notation d’images qui valent pour elles-mêmes, c’est-à-dire non pas en tant que matériaux pour l’édification d’une oeuvre, mais comme émergence de l’art dans l’existence. En voici un exemple de l’année 1972 :
AVRIL
Le baume inutile des arbres.
(Il m’arrive de le haïr, et tout le baume poétique, par moments.
Celui-ci, en tout cas, insupportable à moins d’une qualité très haute,
extrêmement rare.
C’est se condamner soi-même ; peut-être aussi faire un pas en avant, ou
le permettre, y aider ?)
MAI
Ceux que le soleil ne parvient pas à réchauffer, qui marchent dans l’été
comme une frêle brassée d’os.
Une cage d’os, branlante, où il n’y a presque plus de feu.
Le feu soufflé dans la lanterne d’os.
*
Gottfried Benn. Il est curieux de voir, à travers la version française, inégale, comment il a passé d’un expressionnisme funèbre à une sorte de cubisme […][18].
En plus des motifs de l’arbre et de la cage d’os qui rappellent très directement l’écriture de Garneau, on remarque au départ une semblable association entre la nature, la poésie et soi-même sous le signe de la critique, puis l’émergence de l’image de la cage d’os, renvoyant ici à des personnes qui rappellent le mauvais pauvre ; apparaît ensuite, brusquement, le commentaire analytique d’une lecture. Cette construction par fragments met en valeur l’intensité de moments séparés plutôt qu’un discours d’ensemble ou une forme générique stable qui les surplomberait. Les cahiers de Garneau, comme les essais de Montaigne, les carnets de Joubert, les cahiers de Valéry ou La semaison de Jaccottet, montrent l’invention jamais achevée, jamais vraiment instituée d’une forme inséparable de son support même, d’un texte qui se situe en deçà de la figure idéale du Livre, et cependant au delà des conventions de la littérature.
Appendices
Note biographique
François Dumont est professeur titulaire au Département des littératures de l’Université Laval, où il dirige le Centre Hector-De Saint-Denys-Garneau. Il a publié des ouvrages et des articles portant principalement sur la poésie et sur l’essai, des poèmes et, avec Michel Biron et Élisabeth Nardout-Lafarge et la collaboration de Martine-Emmanuelle Lapointe, une Histoire de la littérature québécoise (Montréal, Boréal, 2007 ; 2010). Il a récemment supervisé une nouvelle édition du Journal (1929-1939) de Saint-Denys Garneau (Québec, Nota bene, coll. « Cahiers du Centre Hector-De Saint-Denys-Garneau, 2012).
Notes
-
[1]
Saint-Denys Garneau, Oeuvres (édition de Jacques Brault et Benoît Lacroix), Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Bibliothèque des lettres québécoises », 1971, p. xii, note 7. Dorénavant désigné à l’aide des lettres Oe, suivies du numéro de la page.
-
[2]
La première édition du journal (d’où ont été retranchés les poèmes, les lettres et plusieurs passages), réalisée par Robert Élie et Jean Le Moyne, est parue en 1954 chez Beauchemin, avec une préface de Gilles Marcotte. L’édition critique de Jacques Brault et Benoît Lacroix, publiée en 1971 aux Presses de l’Université de Montréal, place les poèmes et les lettres du journal dans des sections distinctes. Le premier tome de l’édition critique de Giselle Huot, Oeuvres en prose, paru en 1995 chez Fides, reporte la publication des poèmes et des lettres du journal aux deux tomes à venir. L’édition de poche du journal parue chez BQ en 1996 reprend l’édition partielle de Giselle Huot. Une nouvelle édition intégrant tous les textes du journal dans leur succession originale, préparée au Centre Hector-De Saint-Denys-Garneau de l’Université Laval, vient de paraître (Hector de Saint-Denys Garneau, Journal 1929-1939, Québec, Nota bene, coll. « Cahiers du Centre Hector-De Saint-Denys-Garneau », 2012).
-
[3]
Vincent Kaufmann, L’équivoque épistolaire, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1990, p. 26.
-
[4]
Michel Biron, L’absence du maître. Saint-Denys Garneau, Ferron, Ducharme, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Socius », 2000, p. 69.
-
[5]
Frédérique Bernier, La voix et l’os. Imaginaire de l’ascèse chez Saint-Denys Garneau et Samuel Beckett, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Espace littéraire », 2010, p. 35.
-
[6]
Paul Éluard, Donner à voir, dans Oeuvres complètes I, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1968, p. 980.
-
[7]
Sur le caractère fondamental de cette figure dans l’oeuvre de Garneau (et de Beckett), voir Frédérique Bernier, op. cit.
-
[8]
Robert Melançon, « Lire, cette pratique… lecture de “Un bon coup de guillotine” de Saint-Denys Garneau », dans François Dumont et Andrée-Anne Giguère (dir.), Saint-Denys Garneau en revue, Québec, Presses de l’Université du Québec ; Montréal, Revue Voix et images, coll. « De vives voix », 2011, p. 292.
-
[9]
Garneau résume en ces termes le passage de l’expérience de l’art à l’esthétique dans ses commentaires sur une exposition de peintures chinoises, japonaises et tibétaines : « Déformer légèrement une forme par notre intrusion à l’intérieur, puis la reformer à l’aide d’elle-même dans sa rigueur » (Oe, 449).
-
[10]
Voir par exemple le texte qui suit immédiatement dans le dernier cahier retrouvé (Oe, 575-577) et une esquisse de 1935 qui a pour titre « Destructeur. Analyse » (Oe, 385-387). La stratégie est la même, sur un mode plus euphorique, dans « Propos sur l’habitation du paysage » (Oe, 674-676).
-
[11]
La figure du « mauvais pauvre », par la diversité des discours qu’elle convoque (la parabole du « mauvais riche » de l’Évangile, les discours sur la crise économique récente, le chapitre « Le mauvais pauvre » des Misérables de Hugo, le poème « Le bon pauvre » d’Alfred Garneau, etc.), opère une semblable traversée des genres. Sur ce réseau intertextuel, voir Pierre Popovic, « Littérature et sociocritique au Québec : horizon et points de fuite », dans François Dumont et Louise Milot (dir.), Pour un bilan prospectif de la recherche en littérature québécoise, Québec, Nuit blanche éditeur, coll. « Séminaires », 1993, p. 213 et suivantes. Dans une analyse ultérieure du même texte, Popovic l’identifie au genre de l’« autofiction délibérative » (« Saint-Denys Garneau, celui qui s’excrit », Études françaises, vol. XXX, no 2, automne 1994, p. 112).
-
[12]
Voir Alain Girard, Le journal intime, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Dito », 1986, p. 20-29, et Béatrice Didier, Le journal intime, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Littératures modernes », 1976, p. 31-35.
-
[13]
Béatrice Didier, op. cit., p. 32.
-
[14]
L’expression est de Jean-Louis Major. Chez Garneau, écrit-il, c’est « par rapport à la forme même du Journal comme structure englobante, que se détermine le sens du projet d’écriture », « Saint-Denys Garneau ou l’écriture comme projet de soi », Voix et images, vol. XX, no 1, 1994, p. 22.
-
[15]
Michel de Montaigne, « Des livres », dans Les Essais, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2007, p. 427 et 429.
-
[16]
Maurice Blanchot, Le livre à venir, Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1959, p. 76.
-
[17]
À l’instar des vers qui figurent dans le journal de Garneau, ces poèmes sont radicalement transformés par leur soustraction de l’ensemble des Cahiers, comme on le voit dans l’édition de Michel Jarrety : Poésie perdue. Les poèmes en prose des Cahiers, Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 2000.
-
[18]
Philippe Jaccottet, La semaison. Carnets 1954-1979, Paris, Gallimard, 1984, p. 177-178.