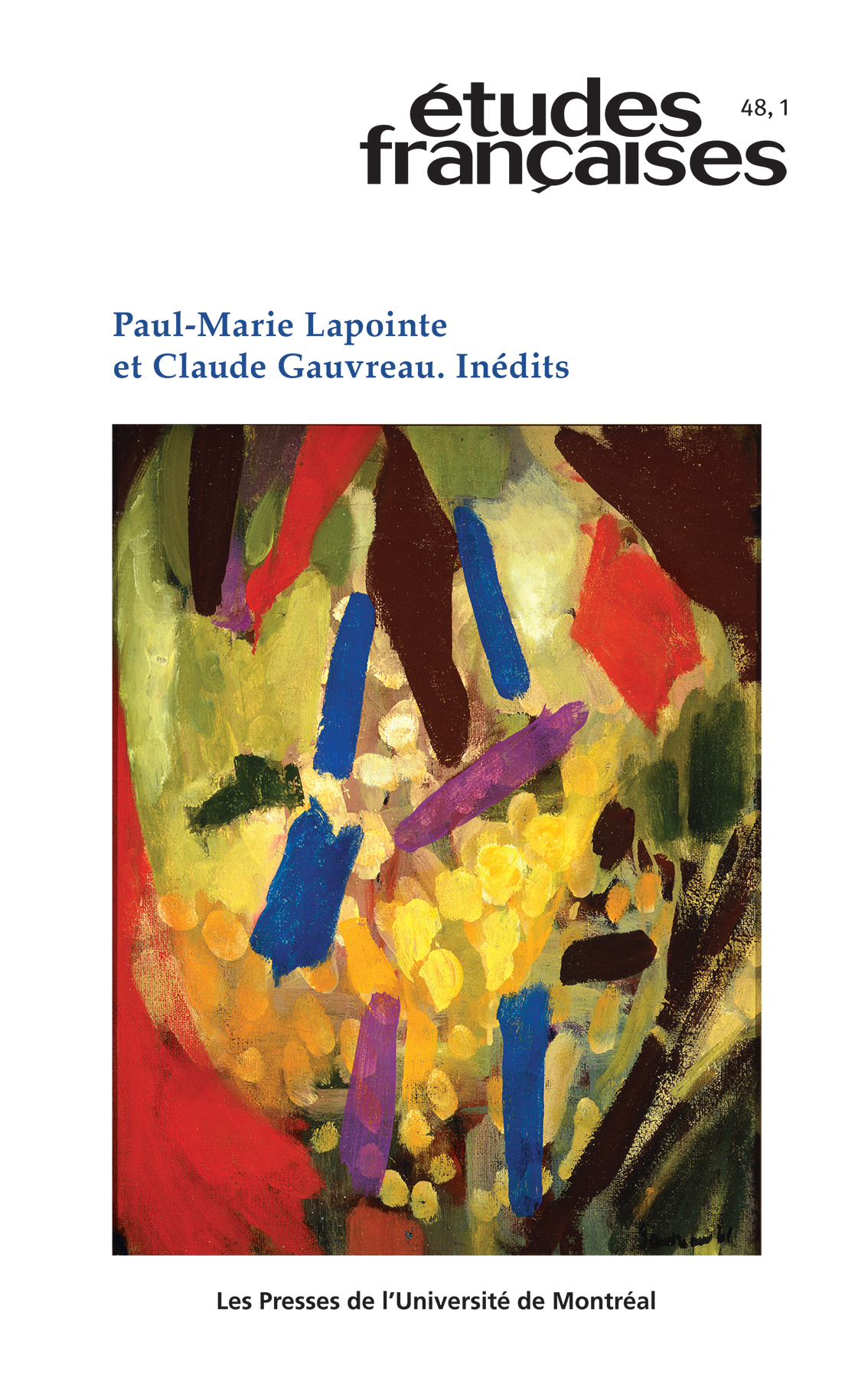Abstracts
Résumé
Dans ce texte, Pierre Nepveu explore l’univers foisonnant, que ce soit en arbres, en fleurs, en animaux ou en hommes, de la poésie de Paul-Marie Lapointe, une poésie porteuse d’une vision du monde, non pas théorique ou abstraite, mais portée par l’écriture. Celle-ci se soutient de deux grands récits, l’un de nature cosmologique, l’autre de nature sociale. Le récit cosmologique dit que nous nous inscrivons, comme humains, dans le grand cycle qui régit les espèces et jusqu’aux astres les plus lointains, un cycle de vie et de mort, de fertilité et de désolation, de création et de destruction. Le récit social, qui lui est complémentaire, consiste à dire que dans ce grand cycle auquel personne n’échappe, se joue un perpétuel et fatal combat entre les puissants et les faibles, entre les détenteurs du pouvoir et les « petits hommes ». Ces deux récits concomitants donnent à la poésie de Lapointe, profondément ancrée dans le monde contemporain, sa couleur archaïque et mythologique. Ce qui étonne dans ce mariage poétique du social et du cosmique, de l’économie politique et de l’économie naturelle, c’est à quel point il annonçait dès les années 1960 un grand récit qui allait devenir hégémonique dans les décennies suivantes et qui est plus prégnant qu’aucun autre aujourd’hui : celui de l’écologie. Pierre Nepveu constate ainsi combien Le réel absolu et L’espace de vivre, par la vaste écologie humaine, sociale et naturelle à laquelle ils convient, se distancient d’une conception anthropologique de la culture et d’une vision du monde fondée sur l’identité nationale.
Abstract
In this text, Pierre Nepveu explores the universe of Paul-Marie Lapointe’s poetry in all its profusion, whether in trees, flowers, animals or man, a poetry that declares a vision of the world that is neither theoretical nor abstract yet flowers in writing. This poetry is formed on two great narratives, one cosmological in nature, the other social. The cosmological narrative declares that we humans are part of a cycle of life and death, of fertility and decline, creation and destruction. The social narrative, which is complementary, states that in this grand cycle escaped by no one, an endless and fatal combat plays out between the powerful and the weak, between the wielders of power and the “little man”. These concomitant tales give Lapointe’s poetry its archaic and mythological essence rooted in the contemporary world. What is astounding in this poetic wedding of the social and the cosmic, the political and the natural economy, is the extent to which, starting in the 1960s, it presaged an ultimately dominant and more pregnant narrative than all others today : that of ecology. Pierre Nepveu thus observes how Le réel absolu and L’espace de vivre, with its vast human, social and natural ecology, retreat from an anthropological conception of culture and a vision of the world based on national identity.
Article body
Il m’arrive souvent de rouvrir au hasard l’un des deux livres de Paul-Marie Lapointe qui rassemblent pour l’essentiel son oeuvre, désormais achevée non par sa volonté mais par la seule force du destin : Le réel absolu et L’espace de vivre. L’expression « rouvrir au hasard », l’un des grands bonheurs de toute bibliothèque, prend ici tout son sens, car il y a peu d’oeuvres qui soient moins déterministes, moins linéaires que celle de l’auteur du Vierge incendié, et qui soient dès lors aussi lisibles par fragments. Dans le livre inaugural de 1948, je tombe sur la fin de tel poème, le premier d’une section qui a pour titre « Il y a des rêves… » : « Yeux fermés pour somnoler le ventre sur un caillou digitale ronde de portée sans bémols musique un doigt dans la bouche de velours[1]. » Toute la page a convoqué une incroyable faune bigarrée : chiens, ourson, caméléons, tortue, papillons, guêpes, poissons. Cette abondance est déjà en elle-même une joie, mais dans ce monde souvent surpeuplé, fourmillant, pléthorique, que ce soit en arbres, en fleurs, en animaux ou en hommes, il y a aussi ces soudaines plages de repos, ces îlots où il fait bon s’abandonner au seul plaisir d’être. Et pourtant je demeure étonné, perplexe : « le ventre sur un caillou », est-ce si confortable et ne souhaiterait-on pas à tout le moins une grande pierre ? Et cette fleur étrange, qui ressemble à une note musicale, mais qui évoque aussi un doigt suçoté doucement, satisfaction primaire dont la connotation peut être aussi bien enfantine qu’érotique ? Mon bonheur de lecture, je choisis de le conclure dans cette scène délicieuse et un peu coquine, qui semble avoir d’un seul coup, et sans raison apparente, fait taire la bruyante ménagerie qui s’agitait dans le poème.
Cela est, cela doit être. Es muss sein, écrivait Beethoven en marge de l’un de ses derniers quatuors à cordes. La poésie de Lapointe trouve là son allégresse, mais aussi sa gravité, sachant toujours qu’il n’y a de bien-être qui ne couve une inquiétude, de fécondité qui ne soit soeur de la destruction et de la mort. Même dans son poème sans doute le plus connu, « Arbres », si merveilleusement généreux en espèces et en usages, il y a ce passage dissonant, un autre de ces fragments qui semblent vivre de manière autonome à même l’ampleur du long poème :
RA, 173j’écris arbre
arbre pour le thorax et ses feuilles
arbre pour la fougère d’un soldat mort sa mémoire de calcaire et l’oiseau qui s’en échappe avec un cri
Si la douceur et le repos peuvent se donner soudain au milieu du chaos et du carnage, l’inverse est vrai et c’est parfois toute une histoire de guerre et de destruction qui refait surface au coeur de la plus belle exubérance. Rien n’est raconté mais il suffit d’un frémissement végétal pour que l’idée d’une inhumation ancienne se présente, la remontée d’une « mémoire » enfouie jusqu’aux racines — et pour que l’effroi suscité, ce sentiment si caractéristique de la poésie de Lapointe, se fasse entendre dans l’envol strident d’un oiseau.
De tels fragments, parmi des milliers d’autres possibles, donnent l’impression que chaque détail de l’oeuvre reproduit en miniature l’oeuvre entière, comme dans ces images fractales où le motif général réapparaît à petite échelle au niveau des parties. Cela tient sans doute à la forme même de la poésie de Lapointe et à son aptitude à être, plus qu’aucune autre, totalement présente à elle-même à chaque instant. Mais il s’agit tout autant d’une vision du monde, non pas théorique ou abstraite, mais portée par l’écriture. Si peu narrative soit-elle, celle-ci se soutient de deux grands récits, l’un de nature cosmologique, l’autre de nature sociale. Le récit cosmologique dit que nous nous inscrivons, comme humains, dans le grand cycle qui régit les espèces et jusqu’aux astres les plus lointains, un cycle de vie et de mort, de fertilité et de désolation, de création et de destruction. Le récit social, qui lui est complémentaire, consiste à dire que dans ce grand cycle auquel personne n’échappe, se joue un perpétuel et fatal combat entre les puissants et les faibles, entre les détenteurs du pouvoir et les « petits hommes ».
Ces deux récits concomitants, tous deux d’un grand schématisme, donnent à la poésie de Lapointe, profondément ancrée dans le monde contemporain, sa couleur archaïque et mythologique. Robert Melançon a bien vu que la cosmologie du poète relève d’une « érotique générale[2] » qui anime les êtres et les astres d’un même mouvement d’attraction et qui rappelle Dante et même Lucrèce. Belle simplicité, belle universalité de ce modèle qui affirme que tout est désir. Mais le récit social qui habite, pour ainsi dire, cette cosmologie, n’est pas moins simple et « général ». Dans son analyse très fouillée de « Psaume pour une révolte de terre » (RA, 207-212), paru d’abord dans un des premiers numéros de la revue Parti pris à l’automne 1963, Michel Biron observait que « le socialisme inscrit dans le poème […] n’est pas moins rudimentaire que celui de la revue[3] ». L’épithète peut sembler péjorative, mais elle l’est sans doute davantage à l’égard de Parti pris que du poète lui-même. La force de Lapointe a précisément toujours été de maintenir une simplicité fondamentale du social et du politique : le foisonnement du monde, dans son incessante prolifération d’« espèces fragiles », est parcouru de tout temps par le grand courant maléfique de la domination, de l’exploitation, par la perpétuelle captation de la proie par le prédateur. On aurait pu croire que l’hégémonie de la vision cosmologique confinerait Lapointe à une sorte de fatalisme réduisant le combat social à une loi naturelle qui assure à jamais la suprématie du loup sur le mouton, du lion sur l’antilope. Il n’en est rien et ce n’est pas la moindre beauté de sa poésie que de faire entendre, sous sa grande valse cosmique, une sourde et incessante indignation. « En ces temps terribles/la terre me pèse » (EV, 86), écrit le poète, et on peut être sûr que ce recours, rare chez lui, à la première personne n’est pas réductible à un simple accablement. En réalité tous les temps sont terribles, toutes les époques sont scandaleuses, « l’éternité n’étant que l’écoulement du fric dans la besace à trous […]/l’amoncellement catastrophique des galaxies dans les coffres de la divinité » (EV, 85).
L’indignation qui s’exprimait en 1974 dans ces vers de « Voyages et autres poèmes » montre à quel point la vision cosmologique et la vision sociale sont ici indissociables. Il n’en sera pas autrement dans Le sacre, où l’apparente légèreté ludique des permutations à l’infini (il y aurait, note Lapointe en avant-propos, « 3 628 800 d’anagrammes » en puissance dans le seul mot « tabarnacos », EV, 206), laisse affleurer de loin en loin une dénonciation plus directe et rageuse encore que ne l’affichaient les recueils précédents. Ainsi dans « Tao scabran » :
EV, 438Scabreux aberrant,
le Capital,
ayant soumis l’État
le Peuple et ses Dieux,
poussant devant lui
son globe d’excréments,
se croit le Tao
et Scarabée sacré
Tout l’univers poétique de Lapointe est parasité par de telles figures du pouvoir : riches et rois, idoles et grands seigneurs, maîtres et conquérants, Capital et bombardiers — mais son originalité est de voir dans ces figures de l’unicité dominante un véritable appauvrissement cosmique, sur le double mode du gaspillage et de la thésaurisation, ce qui finit par revenir au même. Le vrai scandale de toutes les époques, c’est ce qui prétend réduire, voire abolir, la formidable prolifération des êtres et des espèces, c’est l’absurde projet de mettre les galaxies dans des « coffres ». De ce point de vue, la puissance du fragment, chez Lapointe, est une réponse proprement poétique, voix de l’abondance et du multiple, à un appauvrissement toujours possible de notre monde.
Ce qui étonne, dans ce mariage poétique du social et du cosmique, de l’économie politique et de l’économie naturelle, c’est à quel point il annonçait dès les années 1960 un grand récit qui allait devenir hégémonique dans les décennies suivantes et qui est plus prégnant qu’aucun autre aujourd’hui : à l’évidence, c’est celui de l’écologie. Lapointe a été le premier, dans la poésie québécoise, à parler de la terre entière comme un objet de soins et d’amour, à écrire : « planète/nous adorons parler de toi/ainsi que de tes habitants » (RA, 258). Aussi bien « l’érotique générale » dont parlait Robert Melançon que le « socialisme rudimentaire » évoqué par Michel Biron signifiaient du même coup — et les deux lecteurs l’ont bien vu — le refus d’une vision du monde fondée sur l’identité nationale. Sans prétendre nier en aucune manière que les références québécoises soient fortes de bout en bout et sur tous les plans dans la poésie de Lapointe, ce qui serait absurde, il faut constater combien Le réel absolu et L’espace de vivre se distancient de toute conception anthropologique de la culture, qui consiste à saisir chaque société comme un ensemble organisé et relativement cohérent de pratiques et de signes. Ce modèle a joué un rôle essentiel dans la pensée québécoise moderne, au moment même où l’oeuvre de Lapointe prenait son envol et s’affirmait. C’est ce modèle qui a permis d’interpréter l’histoire des Canadiens français comme celle d’un « nous » dépossédé de lui-même, exilé de son lieu propre, privé de sa cohérence, de son adéquation à soi — et, par conséquent, à envisager son destin sous le signe d’une reconquête, d’une réintégration, emblématisées par le terme de « Québécois » qu’aura imposé notamment la revue Parti pris.
Lapointe, que je sache, n’a jamais cherché à discréditer ce grand récit québécois, mais on aurait bien du mal à trouver des traces de celui-ci dans sa propre pratique de poète comme d’ailleurs dans ses rares interventions sous la forme de courts articles ou d’entrevues. Ironiquement, l’autre aspirant le plus légitime au titre de « plus grand poète québécois », et l’un des plus fervents porte-parole du modèle anthropologique, Gaston Miron, ne cessait d’affirmer que c’était Lapointe qui était « le plus grand » ! Si ce genre de compétition ou de classification me paraît futile, particulièrement lorsqu’il s’agit à l’évidence de deux poètes majeurs, le choc des visions du monde n’en est pas moins notable. À travers la poésie de Lapointe se profile un récit qu’il est facile de négliger et d’occulter, parce que l’auteur du Réel absolu n’a jamais cru bon de l’articuler et de le théoriser et qu’il s’est contenté, sans doute par tempérament, de laisser parler ses poèmes.
Le modèle cyclique n’est pas chez lui un pur désespoir historique, malgré le fait que la répétition en soit une composante essentielle. Il suppose plutôt une vaste écologie humaine, sociale et naturelle, dans laquelle la diversité (on dirait aujourd’hui la « biodiversité ») exclut toute prétention univoque à l’unité et à l’homogénéité. Il n’y a pas « l’arbre », figure de l’enracinement et de la montée vers la lumière, il y a des individus arbre, innombrables, irréductibles l’un à l’autre aussi bien dans leurs formes que dans leurs emplois. Leur pluralité n’est pas une tare, quelque indice d’une fragmentation mortelle ; elle est la texture même de notre monde et de notre conscience. À cet égard, l’évocation de Lucrèce par Robert Melançon ne saurait être plus pertinente. Philosophe du multiple, de l’infinie fécondité créatrice de l’univers, le poète-philosophe épicurien ne peut que trouver aberrante toute idée d’un centre, quel qu’il soit, mais chose encore plus intéressante pour le poète Lapointe, il conçoit la multiplicité comme une combinatoire illimitée à partir d’un nombre discret d’éléments. Dans un passage célèbre de son livre De la nature, il explique que l’extraordinaire diversité des formes et des espèces à partir d’un nombre réduit d’atomes ne devrait pas étonner davantage que la fécondité de la langue elle-même, capable de produire une multitude de mots en combinant une quantité très limitée de lettres organisées chaque fois dans un ordre différent[4]. Entre les « arbres » de Lapointe et l’extraordinaire dissémination de ses « tabarnacos », la même intuition se manifeste : le monde et le langage relèvent d’une commune combinatoire qui est aussi une logique de l’expansion, à la mesure même des constellations.
Mais l’affirmation et la pratique de ce pluriel sans limites ne risquent-elles pas de devenir univoques, d’instaurer une nouvelle hégémonie ? Le multiple peut être loufoque, hilarant même, comme le montrent les listes de permutations du vocable « Acapulco » dans Le sacre. Mais l’exubérance de la prolifération sans limites ne porte-t-elle pas en elle-même quelque chose d’assez inquiétant, voire de monstrueux ? La sagesse écologique de Lapointe lui commande de ne jamais s’abandonner une fois pour toutes à la griserie de l’expansion incontrôlée, à une religion du multiple. Il faut toujours revenir à la terre et au singulier et peu de motifs chez lui sont aussi émouvants à mes yeux que celui de l’exhumation, inséparable de son contraire, la mise en terre :
RA, 213chaque jour une terre assassinée ensevelit ses hommes
soleil tonitruant
jaloux des espèces différentes
et du tournoiement des veuves faibles
Ces vers de Pour les âmes disent bien qu’il y a toujours quelque part un « soleil », un tyran étincelant, jaloux de son pouvoir, et prêt à tout pour abolir la bio- et, devrait-on dire, l’anthropodiversité. Mais comme la « fougère » du « soldat mort » dormant dans le « calcaire » et d’où s’envole un oiseau criard, l’ensevelissement ne va jamais sans une remontée possible, une sorte de retour archéologique dont une des plus belles expressions se trouvait, en un raccourci éblouissant, parmi les « Courtes pailles » du même recueil :
RA, 234Dans la glaise l’amante ancienne et blanche
dans le calcaire l’espace tendre de ses os
dans le plumage d’un oiseau
une planète de frissons
Si le multiple peut être l’objet d’un assassinat, on ne saurait en faire l’apologie sans repartir du singulier, sans déterrer celui-ci, littéralement, de telle sorte qu’il renaisse, « planète de frissons ».
À partir des Tableaux de l’amoureuse dont fait partie « Art égyptien », le motif de l’exhumation devient de plus en plus insistant chez Lapointe. Parce qu’elle est « brune », la jeune fille peinte par Gisèle Verreault a « un visage de lanterne sourde/ô beau visage surgi de la sombre terre » (EV, 42) et l’amant lui-même, enfoui dans quelque déréliction, se voit réveillé par le foisonnement irrépressible de la femme « une » et multiple : « mille amoureuses m’extraient de la mort/me tirent de la terre//mille amoureuses toujours la même » (EV, 51). De telles images semblent préparer la série des statuettes et figurines déterrées qui, d’« Art égyptien » à Espèces fragiles, hantent cette poésie : vieux couple anonyme, chancelier puissant, concubine, maître ou esclave, « homme de peine » tout juste exhumé, « petit homme d’argile seul et nu/jeté là dans le paysage vide » (EV, 525). Alors que le grand récit anthropologique québécois a le plus souvent adopté la forme d’un voyage horizontal, d’une rentrée d’exil qui est un retour au pays, le « récit » de Lapointe a toujours privilégié l’axe vertical : enfouissement et remontée, enterrement et envol. Il est révélateur que les itinéraires mexicains, dans Le sacre, à travers des villes et villages qui recomposent, par la lettre initiale de leur nom, le mot « tabarnacos », fassent ressurgir non seulement toute une mémoire historique et politique, mais aussi le motif même de la figurine arrachée (et rendue) à la terre. Ainsi en est-il, à la faveur d’un savoir philologique (« argile » se dit « arcilla » en espagnol) qui contamine le nom d’une petite ville se trouvant sur l’un de ces itinéraires :
EV, 340Arcelia.
N’oublions pas ce lieu,
ce nom à la sonorité d’argile (arcilla),
surgi telle une figurine
du sol du Guerrero,
loin des ruines impériales
Cette fois, aucun envol mais plutôt une boucle qui rend cet « objet » à sa provenance, sans autre but que de lui faire « accompagner/dans la terre qui le recèle/les morts que l’on aima ». Cet « objet », n’oublions pas que c’est ici en réalité un mot, un simple assemblage de lettres : entre l’humus où dorment les morts et le scintillement des astres dans les lointains du ciel, tel est le territoire du langage et de la poésie, magnifique combinatoire, incessant recyclage de ce qui a vécu et perpétuel avènement de ce qui veut se multiplier.
*
Le concept d’« américanité », souvent accolé avec raison à l’oeuvre de Lapointe, n’est pas suffisant pour rendre compte de sa démarche, pas plus que pour l’oeuvre d’un artiste comme René Derouin. Je vois une parenté profonde entre ces deux artistes si différents l’un de l’autre. Parmi leur génération, ils ont en commun d’avoir pour territoire une géographie qui va du nord jusqu’au Mexique, de la neige aux tropiques, mais cette géographie est aussi un cosmos, régi par le foisonnement, la multiplicité, le mouvement incessant. Tout comme Lapointe, Derouin n’oublie pas que la diversité des espèces et du petit peuple risque toujours d’être soumise à une oppression tyrannique. Dans son installation « Place publique », les lutrins dominant la place où évolue la multitude des petits personnages rappellent que les humains en migration peuvent toujours se trouver soumis à des discours hégémoniques, dont les valeurs sont souvent celles de la cohésion et de l’unité. Les innombrables figurines de Derouin dans l’une de ses oeuvres les plus ambitieuses, Migrations, ne sont pas sans évoquer l’univers foisonnant de Lapointe : chez les deux créateurs, le pluriel est fait de singularités, d’individualités. Chez les deux aussi, l’acte créateur est inséparable à la fois d’une mémoire des profondeurs, d’une conscience archéologique, et d’une insertion de la culture dans les grands cycles naturels.
Dans cette vision qui lie le langage et le geste au cosmos, nous sommes certes de « petits hommes », mais cela n’empêche ni Lapointe ni Derouin de nourrir un commun radicalisme. Par un étonnant paradoxe, leur humilité est inséparable d’un désir extrême de dépense, dont l’entreprise de « largage » est chez Derouin la forme apparemment la plus insensée, la moins recevable, comme en témoigne notamment le « refus » qu’a exprimé Pierre Vadeboncoeur à ce sujet[5]. Derouin, on le sait, après avoir présenté Migrations au Museo Rufino Tamayo de Mexico puis au Musée du Québec, décidait en 1994 de larguer les 19 000 figurines de cette installation en divers endroits du Saint-Laurent allant de l’île Sainte-Hélène, en face de Montréal, jusqu’à l’Isle-aux-Coudres, dans Charlevoix. Cet engloutissement se voulait aussi un rituel funéraire, le père et l’un des frères de l’artiste étant morts noyés accidentellement dans le Saint-Laurent.
Je ne suis pas loin de voir aussi une forme de « largage » dans les zones les plus radicales de l’oeuvre de Lapointe, écRiturEs et, pour une part, Le sacre. Quelque part, la création doit se mesurer à son contraire : destruction de l’objet, annihilation du sens. Il y a là comme l’imitation d’un processus naturel dans lequel le « gaspillage » des mots et des formes dessaisit le créateur de son oeuvre, comme le suggérait la critique d’art Jocelyne Connolly à propos de Derouin[6], et le resitue dans une vaste écologie humaine et cosmique. Il n’y a plus de centre, plus de lieu, plus de retour chez soi : mais c’est dans ce foisonnement du monde, dans cette perpétuelle migration des êtres et des formes, dans cette dépense insensée des espèces qui ne cessent d’advenir et de mourir que « chaque jour, étonné, [on] reprend terre » (RA, 259).
Appendices
Note biographique
Triple lauréat du Prix du Gouverneur général, Pierre Nepveu a enseigné les lettres à l’Université de Montréal. Il a publié plusieurs recueils de poésie (dont Lignes aériennes, Montréal, éditions du Noroît, 2002 et Les verbes majeurs, Montréal, éditions du Noroît, 2009), des romans (L’hiver de Mira Christophe, Montréal, Boréal, 1986, Des mondes peu habités, Montréal, Boréal, 1992), des essais (notamment L’écologie du réel. Mort et naissance de la littérature québécoise contemporaine, Montréal, Boréal, 1988, Intérieurs du Nouveau Monde. Essais sur les littératures du Québec et des Amériques, Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 1998, et Lectures des lieux. Essais, Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 2004) ainsi qu’une biographie de Gaston Miron (Gaston Miron. La vie d’un homme, Montréal, Boréal, 2011). Pour l’ensemble de son oeuvre, il a reçu le prix Athanase-David en 2005 et l’Ordre du Canada en 2011.
Notes
-
[1]
Paul-Marie Lapointe, Le réel absolu. Poèmes 1948-1965, Montréal, l’Hexagone, 1971, p. 103. Dans la suite de mon texte, les citations tirées de ce livre sont simplement suivies du sigle RA et du numéro de la page. Il en est de même pour la rétrospective postérieure de Lapointe, L’espace de vivre. Poèmes 1968-2002, Montréal, l’Hexagone, 2004, identifié par le sigle EV.
-
[2]
Robert Melançon, Paul-Marie Lapointe, Paris, Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui », 1987, p. 55.
-
[3]
Michel Biron, « Idéologie et poésie : un poème de Paul-Marie Lapointe », Voix et images, vol. 14, nº 1, automne 1988, p. 109. C’est moi qui souligne.
-
[4]
Car les mêmes atomes qui forment le ciel, la mer, les terres, les fleuves, le soleil, forment également les moissons, les arbres, les êtres vivants ; mais les mélanges, l’ordre des combinaisons, les mouvements diffèrent. Ainsi, à tout endroit de nos vers mêmes, tu vois une multitude de lettres communes à une multitude de mots, et pourtant, il te faut bien reconnaître que vers et mots diffèrent et par le sens et par le son ; tel est le pouvoir des lettres par le simple changement de leur ordre.
Lucrèce, De la nature, traduction d’Alfred Ernout, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1990, p. 50 -
[5]
Voir Pierre Vadeboncoeur, « La cathédrale à demi engloutie », dans René Derouin, Ressac. De Migrations au largage, Montréal, l’Hexagone, 1996, p. 235-239.
-
[6]
Voir Jocelyne Connolly, « Forme et contexte pour un monument : Migrations », dans René Derouin, op. cit., p. 169-221.