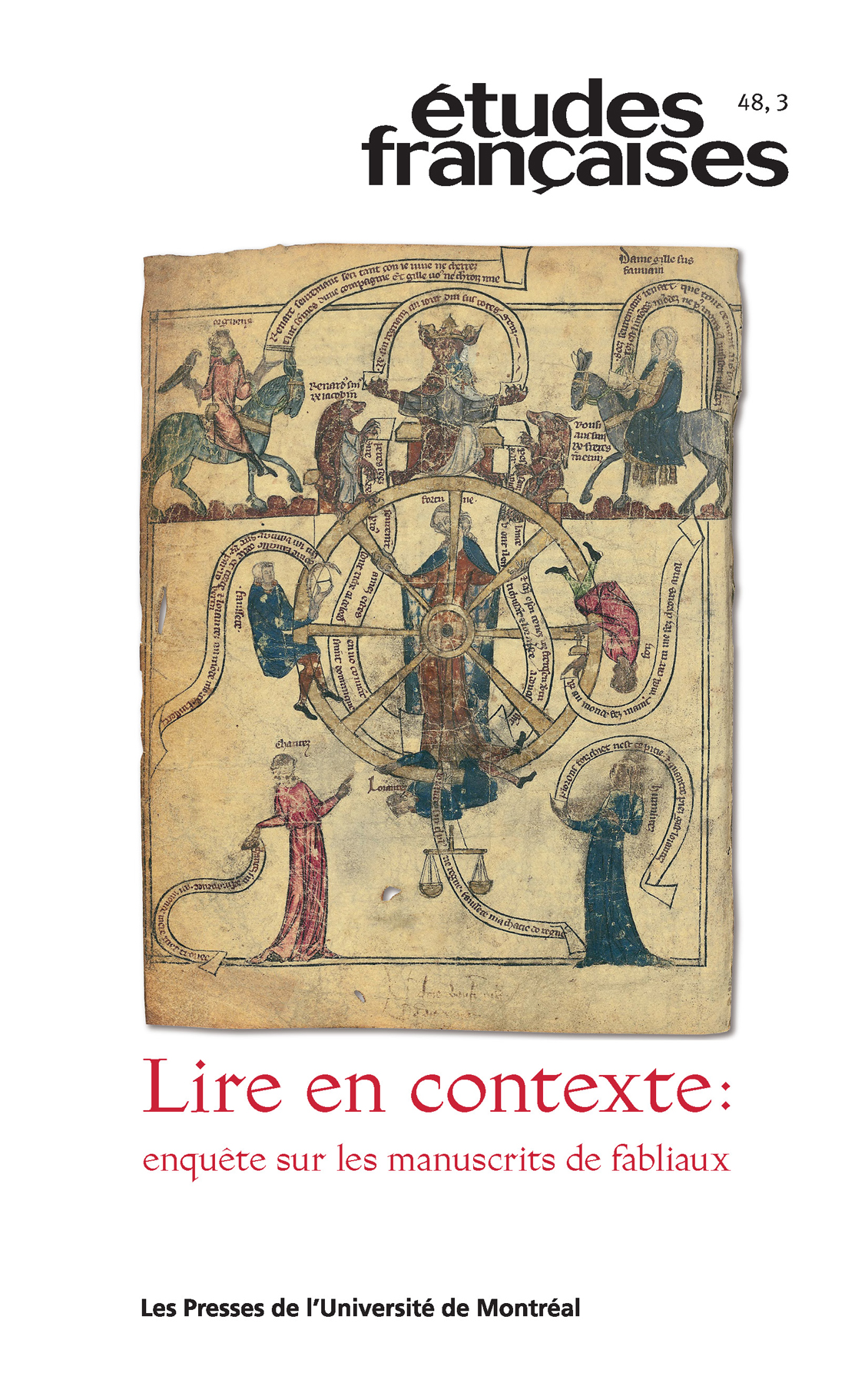Abstracts
Résumé
Lorsqu’on s’attache à un corpus de manuscrits pour dégager le sens de la présence et de la distribution des représentants d’un genre narratif, il convient, au préalable, de situer précisément dans le temps et dans l’espace, ainsi que dans le contexte socioculturel, chaque élément du corpus. À cette fin, le chercheur est amené à battre plusieurs pistes, suivant les cas. L’exemple du manuscrit L.II.14 de la Biblioteca Nazionale Universitaria deTurin — un recueil attachant, qui soude avec désinvolture quelques cycles épiques majeurs à l’histoire sacrée — montre que la lecture des textes, l’exploration des traditions manuscrites et la mise à contribution des résultats obtenus dans d’autres domaines d’études permettent de formuler des hypothèses fondées à ce sujet. À partir de cette assise, même provisoire, l’interprétation de la présence, de la position et du profil des fabliaux dans le recueil se fait moins arbitraire et se soustrait aux partis pris et aux catégories herméneutiques préétablies du chercheur.
Abstract
In exploring a corpus of manuscripts to find the meaning of the presence and distribution of the representatives of a narrative genre, one must first pinpoint the precise period and place for each element of the corpus, along with the socioculturalcontext. The researcher must devise or delineate various paths as each case warrants. The example of the Turin manuscript L.II.14 at the Biblioteca Nazionale Universitaria — an appealing recueil that merges some major epic cycles with sacred history — shows that the reading of texts, the investigation of manuscript traditions, and information garnered from other areas of study canbe a basis for formulating hypotheses. This basis, while tentative, allows for aless arbitrary interpretation of the presence, position and profile of the fabliaux in the collection and excludes the researcher’s bias and pre-established hermeneutic categories.
Article body
Travailler sur les recueils littéraires du Moyen Âge expose, en ce début de xxie siècle marqué par une attention accrue à la matérialité de la transmission, à des embûches sournoises[1]. Une approche pertinente de ce domaine d’étude requiert, certes, une pluralité de compétences, mais elle demande également de savoir « intégrer les réflexes codicologiques sans jamais perdre le sens des textes[2] ». Afin de nous placer d’emblée à la bonne distance de l’objet, il convient de partir de ce double postulat :
Les manuscrits sont des objets historiques, et comme tels ils ne peuvent être correctement interprétés que s’ils ont été convenablement replacés dans leur contexte chronologique et géographique. Mais il est également possible de retourner cette relation, et de considérer que chaque manuscrit est un objet archéologique qui véhicule des informations sur le milieu dont il est issu — un milieu qu’il convient de définir, entre autres paramètres, par sa position dans l’espace et dans le temps[3].
Il en découle que tous nos efforts d’interprétation de la présence et de l’assemblage des textes dans un recueil donné seront précédés par — et, par la suite, se fonderont sur — la tentative d’établir, de la manière la plus précise possible, les coordonnées chronologiques, géographiques et socio-culturelles de ce même manuscrit. Répondre à ce questionnement primordial, ou bien dresser des hypothèses sérieuses à son égard, est un gage de solidité pour n’importe quel essai d’interprétation. C’est justement sur l’importance de cette opération que je voudrais insister, par le biais de l’examen d’un cas de figure précis[4]. On peut en effet esquisser une hypothèse, certes provisoire mais non pas volatile, au sujet de la position d’un manuscrit dans l’espace et dans le temps, sans pour autant avoir à recourir à des compétences exceptionnelles ou à des procédés abscons. L’auscultation des textes, l’exploitation des traditions manuscrites et la prise en compte des résultats obtenus par les spécialistes d’autres disciplines vont ici constituer les seules pistes explorées[5].
Mise à l’épreuve
On sait que de nombreux manuscrits ont conservé, à côté de textes pieux, hagiographiques ou moraux, ou encore romanesques, épiques et historiques, quelques fabliaux en nombre restreint (d’un à six, suivant les recueils). Il s’agit, bien entendu, des cas parmi les plus intéressants que présente le corpus, puisque la friction entre textes, traditions et manuscrit en présence y est normalement des plus intenses et que nos réflexions sur cette contiguïté entre fabliaux et textes principaux doivent se confronter et, éventuellement, s’accorder avec l’interprétation globale du recueil.
Le spécimen le plus éblouissant de ce groupe est sans conteste le ms L.II.14 de la Biblioteca Nazionale Universitaria de Turin (r), un recueil colossal, de presque six cents feuillets à l’origine, de grand format, richement enluminé et transcrit avec soin par différents scribes. Ce qui détonne, au-delà de son aspect luxueux, c’est le fait qu’il renferme un projet littéraire ambitieux : lier les protagonistes du cycle des Lorrains et du cycle de Huon de Bordeaux, par voie (pseudo-)historique et généalogique, à l’histoire sacrée, depuis la Genèse jusqu’à la vengeance du Christ. Ce projet audacieux est l’oeuvre d’un clerc expérimenté qui n’hésite pas à remanier ou à écrire lui-même les textes dont il a besoin et qui ne sont conservés, à présent, que dans notre recueil (unicum). Si l’intention de sauvegarder une masse importante de textes a dû assurément jouer un rôle, il n’y a pas lieu de douter du fait qu’un projet intellectuel précis ait guidé, dès le début, la copie et l’assemblage des textes au sein de ce recueil organique[6]. C’est ce qu’illustre de toute évidence la section précédant les blocs de chansons de geste, une compilation habile de légendes sacrées et de textes disparates, assemblés comme on le ferait dans un collage et couvrant l’ensemble de l’histoire sacrée (fol. 1 à 102) :
1)
[fol. 1ro-] extrait de la Bible de Herman de Valenciennes (création du Paradis terrestre et d’Adam)
2)
Généalogie des Lorrains
[unicum]
3)
débat entre Néron et Virgile
[unicum]
4)
récit de Virgile sur l’histoire sacrée (d’Adam chassé du Paradis à Abraham)
[unicum]
5)
extrait de la Bible de Herman (d’Abraham à l’ascendance de Marie)
6)
extrait du Romanz de Saint Fanuel (d’Élisabeth aux miracles de l’enfant Jésus)
7)
extrait de la Bible de Herman (de la visite de l’ange à Joseph à la Tentation du Christ)
8)
extrait du Romanz de Saint Fanuel (des Noces de Cana à la Résurrection)
9)
prologue de la Venjance Nostre Seigneur
[unicum]
10)
Venjance Nostre Seigneur [fol. -102vo]
Cette compilation est soumise à la section épique du recueil, à laquelle elle fournit un prodrome magnifiant et sacralisant, puisque saint Seurin, fils de l’empereur Vespasien et frère de Titus (et de sainte Hélène), les deux protagonistes du texte 10, se révèle (texte 11), d’un côté, l’ancêtre de Hervi, le héros du texte ouvrant le cycle des Lorrains (12), et l’ancêtre de Huon de Bordeaux de l’autre (15)[7]. La continuité avec l’arrière-plan d’histoire sacrée fabriqué ad hoc étant désormais garantie, le long fleuve proprement épique peut se dérouler. Cette deuxième section se laisse aisément diviser en trois blocs, correspondant aux chansons du cycle des Lorrains (fol. 103 à 282), au cycle de Huon de Bordeaux (fol. 283 à 460) et au Beuve de Hantone (fol. 461 à 576), trois ensembles épiques qui partagent maints liens et interférences[8] :
11)
[fol. 103ro-] Prologue des Lorrains
[unicum]
12)
Hervis de Metz
13)
Garin le Lorrain [fol. -282ro]
14)
[fol. 283ro-] Roman d’Auberon
[unicum]
15)
Huon de Bordeaux
16)
Esclarmonde
[unicum]
17)
Clarisse et Florent
[unicum]
18)
Ide et Olive
[unicum]
19)
Godin [fol. -460vo]
[unicum]
20)
[fol. 461ro-576ro] version III de Beuve de Hantone
Des textes courts prennent enfin place à la fin du recueil. Deux d’entre eux se chargent de développer le thème de la punition des responsables de la mort du Christ, qui était au centre du texte 10[9], suivant la « […] propensione al ciclo compiuto, alla saturazione delle possibilità narrative implicite in un intreccio[10] » propre à notre recueil, et donnent suite, en passant, à un épisode d’Esclarmonde (texte 16) dans lequel Huon rencontre, pendant son voyage en mer, Judas en train de purger sa peine attaché à un rocher (v. 996-1089) :
21)
[fol. 577ro-] Vie de Pilate
[unicum]
22)
Vie de Judas [fol. -583vo]
[unicum]
Le lien des deux dernières pièces avec l’architecture générale du recueil est, en revanche, beaucoup plus lâche, puisque le dit allégorique (23) et le fabliau (24) se bornent à parachever le long récit épique sacré sur un ton fermement moralisateur :
23)
[fol. 583vo-] Dit de l’unicorne et du serpent
24)
La Housse partie [fol. -586vo]
Il n’est d’ailleurs pas sûr que ces deux derniers éléments aient fait partie du plan originel du recueil, eu égard au fait que la Vie de Judas se clôt sur un colophon (fol. 583c14-16) qui fixe l’achèvement de la copie au mois de juin 1311[11]. L’incendie qui s’est produit à la Biblioteca Nazionale Universitaria de Turin en 1904, et qui a détruit les fol. 584-586 du manuscrit et mis à mal, entre autres, les feuillets qui précèdent, nous ôte la possibilité de vérifier la congruence matérielle des textes 23 et 24 au tronc du recueil. Certes, il convient de se méfier du colophon, notamment quand il ne fait pas suite au dernier texte d’une unité codicologique, car il pourrait aussi avoir été transcrit tel quel à partir du modèle[12]. Mais l’examen des différents composants du recueil ne s’oppose nullement à une telle datation, de sorte que, même si le colophon du fol. 583vo procède d’une transcription passive, le modèle ne devait pas être beaucoup plus ancien que le manuscrit conservé aujourd’hui à Turin.
Si l’on peut par conséquent retenir sans hésitation la date, précise ou approximative, de 1311 pour cet étonnant effort de mise en recueil de quelques cycles majeurs de la chanson de geste, sa localisation pose davantage de problèmes. Nous allons donc explorer les pistes évoquées plus haut, en commençant, bien entendu, par les textes, en poursuivant la quête du côté des traditions manuscrites et à l’aide des éclaircissements glanés dans d’autres domaines d’étude.
Piste no 1 : les textes
Il convient, tout d’abord, de lire les textes contenus dans le recueil, notamment ceux faisant fonction de raccord entre ses différentes sections. À cet égard, la Généalogie et le Prologue des Lorrains (textes 2 et 11) jouent un rôle primordial dans le but de mettre la section d’histoire sacrée (fol. 1-102) en phase avec le cycle des Lorrains (fol. 103-282) et l’ensemble de la section épique (fol. 103-576). Le premier texte bref contient en effet une généalogie haute en couleur de Garin et Fromont, les ancêtres des deux clans qui s’affrontent dans le cycle des Lorrains, et indique ainsi sans ambiguïté quelle est la perspective à adopter dans la lecture du collage d’histoire sacrée ; le deuxième, centré sur les exploits de saint Seurin dans la lutte contre les païens et sur sa descendance, instaure un lien historico-généalogique décisif entre les exécuteurs de la vengeance du Christ, Vespasien et son fils Titus (texte 10), et le premier héros du cycle des Lorrains, Hervi (12), ainsi qu’avec les protagonistes du cycle de Huon de Bordeaux. Or l’éditeur de ces deux textes de raccord soutient à bon escient que leur auteur « a vécu vers la fin du xiiie siècle, qu’il est vraisemblablement contemporain du copiste, sinon le copiste lui-même[13] ». On serait donc tout près du milieu dans lequel la compilation et, peut-être, le manuscrit lui-même auraient vu le jour. Ce qui nous impose d’aiguiser le regard.
Le Prologue des Lorrains met en scène, dans sa première partie (v. 10-158), l’oeuvre de saint Seurin pour le rayonnement de la foi et, surtout, son combat acharné contre les ennemis de la chrétienté. Dans ce volet, la prise de Cologne, tombée sous la coupe des païens, par saint Seurin et ses compagnons, se taille la part du lion. Si l’auteur de ce petit texte de raccord est le compilateur lui-même, et qu’on songe à son habileté dans l’art de manier et de composer les légendes les plus disparates, on n’est pas surpris du fait qu’il en ait profité pour insérer au sein de la laisse III (v. 26-104) le récit du martyre des onze mille vierges, dont saint Seurin devient ainsi le vengeur. Il s’agit en effet d’une des légendes hagiographiques parmi les plus répandues dans l’Europe médiévale. Un culte des vierges martyres est attesté à Cologne dès le ive siècle, mais ce n’est qu’aux ixe et xe siècles qu’il prend de l’ampleur, lorsque les vierges passent, à cause d’une erreur de lecture, de onze à onze mille et que l’une d’entre elles, Ursule, prend le devant de la scène : la Passio Ursulae (BHL 8427), écrite entre 969 et 976, fixe de manière définitive les contours et les épisodes saillants de la légende. Ursule, fille du roi de Bretagne et chrétienne, reçoit la demande en mariage d’un prince païen ; pour gagner du temps et décourager le prétendant, elle demande un délai de trois ans pendant lesquels elle se rendra en pèlerinage à Rome, accompagnée de dix vierges de haut rang (chaque pèlerine sera en outre suivie par mille vierges) ; la condition étant acceptée, Ursule et ses compagnes se rendent à Rome, sont reçues avec tous les honneurs par le pape et, sur le chemin du retour, sont massacrées par les Huns qui assiègent Cologne. En 1106, lors de la découverte d’un cimetière ancien près de l’église Sainte-Ursule de Cologne, on crut avoir retrouvé les reliques des vierges martyrisées, leur culte explosa et la ville de Rhénanie devint l’un des principaux lieux de pèlerinage de la chrétienté[14].
Bien évidemment, le Prologue ne retient de cette légende que la conclusion, le martyre des onze mille vierges, emprisonnées dans un palais de Cologne par les païens et minées par la disette qui sévit dans la ville assiégée par saint Seurin et les siens. Ce remploi de la légende n’a donc rien d’extraordinaire, à ceci près que sainte Ursule n’y est jamais nommée et qu’une tout autre sainte guide les onze mille vierges au martyre (HM, p. 528) :
Faut leur laens la vïande et li blés,
Sarrazin furent forment desconforté :
Ullent et braient comme chien afamé !
Et les pucelles dou grant palais listé
Tordent lor puins, s’ont tenrement ploré !
Benoite prent tantost a escrier :
« Monnegon, dame, que porons nous penser ?
Chi nos couvient morir et devïer !
N’arons secours de nul houme carnel :
E, Seurins, sire, jentis rois couronnés !
Vos ne savés mie nos povretés ! »
Son chief met hors par .I. des fenestrés
Et voit Bruiant et Toramont passer ;
Sainte Benoite coumenche a escrier :
« E, Toramont, gentis rois couronnés !
Ains que nos faces ci alec afamer,
A Belisors de Roume nos rendés
Ou tu nos viegnes tantost les chiés coper[15] ! »
La substitution n’a pas ému l’éditeur (HM, p. 740, s. Sainte Benoite)[16], mais elle est de taille, eu égard au rayonnement énorme du culte de sainte Ursule au Moyen Âge et au caractère purement local du culte de sainte Benoîte[17], qui était autrefois ancré dans le Vermandois, où se trouvait son foyer principal, le monastère d’Origny-Sainte-Benoîte, une quinzaine de kilomètres à l’est de Saint-Quentin. Cette abbaye de Bénédictines, protégée par la maison royale et relevant du diocèse de Laon, fut fondée vers le milieu du ixe siècle au pied de la colline où sainte Benoîte aurait été enterrée après son martyre et en conservait jalousement les reliques, jusqu’à sa destruction complète pendant la Révolution. Selon la légende, calquée sur un schéma martyrologique ayant bénéficié de nombreuses applications entre Amiens et Reims et informant, notamment, le récit de la passion de saint Quentin[18], Benoîte se rendit de Rome en Gaule, assistée par les douze compagnes qu’elle avait converties, afin d’y prêcher la foi chrétienne, subit menaces, tortures et emprisonnements, fut ensuite libérée par les anges à trois reprises et poursuivit dans l’oeuvre d’éradication de l’idolâtrie païenne, jusqu’à ce que le gouverneur païen de la région, Matroclus, la tue à la hache. Certes, le risque de surinterprétation de cette émergence inopinée est réel, puisqu’elle retombe dans le domaine, insidieux, de l’onomastique hagiographique[19], mais on se doit de suivre la piste suggérant le Vermandois comme éventuel lieu d’élaboration de la compilation ou d’exécution du manuscrit de Turin, et de vérifier si d’autres indications viendraient la corroborer.
Piste no 2 : la tradition des textes
C’est l’examen de la tradition manuscrite du cycle des Lorrains qui va nous livrer une confirmation précieuse, quoiqu’hypothétique. Le cycle épique a subi, dans le recueil de Turin, des modifications et des ajouts qui lui sont propres. Mais, au départ, la physionomie du cycle est identique à celle que l’on retrouve dans deux autres témoins, formant avec le nôtre un groupe solidaire, manifestement écarté de celle qu’on appelle la version commune[20] : il s’agit du ms 528 de la Bibliothèque municipale de Dijon (Garin et Gerbert), que l’on date de la fin du xiiie ou du début du xive siècle et qui provient de Lorraine, et du ms 3143 de la Bibliothèque de l’Arsenal de Paris, qui est le seul à contenir le cycle en entier (Hervis, Garin, Gerbert et une version mélangeant Yonnet de Metz et Anseÿs de Gascogne)[21], mais donne un texte fortement remanié. Le manuscrit de l’Arsenal est un produit courant, portant une seule enluminure sur trois colonnes en tête du fol. 1ro[22]. Alison Stones, à qui l’enluminure a été soumise, suggère qu’elle sort d’une boutique parisienne bien connue, celle du libraire Thomas de Maubeuge, sise rue Neuve Notre-Dame et attestée de 1313 à 1349 ; elle daterait des années 1320 et serait l’oeuvre du Maître de Thomas de Maubeuge, un artiste bien médiocre qui travailla souvent pour ce libraire réputé et se distingue par le manque de précision dans le trait et l’emphase un peu ridicule des visages, tout en ayant façonné, seul ou en collaboration avec d’autres artistes, une trentaine de manuscrits, entre 1303 et 1342 environ[23]. Or une donnée interne à l’Arsenal 3143 nous permet d’approfondir cette indication[24].
Deux couplets introduits au fol. 77ro, au sein de Garin le Lorrain, juste avant une coupure importante signalée par une lettre « puzzle » (c’est le début de la laisse XCIX[25]), semblent nous dire que ce manuscrit a été transcrit à Saint-Quentin, en Vermandois :
Ciz romans est a Jaque de Paris.
Haut soit pendus qui l’enblera en fin.
Sachiés qu’il fu escris a Saint Quentin,
en chiés Robert d’Ardane Houdebin[26].
Le quatrain éveille toutefois les soupçons, puisqu’il n’est qu’un colophon, si l’on fait abstraction de sa position dans le volume. Il s’accroche en effet à la conclusion de la laisse XCVIII, sans se voir rehaussé ni détaché de ce qui précède, et la suite de la narration prend place en tête de la colonne suivante, sans changement de main ni d’encre[27] : il se peut que le copiste ait transcrit le quatrain en suivant le modèle de façon mécanique, sans se rendre compte qu’il s’agissait d’un colophon, à l’origine[28]. D’ailleurs, en règle générale, « the more the colophon is integrated with the text either physically or in its formulation, the more it should be viewed with suspicion[29] ».
Loin de nous décevoir, cette conclusion prudente nous permet de mettre en perspective la remarque perplexe de l’éditeur de Hervis de Metz, qui, tout en enregistrant la localisation étalée par le quatrain de l’Arsenal 3143, soulignait que « l’étude attentive de la langue du manuscrit […] ne conforte guère cette localisation, puisque les traits picards, et plus généralement dialectaux, y sont rares » ; d’après lui, ce copiste cultivé et habile « suivait un modèle de l’Est dont il s’efforçait d’éliminer les traits provinciaux » et, dans cet effort, il s’est peu soucié de la mesure des vers, à tel point qu’il a laissé passer plus de deux cent cinquante vers faux (HM, p. xiv et xviii ; voir aussi YM, p. 47-54). Si l’on suppose, sur la base de l’expertise d’Alison Stones, que l’exécution du ms 3143 de l’Arsenal (transcription, ornementation, illustration) a eu lieu à Paris, à partir d’un modèle (ou de la copie d’un modèle) réalisé auparavant à Saint-Quentin par un copiste dénommé Robert, originaire (ou dont la famille était originaire) de l’Ardenne (peut-être même de l’Ardenne belge), le nettoyage linguistique qu’aurait mis en oeuvre le copiste de l’Arsenal 3143 — avec ses dégâts collatéraux, telle l’inattention au mètre — devient encore plus plausible, puisqu’il aurait eu lieu à Paris, dans les années 1320, et non pas à Saint-Quentin, sous la plume d’un copiste d’origine ardennaise, à l’intention d’un commanditaire parisien. Dans tous les cas, le lien du témoin du cycle des Lorrains conservé à l’Arsenal avec le Vermandois est robuste, tient apparemment à la provenance de son modèle et confirme, de manière non anecdotique, la lumière jetée sur le Vermandois par l’irruption de sainte Benoîte à la tête des vierges martyrisées à Cologne dans le Prologue des Lorrains contenu dans le recueil de Turin[30].
Piste no 3 : le travail d’autrui
Un apport décisif à nos hypothèses provient des spécialistes de l’enluminure médiévale et du concours heureux que nous apportent leurs recherches. D’abord, Alison Stones a fait le point sur la production du Maître de sainte Benoîte, un artiste de premier plan ainsi dénommé à partir de son chef-d’oeuvre, le merveilleux liber aureus du monastère d’Origny-Sainte-Benoîte conservé à présent à Berlin, qui contient un ensemble foisonnant de textes (latins et français) et d’images composant le dossier hagiographique de sainte Benoîte et relatant l’histoire légendaire de l’abbaye, ainsi que ses pratiques liturgiques et administratives[31]. Il serait intervenu, de façon ponctuelle ou en tant que maître principal, dans sept manuscrits (ou fragments de manuscrits)[32] :
Berlin, Staatliche Museen – Preußischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett, 78 B 16 ;
Wien, Österreichisches Museum für angewandte Kunst, Inv. 1073 ;
London, British Library, Sloane 1977 ;
New York, Pierpont Morgan Library, M 805-M 806 ;
Modena, Biblioteca Estense Universitaria, lat. 1152 (α.S.2.12) ;
New York, Pierpont Morgan Library, M 1042 ;
Rouen, Bibliothèque municipale, 1050 (U.12).
Ensuite, François Avril a confirmé, dans ses grandes lignes, le regroupement établi et lui a rattaché deux autres manuscrits[33] :
Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, L.II.14 ;
Arras, Médiathèque, 790.
L’illustration abondante du recueil de Turin serait en effet due, en bonne partie, au Maître de sainte Benoîte, « une des personnalités les plus fascinantes du milieu artistique du nord de la France vers 1310-1315 », dont « les personnages […] ont des visages arrondis, aux yeux caves, très caractéristiques[34] ». D’autres spécialistes se sont par la suite chargés d’approfondir, de discuter et de préciser ces indications, à partir d’angles d’approche différents[35].
Or, selon eux, cet artiste remarquable se serait formé dans le milieu royal parisien, comme l’indique sa participation probable à l’illustration du bréviaire fragmentaire de New York (ms 6), qui est à l’usage de la Sainte-Chapelle de Paris et devait sans doute servir à une reine de France (probablement Marie de Brabant [† 1321], au temps de son veuvage, au vu de la guimpe de veuve que la dame porte dans la lettre historiée du fol. 8ro, donc entre 1285 [mort de Philippe III] et 1297[36]), et son intervention présumée dans l’enluminure du fol. 34ro du Roman de Jules César de Rouen (7), que Patricia Stirnemann rattache à la production parisienne autour de 1290[37]. Une fois son apprentissage complété, le Maître de sainte Benoîte, dont on admet désormais qu’il fut actif entre la fin du xiiie et la deuxième décennie du xive siècle, se serait installé — ou serait rentré — en Picardie, où il aurait fait l’essentiel de sa carrière. Mais où, au juste, en Picardie ? Certains penchent pour Amiens[38], d’autres hésitent[39]. Certes, un maître de telle envergure a dû participer à des entreprises collectives s’étendant sur un ample rayon géographique et s’adaptant au rang et aux possibilités financières d’une clientèle changeante[40]. C’est pourquoi on a supposé que le ms Sloane 1977 (ms 3), contenant des traités médicaux et chirurgicaux en ancien français, aurait été réalisé à l’intention de la Confrérie de Saint-Côme et Saint-Damien de Paris, la corporation des chirurgiens créée au xiiie siècle[41] ; en plus, l’assistant talentueux du Maître de sainte Benoîte dans le Lancelot en prose de New York (4) est le maître unique d’un missel datant, selon le calendrier, d’après 1297, destiné à une institution éloignée des centres picards, le couvent augustinien de Saint-Denis de Reims (Reims, Bibliothèque municipale, 217[42]).
Mais il faut souligner que certains produits issus de la main du maître convergent sur une aire qui nous est désormais familière. D’abord, l’oeuvre la plus impressionnante du groupe, le liber aureus des Bénédictines d’Origny-Sainte-Benoîte (ms 1), a été commencée en 1312 à la demande de la trésorière de l’abbaye, Heluis de Conflans, issue d’une famille noble de la région, et vient consacrer l’apogée du culte de la sainte patronne, dont un renouveau sensible est encouragé tout au long du xiiie siècle ; ensuite, le psautier de Modène (5), qui est à classer dans la catégorie du « petit livre de dévotion fait en très grand nombre à l’époque pour des membres de la classe bourgeoise[43] », porte un calendrier à l’usage de Saint-Quentin et sa décoration secondaire serait due au deuxième assistant du Maître de sainte Benoîte dans le liber aureus[44] ; enfin, les deux feuillets subsistants de Vienne (2) partagent, sur de nombreux points, l’histoire du liber aureus et le volume dont on les a extraits — un missel ou un livre de dévotion — était peut-être réservé, lui aussi, à l’abbaye bénédictine du Vermandois : le premier assistant du Maître de sainte Benoîte dans le codex de Berlin, qui s’occupe des enluminures des fol. 53vo et 54ro, ainsi que du calendrier (fol. 55ro-69vo), a été reconnu dans le décor marginal des feuillets de Vienne[45] ; sur ces mêmes bordures, on observe des têtes de bénédictines[46] ; le liber aureus et les feuillets conservés à Vienne ont appartenu tous les deux à Johann Daniel Friedrich Sotzmann (Berlin, 1781-1849)[47].
Mises à part les collaborations ponctuelles de l’époque de sa formation (mss 6 et 7) et la Bible latine d’Arras (9), qui n’a pas encore fait l’objet, à ma connaissance, d’une étude poussée, trois des six manuscrits sur lesquels le Maître de sainte Benoîte a travaillé sont ancrés, à des degrés variables, dans le Vermandois, sur l’axe reliant Saint-Quentin à Origny-Sainte-Benoîte, et partagent, du moins en partie, les mêmes équipes d’artisans. Dans ce contexte, les indices tirés de l’examen des textes contenus dans le recueil de Turin (8) et de leurs traditions manuscrites, pointant le Vermandois et le même horizon culturel régional, suggèrent de restreindre provisoirement à cette région le centre de gravité (ou l’un des centres de gravité) de l’activité du maître, ainsi que le lieu d’exécution du recueil de Turin[48]. Il convient en effet d’insister sur le recoupement chronologique exact — début des années 1310 — entre les deux membres du sous-groupe passibles de datation (1 : à partir de 1312 ; 8 : 1311, ou peu après), ainsi que sur l’éclairage mutuel que les différents indices recueillis apportent : au sein d’un atelier ou, plus probablement, d’un réseau de professionnels ayant l’habitude de travailler pour l’abbaye bénédictine d’Origny-Sainte-Benoîte et pour les laïcs pieux de la région, la promotion de sainte Benoîte à la tête des onze mille vierges de Cologne, dans le Prologue des Lorrains, tout en demeurant une manoeuvre hardie, n’a rien d’inimaginable[49].
Tentative de mise à profit
Que peut-on tirer, pour l’interprétation de l’ensemble du recueil et de ses composants, de cette définition provisoire du lieu, du milieu et du contexte d’exécution du manuscrit ? Il est encore tôt pour échafauder des conclusions arrêtées, ainsi que pour prospecter le recueil de Turin en tant qu’objet archéologique, comme le préconise Denis Muzerelle. Mais il n’est pas inutile de montrer comment notre regard peut et doit évoluer, à la lumière de ces informations nouvelles. Prenons le cas du dernier texte, La Housse partie (24), un fabliau noir et cynique, porté par un esprit moralisateur appuyé, à tel point que certains spécialistes du genre l’ont exclu du canon et rejeté dans le terrain en friche des contes moraux[50]. C’est déjà un élément fort de continuité par rapport au texte précédent, le Dit de l’unicorne et du serpent (23). Mais ne nous contentons pas de ces formules interprétatives, certes pertinentes, dans le cas présent, et venons-en au contenu du fabliau[51]. Il en existe trois témoins (Paris, BNF, fr. 837 [A], r et Princeton, University Library, Taylor Medieval, 12 [s]), et autant de versions indépendantes (I, II, III), qui élaborent différemment le récit et divergent également en longueur (416 [le début fait défaut], 184, 274 vers), mais relatent toutes la même histoire[52] : un riche cède tous ses biens à son fils, qui se marie et a un enfant ; après quelques années, la belle-fille convainc son mari de chasser le père improductif, et le fils obéit ; le père proteste et demande au moins une housse pour se couvrir ; le fils ingrat lui dit d’aller en demander une au petit-fils, qui travaille à l’étable ; le petit-fils ne propose à son grand-père que la moitié de la housse demandée ; interrogé, le garçon explique qu’il garde l’autre moitié pour son père, pour quand il sera lui aussi devenu vieux ; ce qui ouvre les yeux au fils ingrat, qui demande pardon et remet tous les biens à la disposition de son père.
La morale de premier niveau est explicite, et la conclusion du fabliau ne manque pas de la souligner, dans le témoin de Turin aussi (v. 175-184) : dépendre d’autrui est dangereux, fût-ce de son propre fils. Leslie C. Brook a tenté une lecture anagogique du fabliau, en s’appuyant sur la version I (ms A) : le fils ingrat est le chrétien, tout ce qu’il possède lui vient de Dieu et à Dieu doit revenir[53]. Certes, il est possible que cette interprétation saisisse le sens caché et originel du récit, mais il est plus intéressant, dans notre perspective, de se demander quelles sont les motivations qui ont poussé à insérer ce fabliau à la fin du manuscrit — si ce n’est une simple volonté de le sauvegarder ou la forte affinité de ton avec le dit qui précède. Le lecteur du xxie siècle perçoit, avant tout autre chose, dans les différentes versions de ce conte, une reprise audacieuse du célèbre épisode de la Charité de saint Martin, celui du manteau militaire que saint Martin fend en deux avec son épée pour en donner la moitié à un pauvre transi de froid, lorsqu’il est, en 337, un jeune soldat romain en garnison à Amiens. La suite, avec son accomplissement christique et évangélique, est connue :
Nocte igitur insecuta, cum se sopori dedisset, uidit Christum chlamydis suae, qua pauperem texterat, parte uestitum. […] Mox ad angelorum circumstantium multitudinem audit Iesum clara uoce dicentem : Martinus adhuc catechumenus hac me ueste contexit. Vere memor Dominus dictorum suorum, qui ante praedixerat : quamdiu fecistis uni ex minimis istis, mihi fecistis, se in paupere professus est fuisse uestitum […][54].
Il faut en effet se rappeler que, dans La Housse partie, le père demande précisément au fils ingrat « […] une de tes vieles houces/Dont tu fais tes chevaus couvrir » (v. 94-95[55]) et que, en ancien et moyen français, houce (housse) désigne autant une « couverture feutrée qui couvre le dos d’un cheval » qu’un « manteau long et ample à larges manches »[56]. Or, dans la scène de la Charité, qui domine sans conteste son iconographie, Martin est normalement vêtu en soldat, doté d’un ample manteau et, surtout, monté sur un cheval :
La rencontre de Martin et du pauvre d’Amiens est demeurée la scène la plus universellement célèbre de la Vita. Dans la miniature et la statuaire, le vitrail et l’estampe, elle allait devenir et rester l’un des thèmes de prédilection de l’art occidental, en particulier dans ses formes populaires. Une aussi prodigieuse fortune ne tient pas seulement à la beauté formelle de cette « charité de saint Martin », ni à la résurgence, dans le groupe traditionnel du saint cavalier et du piéton misérable, d’archétypes artistiques extrêmement anciens. Si l’imagination des artistes médiévaux s’est saisie de la scène avec une passion aussi exclusive, c’est sans doute que la piété du peuple chrétien qui affluait à la basilique de Tours les y avait tout particulièrement conviés. Aux lecteurs de la Vita comme aux pèlerins qui contemplaient à l’aube du Moyen Âge les fresques de Tours, cette scène est apparue comme l’illustration la plus achevée de la spiritualité martinienne, dans sa fidélité totale à l’Évangile[57].
La présence de l’épisode hagiographique en amont de La Housse partie devait paraître si flagrante, au Moyen Âge, que la version I (ms A) n’a pas hésité à en rajouter, en glissant, de façon bien peu innocente, l’invocation du nom de saint Martin au sein du discours de repentir que le fils ingrat adresse, vers la fin, à son père (v. 383[58]). D’autres détails, qui ne font pas surface dans la version II, témoignent d’ailleurs de cette recherche insistante, au sein de la version I, du parallélisme entre le récit en cours et l’épisode célèbre ayant pour protagoniste le futur évêque de Tours — la supplique du père au fils ingrat est motivée explicitement par le besoin de se protéger du froid (v. 297-300 [élément présent également dans la version III, v. 180-187]) et le petit-fils coupe en deux la housse « […] a son coutel » (v. 333[59]), sous les yeux du lecteur.
La portée morale bien tranchée du conte ne devait pas lui déplaire, mais il est fort probable que le compilateur du manuscrit de Turin — ou celui qui a complété le volume à l’aide de quelques textes brefs — ait surtout été séduit par le détournement habile que le fabliau comporte d’un épisode universellement connu, concernant l’introducteur du monachisme en Occident, le premier saint non martyr, l’apôtre des Gaules ou treizième apôtre, jouissant d’une popularité exceptionnelle dans toute l’Europe et dont l’attribut est le manteau partagé[60]. Ce compilateur si expérimenté dans le brassage des légendes, des mythes et des récits, si désinvolte avec les saints, leur biographie et leurs attributs, devait apprécier d’emblée la subtilité hardie de la démarche : viser la plus cruelle des ingratitudes humaines sur le contrepoint de l’un des essais les plus émouvants de charité chrétienne.
Appendices
Note biographique
Gabriele Giannini s’est formé aux Universités de Bologne et La Sapienza de Rome, puis à l’École Pratique des Hautes Études de Paris. Parmi ses centres d’intérêt figurent la littérature apocryphe et hagiographique en langue d’oc (Vangeli occitani dell’infanzia di Gesù. Edizione critica delle versioni I e II [avec la collaboration de Marianne Gasperoni], Bologne, Pàtron, coll. « Biblioteca di filologia romanza », 2006) et le rayonnement du roman français en vers en Italie au Moyen Âge, par sa circulation dans les manuscrits.
Notes
-
[1]
À ce sujet, voir la mise en garde de Richard Trachsler, « Observations sur les “recueils de fabliaux” », dans Olivier Collet et Yasmina Foehr-Janssens (dir.), Le recueil au Moyen Âge. Le Moyen Âge central, Turnhout, Brepols, coll. « Texte, codex & contexte », no 8, 2010, p. 35-46.
-
[2]
Jacques Dalarun, « Avant-propos », dans Maria Careri et collab., Album des manuscrits français du xiiie siècle, Rome, Viella, 2001, p. v.
-
[3]
Denis Muzerelle, « Dating Manuscripts : What Is at Stake in the Steps Usually (but Infrequently) Taken », Journal of the Early Book Society, vol. XI, 2008, p. 173-174.
-
[4]
À un autre cas passionnant, mais plus complexe, est consacrée une étude en préparation. Il s’agit du ms 3114 de la Bibliothèque de l’Arsenal de Paris (sigle e), qui se compose de dix-huit feuillets et de six textes brefs, dont un fabliau (La Dame escoillee). L’étude quelque peu poussée des textes et de leur tradition m’a permis d’établir que ces dix-huit feuillets ont été découpés au xviiie siècle d’un recueil assez imposant qui ne comptait, à l’origine, pas moins de deux douzaines de textes (de longueur et de teneur extrêmement variables). J’ai pu identifier le gros du recueil originel, lui aussi conservé à présent dans une bibliothèque parisienne, et reconstruire ainsi les étapes principales de son parcours, entre la date, le lieu et le contexte de sa fabrication et ceux de son dépeçage. Il est évident que de tout autres horizons d’interprétation s’ouvrent au chercheur, que les méfaits du marché du livre ancien avaient jusqu’ici occultés.
-
[5]
La même démarche est mise en oeuvre, notamment par le biais de l’exploitation des indications offertes par les remplissages, les textes de raccord et les pièces de circonstance, par Olivier Collet, « “Textes de circonstance” et “raccords” dans les manuscrits vernaculaires : les enseignements de quelques recueils des xiiie-xive siècles », dans Tania Van Hemelryck et Maria Colombo Timelli (dir.), Quant l’ung amy pour l’autre veille. Mélanges de moyen français offerts à Claude Thiry, Turnhout, Brepols, coll. « Texte, codex & contexte », no 5, 2008, p. 299-311, à propos de deux recueils contenant également des fabliaux (Paris, BNF, fr. 1553 [J] et fr. 25545 [I]).
-
[6]
J’emploie ici la terminologie établie par Geneviève Hasenohr, « Les recueils littéraires français du xiiie siècle : public et finalité », dans Ria Jansen-Sieben et Hans van Dijk (dir.), Codices Miscellanearum (Colloque Van Hulthem, Bruxelles, 1999), Bruxelles, Association des archivistes et bibliothécaires de Belgique, coll. « Archives et bibliothèques de Belgique. Numéro spécial », 1999, p. 38-39. Il importe peu et il n’est, par ailleurs, guère surprenant que ce projet faramineux mais cohérent et abouti n’ait pas engendré une tradition — du moins, d’après nos connaissances. Voir Armando Petrucci, « Introduzione », dans Edoardo Crisci et Oronzo Pecere (dir.), Il codice miscellaneo. Tipologie e funzioni. Atti del Convegno internazionale (Cassino, 14-17 maggio 2003), Cassino, Università degli Studi di Cassino, coll. « Segno e testo », no 2, 2004, p. 10.
-
[7]
Au sujet du profil hagiographique de saint Seurin, flou et entremêlé, à partir des deux Seurin présentés par Grégoire de Tours au vie siècle, l’un évêque de Cologne, l’autre évêque de Bordeaux, voir Christophe Baillet, Patrick Henriet et Stéphanie Junique, « Le dossier hagiographique de Saint-Seurin », dans Isabelle Cartron, Dany Barraud, Patrick Henriet et Anne Michel (dir.), Autour de Saint-Seurin : lieu, mémoire, pouvoir. Des premiers temps chrétiens à la fin du Moyen Âge. Actes du colloque de Bordeaux (12-14 octobre 2006), Bordeaux, Ausonius, 2009, p. 79-85.
-
[8]
Voir Marguerite Rossi, « Huon de Bordeaux » et l’évolution du genre épique au xiiie siècle, Paris, Honoré Champion, coll. « Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge », 1975, p. 44-65 et 71-74. En revanche, de nombreuses approximations se glissent dans Mieke Lens, « Old French Epic Cycles in MS. Turin L.II.14 : The Development of Old French Narrative Cycles and the Transmission of Such Cycles into Middle Dutch Epic Poetry », dans Bart Besamusca et collab. (dir.), Cyclification. The Development of Narrative Cycles in the Chansons de Geste and the Arthurian Romances, Amsterdam, North-Holland, 1994, p. 127-134.
-
[9]
Par ailleurs, la corrélation est mise en avant à la fin de la Vie de Judas : d’après les v. 637-652, ce qui s’abat sur Jérusalem et sur les Juifs sous Vespasien est la conséquence directe de la trahison de Judas (voir La leggenda di Vergogna, testi del buon secolo in prosa e in verso, e la leggenda di Giuda, testo italiano antico in prosa e francese antico in verso [éd. Alessandro D’Ancona], Bologne, Gaetano Romagnoli, coll. « Scelta di curiosità letterarie inedite o rare dal secolo xiii al xvii », 1869, p. 98-99).
-
[10]
Eugenio Burgio, « Le redazioni antico-francesi delle vite di Giuda e di Pilato. Per la ricognizione di una tradizione manoscritta », dans Giovanni Ruffino (dir.), Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza (Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Università di Palermo, 18-24 settembre 1995), vol. VI, Tübingen, Max Niemeyer, 1998, p. 75 : « […] tendance au cycle accompli, à la saturation des possibilités narratives qui sont implicites dans une intrigue. »
-
[11]
Voir déjà Edmund Stengel, Mittheilungen aus französischen Handschriften der Turiner Universitäts-Bibliothek, Halle (Saale), Max Niemeyer, 1873, p. 35.
-
[12]
Voir en dernier lieu Olivier Legendre, « Some Tools for Dating and Localizing Manuscripts », Journal of the Early Book Society, vol. XI, 2008, p. 181-183.
-
[13]
Hervis de Mes. Chanson de geste anonyme (début du xiiie siècle) (éd. Jean-Charles Herbin), Genève, Droz, coll. « Textes littéraires français », 1992, p. 521 (la Généalogie est publiée aux p. 520-525, le Prologue aux p. 525-535). Dorénavant désigné à l’aide des lettres HM, suivies du numéro de la page.
-
[14]
Pour un aperçu de la légende et de son évolution historique, voir Jacques de Voragine, La Légende dorée (éd. Alain Boureau), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2004, p. 1428-1431.
-
[15]
Ce sont les v. 58-75 du Prologue : « Dans la ville, la viande et le blé manquent,/les Sarrasins se désespèrent : /ils crient et se lamentent comme des chiens affamés !/Et les jeunes filles du grand palais orné d’une bande peinte/tordent leurs poings, elles pleurent intensément./Aussitôt, Benoîte se met à s’écrier : /“Dame Monnegon, que devons-nous en penser ?/Nous mourrons ici, c’est inévitable !/Personne ne nous portera secours : /Hé ! Seurin, seigneur, noble roi couronné ! /Vous n’êtes pas au courant de nos malheurs !”/Elle passe sa tête par une fenêtre/et voit passer Bruiant et Toramont ; /sainte Benoîte commence à crier : /“Hé ! Toramont, noble roi couronné ! /Avant que tu ne nous fasses mourir de faim ici-même,/rends-nous aux soldats chrétiens de Rome/ou viens aussitôt nous couper la tête !” »
-
[16]
Il en est de même dans Jean-Charles Herbin, « Le début de la “Geste des Loherains” dans le manuscrit L-II-14 de Turin (“T”) », Lez Valenciennes, vol. XXV, 1999 (Jean-Charles Herbin [dir.], Première journée valenciennoise de médiévistique. Journée d’étude du 3 avril 1998, Valenciennes, Presses universitaires de Valenciennes, 1999), p. 135-140. En revanche, la portée du transfert n’a pas échappé à Simonetta Castronovo, La biblioteca dei conti di Savoia e la pittura in area savoiarda (1285-1343), Turin/Londres/Venise, Umberto Allemandi & C., coll. « Archivi di arte antica », p. 216, n. 42.
-
[17]
Voir Geneviève Brunel-Lobrichon, Anne-Françoise Leurquin-Labie et Martine Thiry-Stassin, « L’hagiographie de langue française sur le Continent, ixe-xve siècles », dans Guy Philippart (dir.), Hagiographies. Histoire internationale de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1550, vol. II, Turnhout, Brepols, coll. « Corpus Christianorum. Hagiographies », 1996, p. 321.
-
[18]
Voir en dernier lieu Michèle Gaillard et Jean-Luc Villette, « L’histoire de saint Quentin entre textes et images », dans Aux origines de Saint-Quentin. De la tradition littéraire à la réalité archéologique, Saint-Quentin, Musée Antoine Lécuyer, 2011, p. 7-14. D’ailleurs, la première version connue de la légende de la sainte, le Carmen de Sancta Benedicta (BHL 1088), datant du ixe siècle, reprend de très près le Carmen de Sancto Quintino (BHL 7010).
-
[19]
Voir, à ce propos, la mise en garde contenue dans le sévère compte rendu de Philippe Walter à HM, Cahiers de civilisation médiévale, vol. XXXVII, 1994, p. 378-380.
-
[20]
Voir Anne Iker-Gittleman, Le style épique dans « Garin le Loherain », Genève, Droz, coll. « Publications romanes et françaises », no 94, 1967, p. 14-15 et Jean-Charles Herbin, art. cit., p. 131-132.
-
[21]
Yonnet de Metz (éd. Jean-Charles Herbin), Paris, Société des Anciens Textes Français, 2011, p. 79-80 : « Ce manuscrit tente de lier ensemble deux textes à l’origine totalement hétérogènes : Yonnet […] et Anseÿs de Gascogne […] ; le remanieur de N ne cherche point à écourter, mais à faire correspondre le moins mal possible deux textes originellement étrangers l’un à l’autre. » Dorénavant désigné à l’aide des lettres YM, suivies du numéro de la page.
-
[22]
Elle représente le duc Pierre de Metz, ruiné par ses libéralités, en train de céder son unique fille, Ayelis, à un riche bourgeois de Metz, le prévôt Thierry, conformément au début de Hervis de Metz. De leur union naîtra Hervi. Le côté droit de l’enluminure est à présent abîmé.
-
[23]
Voir Alison Stones, « The Stylistic Context of the “Roman de Fauvel”, with a Note on “Fauvain” », dans Margareth Bent et Andrew Wathey (dir.), Fauvel Studies. Allegory, Chronicle, Music, and Image in Paris, Bibliothèque Nationale de France, MS Français 146, Oxford, Clarendon Press, 1998, p. 540-550 et 558-559, puis Richard H. Rouse et Mary A. Rouse, Manuscripts and their Makers. Commercial Book Producers in Medieval Paris 1200~1500, Londres, Harvey Miller, 2000, vol. I, p. 184-187 et vol. II, p. 176-179. L’indication donnée par Frankwalt Möhren, Dictionnaire étymologique de l’ancien français. Complément bibliographique 2007, Tübingen, Max Niemeyer, 2007, col. 798, au sujet de l’Arsenal 3143, est erronée : « pic. déb. 15e s. ».
-
[24]
D’un autre côté, il faudrait vérifier si l’Arsenal 3143 n’est pas le rommanch des Lorehens pour lequel Jean de Florence, émissaire de Guillaume Ier de Hainaut, dit le Bon, comte de Hainaut, de Hollande et de Zélande de 1304 à 1337, paya 13 livres parisiennes à Thomas de Maubeuge en 1323 (voir la note des frais engagés pour constituer la dote des filles du comte, Marguerite et Jeanne, publiée par Godefroy Ménilglaise, « État des bijoux et joyaux achetés à Paris pour Marguerite et Jeanne de Hainaut en 1323 », Annuaire-Bulletin de la Société de l’Histoire de France, vol. V, no 2, 1868, p. 143-144). Ce rommanch des Lorehens n’a jamais été identifié (voir en dernier lieu Richard H. Rouse et Mary A. Rouse, op. cit., vol. I, p. 182 et 372, n. 66) et il est vrai que le Maître de Thomas de Maubeuge travailla souvent pour le libraire parisien. Mais le prix apparaît clairement comme disproportionné, au vu de la facture fort ordinaire de la copie de l’Arsenal, notamment en termes de décoration et d’illustration. Si l’Arsenal 3143 n’est pas le volume commandité par Guillaume le Bon, on ne peut toutefois exclure qu’il représente un sous-produit, aux coûts maîtrisés, sorti de la boutique parisienne dans le sillage de la commande comtale.
-
[25]
La laisse XCVIII mettait un terme aux péripéties du siège de Bordeaux : les Bordelais capitulent et la paix est rétablie pour sept ans et demi. La laisse XCIX s’ouvre, en revanche, sur le chagrin de Bégon, tenaillé par le désir de revoir son frère Garin et prêt, par conséquent, à se rendre à Metz. Je fais ici référence, pour la numérotation des laisses, à Garin le Loherenc (éd. Anne Iker-Gittleman), Paris, Honoré Champion, coll. « Classiques français du Moyen Âge », nos 117-119, 1996-1997. Il convient de préciser que le cycle se présente, dans ce témoin, comme un ensemble homogène, dépourvu de tout principe de détachement de ses composants : seul le début des laisses est marqué par une lettre rouge ou bleue sur deux unités de réglure (en alternance), qui peut aussi se situer à l’intérieur des laisses très longues ; pour le reste, aucun ornement ne rehausse le début des différents textes, si l’on excepte l’enluminure du frontispice, et n’apparaissent que deux lettres « puzzle » (en rouge et bleu), celle entrecoupant Garin au fol. 77ro, sur sept unités de réglure, et celle marquant le début de la seconde partie d’Anseÿs de Gascogne, au fol. 148vo, sur huit unités de réglure (au début de la laisse XVII dans Anseÿs de Mes According to Ms. N (Bibliothèque de l’Arsenal 3143) [éd. Herman J. Green], Paris, s. n., 1939), à l’endroit même où ce témoin rejoint la version commune de la chanson de geste (voir YM, p. 55-57).
-
[26]
Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 3143, fol. 77b46-49 : « Ce texte en français appartient à Jacques de Paris./Puisse-t-il, enfin, être pendu bien haut celui qui le dérobera./Sachez qu’il a été écrit à Saint-Quentin,/dans la demeure de Robert d’Ardenne Houdebin. » (Celle du second vers est une formule de malédiction courante dans les colophons de l’époque : voir Jean-François Genest, « Un objet précieux mais menacé », dans Jean Glénisson [dir.], Le livre au Moyen Âge, Paris, Presses du CNRS, 1988, p. 84). HM, p. xiv interprète la dernière unité graphique du quatrain comme une indication de provenance (« hou de Bin »), renvoyant à une localité proche de Bastogne, dans l’Ardenne belge (plus prudent, YM, p. 47 : « hou de Bin [Houdebin ?] »). La partie correspondante de ce fol. 77ro est reproduite par Keith Busby, Codex and Context. Reading Old French Verse Narrative in Manuscript, Amsterdam/New York, Rodopi, coll. « Faux titre », 2002, t. II, p. 710, fig. VII, 9.
-
[27]
Voir les observations d’Olivier Legendre, art. cit., p. 183 au sujet du colophon du ms Laon, Bibliothèque municipale, 456, fol. 95vo.
-
[28]
Voir déjà, dans ce même sens, la remarque de Keith Busby, op. cit., p. 706-707.
-
[29]
Olivier Legendre, art. cit., p. 183 : « Plus le colophon est intégré dans le texte soit matériellement soit par sa formulation, plus il est à regarder avec suspicion. »
-
[30]
Pour d’autres hypothèses concernant les passages successifs des matériaux épiques élaborés en amont de notre petit groupe de témoins, ainsi que par ses membres, voir Jean-Charles Herbin, art. cit., p. 131-150, Jindrich Zezula, « “Garin le Loherain” et l’abbaye de Saint-Amand », Romania, vol. XCI, 1970, p. 289-305 et Jean-Charles Herbin, « Variations, vie et mort des “Loherains”. Réflexions sur la gestation et les paradoxes d’un grand cycle épique », Cahiers de Recherches Médiévales (xiie-xve siècles), vol. XII, 2005, p. 155, n. 33 : elles ont trait aux abbayes de Saint-Amand, au nord de Valenciennes, et de Saint-Nicaise de Reims. Marcel Dando émettait des spéculations beaucoup plus hasardeuses dans « Récits légendaires et apocryphes dans le manuscrit français L.II.14 de la Bibliothèque Nationale de Turin », Cahiers d’Études Cathares, vol. XXXI, no 88, 1980, p. 5 et 22-23 : « l’animateur-arrangeur » du recueil de Turin serait un « moine de l’abbaye de Saint-Bertin dans la ville de Saint-Omer » et le commanditaire, « un marchand aisé de Saint-Omer ».
-
[31]
Par liber aureus on désigne habituellement le manuscrit luxueux conservé dans le trésor de l’église, auquel la communauté religieuse avait recours dans des circonstances assez rares, comme pour les lectures des offices des fêtes du saint patron (ou de la sainte patronne) ou des serments de fidélité.
-
[32]
Alison Stones, « L’atelier artistique de la Vie de sainte Benoîte d’Origny : nouvelles considérations », Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France, 1990, p. 378-400.
-
[33]
François Avril, « Manuscrits », dans L’art au temps des rois maudits, Philippe le Bel et ses fils, 1285-1328, Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1998, p. 303.
-
[34]
Ibid.
-
[35]
Le travail de Simonetta Castronovo, op. cit., p. 55-69 et 75-79, n. 73-129, p. 194-206 et 215-219, n. 25-67, pl. vi-xi et fig. 21-39 est centré sur le recueil de Turin, tandis que les recherches d’Ingrid Gardill, « La Vie de sainte Benoîte », Art de l’enluminure, vol. IX, juin-août 2004, p. 2-68 et Sancta Benedicta. Missionarin, Märtyrerin, Patronin. Der Prachtcodex aus dem Frauenkloster Sainte-Benoîte in Origny, Petersberg, Michael Imhof, coll. « Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte », 2005 ont comme point de départ l’étude du codex de Berlin. Sur celui-ci, et sur le tome M 805 de New York, revient le riche catalogue d’exposition d’Elizabeth Morrison et Anne D. Hedeman (dir.), Imagining the Past in France. History in Manuscript Painting, 1250-1500, Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, 2010, p. 21-22, 23, fig. 17, p. 25, n. 30-32 et p. 121-126. Je renvoie à ces publications pour des dossiers photographiques conséquents.
-
[36]
Alison Stones, art. cit., p. 393-396.
-
[37]
Voir Olivier Collet, Étude philologique et littéraire sur « Le Roman de Jules César », Genève, Droz, coll. « Publications romanes et françaises », no 207, 1993, p. 14.
-
[38]
Simonetta Castronovo, op. cit., p. 62. En tête de la fiche consacrée au recueil de Turin (8), la spécialiste place toutefois une option différente : « Saint-Quentin (?) » (p. 194).
-
[39]
François Avril, art. cit., p. 298-304 classe le Lancelot en prose de New York (4) parmi les spécimens de la « production amiénoise » (p. 298), mais il suggère ensuite « Saint-Quentin ? Laon ? » (p. 303). De même, Alison Stones, « “Mise en page” in the French “Lancelot-Grail” : the First 150 Years of the Illustrative Tradition », dans Carol Dover (dir.), A Companion to the « Lancelot-Grail Cycle », Cambridge, Brewer, coll. « Arthurian Studies », 2003, p. 128, 130 et 137, ne tranche pas, entre Amiens et Laon. Ingrid Gardill, art. cit., p. 19, propose « la Picardie (Amiens, Saint-Quentin, Laon) comme la région dans laquelle le Maître de sainte Benoîte et ses collaborateurs isolés devaient être actifs » et croit que l’exécution du liber aureus (1) a eu lieu dans l’abbaye d’Origny-Sainte-Benoîte elle-même, où l’on aurait réuni l’équipe assistant le maître principal et d’où proviendrait la responsable de la copie de la plupart du manuscrit, « une femme écrivain du couvent d’Origny-Sainte-Benoîte » (p. 16 ; d’où la localisation à Origny-Sainte-Benoîte des recueils de Londres [3] et Turin [8] avancée par Frankwalt Möhren, op. cit., col. 808 et 875). Au sujet de ce dernier (8), Andreas Bräm, compte rendu de Simonetta Castronovo, op. cit., Kunstchronik, vol. LVI, 2003, p. 233, hésite entre Tournai et Laon.
-
[40]
C’est Alison Stones, art. cit., p. 386 et 388, qui a souligné l’esprit éclectique de cet artiste illustrant des textes de nature très différente (dévotionnelle, hagiographique, littéraire, scientifique), adoptant des formules variées d’intervention (enluminure en pleine page, à scène unique ou en compartiments ; vignette rectangulaire ; lettre historiée) et calibrant l’engagement qualitatif sur la commande.
-
[41]
Ingrid Gardill, op. cit., p. 228-229.
-
[42]
Alison Stones, art. cit., p. 382-386.
-
[43]
Ibid., p. 389.
-
[44]
Ibid., p. 388-392 et 397-400 et Ingrid Gardill, op. cit., p. 199-200 et 221.
-
[45]
Alison Stones, art. cit., p. 384 et Ingrid Gardill, op. cit., p. 196-198 et 200-201. Ces feuillets contiennent deux enluminures en pleine page entourées de tituli : Vierge à l’enfant en trône ; Christ en croix assisté par Marie et Jean (ibid., p. 222-223, fig. 50-51).
-
[46]
Ibid., p. 224.
-
[47]
Ibid., p. 12-13.
-
[48]
Au sujet du partage du travail de décoration et d’illustration du recueil, Simonetta Castronovo, op. cit., p. 60-69 et 76-77, n. 92 a identifié, aux côtés du maître, deux assistants : l’un exécute une seule enluminure, au fol. 47vo (le Baptême du Christ), et il correspondrait à l’artiste responsable de l’illustration du Roman de la Rose du ms München, Staatsbibliothek, gall. 17 (mais elle a été assignée au célèbre et prolifique Maître du Fauvel, actif entre 1314 et 1340 environ, par Richard H. Rouse et Mary A. Rouse, op. cit., vol. II, p. 197) ; l’autre, beaucoup plus sollicité, pourrait avoir suivi le même itinéraire de formation du maître principal et se tient dans son sillage. La spécialiste tente également de prouver (p. 55-56) que le recueil est entré dans les collections des Savoie au temps du comte Amédée V (1285-1323), mais la faiblesse de ses arguments est opportunément pointée par Alessandro Vitale Brovarone, « “Beati qui non viderunt et crediderunt ?” Opinions et documents concernant quelques manuscrits français de la Bibliothèque nationale de Turin », dans Tania Van Hemelryck et Maria Colombo Timelli (dir.), Quant l’ung amy pour l’autre veille. Mélanges de moyen français offerts à Claude Thiry, Turnhout, Brepols, coll. « Texte, codex & contexte », no 5, 2008, p. 458. Celui-ci rappelle in fine que « on est fortement tenté de voir dans la constitution des fonds français qui aujourd’hui se trouvent à la Bibliothèque nationale de Turin, non pas une continuité du Moyen Âge à nos jours, mais la volonté de rétablir et de reconstituer, après les guerres du xvie siècle, un passé digne et noble » (p. 461). Sauf erreur de ma part, la première mention de notre recueil dans la bibliothèque des Savoie date de 1713 (Index alphabétique des livres qui se trouvent en la Bibliothèque Royale de Turin en cette année 1713 [ms Torino, BNU, R.I.5], p. 660, no 79).
-
[49]
Évidemment, Ursule et ses compagnes faisaient partie des saintes honorées dans l’abbaye d’Origny-Sainte-Benoîte, comme l’atteste la légende latine conservée aux p. 829-834 du ms Saint-Quentin, Bibliothèque municipale, 86. Il s’agit d’une sorte de contrepartie du liber aureus, destinée à l’usage courant au sein du monastère, dépourvue d’enluminures mais à la palette de textes beaucoup plus chargée. L’essentiel du volume a été réalisé en 1315-1316 sous l’impulsion du mécène habituel, Heluis de Conflans, mais d’autres matériaux y ont été greffés par la suite. Le texte latin sur sainte Ursule, qui s’arrête avant le martyre de Cologne et ne laisse pas Benoîte s’introduire dans le récit, figure, d’après Robert Marichal, « Les drames liturgiques du “Livre de la Trésorerie” d’Origny-Sainte-Benoîte », dans Mélanges d’histoire du théâtre du Moyen-Âge à la Renaissance offerts à Gustave Cohen par ses collègues, ses élèves et ses amis, Paris, Nizet, 1950, p. 38-40, au sein d’une section appendiculaire (no 10 : p. 627-856) intégrée au noyau du volume à la fin du xve siècle, mais transcrite probablement par l’une des mains actives en 1315-1316 (Ingrid Gardill, art. cit., p. 6, en reproduit la p. 777).
-
[50]
Voir Per Nykrog, Les fabliaux. Étude d’histoire littéraire et de stylistique médiévale, Genève, Droz, coll. « Publications romanes et françaises », no 123, 1973 [1957], p. 15, Roy J. Pearcy, Logic and Humour in the Fabliaux. An Essay in Applied Narratology, Cambridge, Brewer, coll. « Gallica », 2007, p. 143.
-
[51]
Les fol. 584-586 du recueil de Turin ayant brûlé en 1904, le texte nous est préservé dans Recueil général et complet des fabliaux des xiiie et xive siècles imprimés ou inédits (éd. Anatole de Montaiglon et Gaston Raynaud), Paris, Librairie des bibliophiles, 1877,vol. II, p. 1-7 et 309, d’après la transcription prise par Edmund Stengel (voir d’ailleurs Edmund Stengel, op. cit., p. 38). C’est sur cette édition que se fonde Nouveau recueil complet des fabliaux (NRCF) (éd. Willem Noomen et Nico Van den Boogaard), Assen/Maastricht, Van Gorcum, 1986, vol. III, p. 205-209 et 433-435. Dorénavant désigné à l’aide des lettres NRCF, suivies du numéro de la page.
-
[52]
Le conte de l’enfant donnant une leçon à son père, fils ingrat, est un exemplum ayant joui d’une diffusion considérable au Moyen Âge, comme l’atteste, par exemple, Jacques de Vitry dans ses Sermones vulgares. Je donne ici un résumé de la version II du fabliau, attestée par le recueil de Turin, version qui paraît être d’origine picarde (voir NRCF, p. 433).
-
[53]
Leslie C. Brook, « The Moral of “La Housse Partie” », Romanische Forschungen, vol. CVII, 1995, p. 396-401.
-
[54]
Sulpice Sévère, Vie de saint Martin (éd. Jacques Fontaine), Paris, Les éditions du Cerf, coll. « Sources chrétiennes », 1967, vol. I, p. 258 et 259 : « Donc, la nuit suivante, quand il se fut abandonné au sommeil, il vit le Christ vêtu de la moitié de la chlamyde dont il avait couvert le pauvre. […] Puis il entend Jésus dire d’une voix éclatante à la foule des anges qui se tiennent autour d’eux : “Martin, qui n’est encore que catéchumène, m’a couvert de ce vêtement.” En vérité, le Seigneur se souvenait de ses paroles, lui qui avait proclamé jadis : “Chaque fois que vous avez fait quelque chose pour l’un de ces tout-petits, c’est pour moi que vous l’avez fait”, quand il déclara avoir été vêtu en la personne de ce pauvre […]. » La citation de Jésus, faite de mémoire par Sulpice Sévère, paraît combiner les éléments de deux versets du célèbre passage évangélique sur les oeuvres de miséricorde (Mt 25, 40 et 45).
-
[55]
NRCF, p. 207 : « une de tes vieilles housses,/celles que tu utilises pour couvrir tes chevaux. »
-
[56]
Kurt Baldinger et Frankwalt Möhren, Dictionnaire étymologique de l’ancien français H4-H5, Tübingen, Max Niemeyer, 2000, col. 624 et 623.
-
[57]
Sulpice Sévère, op. cit., 1968, vol. II, p. 473-474. Voir aussi Sabine Kimpel, « Martin von Tours », dans Wolfgang Braunfels (dir.), Lexikon der Christlichen Ikonographie, Freiburg im Breisgau, Herder, 1990, vol. VII, col. 572-579.
-
[58]
NRCF, p. 203 et Willem Noomen, « À propos d’une ficelle de métier : noms de saints dans les fabliaux », dans Miscellanea di studi in onore di Aurelio Roncaglia a cinquant’anni dalla sua laurea, Modène, Mucchi, 1989, vol. III, p. 922. D’autres exemples d’emploi significatif du nom du saint évêque de Tours dans les fabliaux sont discutés dans ibid., p. 917 et par Anne Cobby, « “Saint Amadour et sainte Afflise” : Calling upon the Saints in the Fabliaux », dans Adrian P. Tudor et Alan Hindley (dir.), Grant Risee ? The Medieval Comic Presence. Essays in Memory of Brian J. Levy, Turnhout, Brepols, coll. « Medieval Texts and Cultures of Northern Europe », 2006, p. 175-176 et 188-189.
-
[59]
NRCF, p. 202 : « […] avec son couteau. »
-
[60]
Le fait que le Maître de sainte Benoîte ait peint la scène de la Charité de saint Martin dans la drôlerie de la marge de queue du fol. 291ro du ms L.II.14 de Turin ne sera donc qu’un reflet de cette popularité : le saint cavalier y partage son manteau avec l’épée, à l’intention d’un nécessiteux (voir Simonetta Castronovo, op. cit., p. 68-69 et fig. 36). Il est tout de même curieux qu’il s’agisse de la seule scène à caractère sacré introduite par le maître au sein de cette ornementation secondaire. Son répertoire iconographique se borne en effet ici aux animaux et aux créatures hybrides et fantastiques, aux joutes parodiques et aux scènes de chasse, de fauconnerie et de jeux en plein air — rien de plus normal, étant donné que « la grande majorité des motifs qui […] peuplent » les marges des manuscrits contemporains « évoquent le monde de la chasse, de la musique, de la danse et des jeux, dans le but de flatter les goûts d’une clientèle aristocratique dont ce sont les passe-temps » (Jean Wirth, Les marges à drôleries des manuscrits gothiques [1250-1350], Genève, Droz, coll. « Matériaux pour l’histoire », 2008, p. 39). Bien évidemment, cette drôlerie du fol. 291ro n’a aucun rapport avec le texte transcrit plus haut (Auberon) ni avec l’enuminure campée sur la même page (fol. 291a) : celle-ci, qui s’inspire du schéma traditionnel de la Nativité de la Vierge, représente la naissance des jumeaux de Jules César et Morgain, Auberon et Georges, à laquelle président trois fées formant des voeux pour les nouveaux-nés ; elle est placée entre la fin de la laisse XXX, consacrée à la double naissance et aux voeux, et le début de la laisse XXXI (v. 1423-1429), dans lequel les barons accourent pour se féliciter et nommer les jumeaux (voir Simonetta Castronovo, op. cit., fig. 27). Pour ce prologue de Huon de Bordeaux attesté uniquement par le recueil de Turin, dans lequel on forge une généalogie mirobolante à Auberon (Judas Macchabée est son ancêtre, Jules César son père, la fée Morgain, soeur du roi Arthur, sa mère, saint Georges son frère jumeau, etc.), voir Le Roman d’Auberon. Prologue de « Huon de Bordeaux » (éd. Jean Subrenat), Genève, Droz, coll. « Textes littéraires français », no 202 1973 ; pour quelques occurrences de la scène de la Charité dans les drôleries des manuscrits gothiques, voir Lilian M. C. Randall, Images in the Margins of Gothic Manuscripts, Berkeley/Los Angeles, University of California Press, coll. « California Studies in the History of Art », 1966, p. 208 et fig. 622.