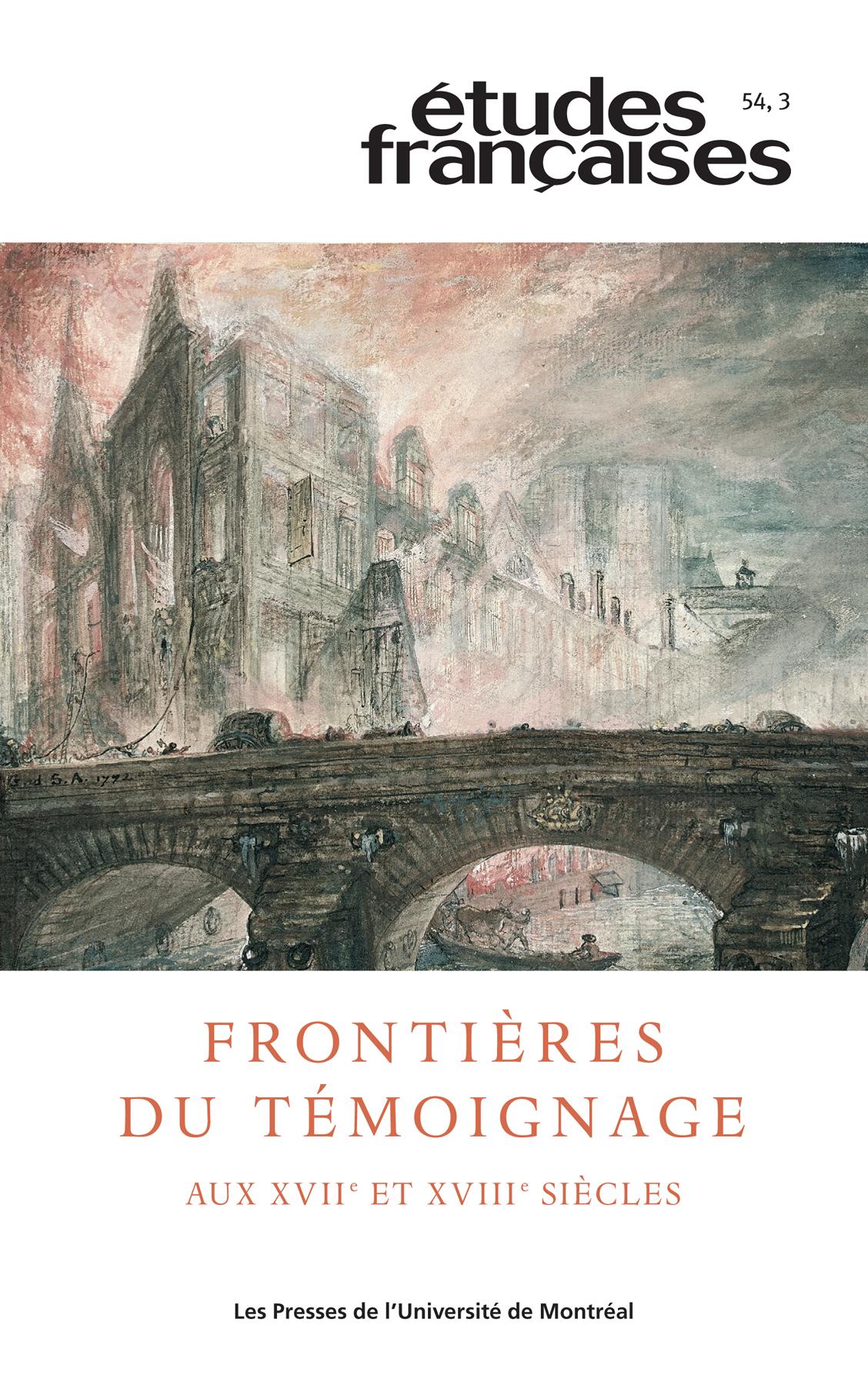Article body
Qu’est-ce donc qu’un témoignage ? quelle est sa place, quel est son rôle en littérature ? Sans circonscrire entièrement l’objet de ce dossier, de telles questions doivent sans doute en former le socle[1]. Au début de la modernité, sous ce qu’il est en France convenu d’appeler l’Ancien Régime, au cours des xviie et xviiie siècles en particulier, qui fournissent aux articles ici rassemblés leur cadre chronologique et leur matière première, le monde de l’écrit est encore déterminé par l’héritage humaniste. Ce que l’on appelle alors les lettres – comme dans l’expression République des Lettres – ou les belles lettres embrasse aussi bien la poésie, les ouvrages d’éloquence et la critique, que les histoires vraies ou fausses, les dialogues philosophiques, les genres moralistes et même les sciences exactes. « Les vraies belles lettres, affirmait ainsi Furetière en 1690, sont la physique, la géométrie et les sciences solides » (s.v. lettres). Or ce sont les accointances des lettres avec l’histoire et avec le droit – par le biais de la rhétorique et de l’art oratoire, comme par la formation juridique fréquente des écrivains, de Corneille à Marivaux et à Sénec de Meilhan – qui éclairent en son sein le jeu des témoignages.
Les anciens lexicographes définissaient le témoignage comme « attestation, relation d’une vérité », et particulièrement comme « passage d’un Auteur, ou autre personne notable, qui dit ou affirme avoir vu ou cru quelque chose » (Furetière, s.v.) ; ou bien comme le « [r]apport d’un ou de plusieurs témoins sur un fait, soit de vive voix, soit par écrit » (Acad., 1762, s.v.). On lui donnait également le sens de signe, de marque, de preuve : « se dit aussi des indices, des preuves qu’on tire souvent des choses inanimées » (Fur., s.v.). Enfin, il pouvait prendre le sens atténué de « simple recommendation, ou asseurance » (ibid.). Si le rapport du témoignage à la preuve, si les emplois juridiques et religieux – martyr, par exemple, vient de márturos (témoin) – donnent au témoignage à l’âge classique une coloration particulière, il possède aussi d’autres champs d’application, au premier rang desquels figure l’histoire. Depuis l’Antiquité, en effet, l’histoire est définie, dans les traités qui lui sont consacrés, les artes historicae[2], par le rappel de formules reprises de Cicéron : « Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis » (De Oratore, II, 9, § 36) : « L’histoire enfin, témoin des siècles, flambeau de la vérité, âme du souvenir, école de la vie, interprète du passé[3]. » De tels éloges, l’éminence de son objet, le lustre de ses modèles ont fait de l’histoire le plus noble des genres en prose, suscitant l’ambition d’écrivains doués – Racine, Voltaire, Chateaubriand furent tous trois décorés en leur siècle du titre d’historiographes de France. Les notions étroitement associées de témoignage et de vérité précisent ensemble la visée de l’histoire et ses moyens : ce sont les témoignages authentiques et dignes de foi qui lui fournissent presque seuls ses informations, le recours aux archives n’étant devenu un réflexe que bien plus tard. Longtemps, le témoignage, dans lequel s’extériorise « la mémoire déclarative[4] », est resté au fondement de la vérité historique, jusqu’à la révolution de méthode et d’esprit qui devait placer la critique des sources au principe du travail de l’historien[5]. À ce titre, il remonte à l’autopsie (attesté en français dès 1573) par laquelle les historiens grecs assuraient avoir vu de leurs propres yeux (autos + opsis) ce qu’ils rapportaient : « je suis allé et j’ai vu de mes yeux (autoptes) jusqu’à la ville d’Éléphantine ; de l’au-delà je parle par ouï-dire (akoe) » (Hérodote, Histoires, II, 29). Voilà en somme l’origine du genre des Mémoires, qui érige à partir du xvie siècle la parole brute du témoin en discours historique à part entière[6]. Même dans son inflexion autobiographique, comme chez Rousseau, c’est encore foncièrement d’un témoignage qu’il s’agit, d’un plaidoyer pro domo sua, présenté à la barre d’une sorte de tribunal public dans un procès en véridiction et affichant sa prétention à être cru sur sa parole.
Cette littérature de témoignage[7] englobe en sus des Mémoires plusieurs autres types d’oeuvres : correspondances, diaires, récits de voyage, voire testaments (de testis, témoin) politiques ou spirituels : toutes celles qui rapportent de première main l’expérience de choses vues, entendues ou faites par celui qui tient la plume, une variété dont les articles de ce dossier peuvent donner une idée, sans prétendre les embrasser toutes. Quelques-unes ont connu d’importants développements au cours de la période qui nous occupe et qui va du règne de Louis XIV à la Révolution, avec des temps forts spécifiques à chacune d’entre elles. La vogue qu’a connue le genre des Mémoires coïncide par exemple avec la fin de la Fronde (1648-1652), maints perdants de la guerre civile, relégués sur leurs terres, y ayant consigné sous cette forme leur témoignage afin de défendre leur action et leur réputation. La publication massive de ces textes après la mort du Roi-Soleil a par la suite encouragé des particuliers que parfois rien ne prédisposait à faire de même à prendre la plume à leur tour : simples particuliers, certains d’extraction fort modeste, paysanne comme Pierre Prion ou Valentin Jamerey-Duval, ouvrière comme Jacques-Louis Ménétra. Elle a également retenti sur la pratique d’autres genres, le journal d’événements par exemple, surtout vers la fin du siècle, la Révolution ayant favorisé une recrudescence de témoignages de toutes factures ; ou le roman, qui en a largement adopté l’allure et les codes – qu’on pense à ceux de Lesage et de Challes, de Boyer d’Argens, de Marivaux ou de Prévost par exemple –, au point que le témoignage apparaît comme l’une des formes que revêt la fiction lorsqu’elle cherche à garantir son affabulation[8]. Aussi le témoignage est-il un élément du pacte de lecture au seuil de textes qui prétendent jouir de la créance du public, une pièce de leur dispositif de validation du savoir, un argument de leur discours. Et comme rien ne distingue essentiellement l’image restituée par la mémoire de celle que forge l’imagination, rien ne permet à coup sûr au lecteur de les départager. De là les soupçons qui pèsent sur le témoignage, vulnérable et susceptible d’erreur aussi bien dans la perception qui en est la source que dans l’anamnèse qui la ressuscite et dans l’énoncé qui la communique[9]. Le cas des Mémoires du cardinal de Retz, écrits un quart de siècle après les faits, est à cet égard paradigmatique. Lui dont le duc de La Rochefoucauld disait qu’il devait plus à son imagination qu’à sa mémoire[10], et dont le témoignage sur la Fronde fut un immense succès de librairie, a constellé son récit de circonstances séduisantes mais douteuses, en homme habitué à captiver son auditoire. La critique les a soigneusement relevées ; et tels épisodes célèbres, comme la rencontre des capucins noirs, apparaissent à ce prisme comme des morceaux de bravoure composés avec d’autant plus de liberté qu’ils n’engageaient rien d’essentiel au déroulement des faits. À la manière des romans, les Mémoires logent ainsi la fiction dans les anecdotes qui sont les creux de l’histoire publique : le diable se dissimule dans les détails.
De ses divers emplois, et de la géométrie changeante qu’ils supposent dans son rapport avec les faits, découlent au reste les limites du témoignage : enfermé dans son regard, le témoin ne dispose pas d’une vision panoptique ; les choses qu’il n’a pu voir forment la première de ces limites, à la frontière du rapport d’autrui, auquel il est forcé de recourir à l’occasion. Au reste, même en ce qu’il sait de première main, le témoin peut être révoqué en doute, car il est prisonnier d’une perspective. La mise en question d’un témoignage par un autre, au coeur du principe juridique du contradictoire, est également cruciale dans l’établissement de la vérité historique ; et l’on sait comment la subjectivité des mémorialistes les a enfin discrédités dans l’historiographie positiviste, alors même que leur point de vue de témoins privilégiés avait longtemps fondé l’autorité de leur parole. Encore pour exercer une telle critique faut-il disposer d’une abondance de témoignages ; mais leur caractère fragmentaire, leur paucité, voire leur absence pour une époque ou pour un événement donné forme une seconde frontière : celle de la tradition, de la rumeur ou de la fable. Au xviiie siècle, les érudits ont cherché à parer la critique dissolvante des sceptiques en explorant les marges du témoignage et en convoquant ces témoins muets que sont les débris matériels, les données de la géographie ou les relevés de l’astronomie, sciences appelées à devenir les auxiliaires de l’historien. À rebours, il arrivait qu’on disposât d’un témoignage écrit détaillé mais unique – testis unus, testis nullus, disait prudemment la maxime juridique –, comme dans tel récit de voyage en des terres inconnues, produit par un explorateur qui pouvait aussi bien être un menteur ou l’auteur d’un roman. Cette frontière de la fiction, que l’on retrouve dans la chronique scandaleuse, dans le roman à la première personne, dans la nouvelle ou le canard, voit dans certaines oeuvres son périmètre brouillé, et l’imagination fondue dans les faits. Ce sont ces diverses frontières, leurs enjeux et leur fonctionnement, que nous avons souhaité explorer dans une série de contributions portant sur des ouvrages de littérature factuelle, sur des débats théoriques, sur des oeuvres de fiction.
Notre dossier commence par deux articles consacrés à l’emploi du témoignage dans le roman. Marie-Pierre Krück a choisi de se pencher sur l’Histoire des Sévarambes (1677) de Denis Veiras, une utopie présentée comme un ouvrage d’histoire et de géographie, et dans laquelle l’auteur recourt aux procédés attendus des récits de voyage, notamment celui de l’autopsie – le témoignage oculaire – pour avérer son récit[11]. Pourtant, celui-ci est sans cesse déstabilisé par les voix qui le tissent et qui mettent en cause l’unité épistémologique du témoin, et par les éléments dystopiques qui minent subtilement ce monde parfait. Ces failles affectent tant l’ethnographie que l’historiographie de la relation du capitaine Siden et la frappent d’incertitude, comme si la rhétorique persuasive du témoignage était travaillée par une rhétorique inverse, de manière à souligner la fonction purement critique du récit. Un phénomène similaire quoique distinct affecte l’Histoire d’une Grecque moderne (1740) de l’abbé Prévost, qu’analyse Audrey Faulot. Le narrateur, démarqué de Ferriol, ancien ambassadeur de France auprès de l’Empire ottoman, raconte à la première personne son histoire d’amour pour Théophé, mais en se présentant comme rendu suspect par sa violente passion. Le mémorialiste fictif jette ainsi le doute sur son propos. Mais si son témoignage ne peut garantir l’accès à la vérité historique, il peut du moins fournir une généalogie de ses erreurs, en déplaçant l’attention vers la façon dont la mémoire fonctionne et dont s’élaborent les biais, c’est-à-dire vers la subjectivité elle-même.
Cette portée épistémologique fait le lien avec les articles suivants, qui mettent en question la connaissance par le témoignage, ses dimensions objectale et subjective, le long de lignes de faille avec la tradition, avec la vision personnelle du monde, avec le point de vue des autres. Au cours des années 1722-1724, quelques savants de l’Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres débattirent vigoureusement du degré de foi qu’il fallait accorder aux oeuvres historiques anciennes lorsque les rares témoignages contemporains des faits qu’elles relataient et sur lesquels elles auraient pu s’appuyer paraissaient douteux, réduits à la simple tradition, comme c’était le cas pour les premiers siècles de Rome. En me penchant sur les textes de cette querelle, j’ai voulu réfléchir au rôle tenu à l’époque par le témoignage dans la connaissance historique, aux conséquences de sa raréfaction, de sa fragmentation, voire de son absence. Cet épisode éclaire la lente transition d’une pratique littéraire de l’histoire à sa pratique scientifique, le rôle des monuments, des traités, des lois, des relevés astronomiques et des autres archives qui ne transcrivent ni témoignage ni mémoire personnelle. À l’autre extrémité du spectre, à la frontière objectale entre le témoignage factuel et le témoignage religieux, le genre du testament moral (testatio mentis) exprime la vision du monde d’un homme au soir de sa vie. Louis Laliberté-Bouchard s’intéresse à celui de Philippe Fortin de La Hoguette (1648), dans un article qui éclaire à la fois la dimension biographique du genre testamentaire et le legs pédagogique qui en découle, l’enseignement d’un père à ses enfants y apparaissant comme un bien à part entière. Enfin, Pascal Bastien et Guillaume Mazeau réfléchissent ensemble à ce qui sépare deux témoignages sur les mêmes événements, problème qui intéresse l’histoire, soucieuse des pratiques d’écriture et de la nature des sources, mais qui illustre aussi le phénomène littéraire de l’individualité du texte et de l’univers qu’il construit. Ils confrontent ici les comptes rendus contrastés des premiers mois révolutionnaires (mai-octobre 1789) par Siméon-Prosper Hardy (P. Bastien) et par Adrien Duquesnoy (G. Mazeau). Souvent présentés comme des « journaux », les manuscrits constituent surtout des notes à partager, par cahiers, lettres ou lectures publiques, dans les réseaux où l’un et l’autre s’inscrivent. Hardy et Duquesnoy offrent dans un intéressant jeu de miroir, à l’aune de parcours et de temporalités différents, le regard sur Paris et Versailles de deux « révolutionnaires ordinaires ».
À l’issue de cette livraison – où vont de conserve histoire et littérature, littéraires et historiens –, nous espérons que le lecteur se fera du témoignage dans les lettres d’Ancien Régime une idée plus précise, depuis le périmètre de sa présence et les rôles qu’il joue, jusqu’aux problèmes qu’il pose, parfois irrésolus.
Appendices
Note biographique
Frédéric Charbonneau, professeur titulaire à l’Université McGill, se consacre à l’histoire littéraire des xviie et xviiie siècles dans trois domaines principaux : les Mémoires, l’histoire des idées sur la gastronomie et les rapports entre littérature et médecine. Il est l’auteur ou l’éditeur d’une douzaine de livres, notamment Ondes de choc. Paysage intérieur de Saint-Simon (Paris, Classiques Garnier, à paraître), L’école de la gourmandise (Paris, Desjonquères, coll. « L’esprit des lettres », 2008) et Les silences de l’Histoire. Les Mémoires français du xviie siècle (Québec, Presses de l’Université Laval, « Les collections de la République des lettres », 2001 ; réédition Paris, Hermann, coll. « Les collections de la République des Lettres », 2016).
Notes
-
[1]
Sur ces questions qui, pour l’Ancien Régime, engagent simultanément l’histoire et la littérature, voir notamment la livraison de la revue Dix-huitième siècle, no 39, 2007, sur le témoignage ; voir aussi de Christian Jouhaud, Dinah Ribard et Nicolas Schapira, Histoire, littérature, témoignage : écrire les malheurs du temps, Paris, Gallimard, coll. « Folio histoire », 2009 ; et de Carole Dornier, « Le récit de témoin : la littérarité du factuel » dans Dominique Maingueneau et Ruth Amossy (dir.), Colloque de Cerisy 2-8 septembre 2002. L’apport de l’analyse du discours : un tournant dans les études littéraires, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2003, p. 405-416.
-
[2]
Gérard Ferreyrolle (dir.), Traités sur l’Histoire (1638-1677), Paris, Honoré Champion, coll. « Sources classiques », 2013.
-
[3]
Cicéron, De l’orateur, éd. E. Courbaud, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Collection des Universités de France », 2002, t. II, p. 20.
-
[4]
Paul Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 2000, p. 181.
-
[5]
Krzysztof Pomian, Sur l’histoire, Paris, Gallimard, coll. « Folio histoire », 1999.
-
[6]
Marc Fumaroli, « Les Mémoires, ou l’historiographie royale en procès », La diplomatie de l’esprit, Paris, Hermann, coll. « Savoir », 1994, p. 217-246 ; Frédéric Charbonneau, Les silences de l’histoire, Paris, Hermann, 2016 [2001].
-
[7]
Cette expression est bien sûr prise ici non dans le sens, aujourd’hui courant, que lui donnent les spécialistes de la Shoah, lesquels s’en servent pour désigner les écrits qui cherchent à rendre compte de l’indicible expérience concentrationnaire, ou de celle des grandes guerres modernes (voir par exemple l’ouvrage de Renaud Dulong, Le témoin oculaire. Les conditions sociales de l’attestation personnelle, Paris, Éditions de l’ÉHESS, coll. « Recherches d’histoire et de sciences sociales », 1998 ; et de Carole Dornier et Renaud Dulong, Esthétique du témoignage, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2005), mais dans une acception se rattachant à la définition du témoignage sous l’Ancien Régime que nous avons rappelée plus haut, et qui comprend les textes rapportant des événements auxquels le locuteur a assisté et dont il veut donner connaissance ou garantir la vérité. Paul Ricoeur souligne au reste le caractère singulier de ces témoignages « des anciens combattants et surtout des rescapés de la Shoah […] qui résistent à l’explication et à la représentation historiographique », op. cit., p. 202.
-
[8]
Voir l’ouvrage classique de René Démoris, Le roman à la première personne, du classicisme aux Lumières, Genève, Droz, coll. « Titre courant », 2002 [1975].
-
[9]
Frédéric Charbonneau, « Myopie et sidération. Les défaillances du témoignage chez les mémorialistes classiques », Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte, vol. xlii, no 3-4, 2018, p. 263-271.
-
[10]
François de La Rochefoucauld, Mémoires, éd. Louis Martin-Chauffier et Jean Marchand, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1964, p. 8-9.
-
[11]
Cf. Carole Dornier, « La rhétorique de l’autopsie, dans le Journal de voyage aux Indes orientales de Robert Challes (1721) », Dix-huitième siècle, no 39, 2007, p. 161-174.