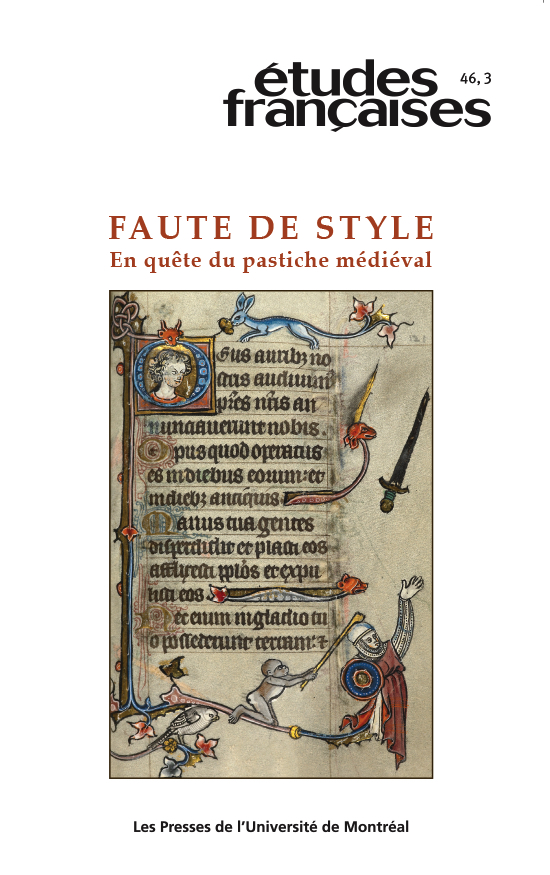Abstracts
Résumé
L’écriture du Chevalier aux deux épées (ca. 1240), roman anonyme conservé dans un manuscrit unique, relève à la fois du pastiche de genre et du pastiche de style à partir du modèle romanesque en vers instauré par Chrétien de Troyes. Les emprunts lexicaux et onomastiques témoignent tout d’abord de ce travail d’imitation qui reprend des traits récurrents du modèle pour mieux les détourner ou les gaber par amplification ou inversion. Situé dans le manuscrit BnF fr. 12603 avant Le chevalier au Lion, Le chevalier aux deux épées réécrit également deux grandes scènes de genre propres à ce roman : la joie de Calogrenant et la scène de lecture dans le verger de Pesme Aventure. Mais ici encore le pastiche est à l’oeuvre et transforme la réception et le sens initiaux de ces épisodes. Malgré l’intention affichée de renouer avec la tradition générique et formelle des romans en vers, le texte subit aussi l’influence des cycles et romans en prose dans le traitement des personnages, des motifs et de la narration. L’épisode crucial de l’épée qui saigne et de la révélation du nom du héros repose sur une réécriture globalisante de multiples traits figuratifs hérités à la fois du Conte du graal et des grands cycles du Graal. Ancré dans une double tradition qu’il se plaît parfois à malmener ou à amplifier, Le chevalier aux deux épées témoigne de la réception et de l’assimilation d’une masse romanesque considérable qu’il s’attache à renouveler autant qu’à perpétuer.
Abstract
The writing of the Chevalier aux deux épées (ca. 1240), a medieval romance preserved in a single manuscript, is inspired by the pastiche of genre and style based on the model of narrative literature set in verse by Chrétien de Troyes. Evident in this work are the lexical and onomastic borrowings that highlight and enhance the recurring features of the model through amplification and inversion. In the BnF fr. 12603 manuscript that precedes Le chevalier au lion (The Knight with the Lion), Le chevalier aux deux épées (The Knight of the Two Swords) also rewrites two major scenes of the romance : Calogrenant’s “joie,” and the reading scene in the orchard from Pesme Aventure. But here again pastiche is at play, transforming the initial reception and experience of these episodes. While renewal of the formal verse tradition and genre is clearly intended, the text succumbs to the influence of prose cycles and romances in its treatment of characters, motifs, and narration. The crucial episode of the bleeding lance and the revelation of the hero’s name entails a global rewriting of the many figurative traits passed down from the Story of the Grail and the great Grail Cycles. Rooted in a dual tradition that is often content to dissemble or embellish, Le chevalier aux deux épées has manifestly received and assimilated a massive corps of romance that it strives to renew and perpetuate.
Article body
Les romans arthuriens en vers comme Le Chevalier aux deux épées[1] composés dans les premières décennies du xiiie siècle, après les cycles en prose, donnent fréquemment une impression de retour à une forme et à un style romanesques propres aux romans de Chrétien de Troyes[2]. Il est pourtant difficile de considérer ces textes dans une simple relation de continuité avec l’oeuvre du maître champenois. En effet, l’éclosion et le développement des romans et cycles en prose marquent une rupture profonde dans le traitement de la matière arthurienne, rupture qu’il faut prendre en compte dans l’étude de ces romans en vers. Peut-on véritablement écrire à la manière de Chrétien après Robert de Boron et les auteurs anonymes des grands cycles ? Dans quelle mesure la prose serait-elle venue bouleverser ce qui se présente comme un exercice de réécriture plus ou moins inféodé au modèle proposé par Chrétien ?
Le problème des réécritures dans le roman arthurien pose inévitablement la question de la reprise narrative et thématique et celle de l’imitation stylistique. La première, quoique complexe et délicate, a été bien balisée dans les études médiévales et formalisée grâce à la notion de motif narratif et merveilleux[3]. La seconde soulève des difficultés au moins aussi grandes. Parler d’imitation stylistique pour les romans arthuriens semble à la fois anachronique et paradoxal, en raison du caractère instable et souvent anonyme des oeuvres[4]. Nul doute cependant que ces romans en vers du xiiie siècle aient non seulement subi de manière passive l’influence des oeuvres antérieures, mais qu’ils aient aussi sciemment commis des emprunts de toute nature, d’une simple tournure lexicale à la réécriture par amplification ou inversion, au détournement de passages clairement identifiables. Le caractère justement tardif du Chevalier aux deux épées dans la production romanesque arthurienne, en même temps que son immédiate proximité avec les textes sources — une cinquantaine ou une soixantaine d’années au plus le sépare de Chrétien de Troyes — en font ainsi un objet d’étude privilégié dans ce domaine. Le premier écueil auquel doit faire face le médiéviste dans le domaine des études de style est évidemment celui de la variante manuscrite. L’oeuvre retenue facilite en cela la tâche : le Chevalier aux deux épées est un hapax, placé en ouverture du manuscrit BnF fr. 12603 (fol. 1r-71v), juste avant Le Chevalier au Lion (fol. 72r-110r)[5]. Le contenu et l’organisation du manuscrit soulignent le lien entre ce roman tardif et l’oeuvre de Chrétien, en particulier avec le Chevalier au Lion qui sert probablement de modèle et de source d’imitation et de détournement pour le Chevalier aux deux épées. Dans ce contexte, il apparaît donc scientifiquement possible d’aborder cette oeuvre sous l’angle de l’imitation stylistique et de la reprise, c’est-à-dire du pastiche.
Cette notion récemment encore définie dans l’histoire littéraire par Paul Aron[6] semble a priori étrangère à la littérature médiévale, sans doute pour les raisons précédemment évoquées. En tant qu’« imitation des qualités et des défauts propres à un auteur ou à un ensemble d’écrits[7] », le pastiche implique effectivement l’existence d’un auteur et l’intentionnalité d’une pratique qui vise à marquer des traits expressifs propres à un texte, une oeuvre ou un genre, autant d’éléments qui contreviennent apparemment à la personne et à la fonction du copiste médiéval. Alors même qu’il exclut de son champ d’étude les textes médiévaux, Paul Aron dresse toutefois ce parallèle entre le conteur du xviie siècle et le pasticheur :
Comme le pasticheur, son écriture se fonde sur la reprise, sur la transformation d’un texte ou d’un scénario clairement identifié (oral ou écrit) en un texte nouveau dans lequel le créateur doit rester discret pour conserver toute sa visibilité à sa source première, et néanmoins être présent pour être apprécié par son public[8].
N’est-ce pas là, par définition, le processus essentiel de (re)création et de (ré)écriture propre à la littérature médiévale ? Entre 1230 et 1250, le public supposé du Chevalier aux deux épées avait certainement une connaissance intime de la matière arthurienne en vers et en prose pour laquelle il témoignait sans doute un intérêt particulier, sans quoi la composition même des oeuvres en vers tardives se serait vue compromise. Les propos cités réduisent par ailleurs la tension entre pure imitation stylistique et imitation de genre, et permettent de distinguer tout en les conciliant les notions de pastiche de style et de pastiche de genre. Le premier, limité à un texte court, repose sur une observation minutieuse préalable du texte source, tandis que le second « se donne comme l’imitation d’une oeuvre complète à partir d’un certain nombre d’échantillons[9] ». Aux contraintes génériques peuvent ensuite s’ajouter celles qui relèvent d’une expression particulière. Toutes deux se complètent alors plus qu’elles ne s’opposent :
Le pastiche, qu’il soit d’un genre ou qu’il soit d’un style, se caractérise en fait davantage par la reprise de procédés de tous ordres que par une thématique qui, se devant d’être appropriée à un projet singulier, se trouve dépourvue de toute valeur archétypale[10].
La tension inhérente à cette pratique se déplace alors des modalités de l’imitation aux rapports entre le texte source et le pastiche, entre la « reconnaissance et la destruction d’un genre convenu, qui a suffisamment fait ses preuves pour pouvoir être imité, mais dont l’autorité est vécue comme une contrainte[11] ». En ce sens, le Chevalier aux deux épées peut se lire comme un pastiche de la tradition en vers de la fin du xiie siècle et des romans de Chrétien en particulier, combinant imitation stylistique formelle au sein d’un même manuscrit et imitation et renouvellement d’un genre par l’identification et la reprise de motifs et de figures, par le traitement réservé au personnel romanesque et par l’apport de procédés et de figures caractéristiques de la prose.
Les types d’emprunts observés dans les textes de la deuxième génération nous renseignent sur ce qui est perçu comme caractéristique de l’oeuvre mère et sur la réception qui en est faite au cours du xiiie siècle. La reprise systématique de procédés lexicaux ou de données onomastiques favorise dans un premier temps le rapprochement entre les romans de Chrétien et le Chevalier aux deux épées. L’auteur semble en effet avoir repéré un certain nombre de traits lexicaux propres à des situations narratives récurrentes dont il systématise l’usage dans son propre texte. Les scènes d’ouverture lors d’une cour plénière font ainsi l’objet de pastiches de style, notamment dans la description de l’attitude pensive du roi. On se souvient à ce sujet du début du Conte du graal où « […] li rois Artus s’ert asis/au chief d’une table pansis ;/et tuit li chevalier parloient,/li un as autres deduisoient,/fors il qui fu pansis et muz[12] ». La scène revient à intervalles réguliers sur ce détail : « Li rois se test et ne dist mot/[…]./Li rois panse et mot ne li sone » (v. 922-924), jusqu’au moment où Arthur adresse enfin la parole à Perceval : « Li rois torne vers le vaslet/le chief que il tenoit beissié,/si a tot son pansé leissié » (v. 936-937). L’affliction du roi causée par l’outrage du Chevalier Vermeil devient dans le Chevalier aux deux épées une attitude topique que les circonstances n’expliquent pas toujours et où le verbe penser et ses dérivés fonctionnent comme des automatismes lexicaux, des signaux d’appartenance stylistique à la tradition des romans arthuriens en vers. Dans la scène d’ouverture, Arthur est pensis (v. 119) en raison de l’absence de Gauvain et de quelques autres chevaliers : « Li rois aval son cief broncha,/Et tout maintenant commencha/A penser […] » (v. 145-147). L’absence d’aventure le contrarie, et l’auteur d’insister : « Pour chou pensa il plus griément » (v. 157)/« […] Si pensa mout,/Et laissa le mengier trestout » (v. 163-164). Le sème du penser se retrouve en fait systématiquement dans toutes les scènes où apparaît le roi. Lors de la seconde cour plénière où le héros accomplit l’épreuve du baudrier, Arthur se montre encore après le repas « mout pensis » (v. 1504) et « mout pensans » (v. 1509). Quand la cour se déplace à Clamorgan, la même scène montre encore un roi qui « commence a penser » (v. 1901) et l’épisode s’achève sur l’image de l’homme pensis (v. 2383). À la fin du roman, le comportement d’Arthur n’a guère changé : « Et il fu pensis » (v. 11208), sans que rien ne le justifie alors. Tiré d’une situation donnée chez Chrétien, l’adjectif pensif qualifie désormais systématiquement le personnage d’Arthur ; il souligne par la récurrence d’un véritable automatisme lexical un stéréotype qui semble gagner de façon comique ou parodique toutes les figures royales.
Le roi Ris, ennemi déclaré d’Arthur et qui le provoque au début du roman en lui demandant de lui envoyer sa barbe, est lui aussi régulièrement qualifié de pensif. Lors du retour du messager de Ris auprès de son souverain, la scène d’ouverture à la cour arthurienne recommence sous la forme d’une mise en abyme pastichée et distanciée de ce qui précède. Le messager interrompt ainsi le repas de Ris comme il avait interrompu celui d’Arthur, tandis que Ris adopte une attitude pensive tout à fait comparable à celle de son rival : « Et li rois est de grant maniere/Iriés et pense une grant piece/[…]./Que ke li rois ensi pensoit […] » (v. 389-391). L’arrivée du nain qui lui impose une épreuve de la part de la dame d’Islande suscite encore la même réaction : « Ains ke de son pensé reviegne […] » (v. 425)/« Et li rois […]/A son pensé recommenchié./Quant li rois ot pensé assés,/De pour piece s’est pourpensé […] » (v. 440-444). La figure dédoublée du roi pensif est un clin d’oeil lexical et thématique à la tradition arthurienne en même temps qu’elle affiche une certaine distance grâce à la réécriture décalée du motif de la scène d’ouverture royale. Comme au début du Chevalier au Lion, l’aventure a en effet déserté la cour d’Arthur et l’arrivée impromptue d’un chevalier vêtu d’une « escarlate vermeille » (v. 169) n’est qu’un trompe-l’oeil narratif. Certes, la couleur vermeille associée en contexte à l’image du roi pensif évoque implicitement l’aventure du Chevalier Vermeil au début du Conte du graal, mais le nouvel arrivant n’est qu’un messager dont le défi ne permet pas réellement à la cour de renouer avec l’aventure.
Son intervention marque au contraire, par une curieuse technique d’entrelacement qui semble étrangère aux premiers romans en vers, l’effacement temporaire de la cour arthurienne du champ narratif. Au moment du départ, le récit suit en effet le messager à la cour de Ris et annonce cette bifurcation de manière apparemment topique : « Ichi lairons du roi ester,/Pour ce k’il nous couvient conter/Du messager […] » (v. 314-316). La technique de l’entrelacement inaugurée par Chrétien dans le Conte du graal et systématisée dans les cycles en prose diffère cependant, dans la mesure où à peine présenté, l’univers arthurien est ici délaissé au profit d’un univers parallèle. La technique de l’entrelacement entre deux séquences narratives repose généralement sur un élément de continuité représenté par un héros arthurien ou par un personnage familier du lecteur, en tout cas issu de l’espace de référence. Or le messager n’entre pas dans ce cas de figure. La continuité narrative est ainsi détournée au profit de la mise en perspective d’épisodes construits sur un parallèle thématique et lexical appelant le lecteur à la comparaison. Celle-ci débouche sur un jugement sans appel : c’est bien à la cour de Ris qu’interviennent désormais merveilles et aventures, non à celle d’Arthur. L’arrivée d’un nain « petit a desmesure » (v. 394), monté sur une mule « plus blanche ke n’est nois negie » (v. 397), muni d’une corgie de soie et d’ivoire, porteur des pastures d’or et de cristal envoyées par la dame d’Islande n’ont pas d’équivalent dans l’ouverture arthurienne, laquelle se solde au contraire par l’humiliation et la mélancolie du roi. La scène concentre toutes les figures stéréotypées de la merveille porteuse d’action et d’aventure : préciosité des matériaux, couleur blanche de l’animal, taille exceptionnellement petite du nain : autant d’éléments qui évoquent, par exemple, l’ouverture d’Érec et Énide jusqu’à la rencontre du héros avec le nain discourtois. À partir de l’imitation stylistique fondée sur la systématisation de reprises lexicales identifiables par un public rompu à la pratique des romans arthuriens, le récit joue ainsi des attentes suscitées par l’écriture conventionnelle : Arthur privé d’aventures au profit d’un roi de pacotille, un gab imagé de lui-même, suscite le ris du lecteur et peut bien, dès lors, s’absorber dans de mornes pensées…
Dans le Chevalier aux deux épées, l’onomastique fonctionne de même comme un signe lexical d’appartenance au champ du roman arthurien en vers[13]. Le roman énumère ainsi à l’ouverture les rois présents à la cour sur le modèle d’Érec et Énide[14]. Le Chevalier aux deux épées présente une liste réduite[15] où, comme à l’ouverture du Chevalier au Lion[16], Yvain et Gauvain sont associés par la rime : « Li peres mon seigneur Gauwain ;/Li pere mon seigneur Ywain » (v. 79-80), à ceci près que l’auteur du Chevalier aux deux épées préfère évoquer d’abord la génération des pères, comme s’il se situait chronologiquement avant la génération des héros de Chrétien. À y regarder de plus près, on trouve cependant quelques intrus comme le roi Estrangare « Ki la cité de Pelle tint » (v. 106), dont l’origine géographique fait davantage écho au roi Pellès du Lancelot-Graal et à la tradition des cycles en prose. L’onomastique trahit en réalité l’influence ou le détournement par la prose de la tradition versifiée. Ainsi dans le Chevalier aux deux épées Perceval est-il présenté comme « le fil Alain/Le Gros des Vaus de Kamelot » (v. 2608-2609) ; or cette dénomination, absente du Conte du graal, provient sans aucun doute du Perlesvaus[17], roman en prose bien postérieur. Dans le Chevalier aux deux épées, les noms à connotation arthurienne ne sont en fait souvent plus que des signes vides, des signifiants qui, au fil des textes et des usages, ont perdu leurs signifiés. Le prétendu meurtrier de Gauvain, Brien des Îles, porte ainsi le même nom qu’un chevalier mentionné à la fin d’Érec et Énide, mais l’emprunt s’arrête là où commence le pastiche à visée parodique. Parvenu chez Brien à la cité de Rades, Gauvain suscite en effet ainsi le rire de son interlocuteur :
Le Chevalier aux deux épées, v. 5316-5320 ; 5322-5323[18].« Frere, et u sont les illes dont ? »
Et li vallés commence a riere,
Et en riant li respont : « Sire,
Es illes, si ne le savés,
Estes vous, quart jor a, entrés. […]
Les Illes, se saciés vous bien,
Claime on le païs environ. »
Le roman souligne la valeur purement sémiologique de la reprise onomastique : le nom propre, nom de lieu ou nom de personne, agit simplement comme un signe arthurien dont l’auteur a compris le caractère complètement stéréotypé et éculé. Le surnom que se donne le chevalier aux deux épées, « li chevaliers as dames » (v. 8564), est victime du même traitement. L’expression renvoie bien à la tradition romanesque, en vers comme en prose, puisque Gauvain porte dans La Suite du Roman de Merlin un surnom similaire : « li Chevaliers as Damoisieles[19] ». Mais comme l’attribut « des Îles », celui-ci prête à rire et Gifflet se moque bien du héros : « Tel chevalier ne valent rien./De feme ont et cuer et ames » (v. 8750-8751). Nouveau clin d’oeil ironique à la tradition, la réflexion de Gifflet suppose qu’ont vécu plusieurs chevaliers aux dames et qu’après des décennies de romans arthuriens, ce surnom interchangeable a tellement circulé d’une oeuvre et d’un personnage à l’autre qu’il n’est plus qu’un référent au sémantisme vide.
L’impression de pastiche provient encore de l’emphase hyperbolique avec laquelle les emprunts lexicaux et stylistiques sont traités. La présentation élogieuse de la cour lors de la scène d’ouverture procède manifestement d’une véritable amplificatio par comparaison avec les incipit des manuscrits de Chrétien[20]. Le Chevalier aux deux épées présente, comme le Chevalier au Lion qu’il précède dans le BnF fr. 12603, un début in medias res exempt de tout prologue direct, et s’ouvre sur la mention d’un univers surdéterminé où règnent le faste et la courtoisie. La présentation méliorative topique d’Arthur dans le Chevalier aux deux épées : « […] li boins rois, ki, tant valoit » (v. 7) rappelle bien ou annonce — si l’on considère l’organisation interne du manuscrit et non la chronologie des oeuvres — les premiers vers du Chevalier au Lion : « Li boins roys Artus de Bretaigne,/La qui proeche nous ensengne/[…] » (v. 1-2). Chez Chrétien, la description de la cour lors des scènes d’ouverture reste toutefois assez sommaire : tout est dit ou suggéré en quelques vers, la mention même de l’espace-temps arthurien suffisant à conforter plus qu’à établir la représentation du lecteur-auditeur. Dans LeChevalier au Lion, l’entrée en matière tient ainsi en sept petits vers : « Li boins roys Artus de Bretaigne,/La qui proeche nous ensengne/Que nous soions preus et courtois,/Tint court si riche comme rois/A chele feste qui tant couste,/C’on doit nommer le Penthecouste./Li rois fu a Cardoeil en Gales » (v. 1-7)[21]. Il suffit à chaque fois à Chrétien de quelques substantifs (« roi », « court », « feste », « proeche ») et adjectifs les qualifiant (« boin », « preu », « courtois », « riche »), puis de quelques intensifs (« si », « tant », « mout ») ou adverbes soulignant le caractère exceptionnel de l’événement (généralement « onc ») pour combler une attente déjà considérablement restreinte par la mention même des lieux et d’Arthur. Par comparaison, l’ouverture du Chevalier aux deux épées sur le topos de la cour plénière semble bien traitée sur le mode hyperbolique. Les adjectifs mélioratifs sont au superlatif et toutes les catégories du discours représentant un mot ou une image-clé de la description font l’objet de doublets synonymiques :
Le Chevalier aux deux épées, v. 7-18[23].Et li [1- boins] rois, [1- ki tant valoit],
Se pourpensa lors k’il tenroit
Court [2- la plus bele] et [2- la grignour]
K’il [3- onques] tenist a [3- nul] jour,
Dont de mout grans tenir soloit,
Car ch’est la riens k’il [4- plus voloit],
Et ki [4- plus li plaisoit a faire]
Pour [5- aloier] et pour [5- atraire]
A lui les cuers des chevaliers.
Tant les [6- amoit] et [6- tenoit chiers]
Ke ja nus d’els, së il peüst,
D’entor lui ne se remeüst[22].
Sous un angle purement quantitatif, la description de l’ouverture de la cour est deux fois plus longue en raison de l’usage systématique des tournures d’insistance. Depuis les années 1210-1230, face à un public plus que familier de la tradition des romans arthuriens, cette démarche est pourtant inutile et d’un point de vue strictement diégétique, l’heure serait plutôt au sommaire et à l’économie de détails rebattus. Chez Chrétien, c’est d’ailleurs le premier roman, Érec et Énide, qui développe le plus cette scène, Le Chevalier de la Charrette en présente une version réduite, tandis que le Conte du graal la fait complètement disparaître, comme si de telles précisions avaient perdu au fil du temps et des récits leur utilité. La raison de cette imitation emphatique réside bien donc dans la revendication de l’appartenance à un genre auquel les cycles en prose ont sans doute fait de l’ombre. Et du point de vue de l’organisation du manuscrit, c’est désormais la version hyperbolique du Chevalier aux deux épées qui semble servir de modèle à une variation réduite au début du Chevalier au Lion.
Après cette longue description suit un développement assez conséquent (v. 20-36) sur la larguece (v. 28) d’Arthur dont le texte vante l’extrême générosité selon les mêmes tournures hyperboliques. Ce genre de passage, a priori attendu dans un roman arthurien, ne se trouve cependant jamais à cet endroit chez Chrétien où la largesse du roi est plutôt mentionnée à la fin, comme à l’occasion du couronnement d’Érec. Qui plus est, la convocation de la cour à Carduel s’accompagne ici d’une étrange menace, comme s’il était envisageable de renoncer à une fête dont les vers qui précèdent ont pourtant souligné le faste inégalé : « […] Ki n’i venroit/De voir seüst k’il fourferoit/Tout, sans pardon et sans pitié,/L’amour de lui et tout son fié » (v. 47-50). Dans une cour désertée par les aventures et les merveilles, seules la générosité et la magnificence du roi peuvent désormais sauver les apparences et attirer ceux qui, autrefois, hantaient les lieux au nom de l’honneur et de la courtoisie, comme le rappelle le début du Chevalier au Lion (v. 9-32). L’amplificatio met ainsi en évidence les emprunts et le travail d’imitation stylistique, mais elle souligne aussi l’écart que les années ont intensifié entre les romans de Chrétien et les romans en vers du xiiie siècle, écart que l’hyperbole creuse tout autant qu’elle essaie de combler. L’emphase descriptive produit a contrario l’image sous-jacente d’une cour léthargique aux valeurs menacées ou dégradées, qui ressemble en fait bien plus à la représentation assumée de la cour arthurienne au début du Perlesvaus : oublieux de ses devoirs de largesse, le roi y a perdu la majeure partie de ses compagnons, partis chercher ailleurs le faste et les aventures qui ont déserté le royaume[24].
Au-delà des signes lexicaux et syntaxiques du pastiche de style, le Chevalier aux deux épées présente par ailleurs un véritable travail de reprise et de détournement stylistique et générique d’épisodes propres au Chevalier au Lion, lesquels font partie des motifs narratifs précisément hérités de Chrétien de Troyes et reconnus par le public comme tels, et non de ces motifs folkloriques communs à toute une tradition sans paternité avérée[25]. La première scène concerne Gauvain et se situe après le départ de la cour du chevalier aux deux épées. Le neveu d’Arthur part seul un matin, sans armure, et parvient auprès d’un hêtre — un fou (v. 2715) — des plus beaux, peuplé d’oiseaux dont le chant le ravit et lui procure une joie immense :
Le Chevalier aux deux épées, v. 2715-2732[26].Et en mi lui un fou avoit
Dont il nul plus biel ne savoit.
S’ert par desous vers les praiaus.
Mais nul ki de loing fust si biaus
Ne vit nus ains, ne frans ne sers.
Et li fous estoit tout couvers
De tantes manieres d’oisaus
Que c’estoit deduis et aniaus
D’oïr la joie k’il faisoient,
Car en lor langage cantoient,
Chascuns endroit soi, si tres bel,
Ke por l’amor du tans nouvel
Et por la douce matinee,
Ke nule rien de mere nee
Onques mais tel joie ne fist.
Mesire Gauvains s’esjoïst
De la joie k’il a oïe,
Si k’a peu k’il ne s’entroublie
Ce passage présente indubitablement une réécriture du début du Chevalier au Lion où Calogrenant éprouve, après l’épreuve de la fontaine et de la tempête, une joie ineffable grâce au chant des oiseaux perchés sur un arbre merveilleux. Dans BnF fr. 12603, la séquence est ainsi transcrite :
01. Quant li lais tans fu trespassés,
Vi sour le pin tant amassés
Oisiaus, s’est ki croire m’en voelle,
K’il n’i avoit brance ne fuelle
05. Que ne fust couverre d’oisiaus.
S’en estoit li arbres plus biax.
Et tout li oiselet cantoient
Si ke molt bien s’entracordoient.
Mais divers cans cantoit li uns
10. Que çou que y cantoit li uns
L’autres ne cantoit pas ensi.
De la joie m’en resjoï ;
S’atendi tant k’il orent fait
Lor serviche trestout a trait,
15. C’ainc mais ne vi si bele joie
Ne mais ne cuie que nus home l’oie
Se cil n’en a celui oï,
Ki tant me plot et abieli
C’on n’en doit parole tenir[27].
Par comparaison avec la version de BnF fr. 1433, le passage est amputé des quelques vers qui précèdent : « De joie fui tout asseür,/Que joie, s’onques le connui,/Fait tost oublïer grant anui[28] », mais ils témoignent de ressemblances qui laissent supposer que l’épisode était dans son ensemble connu et identifié comme tel. Seule la nature de l’arbre change : le pin du Chevalier au Lion devient un fou. Peut-il s’agir, par un jeu d’homophonie, d’une allusion à Calogrenant, rendu fou par le chant des oiseaux ? L’hypothèse est probable, d’autant que Gauvain éprouve une sensation tout à fait comparable : il « […] s’entroublie./Et il a regardé ses piés,/Et ses gambes s’est aficiés/Si fort k’il a fait alongier/Les estrers et les fait brisier » (v. 2732-2736). Le polyptote fondé sur la reprise dans les deux textes du mot « joie » et de ses dérivés souligne encore leur parenté et l’on passe bien à chaque fois de la joie des oiseaux à celle que ressent en conséquence le chevalier. Les vers 2720 à 2725 du Chevalier aux deux épées et les vers 2 à 11 du Chevalier au Lion présentent enfin de grandes similitudes lexicales et syntaxiques quant à la description de l’arbre et au chant des oiseaux. L’emprunt et le pastiche sont indéniables, mais certains détails font douter du sérieux de l’entreprise : le nom de l’arbre d’abord, puis le traitement détourné des oiseaux dont Le Chevalier au Lion souligne l’incroyable harmonie malgré le caractère unique des chants (v. 7-11). Le Chevalier aux deux épées insiste aussi sur ce trait (v. 2724-2725), mais en fait la cause de l’anui que l’auditeur peut dès lors ressentir, et qui, au lieu de sublimer la joie, lui nuit désormais (v. 2722-2725). Le ravissement sensoriel de Calogrenant suggère par ailleurs une allusion métaphorique à la joie du poète dans la tradition de la lyrique courtoise, joie du chant et de l’amour qui se rapproche de l’extase du personnage. La réaction de Gauvain est au contraire bien terre à terre : l’élévation des sentiments et de l’esprit que devrait susciter en lui la joie des oiseaux lui fait porter son regard vers ses pieds et briser de bonheur ses étriers ! L’emprunt détourne ainsi de façon ironique, voire parodique, le texte source et place finalement Chrétien dans la position non de l’inspirateur, mais du pasticheur d’une version présentée comme initiale dans l’organisation du manuscrit.
Une deuxième scène de genre tirée du Chevalier au Lion se trouve dans l’aventure du Castel du Port dont Gauvain est encore le protagoniste. Il s’agit ici d’une réécriture manifeste de l’épisode de Pesme Aventure, quand Yvain entre dans le verger où se divertissent le seigneur des lieux et sa famille. L’originalité du passage tient en partie chez Chrétien à cette mention d’une activité de lecture privée, telle que le transcrit le manuscrit propre aux deux oeuvres :
Apoiés voit desour son coute
.i. preudomme qui se s[e]oit
Sour .i. drap de soie et lisoit
Une pucele devant lui
En .i. roumant ne sai de qui[29].
De même, Gauvain pénètre dans un praiel enclos où l’on retrouve la scène familiale : un seigneur, son épouse et leur fille qui « lisoit d’un romans de Troie » (v. 4276). Outre le cadre de l’action, le détail est éloquent et la version proposée par le Chevalier aux deux épées : « un romans de Troie » peut se lire comme une variante du Chevalier au Lion : « En .i. roumant ne sai de qui », voire comme une réponse ou une précision sur le sujet du livre ou l’identité de son auteur. Dans les deux cas, la préposition « de » semble en effet traduire une relation de propos entre déterminé et déterminant. C’est d’ailleurs l’option que suivent David F. Hult et Paul V. Rockwell dans leurs traductions respectives : « un roman, je ne sais pas au sujet de qui » (Chevalier au Lion) et « she was reading from a romance about Troy » (Chevalier aux deux épées). L’assimilation de la forme « Troie » à la ville antique se justifie d’ailleurs par la présence dans le manuscrit après Le Chevalier au Lion du roman d’Énéas auquel il pourrait être fait allusion. Il est à noter toutefois que dès l’ancien français, la préposition « de » tend à se substituer aux autres formes de construction du complément déterminatif exprimant une relation d’appartenance[30] que les deux vers sont donc aussi susceptibles d’exprimer : « un roman, je ne sais pas de qui ». Dans le dernier cas, le morphème « Troie » renverrait davantage à l’auteur Chrétien de Troyes. En plus du pastiche, l’épisode fonctionnerait alors comme une mise en abyme du texte originel dont il opère une relecture et une réécriture : référer ainsi dans une scène de genre explicitement à Chrétien revient à révéler à la fois l’emprunt et la source.
L’hypothèse est d’autant plus probable que suit une description qui joue des règles du portrait canonique et des modèles perpétués par Chrétien[31]. Le portrait de la demoiselle commence ici par les vêtements, lesquels ne manquent pas d’évoquer ceux d’Énide dont la description débute de la même manière : « Si ot un chainse deliié/Et une mout blance chemise » (v. 4278-4279). Les adjectifs « blance » et « deliié » et la mention du « chainse » et de la « chemise » renvoient inévitablement à Énide, trop pauvre pour posséder un habit complet. Rien à part le clin d’oeil à une célèbre héroïne de Chrétien ne justifie en revanche la tenue de la demoiselle du Castel du Port dont le portrait inverse totalement les règles canoniques. Certes l’ensemble fait appel à la rhétorique habituelle ; les qualificatifs et les comparaisons — la gorge passe de « blanchor noif nouviel cheüe » (v. 4291), le visage est plus pur « ke rose […] ne lis » (v. 4312) — sont identiques à ceux que Chrétien emploie pour Soredamor ou Philomena. Quant à ses yeux « vair et cler, fendu et riant » (v. 4302), la jeune fille semble emprunter par simple déplacement du premier adjectif ceux de Blanchefleur : « Riant et vair, cler et fandu[32] ». Il s’agit toutefois d’un portrait ascendant où l’on décrit à la suite la taille, les hanches, la poitrine, le cou, les cheveux et le visage selon l’ordre inverse des portraits traditionnels, ordre auquel Chrétien ne déroge pas. Comme dans la description initiale de la cour, l’auteur procède de plus par amplification : ce qui se dit en un vers chez Chrétien et reste parfois de l’ordre de la suggestion est développé de façon redondante dans le Chevalier aux deux épées. Dans le portrait de Philomena, modèle canonique s’il en est, la silhouette de l’héroïne est ainsi rapidement décrite : « Gresles les flans, basses les hanches[33] », tandis que dans le Chevalier aux deux épées, la figure féminine est reprise à l’identique et amplifiée : « Graile estoit par les flancs et gente./Et ot les rains un poi grossetes,/Et hances seans et bassetes » (v. 4282-4284). Le passage offre à la fois un pastiche de genre et un pastiche de style à travers l’usage inversé ou systématisé de la rhétorique du portrait et des stéréotypes lexicaux de manière à jouer, à travers les allusions aux oeuvres de Chrétien, avec une tradition figée peut-être trop conventionnelle dont l’auteur se plaît à grossir ou à malmener les traits.
Dans l’ensemble, le Chevalier aux deux épées renoue, à partir de scènes, de schèmes ou de lexèmes clairement associés à l’oeuvre de Chrétien, avec la tradition des romans en vers de la fin du xiie siècle. Mais comme on l’a affirmé à propos de l’onomastique, cet héritage se combine avec celui des cycles en prose qui apparaissent comme des modèles repoussoirs dont le roman ne saurait pourtant faire l’économie. Le premier élément réside dans le traitement du personnage de Gauvain, échappé des romans de Chrétien qui, malgré la récurrence du personnage, n’en fait jamais un véritable héros. La bipartition des aventures entre Gauvain et Mériadeuc dans le Chevalier aux deux épées rappelle ainsi inévitablement la structure du Conte du graal dont l’auteur du Chevalier aux deux épées composerait une sorte de réécriture achevée, à la grande différence toutefois que le Graal a ici disparu. Le choix de Gauvain s’explique aussi peut-être par le traitement que lui ont réservé les cycles en prose : comme dans les romans en vers, il n’est jamais non plus un vrai protagoniste, à l’inverse de Lancelot ou Perceval qui sont désormais moins disponibles, trop liés à la quête du Graal, aventure saturée dont les romans en vers du xiiie siècle ne veulent manifestement plus et qu’ils n’évoquent jamais. Enfin Gauvain est dans La Queste del saint Graal marqué par ses échecs et ses péchés, tandis que les cycles plus tardifs du Tristan en prose et de la Post-Vulgate noircissent considérablement le personnage, au point d’en faire le premier meurtrier des compagnons de la Table Ronde et un chevalier pourri d’orgueil oublieux de ses devoirs. Réintégrer Gauvain à la tradition des romans en vers s’apparente alors à une entreprise de réhabilitation qui explique les mésaventures inaugurales du personnage : sommé de se battre sans armure, il passe pour mort et doit par conséquent faire de nouveau la preuve de sa valeur pour retrouver son identité. Mais le Gauvain de Chrétien subit dès lors le même sort qu’Arthur : confronté à un univers romanesque en crise qui se détourne en réalité des conventions du roman en vers ou les reprend pour mieux les dénoncer, le personnage subit aussi un traitement distancié qui le rend disponible pour le pastiche ou la parodie. Certes la prose lui a été fatale, mais sa réhabilitation n’est peut-être, comme l’ensemble des conventions narratives dans le Chevalier aux deux épées, que de façade.
L’absence du Graal, grand moteur de développement romanesque entre la fin du xiie et le premier tiers du xiiie siècle, n’est finalement aussi qu’apparente. Il réapparaît en filigrane dans le double épisode de l’épée sanglante et de la révélation du nom du héros. L’ensemble procède d’un syncrétisme romanesque qui dépasse la notion de pastiche dans la mesure où il s’agit là d’une réécriture globalisante, par fusion d’éléments divers issus des traditions en vers et en prose. Le héros découvre en effet près d’une fontaine une épée « tout[e] vermeille/De fresc sanc de la pointe a mont/Dusqu’an mi » (v. 6350-6352). Le phénomène se révèle vite merveilleux car Mériadeuc a beau frotter l’épée, celle-ci continue de saigner. D’emblée cette figure rappelle la lance ensanglantée du Conte du graal que l’ensemble des romans arthuriens exploite par la suite. Or dans les Continuations du Conte du graal et les cycles en prose, la lance et l’épée représentent deux figues dédoublées qui se complètent ou se substituent l’une à l’autre quand il s’agit d’opérer les fonctions/frapper/ou/blesser/[34]. La fonction/saigner/demeurait jusqu’à présent l’exclusivité de la lance ; elle est maintenant transférée sur une épée avec laquelle elle fusionne pour créer une nouvelle figure chargée de tous les antécédents romanesques. À l’image première de l’épée sanglante s’ajoutent ensuite les thèmes complémentaires de l’élection et du tabou : nul ne doit en effet retirer l’épée du fourreau ni la ceindre sous peine de mort, sauf le chevalier destiné à accomplir l’aventure et à accéder à la royauté. L’arme renoue ici avec les attributs habituels des épées magiques telles que les Continuations ou la Questedel saint Graal les présentent : un seul chevalier est habilité à souder l’épée brisée ou à brandir celle de la nef de Salomon et ceux qui bravent l’interdiction sont tués ou blessés. De retour à la fontaine dans la deuxième partie de l’épisode, Mériadeuc trouve la réponse au phénomène du sang qui coule : l’épée appartenait à un chevalier faé qui en frappa, lors d’un combat, Gaus, le fils du roi de Norual. Ce dernier en fut gravement blessé et seul un autre coup de cette épée, porté par le chevalier élu, peut conjurer le maléfice et guérir la plaie. Les figures de la blessure et de la guérison par l’arme responsable du mal, particulièrement diffusées dans les romans du Graal en prose, refont ici leur apparition. Associées à la lance dans La Suite du Roman de Merlin et LaQueste del saint Graal, elles sont ici transposées sur une épée qui concentre en elle-même tous les traits précédemment exposés[35]. Enfin, une inscription sur la lame révèle l’identité du héros et se rattache de ce fait à une autre tradition commune au vers et à la prose : elle évoque les lettres gravées sur l’épée as estranges renges de la Queste ainsi que le message sur celle que le Roi Pêcheur offre à Perceval dans le Conte du graal.
La seule figure de cette épée opère donc dans le Chevalier aux deux épées de multiples fonctions : saigner, désigner un élu, faire l’objet d’une interdiction, porter un coup douloureux, guérir ce même coup, révéler une identité. L’épisode ainsi recomposé suscite une impression de familière étrangeté et suggère, à travers la figure du sang et l’évocation implicite du modèle de la lance, la présence in absentia d’un Graal qui a assez marqué la matière romanesque du xiiie siècle pour qu’il soit désormais difficile de s’en priver. Mais une nouvelle fois, le syncrétisme figuratif et thématique tend à l’amplification : jamais ailleurs les armes magiques ne cumulent en effet toutes ces fonctions. On constate à nouveau cette surenchère dans l’exploitation du stéréotype, surenchère qui révèle justement le pastiche, l’imitation ludique ou détournée. Le discours rapporté du chevalier estrange responsable de la blessure de Gaus de Norual est symptomatique de ce recours à l’emphase hyperbolique. Les paroles du personnage contiennent toutes les réponses aux diverses énigmes suscitées par l’épée, mais la manière dont elles s’organisent correspond au degré zéro de la cohésion logique. On observe ainsi un usage plus que redondant de la conjonction « et », chargée d’introduire à chaque fois un nouvel élément :
Le Chevalier aux deux épées, v. 10701-10708 ; 10711-10713 ; 10715-10717[36].[…] ; et est escris
En l’espee nealeÿs
D’or ses nons ; et si i para
Li sans tant ke vous referra
Cil ke je di. Et faés sui.
Et por ce [ke] chevaliers fui
Le boin roi Artu de Bretaigne,
Vous proi ke la cose remaigne
[…]. Et je m’en vois.
Et saciés ke li plus cortois
Est, et li plus biaus chevaliers
[…]. Et si venra
Ici aluec quant ce sera,
Et mout avra ains enduré.
Cela produit un effet accumulatif où tout se juxtapose et se confond comme autant d’ingrédients propres à une recette de roman arthurien avant composition. L’objet merveilleux, le chevalier faé et la Table Ronde se situent sur le même plan et forment des éléments interchangeables dont la simple présence suffirait à créer un « effet tradition » censé renvoyer à une matière romanesque pourtant différente et plus épurée. Chez Chrétien comme dans les cycles en prose, les chevaliers faés n’appartiennent en effet pas au monde arthurien ; ils en sont même traditionnellement les opposés, si bien que l’association de l’un à l’autre ne peut finalement être ici qu’un nouveau cas de faux-semblant.
Le chevalier aux deux épées témoigne donc ouvertement de la réception des romans arthuriens composés dans les décennies qui précèdent. Sous couvert de renouer avec la tradition née de Chrétien, il inverse et détourne les règles génériques et stylistiques propres à son modèle plus qu’il ne les emprunte. Entre 1220 et 1240, l’auteur ne peut d’ailleurs manifestement écrire en vers comme en 1180 : les romans et grands cycles en prose ont laissé leur trace et leur influence atteint l’oeuvre malgré elle. Le pastiche de style et de genre participe alors d’un renouvellement du texte arthurien : les noms, les personnages, les motifs ont la couleur du roman en vers, mais une couleur hautement nuancée par les innovations et les transformations des cycles en prose. La description du manteau de Lore, dans la scène finale du mariage et du couronnement, illustre parfaitement le double transfert. Ce vêtement évoque en effet dans un contexte comparable la robe d’Érec, peinte selon les préceptes de Macrobe, où sont représentés les sept arts libéraux. La reube de Lore est quant à elle ornée de scènes qui illustrent la naissance d’Arthur et ses exploits, autant d’événements qui se rattachent à la tradition latine de Geoffroy de Monmouth comme à celle des cycles en prose. La translatio studii du savoir antique à l’espace-temps breton est ici achevée et dépassée. La matière de Bretagne est désormais source et sujet du livre : entre histoire et fiction, le monde arthurien engendre le monde arthurien. Le transfert ne se fait toutefois pas en vase clos, mais plutôt suivant l’image d’une spirale qui progresse et s’étend par des retours ponctuels toujours plus distanciés à des points de référence initiaux.
Appendices
Note biographique
Hélène BOUGET
Hélène Bouget est maître de conférences de langue et littérature médiévales à l’Université de Bretagne Occidentale (Brest). Ses recherches portent sur la littérature arthurienne et la poétique du roman médiéval. Elle est l’auteur d’une thèse (à paraître) sur la poétique de l’énigme dans les romans arthuriens français et a publié plusieurs articles consacrés à ce genre, dont « Li Chevaliers as deus espees : la fabrique ratée d’un personnage ? » (dans Chantal Connochie-Bourgne [dir.], Façonner son personnage au Moyen Âge, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, coll. « Senefiance nº 53 », 2007, p. 77-86) et « Haine, conflits et lignages maudits dans le cycle de la Post-Vulgate » (dans Christine Ferlampin-Acher et Denis Hüe [dir.], Lignes et lignages dans la littérature arthurienne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 2007, p. 219-230). Elle s’intéresse également aux procédés de réécriture contemporains de la matière arthurienne.
Notes
-
[1]
La datation de ce roman reste problématique en raison d’un manuscrit unique : BnF fr. 12603. Wendelin Foerster (Li Chevaliers as deus espees. Altfranzösischer Abenteurroman, Halle, Niemeyer, 1877, Amsterdam, Rodopi, 1966) situe Le Chevalier aux deux épées juste avant le milieu du xiiie siècle (p. lii). Il pourrait toutefois avoir été composé avant les années 1235-1240, soit avant le roman en prose de La Suite du Roman de Merlin (éd. Gilles Roussineau, Genève, Droz, 2 vol., 1996, p. xvi). Paul V. Rockwell (French Arthurian Romance, vol. III – Le Chevalier as deus espees, Cambridge, D. S. Brewer, 2006) étend la période de composition entre 1210 — après le Perlesvaus et La vengeance Raguidel auxquels le texte fait allusion ou emprunte certains épisodes — et 1235 pour La suite du Roman de Merlin (p. 2-3).
-
[2]
Voir à ce sujet Beate Schmolke-Hasselmann, Der arthurische Versroman von Chrétien bis Froissart, Tübingen, Max Niemeyer, 1980 (The Evolution of Arthurian Romance. The Verse Tradition from Chrétien to Froissart, trad. de Margaret et Roger Middleton, Cambridge, Cambridge University Press, 1998 [1985]) et The Legacy of Chrétien de Troyes (éd. Norris J. Lacy, Douglas Kelly et Keith Busby), Amsterdam, Rodopi, 2 vol., 1987 (vol. 1) et 1988 (vol. 2).
-
[3]
Voir Paul Zumthor, « Topique et tradition », Poétique, no 7, 1971, p. 354-365 ; F. Dubost, « Un outil pour l’étude des transferts de thèmes : Le Thésaurus informatisé des motifs merveilleux de la littérature médiévale », dans Marie-Madeleine Fragonard et Caridad Martinez (dir.), Transferts de thèmes, transferts de textes, Barcelone, PPU, 1997, p. 21-47 ; « De quelques outils merveilleux rattachés à la Catalogne dans les Otia Imperialia et leur traitement dans le Thésaurus informatisé (équipe MA-REN-BAR) », dans Christian Camps et Carlos Heusch (dir.), Languedoc – Roussillon – Catalogne. État, nation, identité culturelle régionale (des origines à 1659), Université Paul-Valéry, Montpellier, 1998, p. 123-142 ; Jean-Jacques Vincensini, Motifs et thèmes du récit médiéval, Paris, Nathan, coll. « Fac. Littérature », 2000.
-
[4]
L’ouvrage de Danièle James-Raoul, Chrétien de Troyes, la griffe d’un style (Paris, Champion, coll. « Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge », 2007), ouvre réellement la voie aux recherches sur le style dans la littérature arthurienne en vers.
-
[5]
Voir la description du manuscrit dans Les manuscrits de Chrétien de Troyes (éd. Keith Busby, Terry Nixon, Alison Stones et Lori Walters), 2 vol., Amsterdam, Rodopi, 1993, t. II, p. 69-70. Voir également Richard Trachsler, « Le recueil Paris, BnF fr. 12603 », Cultura Neolatina, vol. 54, nos3-4, 1994, p. 29-43.
-
[6]
Paul Aron, Histoire du pastiche. Le pastiche littéraire français, de la Renaissance à nos jours, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Les littéraires », 2008.
-
[7]
Ibid., p. 5.
-
[8]
Ibid., p. 82.
-
[9]
Annick Bouillaguet, L’écriture imitative. Pastiche, parodie, collage, Paris, Nathan, coll. « Fac. Littérature », 1996, p. 48.
-
[10]
Ibid., p. 66.
-
[11]
Ibid., p. 51.
-
[12]
Les Romans de Chrétien de Troyes édités d’après la copie de Guiot, V, VI, Le Conte du graal (Perceval), manuscrit BnF fr. 794 (éd. Félix Lecoy), 2 vol., Paris, Honoré Champion, coll. « Classiques français du Moyen Âge », 1990 [1973]. Var. ms. Berne, Burgerbibliothek, 354 (éd. Charles Méla), Paris, Le Livre de Poche, coll. « Lettres gothiques », 1990 : « Et li un as autres disoient :/“Qu’a li rois, qu’est pensis et muz ?” » (v. 868-869).
-
[13]
Voir les répertoires de G. D. West, An Index of Proper Names in Arthurian Verse Romances, 1150-1300, Toronto, Toronto University Press, 1969 et An Index of Proper Names in Arthurian Prose Romances, Toronto, Toronto University Press, 1978.
-
[14]
Érec et Énide (éd. Mario Roques), Paris, Honoré Champion, 1990 [1952], d’après le ms. BnF fr. 794, v. 1671-1706 et v. 1884-1954 ; (éd. Jean-Marie Fritz), Paris, Le Livre de Poche, coll. « Lettres gothiques », 1992, d’après le ms. BnF fr. 1376, v. 1687-1746 et v. 1930-2007 ; (éd. Michel Rousse), Paris, G-F Flammarion, 1994, d’après le texte de l’éd. Foerster (1934), v. 1687-1750 et v. 1935-2007.
-
[15]
V. 77-110.
-
[16]
Le Chevalier au Lion (éd. David F. Hult), Paris, Le Livre de Poche, coll. « Lettres gothiques », 1993, d’après le ms. BnF fr. 1433 : « Et Keus et mesire Gavains ;/Et s’i fu pres mesire Yvains » (v. 55-56).
-
[17]
Dans Le Haut Livre du Graal (éd. Armand Strubel, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Lettres gothiques », 2007), le père de Perlesvaus est Julain le Gros des Vax de Kamaalot (p. 130, v. 7-8).
-
[18]
« Frère, où sont donc les îles ? » Le jeune homme se prit à rire et lui répondit, riant toujours : « Seigneur, vous l’ignorez, pourtant vous avez pénétré dans les îles depuis quatre jours […]. Sachez-le, on nomme les îles le pays environnant » (notre traduction).
-
[19]
Op. cit., t. I, p. 237, v. 16.
-
[20]
Pour une étude comparée des séquences initiales chez Chrétien et dans les romans en vers du xiiie siècle, voir Beate Schmolke-Hasselmann, op. cit., p. 41-55.
-
[21]
Dans Érec et Énide, la description initiale de la cour est tout aussi sommaire (huit vers) : « Un jor de Pasque, au tens novel,/A Caradigant son chastel/Ot li rois Artus cort tenue./Onc si riche ne fu veüe,/Car mout i ot boens chevaliers,/Hardiz et corageus et fiers,/Et riches dames et puceles,/Filles de rois, gentes et beles » (éd. Jean-Marie Fritz, v. 27-34). Les autres versions manuscrites ne présentent guère ici de variante significative. Dans Le Chevalier de la Charrette, l’ouverture est réduite à quatre vers : « […]/Et dit qu’a une Acenssïon/Li rois Artus cort tenue ot/Riche et bele tant con a lui plot,/Si riche com a roi estut » (éd. Charles Méla, v. 30-33).
-
[22]
Nous soulignons les superlatifs et indiquons entre crochets les doublets synonymiques.
-
[23]
« Alors le noble et si valeureux roi décida de rassembler la plus splendide et la plus majestueuse cour qu’il ait jamais tenue, et il avait coutume d’en rassembler de bien fastueuses. C’était en effet la chose qu’il désirait et qui le satisfaisait le plus pour attirer à lui et gagner les coeurs des chevaliers. Il les aimait et leur témoignait tant d’affection qu’aucun parmi eux ne l’aurait quitté, même s’il en avait eu la possibilité » (notre traduction).
-
[24]
Pour Beate Schmolke-Hasselmann, de tels passages constituent surtout une critique ou un changement d’attitude et de considération des auteurs et du public envers certains aspects devenus absurdes à force d’être employés et stéréotypés dans les romans du xiie s. (op. cit., p. 87).
-
[25]
Distinction établie par Beate Schmolke-Hasselmann entre certains motifs narratifs traditionnels tels que géants, dragons, messagers, etc. et ceux qui peuvent être exclusivement et sans ambiguïté attribués aux romans de Chrétien, comme la fontaine du Chevalier au Lion ou la Joie de la Cour d’Érec et Énide (ibid., p. 195-196).
-
[26]
« Au milieu [de la clairière] était planté un hêtre, le plus beau qu’il ait jamais rencontré. Il se trouvait un peu plus bas, en direction de la prairie. Mais jamais personne, homme libre ou serf, n’en avait vu qui approchât la beauté de celui-ci. Le hêtre était entièrement couvert de toutes sortes d’oiseaux, si bien que c’était à la fois un plaisir et un tourment d’entendre la joie qu’ils manifestaient. Chacun chantait en effet magnifiquement pour lui-même, dans son propre langage, célébrant le printemps et la douceur du matin : personne au monde n’avait jamais témoigné une telle joie. Monseigneur Gauvain éprouva tant de joie à entendre celle-ci qu’il manqua se perdre dans ses pensées » (notre traduction).
-
[27]
Folio 75 ro. Notre transcription, notre ponctuation et notre numérotation. « Quand la tempête fut passée, il vit rassemblés sur l’arbre une telle quantité d’oiseaux, croyez-moi, que toutes les branches et les feuilles en étaient couvertes, et l’arbre n’en était que plus beau. Tous les petits oiseaux chantaient en grande harmonie, pourtant chacun chantait un chant différent, et ce que l’un chantait ne l’était pas par un autre. J’éprouvai du plaisir à cette joie et patientai jusqu’à ce qu’ils aient parfaitement accompli leur office, car jamais je ne fus témoin d’une si magnifique joie et je ne crois pas qu’il soit donné à personne de la connaître, s’il n’a pas entendu celle-ci : elle m’a tellement porté aux nues qu’on ne peut que se taire à son sujet » (notre traduction).
-
[28]
Éd. David F. Hult, v. 454-456.
-
[29]
Fol. 102 ro. Notre transcription et notre ponctuation. « Un noble personnage se tenait assis, accoudé sur un tissu de soie, tandis qu’une jeune fille lui faisait lecture d’un roman dont j’ignore le sujet [l’auteur ?] » (notre traduction). L’édition du ms. BnF fr. 1433 ne présente guère de variante notable. Le vers 5362 recourt toutefois à une morphologie différente du pronom relatif cas régime tonique qui : « En un rommans, ne sai de cui. »
-
[30]
Geneviève Joly, Précis d’ancien français, Paris, Armand Colin, coll. « U. Lettres », 1998, p. 240.
-
[31]
Voir Alice Colby, The Portrait in the Twelfth-Century French Literature. An Example of the Stylistic Originality of Chrétien de Troyes, Genève, Droz, 1965.
-
[32]
Perceval ou le Conte du graal (trad., prés. Jean Dufournet d’après l’éd. Hilka de 1932), Paris, GF- Flammarion, 1997, v. 1821. Le ms. Berne 354 (éd. Charles Méla), offre une leçon identique (v. 1779). Var. BnF fr. 794 (éd. Félix Lecoy) : « riant et veir et cler fandu » (v. 1819).
-
[33]
Philomena (éd. C. de Boer, trad. Olivier Collet), dans Chrétien de Troyes, Romans, Paris, Librairie Générale Française, coll. « La Pochothèque », 1994, v. 164.
-
[34]
Dans les Continuations du Conte du graal, notamment La Première Continuation de Perceval (trad., prés. Colette-Anne Van Coolput-Storms, éd. William Roach, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Lettres Gothiques », 1993), la lance qui saigne dans le cortège du Graal devient l’arme dont se serait servi Longin pour frapper le Christ. Par ailleurs, les quatre Continuations posent l’énigme de l’épée brisée, motif aussi associé aux figures du chevalier enferré — également exploitée par le Lancelot en prose — et du Roi Méhaigné, en particulier dans La Troisième Continuationdu Conte du graal (trad., prés. Marie-Noëlle Toury, éd. William Roach, Paris, Honoré Champion, coll. « Champion classiques », 2004). Le Roman de l’Estoire dou Graal attribué à Robert de Boron et L’Estoire del saint Graal présentent l’histoire de la lance de façon similaire, tandis que La Queste del saint Graal rend l’épée responsable à la fois de la blessure du roi et de la dévastation de la terre.
-
[35]
Il ne serait donc pas impossible que Le Chevalier aux deux épées soit légèrement postérieur à La Suite du Roman de Merlin et que l’emprunt, nourri de pastiche et de parodie, ne se soit fait, finalement, dans la reprise de la prose par le vers.
-
[36]
« […] et son nom est écrit sur l’épée niellée d’or, et le sang y coulera jusqu’à ce que celui dont je vous parle vous frappe du même coup. Je suis sous le coup d’un enchantement et, parce que je fus un chevalier du noble roi Arthur, je vous prie de renoncer à aller plus loin […]. Je m’en vais, et sachez qu’il s’agit du plus beau et du plus courtois des chevaliers […]. Il arrivera le moment venu, après avoir affronté bien des épreuves » (notre traduction).