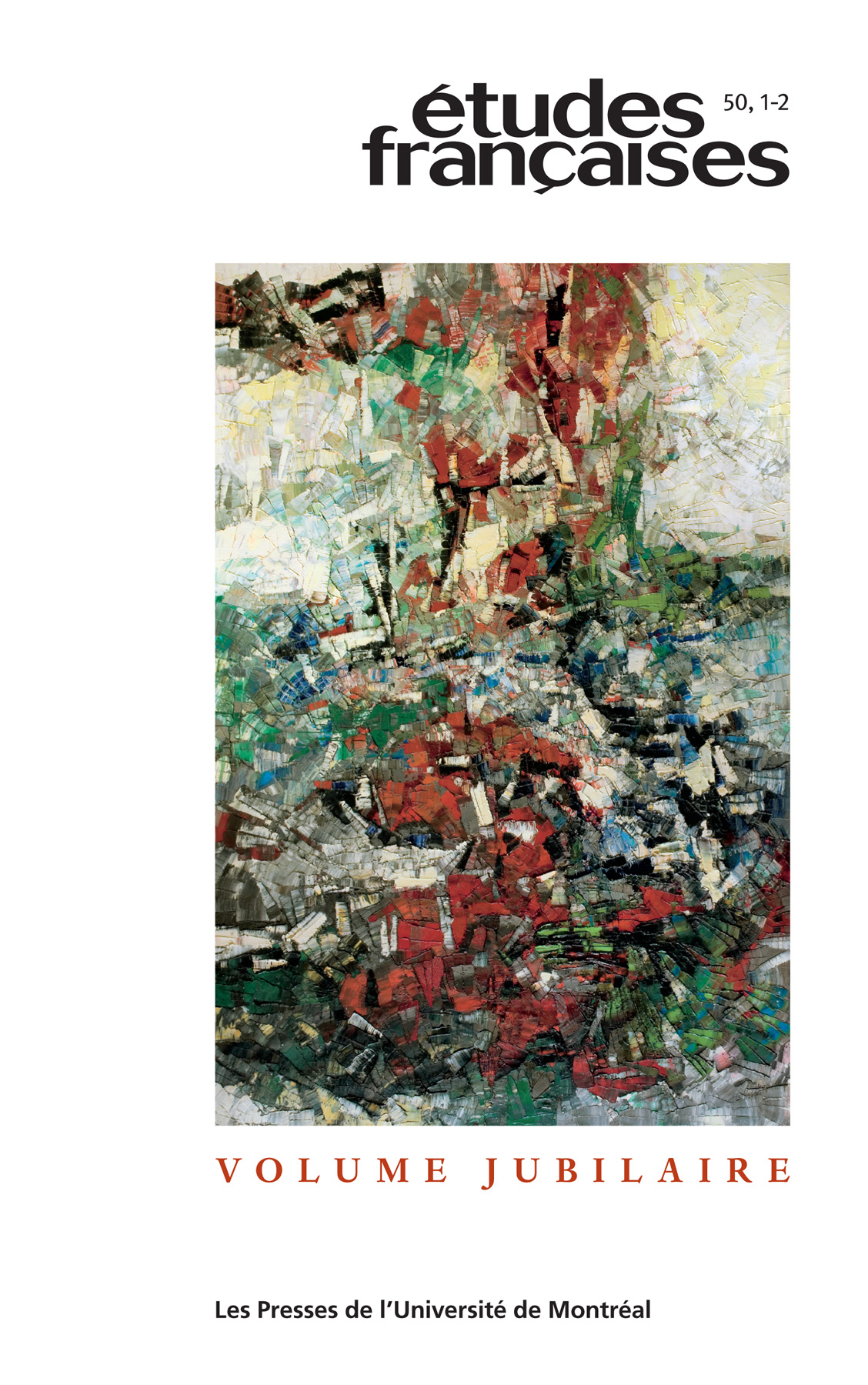Le passé est-il toujours le meilleur juge du présent ? Dans son Éloge de Dürer, un essai recueilli dans ses Fantaisies sur l’art, l’écrivain romantique Wilhelm Heinrich Wackenroder porte sur la peinture de son temps le regard désabusé de tout moderne sur ce qui lui semble l’érosion irréversible de la beauté ancienne. Le modèle du grand Dürer est certes exalté, mais c’est d’abord pour retirer toute légitimité à un art facile, divertissant, léger, cet art du xviiie siècle confiné dans la sphère du plaisant. Que représente donc Dürer à ses yeux, sinon la figure austère d’un artiste que tout sépare de la frivolité ? À l’inverse de ces artistes friands de succès, le grand maître offre l’exemple d’un peintre sanctifié par son art et désireux de glorifier la source divine de la nature. Ce qu’il dit des peintres, Wackenroder ne cesse de le répéter pour les musiciens, oublieux de la fonction sacrée de leur art. Comment peuvent-ils faire passer le plaisir des sens devant le rappel de l’absolu divin, seul capable d’élever l’esprit humain à la sublimité de l’au-delà ? Le rappel de cet idéal de sublimité caractérise toute l’esthétique romantique et quand nous le retrouvons sous la plume de Glenn Gould, la référence à cette hiérarchie spirituelle des oeuvres n’en est que plus marquée. Même si Gould a toujours affirmé qu’il n’était pas romantique, et qu’il avait des affinités plus profondes avec un certain puritanisme — ce que l’ensemble de son travail de pianiste vient confirmer —, l’énoncé de son esthétique renoue avec la spiritualité promue par le romantisme allemand : Cette phrase a été beaucoup citée et sa portée est universelle : elle s’adresse en effet autant à l’écriture dans l’histoire de la musique, où la recherche de la contemplation règle le jugement esthétique, qu’au rapport de chacun avec ce qu’il attend de la musique dans l’expérience quotidienne. Parler d’édification rapproche déjà des idéaux de penseurs comme Wackenroder et Novalis, pour qui la musique constituait l’art suprême en raison de cette capacité unique à élever, à édifier. Gould n’a cessé d’évoquer ce principe et on peut se surprendre qu’il n’en ait pas reconnu l’origine romantique. Pour lui comme pour Wackenroder, ce conflit entre le sublime et le léger s’établit sur le fond d’une métaphysique de l’émotion esthétique. Ne sommes-nous émus que par l’accès à une origine qui transparaît dans le sensible et qui, dès lors que nous y accédons, disqualifie tous les chemins et tous les supports qui nous ont permis d’y parvenir ? Sur cette échelle de Jacob, l’art ne serait dès lors que la forme transitoire et fugace d’une mystique abstraite, au sein de laquelle le sentiment aurait le statut d’une illusion. Cette pensée peut atteindre des limites insoupçonnées. Glenn Gould n’affirmait-il pas qu’un véritable amour de la musique peut se passer de l’exécution de l’oeuvre, celle-ci reposant d’abord sur une figure séparée et quasi transcendantale ? L’oeuvre écrite n’aurait rien en commun avec l’émotion sensible qu’elle suscite, elle ne partagerait qu’accidentellement la réalité du sentiment : elle serait d’abord une architecture admirée pour son travail de construction et révélatrice de la perfection de la raison qui la constitue. En musique, Jean-Sébastien Bach répond ainsi à Dürer, autant par la sainteté des objets que par la puissance du contrepoint. Par comparaison, le sentiment provoqué par le concert et l’exécution semble relever d’une pathologie blâmable : la beauté musicale ne saurait être réduite à un simple « ébranlement nerveux », elle est un acte de l’esprit, une activité de la pensée que Gould identifie à une forme de contemplation pure et de sanctification. Cette …