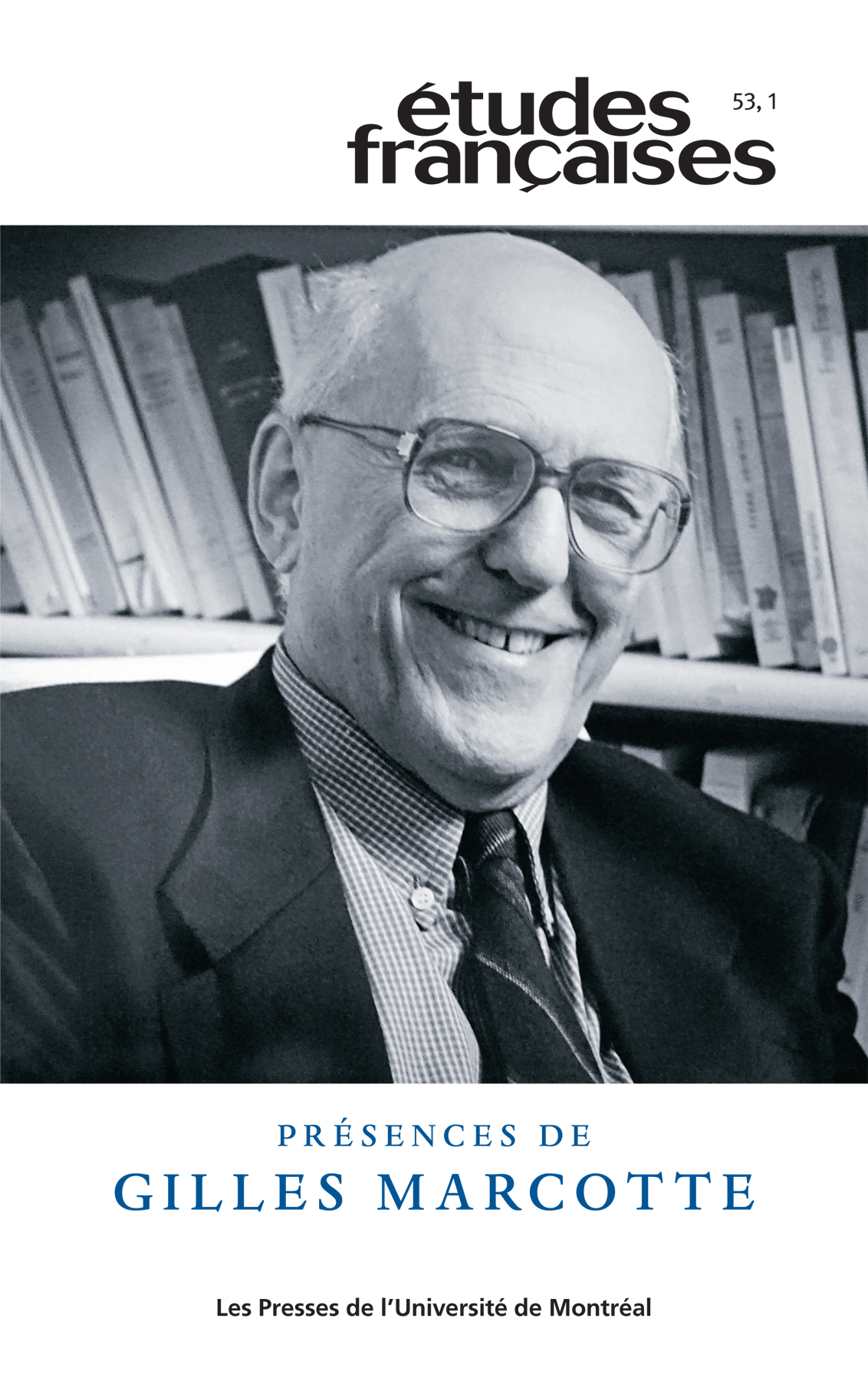Abstracts
Résumé
Si l’oeuvre de Gilles Marcotte est reconnue comme celle d’un critique majeur de la littérature québécoise, elle est beaucoup moins souvent lue comme celle d’un essayiste. Il est vrai que cette oeuvre ne correspond pas tout à fait aux critères par lesquels l’essai est généralement identifié, et qui tiennent à la position de distinction ou de distance de l’essayiste face au monde. Gilles Marcotte écrit au contraire depuis la conscience forte d’une communauté – une communauté qui inclut les vivants et les morts, les lecteurs ordinaires –, sans laquelle il ne saurait y avoir pour lui ni art ni littérature. Par cette position au sein du monde, il pratique une forme plus discrète d’essai, mais aussi, à bien des égards, plus singulière.
Abstract
Although much praised as literary criticism, Gilles Marcotte’s writings are seldom read as literary essays. It is true that they do not quite correspond to the criteria generally used to define the essay as a form, i.e., the distanced position from which the essayist looks at the world. Instead Gilles Marcotte writes from a strong sense of community—a community of the living and the dead, of common readers—without which for him art and literature could not exist. This position from within makes for a more discreet form of essay, but also, in many respects, for a more singular one.
Article body
Gilles Marcotte est le grand oublié de ce qu’on a coutume d’appeler l’« essai québécois ». Dans les anthologies, les colloques, les ouvrages d’histoire littéraire, son nom n’apparaît jamais, ou presque jamais, comme celui d’un écrivain dont on lirait l’oeuvre pour elle-même. Sauf rares exceptions – la plus notable étant la préface que signe Jean Larose à la réédition d’Une littérature qui se fait[1] –, c’est toujours du côté de la critique et du commentaire, c’est-à-dire en raison de ce qu’ils nous apprennent des oeuvres d’autrui, que l’on range ses livres, même les plus personnels. Les auteurs de l’Histoire de la littérature québécoise, par exemple, dans le chapitre qu’ils consacrent à « l’essor de l’essai » dans les années 1960, citent Jean Le Moyne, Pierre Vadeboncoeur et Fernand Dumont, mais parlent de Gilles Marcotte dans un chapitre adjacent consacré, et l’expression est sans doute plus éloquente qu’ils ne la voulaient, au « poids de la critique[2] ».
Certes, on pense comprendre que le « lecteur de poèmes », l’« amateur de musique » ou tout simplement le professeur qu’était Marcotte se contentait d’assez bonne grâce de ce rôle en apparence auxiliaire et qu’il aurait même été réticent à voir ses travaux – la notion de travail accompagne toujours sa pensée – promus au rang de « corpus ». Mais on n’en demeure pas moins frappé par cette distinction, ou par ce malentendu, qui le place en marge ou simplement en appui de ceux qui « font » la littérature québécoise. Car, par leur imagination et leur liberté, par leurs propositions et leurs prospections, par la singularité de leur écriture et l’aventure de la pensée qui s’y déploie, Une littérature qui se fait, Le temps des poètes et Le roman à l’imparfait ne sont pas moins des essais, même s’ils sont aussi des ouvrages de critique, que ne le sont La ligne du risque de Pierre Vadeboncoeur ou Le lieu de l’homme de Fernand Dumont, tout comme Littérature et circonstances et Le lecteur de poèmes, pour rester dans des concordances temporelles, ne le sont pas moins que Surprendre les voix d’André Belleau ou Intérieurs du Nouveau Monde de Pierre Nepveu[3]. Mais le partage s’est installé, comme si, pour reprendre les catégories employées par les auteurs de l’Histoire de la littérature québécoise, « l’attention critique aux oeuvres » et le « mode essayistique »[4] constituaient des actions sinon incompatibles, du moins séparées, qui impliquent qu’un ouvrage loge, selon les proportions relevées, dans l’un ou l’autre camp.
Sans doute les « circonstances », dont Gilles Marcotte nous a appris toute l’importance, et notamment l’effet de groupe, ou en l’occurrence de non-groupe, ont-elles ici leur rôle à jouer. Marcotte, on le sait, n’est pas l’homme des comités et des bandes et, pour toutes sortes de raisons, le hasard n’étant pas la moindre, son oeuvre est difficilement assignable à une génération. S’il a, à quelques années près, le même âge que Pierre Vadeboncoeur et Fernand Dumont, dont l’oeuvre s’impose dès le début des années 1960, c’est surtout à partir des années 1980 et plus encore des années 1990 que sa pratique de l’essai devient, du moins par le nombre de livres publiés, la plus courante, et qu’elle prend la forme d’une pensée inextricablement liée à l’existence et à la vie. Mais ce sera alors, à ce moment-là, une autre génération, celle de Jean Larose, Pierre Nepveu, François Ricard, Yvon Rivard, qui incarnera dans les esprits ce qu’est l’essai québécois, qui en définira la manière et les thèmes. De sorte que, par rapport à cette génération née dans l’immédiat après-guerre comme à la sienne propre, Marcotte apparaîtra toujours plus ou moins comme un solitaire ou, disons, un accompagnateur, celui qui vient après ou en second.
Mais la littérature n’est pas qu’affaire de circonstances. Si nous ne voyons pas en Gilles Marcotte un essayiste au même titre que Pierre Vadeboncoeur, André Belleau ou Pierre Nepveu, c’est-à-dire si nous ne voyons pas en lui un écrivain, c’est aussi parce qu’il ne pratique pas l’essai de la même façon qu’eux. Dans sa définition courante, qui est celle en laquelle nous reconnaissons les oeuvres de Vadeboncoeur, Belleau et Nepveu, comme aussi bien celles de Larose et Ricard, l’essai (je parle bien sûr ici de l’essai littéraire) est le lieu et la forme sinon d’une opposition au monde, tout au moins d’un retrait par rapport au monde. Selon cette définition, l’essayiste est celui qui, dans la solitude et le recueillement de sa pensée, examine les choses dans la distance, parfois même avec défiance, les soupèse, les retourne, cherche ce qu’elles recèlent de paradoxes et d’étrangeté. Cette conception n’a strictement rien d’erroné ; tout au contraire, l’essai est, au sens étymologique même du terme, une mise à l’épreuve du monde, des idées et des discours qui y circulent, des apparences qui le brouillent, des vérités sur lesquelles on le croit fondé. Mais ce qu’on oublie souvent de remarquer, une fois cette définition posée, c’est le portrait de l’essayiste qu’elle se trouve à tracer : par le travail de dévoilement qui est le sien, celui-ci occuperait toujours au sein de son texte, quelles que soient sa personnalité et les modalités de sa présence, la place du « héros » ou, si l’on préfère, du combattant.
Or c’est cette place qu’on ne trouve pas chez Marcotte, ou qu’on ne trouve pas de la même façon. Ce n’est pas seulement une question de modestie, même s’il insiste souvent sur les limites de son savoir ou sur sa nature de non-spécialiste, comme lorsqu’il se dit, juste avant de commenter son oeuvre, « lecteur débutant » de Wallace Stevens et « qui, au surplus, n’a pas une longue habitude de la poésie de langue anglaise[5] », ou qu’il renonce d’entrée de jeu à répondre aux reproches que lui fait un critique d’avoir publié dans L’amateur de musique des textes inégaux :
Il est gêné que j’aie fait paraître des chroniques superficielles à côté de textes assez bien venus. Il me conseille d’emprunter désormais la voie sérieuse de ces derniers textes, sur lesquels il formule quelques remarques aimables. Je ne suivrai pas ce conseil. Je vais continuer à confectionner des livres essentiellement imparfaits, sur lesquels des critiques compétents pourront émettre des réserves importantes[6].
Ce n’est pas non plus seulement une question de réticence à parler de soi et à recourir au « je », dont on dit souvent qu’il est, sous sa forme non métaphorique, la marque distinctive de l’essai[7]. Cette définition est juste, mais cause fréquente de malentendu, car on a tendance à la prendre au pied de la lettre et à faire de l’utilisation concrète de la première personne un des critères de l’essai. Or un essayiste peut très bien faire entendre sa subjectivité et sa voix singulières même sans recourir nommément au « je » et même sans parler de ses expériences personnelles (inversement, l’utilisation de la première personne dans un texte de réflexion ou de critique ne transforme pas celui-ci ipso facto en essai). Certes, il est vrai que la mesure de ce qui lui manque (comme de ce qui manque au monde qui est le sien : on se souvient qu’au début d’Une littérature qui se fait, il dit ne pas avoir le « loisir d’attendre[8] » les chefs-d’oeuvre pour engager la discussion sur les livres d’ici) et une forme assumée de pudeur expliquent en bonne partie que Marcotte n’endosse pas les habits du héros ou du combattant. On pourrait trouver une autre explication encore dans sa conscience qu’une pensée vraiment libre – et donc vraiment héroïque – est infiniment plus rare qu’on se l’imagine. Devant l’affirmation de Marthe Robert voulant qu’un écrivain ait la liberté d’affirmer sans preuve et de se contredire autant qu’il le souhaite il s’interroge :
Condamnation, ou éloge ? Je tergiverse. L’absence de preuve, j’aime assez, à condition que l’écrivain vraiment se prive de preuves, qu’il avance à visage découvert, qu’il prenne le risque total de l’affirmation. C’est plus difficile, plus exigeant qu’il ne paraît. Il y a toujours quelques petites preuves qui tentent de s’introduire dans le texte, pour rassurer un peu le pauvre homme[9].
Mais, si la réserve et la prudence permettent de comprendre pourquoi Marcotte ne revêt pas les habits du héros, elles ne sauraient expliquer à elles seules pourquoi ce rôle lui reste foncièrement étranger. À bien des égards, elles constituent même des explications secondaires en regard d’une raison beaucoup plus structurante et englobante (dont elles sont en quelque sorte des dérivés) : si Marcotte n’occupe pas dans ses textes la place du combattant, c’est parce qu’il ne cesse jamais, dans le même temps qu’il observe le monde avec toute la distance critique voulue, de se trouver non pas face à lui, mais à ses côtés.
Être aux côtés du monde, c’est d’abord être du côté très concret de la réalité. La réalité sociale, bien sûr, à laquelle Gilles Marcotte a toujours accordé une grande part de son attention, mais aussi la réalité tout court, objective, matérielle, celle qui résiste par sa simple présence, son simple bon sens aux idées et aux discours. Marcotte en offre une excellente définition lorsqu’il écrit, à propos d’un commentaire de Jean-François Revel expliquant dans ses Mémoires que s’il a su résister à la tentation du communisme, contrairement à beaucoup d’intellectuels de son époque, c’est grâce à son sens du ridicule :
Il ne s’agit pas là d’une petite vertu. Avoir le sens du ridicule, c’est aimer la réalité plus que tout ; la réalité plate, la réalité évidente, la réalité de bon sens, celle qui le plus souvent n’a aucun prestige intellectuel. J’ai vu Georges Marchais, il y a plusieurs années, commenter à la télévision les résultats de je ne sais plus quelle consultation électorale. C’était pompeux, faux à se rouler par terre, clownesque. Un grand nombre de Français intelligents, cultivés, raffinés ne se sont pas roulés par terre[10].
L’amour de la réalité ne sert pas seulement à se prémunir contre les idéologies et les constructions trop théoriques de l’esprit, mais aussi à se garder contre les « idées simples ». Marcotte se méfie autant de celles qui ont cours en politique –
Il m’est arrivé d’être séduit, pendant quelques minutes ou quelques heures, par un tel voeu de réduction, par la beauté de l’idée simple : un peuple, un pays. Mais les idées simples m’attirent de moins en moins. […] Ce que je veux léguer [à mes enfants], ce n’est pas un pays […] mais la conviction que l’aménagement d’une habitation humaine exige les soins les plus délicats, une attention de tous les instants, habile à déjouer les pièges de la fausse unanimité, de la fausse simplicité[11]
– que de celles qui circulent sur l’art et la littérature, ainsi qu’il le rappelle en ouverture de La littérature est inutile :
Il y a une idée à la fois très simple et très dangereuse – les idées simples sont souvent dangereuses – qui est propagée depuis quelques années ou quelques siècles par les discours sur l’art. Elle veut que la littérature, le théâtre, la peinture et la sculpture, pour ne citer que ceux-là, aient pour mission de transformer le monde, de le purger des maux qui l’accablent, enfin de l’entraîner vers un avenir meilleur[12].
En fait, les idées simples sont les idées qui, sous la forme de programmes, d’idéaux ou d’appels à la vertu, restent soigneusement à l’abri de la réalité. Or cette recherche d’abri, pour Marcotte, était la grande faille du roman québécois :
Il m’arrive de penser que ce qui manque, essentiellement, au roman québécois, c’est une certaine dureté. Elle se manifeste parfois – je pense au mépris du père Didace pour sa famille, dans Le Survenant –, mais furtivement, comme honteuse d’elle-même. Il n’y aura de vrai, de très grand roman québécois que délivré de cette complaisance, de cette compassion qui non seulement suit la faute mais la précède, la prévient, l’empêche d’exister. Je rêve d’un roman dur, cruel même, où le Québec serait l’objet d’une haine bien franche ou d’une ironie féroce. Ce roman nous rendrait fiers d’être Québécois[13].
Il nous rendrait fiers, parce qu’il nous ancrerait dans la réalité, parce qu’il nous donnerait de la réalité. Mais ce roman, Marcotte l’aura attendu toute sa vie.
Être aux côtés du monde, plutôt que face à lui, c’est aussi entretenir un tout autre rapport à autrui que celui qu’entretiennent, pour reprendre les termes que j’ai utilisés plus haut, le héros ou le combattant. C’est là ce qui distingue le plus fortement Gilles Marcotte des autres essayistes : il n’écrit pas dans la solitude ou la singularité de sa conscience, mais dans la compagnie constante de ce qu’on peut appeler une communauté. Comme celui de réalité, il importe d’entendre ce terme dans son sens le plus banal et le plus prosaïque. Il ne s’agit pas de l’ensemble lyrique des humains, de cette « universalité » que l’on est si prompt à convoquer au Québec (le plus souvent dans l’« idée simple » qu’elle permet de transcender tous les particularismes). De tels horizons sont beaucoup trop généraux et abstraits, et même grandiloquents, pour un esprit épris de « circonstances » et de réalité pratique comme l’est celui de Marcotte. Il ne s’agit pas pour autant d’une collectivité particulière, nationale ou autre. Marcotte écrit certes pour un public québécois, mais ce public n’a pour lui rien de politique ni même à vrai dire de sociologique, en dépit de ce qui le distingue des publics dont la culture et les traditions sont plus vieilles et par là plus solides. Le public québécois est, de façon plus fonctionnelle (on serait tenté de dire : plus réelle), celui du lieu où il est né et où il mène sa vie, et s’il participe à la communauté qui est la sienne, c’est parce que cette communauté est, très concrètement, celle des vivants, de ceux avec qui on dialogue, à qui l’on donne et de qui l’on reçoit, dont on est un semblable.
Parmi ces vivants, qui ne sont pas forcément d’exacts contemporains (les vivants peuvent habiter très loin dans le temps), on compte bien sûr les écrivains, auxquels Marcotte accorde toujours, dans chacun de ses textes, le devant de la scène. C’est, comme il le dit à propos de l’absence de preuves, plus difficile, plus exigeant qu’il n’y paraît. Même le critique le plus soucieux de neutralité scientifique et qui prend soin de citer abondamment son objet d’étude n’y parvient que rarement, et pour ainsi dire jamais, justement parce qu’il fait et ne peut pas éviter de faire de l’auteur étudié un « objet ». Or c’est là l’un des traits les plus remarquables de la pensée de Gilles Marcotte : les écrivains ne sont jamais pour lui des objets (d’étude, de réflexion, de méditation), mais des interlocuteurs. Mieux encore, dans le dialogue qu’il entretient avec eux, ce sont toujours eux qui sont les plus malins, et cela même lorsqu’il se fait lui-même très malin (ce qui arrive souvent). C’est le cas, de façon exemplaire, dans le texte intitulé « Réjean Ducharme, lecteur de Lautréamont », qui compte parmi les plus belles leçons de lecture de la critique littéraire québécoise. Marcotte a beau dévoiler une à une, dans cette analyse aussi astucieuse qu’érudite, toutes les références du romancier à l’auteur des Chants de Maldoror, jusqu’aux plus subtiles et aux plus cryptées, Ducharme demeure tout au long du texte celui qui tend les pièges, reste maître de la partie, possède des réserves pour soutenir mille sièges[14]. Voir comme une simple forme de rhétorique ou de politesse ou, encore une fois de modestie, même de haut niveau, cette façon de céder la voie à autrui, de lui laisser en quelque sorte le dernier mot ou, comme on le dit dans certains sports, l’avantage, serait se tromper sur le rapport qui se tisse ici entre l’essayiste et les auteurs dont il parle. Si Marcotte se refuse à être le plus malin et ne le peut pas de toutes façons, c’est parce que la littérature, l’intelligence de la littérature est toujours plus grande, plus profonde que celle des analyses, aussi brillantes soient-elles, qu’on peut lui appliquer. Ainsi écrit-il, à propos des écrivains retenus pour sa Petite anthologie péremptoire de la littérature québécoise :
Les neuf écrivains que j’ai réunis dans ma petite anthologie péremptoire […] ont en commun, me semble-t-il, malgré des orientations formelles et existentielles profondément différentes, par exemple entre Saint-Denys Garneau et Gabrielle Roy, Jean Le Moyne et Jacques Brault, de n’écrire pas pour rire. Ils ont affaire à quelque chose qu’à d’autres époques on appellerait la vérité. Je sais que c’est là un mot dangereux, et que particulièrement dans notre histoire à nous, Canadiens français, il s’est confondu très souvent avec des certitudes artificielles. La vérité dont je parle est le contraire de celle-là, et elle ne s’obtient, toujours infiniment fragile, que par le creusement jamais abandonné de quelques thèmes inépuisables. J’ai besoin de sentir qu’un écrivain me parle, à moi, de choses qui lui importent[15].
Même si Marcotte semble lui accorder plus de soin, c’est moins l’idée de vérité qui compte ici que celle d’importance. C’est parce que la littérature, la musique, les arts disent ou font comprendre des choses qui importent qu’il ne peut pas, qu’il ne saurait « gagner » contre les oeuvres dont il parle. Encore une fois, c’est un exercice beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît, en particulier au Québec, serait-on tenté d’ajouter dans un esprit marcottien, où les oeuvres ont souvent moins de résistance qu’ailleurs (personne ne gagnera jamais contre Racine, Shakespeare, Cervantès) et où l’institution est souvent plus forte que les oeuvres, où, pour le dire comme l’auteur de Littérature et circonstances, elle les précède plutôt qu’elle n’en découle[16].
Mais il n’y a pas que les auteurs qui fondent la communauté à partir de laquelle et pour laquelle écrit Marcotte. Il y a aussi les lecteurs, qui ne sont jamais chez lui des lecteurs spécialisés, mais des lecteurs ordinaires, courants, de bonne foi, ceux que Virginia Woolf appelait les « common readers », prêts à tous les efforts qu’exige la littérature à condition que ces efforts soient justifiés et récompensés, que les oeuvres ne soient pas écrites « pour rire ». Quiconque a lu Marcotte sait qu’il ne cesse jamais de s’adresser aux lecteurs, le plus souvent sous la forme d’un « vous » ou d’un « nous » qui font de ses essais un monde aussi peuplé qu’animé. « Dans quel guêpier sommes-nous fourrés[17] ? », demande-t-il ainsi après avoir cité les premières pages d’Une saison dans la vie d’Emmanuel, celles où nous faisons, aussi perplexes que lui, la connaissance de Grand-Mère Antoinette par les soins d’un bébé qui observe depuis son berceau les gros souliers de son aïeule. Les Histoires de déserteurs d’André Major, nous prévient-il, exigent de la patience :
C’est, comme on dit parfois au Québec, une brique. Quatre cent cinquante pages de grand format, remplies à ras bord d’un texte serré, fait de paragraphes extrêmement longs, massifs, sans pitié pour le lecteur pressé. Déjà, en le prenant dans vos mains, avant de l’ouvrir, vous avez été frappé par son poids. Cela tient difficilement dans vos mains, il faudra vous y habituer[18].
De même à propos de Jacques Brault, dont
l’oeuvre poétique, quand vous la lisez tout entière et la relisez, perd peu à peu cette apparence de chaude maison du langage qui vous avait d’abord attiré. […] Vous la croyiez entièrement vouée à la simplicité, au naturel […] et tel poème la montre tout à coup compliquée, heurtée, exhibant sa propre construction comme une sorte de défi[19].
Là encore, on aurait tort de ne voir dans ces adresses qu’une forme de rhétorique, même si elles constituent assurément une façon de parler de soi en parlant de tous. Car les réduire à une question de forme ou de manière serait rater l’essentiel de ce qu’elles disent, et qui est qu’un lecteur, quel qu’il soit, n’est jamais seul, n’existe pas – ne peut pas exister – sans la compagnie d’autres lecteurs. Il ne s’agit pas de signifier par là que toute lecture est relative, ce qui est une évidence, mais de rappeler ou de ne pas oublier qu’il ne peut y avoir d’oeuvres sans un public pour les attendre, les accueillir, leur donner une raison d’être, en un mot les rendre possibles. On dira que cela aussi est une évidence, mais c’est une évidence dont on sous-estime le sens et les ramifications. Marcotte ne les sous-estimait pas ; il s’agit même, si l’on peut dire, de l’un de ses objets d’attention les plus anciens.
L’idée de communauté apparaît en effet très tôt dans son oeuvre, par exemple dans Le temps des poètes, où il cite en introduction T. S. Eliot et Octavio Paz :
Je pense qu’il est important que chaque peuple puisse avoir sa propre poésie, pas seulement pour ceux qui aiment la poésie – ces gens-là pourraient toujours apprendre d’autres langues et en goûter la poésie – mais parce que cela fait une différence pour la société dans son ensemble, et cela veut dire pour les gens qui ne goûtent pas la poésie » (Eliot, De la poésie et de quelques poètes) ; « Le poème fonde le peuple, parce que le poète remonte le courant et boit à la source originelle. Dans le poème, la société rejoint les fondements de son être » (Paz, L’arc et la lyre)[20].
Certes, Marcotte ne reprend pas le terme de « peuple » et il sait que dans le monde actuel la présence de la poésie n’est plus que l’ombre de ce qu’elle a été jadis, mais, écrit-il, « celui-là même qui fait des vers dans le secret, pour lui-même et peut-être pour quelques happy few, n’ignore pas que son activité intéresse l’ensemble du corps social, nourrit l’espérance d’une communauté[21] ». Trente ans plus tard, il se dira reconnaissant que cette espérance d’une communauté née de la poésie, façonnée par elle, se soit, pour lui, réalisée :
Roman Jakobson a parlé, dans un de ses livres, de la « génération qui a gaspillé ses poètes », sa propre génération, qui a vu mourir dans le désespoir le grand Maïakovski. Ce qui m’a frappé, dans ce texte, c’est le fait même de la génération, la complicité profonde qui existe à certains moments de l’histoire entre poètes et lecteurs, et leur donne en quelque sorte un destin commun […]. J’ai eu le privilège de faire partie – avec une certaine réserve, à une certaine distance : j’étais critique – d’une véritable génération poétique, celle de l’Hexagone, et je dis que si l’on n’a pas vécu une expérience comme celle-là, on ignore quelques aspects essentiels de la vie de la poésie[22].
Cette complicité, ce destin commun entre les écrivains (car on peut bien sûr l’étendre aussi aux romanciers) et les lecteurs est peut-être ce qui éclaire le mieux la distinction, fondamentale pour Marcotte, mais souvent mal comprise, entre l’utilité de la littérature et ce qu’il appelle sa « nécessité », terme qui revient, avec l’adjectif « nécessaire », partout dans son oeuvre, mais la plupart du temps si discrètement qu’on n’y porte guère attention. De l’utilité, on sait ce qu’il pense, lui qui reprend à son compte la réponse faite par Wallace Stevens à la question de savoir si le poète a, à l’endroit de sa société, une quelconque responsabilité morale, philosophique ou politique : « He has none[23]. » On trouve moins facilement une définition claire de la nécessité, ce qui n’a rien d’étonnant, car il s’agit d’un concept beaucoup plus subtil, beaucoup plus exigeant, à la fois intellectuellement et existentiellement, que celui d’utilité. En fait, la littérature est nécessaire précisément en ce qu’elle permet de lutter contre l’utilité (qui n’est que l’autre nom des « idées simples »), ses certitudes, ses leçons de morale, sa bonne conscience. Elle « nous apprend à lire dans le monde ce que, précisément, les discours dominants écartent avec toute l’énergie dont ils sont capables : la complexité, l’infinie complexité de l’aventure humaine[24] ». Mais la littérature est également nécessaire, pourrait-on ajouter, par le fait même qu’elle crée de la communauté, ou, plus radicalement encore, qu’elle crée la communauté, qui ne saurait exister sans les liens que les oeuvres, en particulier les grandes, mais pas seulement elles, tissent entre les consciences et les époques. Rien ne saurait être plus éloigné de la littérature – en tout cas, rien n’est plus éloigné de Marcotte – que l’idée, encore très courante au Québec, qui y voit souvent sa spécificité, que des oeuvres puissent naître de la spontanéité ou du naturel, de l’affranchissement de la culture et de la tradition, de la simple présence au monde, bref, de cette illusion de liberté native et de dépouillement qu’André Belleau associait au mythe « du bon sauvage[25] ». L’idée de nécessité dit tout le contraire : il n’y a de littérature, et il n’y a de communauté, que dans le temps et la durée, l’épreuve de ce qui est reçu et transmis, de ce qui circule et se transforme, se construit patiemment.
Le problème avec la nécessité, comme d’ailleurs avec la communauté et la réalité, c’est qu’elles ne sont jamais spectaculaires. Contrairement à l’utilité, qu’on peut défendre, proclamer, publiciser, ce sont là des domaines discrets de l’existence, et l’essayiste qui en fait le coeur de sa pensée n’a d’autre choix que d’accueillir pour lui-même cette discrétion. Marcotte écrivait d’André Belleau que son panthéon littéraire était composé d’« auteurs au long cours et qui en fauchent large » – Mikhaïl Bakhtine, François Rabelais, Georg Lukacs (celui des premiers essais) – et qu’il « n’était à l’aise que dans ces dimensions-là », même s’il avait conscience de ne pas les habiter lui-même et « en voulait à sa formation québécoise de ne pas lui avoir donné les moyens de se promener à l’aise dans d’aussi vastes cantons[26] ». Les dimensions de Gilles Marcotte ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas moins larges – pensons à ses lectures de Rimbaud, de Claudel et, par sa foi chrétienne, de la Bible, tout particulièrement le Nouveau Testament –, mais elles sont contenues par ce que l’existence a de contingent et de contraignant. Pour cette raison même, ce sont des dimensions qu’il habitait pleinement, qui se fondaient avec celles de la vie de tous les jours et ce qu’on peut appeler la vie d’ici. Il aura oeuvré à cette habitation avec une profondeur de vue, une acuité, une générosité et, on ose le dire, un bonheur dont on trouve peu d’égal au Québec – si même on en trouve. En cela, il aura été l’un de nos essayistes les plus nécessaires.
Appendices
Note biographique
Isabelle Daunais est professeure au Département de langue et littérature françaises de l’Université McGill où elle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’esthétique et l’art du roman. Spécialiste de Flaubert, elle a publié plusieurs études sur le roman moderne, notamment Les grandes disparitions. Essai sur la mémoire du roman (Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2008) et Frontière du roman. Le personnage réaliste et ses fictions (Montréal/Saint-Denis, Presses de l’Université de Montréal/Presses universitaires de Vincennes, 2002). Elle est l’auteure d’une étude sur le roman québécois, Le roman sans aventure (Montréal, Boréal, 2015) et d’un recueil d’essais, Des ponts dans la brume (Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 2008).
Notes
-
[1]
Jean Larose, « Naissance d’un essayiste », préface à Une littérature qui se fait. Essais critiques sur la littérature canadienne-française, Montréal, BQ, 1994 [Montréal, HMH, coll. « Constantes », 1962], p. 7-24. On pense aussi à François Ricard, qui a très tôt distingué Marcotte comme un essayiste (« La littérature québécoise contemporaine 1960-1977. iv - L’essai », Études françaises, vol. 13, no 3-4, 1977, p. 365-381), et à Laurent Mailhot qui lui consacre, aux côtés d’écrivains comme Gabrielle Roy, Saint-Denys Garneau, Gilles Archambault ou Pierre Morency, un chapitre dans Plaisirs de la prose (Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2005) en plus de l’inclure dans son anthologie de L’essai québécois depuis 1945 (Montréal, HMH, 2005).
-
[2]
Michel Biron, François Dumont, Élisabeth Nardout-Lafarge, avec la collaboration de Martine-Emmanuelle Lapointe, Histoire de la littérature québécoise, Montréal, Boréal, 2007, p. 413.
-
[3]
Pierre Vadeboncoeur, La ligne du risque, Montréal, HMH, coll. « Constantes », 1963 ; Fernand Dumont, Le lieu de l’homme. La culture comme distance et mémoire, Montréal, HMH, coll. « Constantes », 1968 ; André Belleau, Surprendre les voix, Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 1986 ; Pierre Nepveu, Intérieurs du Nouveau Monde, Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 1998.
-
[4]
Histoire de la littérature québécoise, p. 600 et 601.
-
[5]
Gilles Marcotte, Le lecteur de poèmes, Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 2000, p. 190.
-
[6]
Gilles Marcotte, Les livres et les jours. 1983-2001, Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 2002, p. 35.
-
[7]
Voir notamment Jean Marcel, « Forme et fonction de l’essai dans la littérature espagnole », dans François Dumont (dir.), Approches de l’essai, Québec, Nota bene, coll. « Visées critiques », 2003, p. 85-103 et François Ricard, art. cit.
-
[8]
Gilles Marcotte, Une littérature qui se fait, p. 27.
-
[9]
Gilles Marcotte, Les livres et les jours, p. 12.
-
[10]
Ibid., p. 123.
-
[11]
Ibid., p. 176.
-
[12]
Gilles Marcotte, La littérature est inutile. Exercices de lecture, Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 2009, p. 7.
-
[13]
Gilles Marcotte, Les livres et les jours, p. 52.
-
[14]
Gilles Marcotte, « Réjean Ducharme, lecteur de Lautréamont », Études françaises, vol. 26, no 1, 1990, p. 87-127.
-
[15]
Gilles Marcotte, Petite anthologie péremptoire de la littérature québécoise, Montréal, Fides, coll. « Les grandes conférences », 2006, p. 39. C’est l’auteur qui souligne.
-
[16]
« Tel est le premier paradoxe qu’il faut relever, quand on parle de l’institution littéraire au Québec : elle précède les oeuvres, elle se crée dans une indépendance relative par rapport aux oeuvres, elle a préséance sur les oeuvres », Littérature et circonstances, Montréal, L’Hexagone, coll. « Essais littéraires », 1989, p. 17.
-
[17]
Gilles Marcotte, Le roman à l’imparfait. La « Révolution tranquille » du roman québécois. Essais, Montréal, L’Hexagone, coll. « Typo », 1989 [Montréal, La Presse, coll. « Échanges », 1976], p. 14.
-
[18]
Gilles Marcotte, La littérature est inutile, p. 90.
-
[19]
Gilles Marcotte, Littérature et circonstances, p. 259.
-
[20]
Gilles Marcotte, Le temps des poètes. Description critique de la poésie actuelle au Canada français, Montréal, HMH, 1969, p. 9-10.
-
[21]
Ibid., p. 10.
-
[22]
Gilles Marcotte, Le lecteur de poèmes, p. 18.
-
[23]
Gilles Marcotte, La littérature est inutile, p. 9.
-
[24]
Idem.
-
[25]
André Belleau, Surprendre les voix, p. 156.
-
[26]
Gilles Marcotte, Littérature et circonstances, p. 306-307.