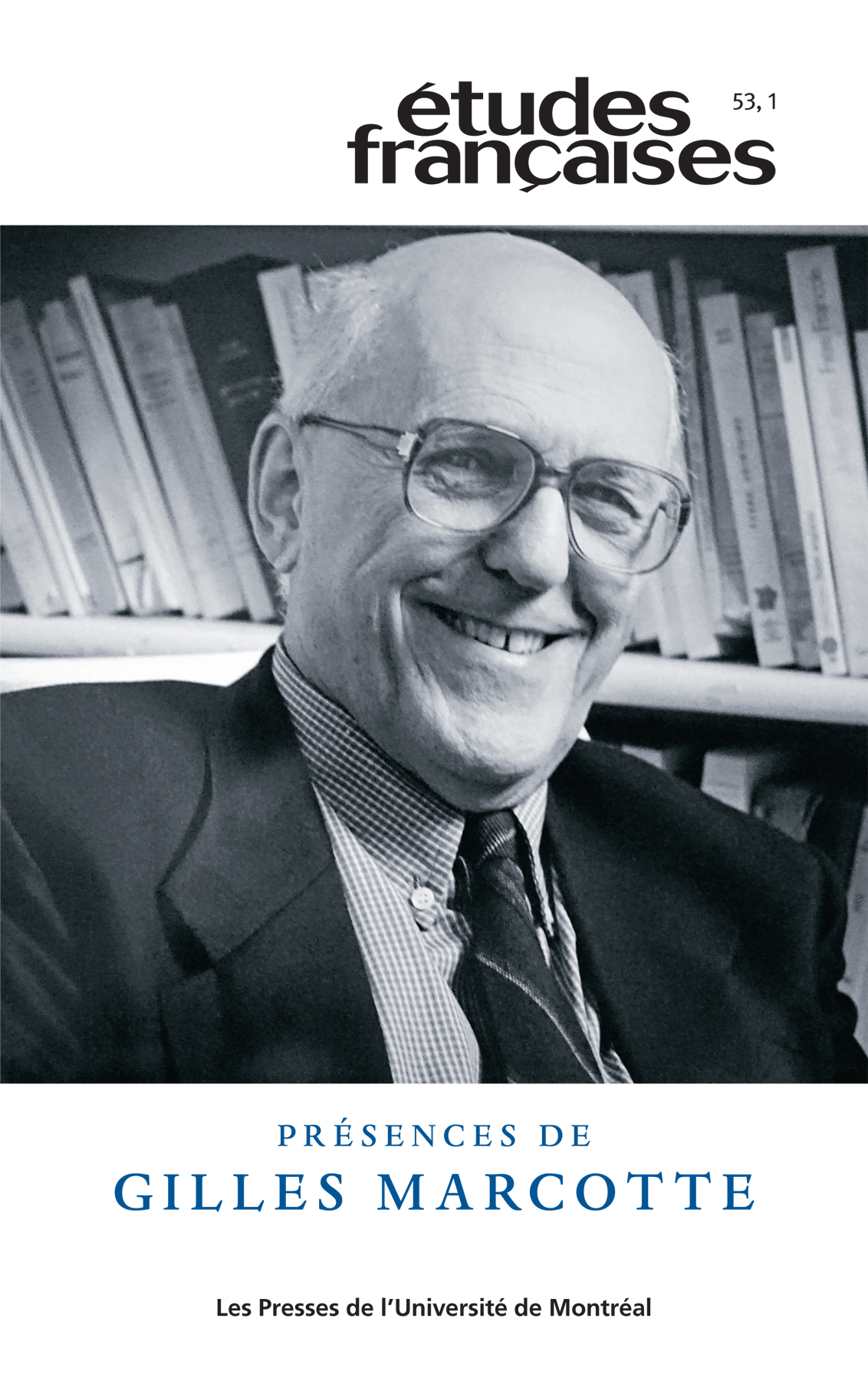Abstracts
Résumé
Cet article s’attache aux divers sens et usages liés dans oeuvre de Gilles Marcotte à Montréal comme lieu polymorphe, à la fois thème et structure, temps et espace. Proche en cela de la notion d’« espace habité » de Michel de Certeau, l’idée selon laquelle on écrit et lit différemment selon les lieux est déjà présente dans La littérature et le reste et réunit les essais du volume Écrire à Montréal. Dans l’oeuvre de Marcotte, ville et écriture se rejoignent dans une commune ouverture aux possibles, dans la pluralité et le mélange, et la radicalité du partage du sens qu’ils induisent. En témoigne le rôle heuristique de Montréal qui apparaît dans Le roman à l’imparfait tandis que d’autres textes de Marcotte, notamment sa contribution à Montréal imaginaire, montrent que le désordre montréalais trouve plutôt à loger dans les oeuvres faiblement légitimées de la littérature populaire ; mystères urbains, récits journalistiques, romans obscurs. Les villes, dans l’oeuvre essayistique, critique et fictionnelle de Gilles Marcotte, n’ont pas la fermeté ontologique qu’une conception réaliste tendrait à leur attribuer, elles relèvent plutôt du mouvement de l’esprit qui les fait advenir dans l’ordre du discours et sont indissociables du projet intellectuel qu’elles manifestent. Ce faisant Gilles Marcotte rend la ville habitable.
Abstract
This article looks at the various related meanings and usages in Gilles Marcotte’s writings about Montréal as a many faceted place, at once theme and structure, time and space. Much like Michel de Certeau’s notion of “espace habité” (“inhabited space”), the idea that we write and read differently depending on the place is already present in La littérature et le reste and brings together the essays of the volume Écrire à Montréal. In Marcotte’s work, city and writing join in a common openness to what’s possible, in the multiplicity and the mix, and the radicality of sharing the meaning they induce. Montreal exemplifies the heuristic role that appears in Le roman à l’imparfait while other Marcotte texts, notably his contributions to Montréal imaginaire, show that Montreal’s disorder appears in some scantly legitimate popular literature: urban mysteries, journalistic accounts, obscure novels. Cities, in Marcotte’s essayistic, critical and fictional work, do not have the ontological assurance that a realist conception would tend to accord them. They flow instead from the movement of the mind that places them in the discourse, undifferentiated from the intellectual aspect they manifest. Thus does Gilles Marcotte make the city “habitable.”
Article body
Gilles Marcotte a beaucoup écrit sur Montréal, particulièrement dans le cadre du projet « Montréal imaginaire », qu’il a codirigé avec Pierre Nepveu. Il a aussi beaucoup écrit à Montréal et cela signifiait hors de tout doute quelque chose de spécifique à ses yeux puisqu’il en fit le titre d’un recueil d’essais : Écrire à Montréal[1]. Je me propose d’arpenter ici à grandes enjambées les divers sens et usages liés dans son oeuvre à Montréal comme lieu polymorphe, à la fois thème et structure, temps et espace dans lesquels et à propos desquels sa pensée se déploie sans viser un achèvement. Je ne chercherai pas à gommer les contradictions que Marcotte avoue d’ailleurs explicitement, de sorte que j’adopterai un plan moins argumentatif que mosaïcal, dont les fragments seront rassemblés autour du lien fort affiché par Marcotte à l’endroit de Montréal.
Quand je dis que je suis attaché à Montréal […] ce n’est pas à cause d’un lieu, d’un décor, d’une atmosphère, d’un charme particuliers – encore que cela existe, bien sûr –, mais parce qu’en elle ont pris forme, pour moi, cette « communion » dont parle Claudel, cette « disponibilité de mouvements » qui est le sens même de la ville[2].
Voici donc Montréal en incarnation du sens de la ville, en ur-ville, et Gilles Marcotte en Montréalais animé de la conviction que cette ville existe : en Montréaliste donc.
Lire et écrire à Montréal
Un jour, Gilles Marcotte m’a donné un livre, « parce que cela vous intéressera et que vous le garderez et en ferez quelque chose », m’avait-il dit. Il s’agit d’une édition scolaire d’Athalie de Racine, publiée en 1969, à lui offerte, longtemps après, par l’auteur de la présentation, H[ermann] P[rinz] Salomon, comme l’indique la dédicace manuscrite de la page frontispice : « Hommage du commentateur, de passage à Montréal, Albany, le 1er novembre 1999[3] ». Cette édition toute classique (la préface est de Jean Mesnard) comporte deux photographies qui renvoient à des mises en scène montréalaises ; l’une du décor de J. A. Rho pour des représentations au Gesù, en 1925, l’autre de la comédienne Denise Pelletier en costume d’Athalie, au Festival de Montréal, en 1956. D’où le don. Gilles Marcotte avait été touché de recevoir cet exemplaire qui témoigne de ce que la pièce de Racine a participé, de quelque façon, à la vie montréalaise, l’édition illustrant deux modes de son appropriation, ou de sa montréalisation, dirai-je, à vingt-cinq ans d’intervalle[4]. La littérature rejoignait ainsi la ville réelle : sans perdre de sa hauteur elle se trouvait en quelque sorte compromise. Lue à partir d’un lieu, elle s’y trouvait soumise et, réciproquement, la ville s’en trouvait configurée autrement.
C’est que, selon Marcotte, énoncer quelque chose à partir d’un lieu, écrire à Montréal, par exemple, ne constitue pas un simple trait anecdotique. Dans La littérature et le reste, échange épistolaire mené tambour battant, dans la complicité, avec André Brochu, le mot Montréal apparaît quasi exclusivement lorsqu’il est question de sport, hockey ou baseball, ce qui semble relever de l’anecdote. Pourtant l’échange littéraire lui-même y a quelque chose de profondément montréalais, tellement qu’une lettre de Marcotte, écrite de l’étranger, « Biddeford Pool, Maine, USA », comporte une longue remarque sur Montréal comme lieu d’écriture :
Je ne suis pas devenu entièrement américain, mais je me repose […]. Vous comprendrez qu’il ne me soit pas facile d’aborder, dans les grandes dimensions, le redoutable problème de l’autonomie de la critique littéraire. Je vous l’abandonne. Ce genre de question se traite mieux à Montréal, banlieue de Paris, qu’à Biddeford Pool, Maine[5].
Puisque la définition de la critique littéraire sert de fil d’Ariane aux débats qui occupent les deux correspondants, aussi bien dire que Montréal constitue une sorte de condition préalable à l’échange, à l’écriture.
Cette idée, selon laquelle on écrirait différemment selon les lieux, est récurrente dans les textes. D’une part, « Paris me donne, mais là vraiment, le goût d’écrire. […] C’est dans l’air, dans l’atmosphère. Écrire à Montréal, ce n’est pas naturel, cela ne va pas de soi[6]. » Mais aussi : « Il m’a toujours semblé que, si j’étais resté à Sherbrooke, ma ville natale, j’aurais écrit différemment, autre chose, et peut-être même n’aurais-je pas écrit du tout, du moins au sens que l’écriture a pour moi aujourd’hui » (ÉM, 7). Si écrire à Paris c’est consentir au mythe[7], écrire à Montréal c’est plutôt « s’inscrire dans une institution littéraire plus exiguë » (ÉM, 8), dans un lieu où on lit certains journaux (Le Devoir, La Presse) – tandis qu’à Biddeford, Maine on lit plutôt « chaque semaine le New York Times et chaque jour le Boston Globe ou le Boston Herald American[8] » –, accompagné par des oeuvres et des critiques. Mais c’est aussi regarder et écouter la ville, faite de discours qui prennent en écharpe le réel : « Et puis, ma foi, regardez la ville. Gaston Miron s’en allait, criant de sa voix forte dans les rues de la métropole : “C’est pas une ville, c’est un garage !” écrit Marcotte, qui poursuit, « Écoutez aussi bien la langue qui se parle à Montréal, la française d’abord, parfois assez mal en point, et l’anglaise, qui malgré toute loi et tous règlements existe fortement à Montréal, et se fraie un chemin jusqu’au coeur de la langue dominante » (ÉM, 8).
Bien sûr, la langue n’est pas tout à fait la littérature, mais la parole de Miron l’est, elle, de plein droit malgré ou à cause de son oralité : le poète qui crie de sa voix forte dans les rues, est bien celui qui écrit « je déparle à voix haute dans les haut-parleurs[9] ». Le réel de la ville et le discours qui la traverse se rejoignent : ils donnent forme à la ville, bruissante de sons et de mots. Peut-être la ville est-elle laide (« On peut très bien aimer sa ville et crier des choses comme cela », précise Marcotte), mais cela ne change rien, cela participe de ce que Marcotte nomme ailleurs le « texte urbain général » (ÉM, 122) de la modernité. « Le Montréal de Gaston Miron, qui est indiscutablement le nôtre », écrit Marcotte dans la conclusion d’un texte qui porte sur les Villes de Rimbaud, devient ainsi, par l’écriture, une ville qui « appartient à l’universel, à l’ordre citadin du monde ; et elle lui appartient comme désordre, par ce qui, en elle, résiste au voeu d’appartenance, au voeu d’unité » (ÉM, 123). Ainsi, Montréal, « le nôtre », est-il, par l’écriture, marqué d’une double implication. Il nous appartient et nous lui appartenons :
or je descends vers les quartiers minables
bas en respirant dans leur remugle
je dérive dans des bouts de rue décousus
voici ma vraie vie – dressée comme un hangar –
débarras de l’Histoire[10].
Le « hangar », le « débarras » de la « vraie vie du poète », c’est tout aussi bien le « garage » qui tient lieu de ville dans l’exclamation de Miron citée plus tôt. Le désordre de Montréal, qui le fait universel – car telle est la ville de la fin du xxe siècle –, fait aussi de lui, paradoxalement, « un lieu pratiqué » ou, selon les termes de Michel de Certeau, « un espace[11] ».
Ville et littérature : pratiques de l’abstrait
Si Gilles Marcotte y insiste, « je ne puis pas m’enlever de la tête que la question du lieu, du lieu urbain, n’est pas indifférente à celle de l’écriture » (ÉM, 8), on peut dire que c’est parce que l’influence réciproque entre espace et écriture marque la plus grande partie de son oeuvre, depuis l’idée de « condition commune » qui traverse Une littérature qui se fait[12], jusqu’aux deux portraits d’écrivains publiés dans La vie réelle, dans lesquels l’écriture d’Octave Crémazie et celle de Patrice Lacombe trouvent leur vérité dans les lieux abstraits qui la modèlent : l’exil pour Crémazie, l’effacement de la vie dans la neige qui tempête pour Lacombe[13]. Il faut rappeler que la ville est aussi une réalité abstraite « générale », écrit Marcotte à la suite de Claudel, faite à la fois de « communion » et de « disponibilité de mouvement », de sorte que Montréal est une « possibilité plurielle, générale d’écriture » (ÉM, 10 ; c’est Marcotte qui souligne). C’est pourquoi Marcotte est attentif aux grandes figures de l’urbanité comme le flâneur, n’hésitant pas à placer sous ce paradigme, côte à côte, Hector Fabre, Baudelaire et Benjamin (voir ÉM, 13[14]) et à parler du Montréal de Miron en l’inscrivant dans le Paris décalé de Rimbaud. À ce titre, ville et écriture se rejoignent dans une commune ouverture aux possibles, dans la pluralité et le mélange, et dans la radicalité du partage du sens qu’ils induisent.
Il me semble que nous croisons là deux des fils principaux de la pensée de Gilles Marcotte sur la littérature : l’insistance qu’il met sur la notion de « circonstances » et sa définition de l’institution comme origine des possibles en littérature. « Le mot circonstances désigne ou plutôt suggère une certaine idée de l’action littéraire », lit-on d’entrée de jeu dans Littérature et circonstances[15]. Sous cette définition un peu énigmatique, deux idées complémentaires : que les oeuvres sont « compromis[es] dans la foire aux langages, aux idéologies qui est notre vie à tous » et qu’elles en livrent l’épure[16]. De ce point de vue, elles sont toujours « de circonstances », même si elles accèdent à une forme d’abstraction. Pour autant, elles ont besoin d’une institution parce que « la liberté ne précède pas mais suit l’institution » (LC, 10). Aussi, littérature et ville manifestent-elles un rapport homologue entre l’histoire agie (les pratiques) et l’abstrait des significations. Toutes deux sont des « espaces pratiqués » ; toutes deux sont créatrices de significations qui toujours les débordent. On mesurera l’importance qu’occupent, dans une telle architecture théorique, le récit et la fiction, qui mettent à l’épreuve les pratiques, les « essaient », mais aussi l’énonciation et, réciproquement, la lecture, qui sont ici le premier degré de l’action, de la vie.
Sans doute serait-il possible de soutenir l’idée que la littérature a depuis ses origines maille à partir avec la ville, qui permet simultanément une communauté d’auditeurs ou de lecteurs et une ouverture aux possibles. Nous partirions de la Grèce antique – Troie et Ithaque sont des villes après tout… Ou encore pourrait-on développer l’idée que l’abstraction qu’est la ville, son urbanité, n’a pas besoin de lieux réels et qu’il suffit d’une communauté qui s’ouvre à la littérature pour que celle-ci se réalise. Gilles Marcotte ne s’aventure pas sur ces chemins. Mais posant, en une surprenante litote, un lien de « non-indifférence » entre écriture et ville, il se donne le droit d’examiner la ville avec les lunettes de la littérature.
Montréal imaginaire
Plusieurs d’entre nous nous rappelons, encore aujourd’hui, l’indignation qui fut celle de Gilles Marcotte à la lecture de l’une des évaluations reçues à propos de la demande de subvention pour le projet « Montréal imaginaire », laquelle disait, en substance, que puisque Montréal existait, elle n’était pas imaginaire, et que donc la demande de subvention devait être rejetée. Son indignation n’était pas sans mélange toutefois parce que ce jugement péremptoire lui paraissait manquer de sens commun au point de sombrer dans le ridicule. Comme toute ville, Montréal est imaginaire, et c’est par « l’écriture montréalaise [que] Montréal devient un lieu réel, un lieu habitable » (ÉM, 12). Retenons-en pour l’instant que, pour Gilles Marcotte, le Montréal réel, celui des sociologues, et le Montréal de la littérature, celui des écrivains, ne peuvent être renvoyés dos à dos : « entre la ville et la littérature, osons dire que l’influence est réciproque », comme le dit l’introduction du collectif Montréal imaginaire[17]. Ce projet, dont la fécondité fut exemplaire (plus de trente chapitres de livres ou articles, trois colloques et un séminaire international, deux anthologies – dont celle méconnue de Nathalie Fredette[18] –, des rapports de recherche, des mémoires et une thèse, etc.), Marcotte s’y engagea, en « obtempérant », dit-il, à Jean-François Chassay et Pierre Popovic (ÉM, 13) pour notre plus grand plaisir : nombre de nos recherches ultérieures sont nées dans les marges du séminaire animé conjointement par Pierre Nepveu et Gilles Marcotte, à la suite de lectures théoriques stimulantes et de la découverte de corpus négligés. S’il a « obtempéré », c’est sans doute parce qu’il y avait là une irrésistible tentation. En effet, la ville, et Montréal en particulier, est présente bien avant dans son oeuvre, elle est le centre qui autorise la pensée théorique parce que, comme les grandes catégories génériques auxquelles s’affronte Marcotte, elle ne constitue jamais un donné.
Le roman à l’imparfait donne une bonne idée du rôle heuristique de la ville. Le premier chapitre porte sur les romans de Gérard Bessette, principalement sur La bagarre. Marcotte y conclut que l’impossibilité d’écrire du personnage principal, Jules Leboeuf, est liée à son projet même : « Son projet d’écriture [celui de Jules Leboeuf], son projet romanesque, n’a de sens que par rapport à la totalité montréalaise. Faire vivre Montréal, disait-il, lui donner une âme en quelque sorte[19]. » Le roman de Montréal que Jules Leboeuf rêve d’écrire est un roman réaliste, qui composerait une « totalité mouvante » dans la perspective de Lukacs, forme déjà disparue dont le modèle et, pour tout dire, la seule véritable incarnation, selon Marcotte, est Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy[20]. Marcotte en montre les traces exhibées dans les personnages de La bagarre, voyant Gisèle Lafrenière comme une sorte de « remake de Florentine Lacasse » et Jules Leboeuf comme un Jean Lévesque « voulant conquérir le monde urbain » (RI, 28). Toutefois il y a une impossibilité radicale : visant la description de cette « totalité mouvante », Gérard Bessette, comme Jules Leboeuf, ne livre que des fragments, des pièces décousues, qui disent le réel de manière brute, avance Marcotte, mais pas sa totalité. L’analyse de Marcotte s’organise alors selon une double proposition dans laquelle Montréal remplit une fonction essentiellement théorique. D’une part, le grand roman réaliste, celui qui permettait d’aborder la ville comme une totalité, n’a plus cours dans la littérature québécoise de 1959 ; d’autre part, si Bonheur d’occasion est un grand roman, c’est qu’à travers Florentine, qui « arrive en ville » (RI, 48. C’est Gilles Marcotte qui souligne), il affronte la ville comme « totalité mouvante », et « que cette ville c’est Montréal, Montréal devenant la vraie ville moderne, ouverte à tous les vents du devenir » (RI, 42. Je souligne). Ainsi Montréal se trouve-t-il, comme le roman, à dire la transition qu’incarne Florentine : « nous entrions dans le siècle – le roman. C’était en 1945 » (RI, 43). Notons au passage l’emploi de l’imparfait qui remplit ici une fonction contraire à celle du titre de l’ouvrage, car Le roman à l’imparfait dit l’impossibilité, désormais, de l’achèvement, autant pour la société québécoise, que pour Montréal et pour le roman, à la suite de Bonheur d’occasion. Il faut voir ici, me semble-t-il, comment la définition, canonique en 1976, de la société québécoise comme société rurale, se trouve à la fois réitérée et minée par les propositions de Marcotte. Certes, « Florentine est bien le personnage type du passage de la société traditionnelle à la culture urbaine » (RI, 42). Mais elle porte aussi en elle les « richesses [du] monde ancien » (idem). Comme Florentine, Montréal est en transition, la ville a donc, comme le personnage, un passé, un présent et un futur. Si, comme le dit Marcotte, « s’accomplit en Florentine le partage de toute une société » (idem), alors la transition porte, larvé, ce passé urbain. D’ailleurs, Florentine, malgré cette transition qu’elle incarne, est toujours déjà urbaine, comme l’a montré ailleurs Gilles Marcotte dans une analyse de l’incipit du roman[21].
Dans la synthèse qui clôt son essai, « Le romancier comme cartographe », Gilles Marcotte, après avoir abordé les oeuvres de Réjean Ducharme, Marie-Claire Blais et Jacques Godbout, métaphorise spatialement ce qu’il a découvert : il parle de la figure de contiguïté qui préside à l’organisation des romans et des « “puissances de l’espace” auxquelles sacrifie la parole vive » (RI, 187-188). Il en expose la violence : « le langage de l’espace est impatient, car rien pour lui n’a de valeur que dans l’instant, il est intolérant, car il doit sans cesse lutter pour définir les frontières de son lieu » (RI, 189) et en dévoile la tyrannie : « la conscience exclusive de l’espace, livre l’homme à l’immédiat, qui est pure violence » (RI, 188). L’espace de référence, celui du cartographe auquel sont renvoyés les romans, est imagination et sa coïncidence avec le réel supposerait un renoncement à sa liberté. Dans ce chapitre proprement sidérant de densité théorique[22], Marcotte montre comment expérience du temps et expérience de l’espace se rejoignent dans les romans étudiés, dans un « présent sans médiations temporelles » (RI, 188) : « le roman vit donc, avec nous, le risque de la parole vive, proliférante, jouant les relations spatiales de l’instant » (RI, 189). Vingt ans plus tard, ces attributs du roman seront devenus ceux-là même de Montréal, espace de contiguïtés, de désordre et d’instabilité : « à Montréal, l’écrivain est immergé dans le divers, le pluriel, le mélange, l’incertain, l’incomplet » (ÉM, 10). Ville et roman sont placés sous les signes de la dispersion et du mouvement. Le cartographe – ou le romancier – en capte un instant, sans prétendre dire le tout du lieu. Point aveugle de l’analyse formelle, Montréal éclaire obliquement les enjeux temporels et spatiaux que le roman « invente » et dévoile tout à la fois, tout comme la carte suggère une configuration inédite, à jamais inconciliable avec les cartes réelles de l’évêque ou du ministre racontées par Jacques Ferron[23]. De ce point de vue, il est intéressant de voir que Montréal ne réapparaît dans les trois analyses qui suivent celle des romans de Bessette qu’à titre d’évidence. Chez Ducharme : « On fait ce que veut le roman. Et le roman veut l’histoire, la ville, le sexe » (RI, 60). Chez Marie-Claire Blais, alors que le bordel et l’usine, formes métonymiques de la ville, en effacent les contours concrets, rendus inutiles, devenus ceux d’une « non-campagne » (RI, 124-125). Chez Godbout, où la ville se manifeste aussi métonymiquement, à travers le journal quotidien (voir RI, 148-169).
Montréal agit comme catalyseur dans le mouvement des formes, sa présence comme son absence sont agissantes. C’est que la ville est, dans la prose de Marcotte, toujours affrontée à d’autres mots qui la font apparaître en creux : la campagne, le monde, les livres, le récit. Je me limiterai ici à examiner le couple ville/campagne. La ville contre la campagne, dirait le texte social. Or ce couple n’est jamais « une chose simple » (MI, 98) chez les romanciers et les poètes, selon Marcotte. Il y a une ambiguïté fondamentale. Arriver en ville, c’est bien sûr, entrer dans un monde nouveau, comme le donne à voir l’arrivée du critique lui-même à Montréal dans « J’arrive en ville » (voir ÉM, 17-22). Mais cela se produit aussi sur un fond de familiarité troublante. La ville a déjà une existence discursive, aussi se laisse-t-elle investir par morceaux, dans une discontinuité qui est celle du regard de celui qui la lit. Et en effet, celui qui arrive en ville, à Montréal, au xixe siècle, n’est pas seulement un habitant, il est toujours déjà un urbain, comme le personnage central de la nouvelle de Charles Lépine, par exemple, pour qui la ville est, malgré le sentiment d’extériorité qui l’étreint, déjà sienne : « or, le monde, pour moi, c’était Montréal, capitale du savoir, du luxe et des affaires » (MI, 97[24]). Le héros, même s’il n’en possède pas toutes les clés, a déjà lu, même mal, la ville. L’opposition imaginée entre la campagne, gardienne du temps, et la ville, incarnation du dévoiement marchand, par les idéologues de la littérature nationale ne résiste pas à l’analyse et Gilles Marcotte y revient sans cesse, montrant que les personnages circulent sans retenue entre les deux pôles et que, par exemple, la famille Chauvin, dans le roman de Patrice Lacombe, sera à la fois une famille d’habitants et une famille du prolétariat urbain, tout comme la famille Lacasse retournera à la campagne, le temps d’une sortie. L’opposition irréductible ville-campagne est contredite par le discours littéraire : la campagne trouve en partie son sens dans la ville.
Montréal dans les marges de la littérature et de l’histoire
Pour Marcotte, contiguïtés, désordre et instabilité ne valent pas que pour le « roman québécois d’aujourd’hui » examiné dans Le roman à l’imparfait. Relisant les essais qui composent le recueil Écrire à Montréal, et aussi celui qui parut dans Montréal imaginaire, « Mystères de Montréal : la ville dans le roman populaire au xixe siècle », on ne peut qu’être frappé de ce que le Montréal de la littérature est doté de ces attributs – diversité, pluralité, mixité, incertitude, incomplétude –, quasi dès ses origines et à tout le moins dès le xixe siècle. Cela ne va pas sans mal. Car il y a un autre récit, ferme, cohérent, éloquent, qui tente de figer les significations, d’arrêter le temps en contrôlant l’espace grâce à une position surplombante, à une définition achevée, celle, nationale, d’Henri-Raymond Casgrain ou de Camille Roy. Montréal n’y a pas sa place. Le désordre montréalais trouve plutôt à loger dans les oeuvres faiblement légitimées de la littérature populaire ; mystères urbains, récits journalistiques, romans obscurs. Ainsi, les Mystères de Montréal d’Hector Berthelot et d’Auguste Fortier, le roman Une de perdue deux de trouvées de Boucher de Boucherville, développent, selon Marcotte, « trois thèmes clés du roman du xixe siècle montréalais : l’hôtel, le déguisement, l’ouverture sur le monde » (ÉM, 90), qui érodent « l’identité stable » et le « rêve conservateur de l’enracinement » caractéristiques de la définition édifiante de la littérature soutenue par Casgrain et ses continuateurs. Ces romans occupent ainsi « le pôle de la résistance, du scandale, de l’ouverture maximale aux courants étrangers » (ÉM, 91). Toutefois, le roman de Chauveau se distingue des deux autres par une représentation totalisante de la ville, qui se trouve être Québec, parce que Québec est semble-t-il toujours saisi par la littérature du point de vue de sa totalité, et par la reconnaissance critique qui lui fait une place dans les premières histoires littéraires du pays. À l’opposé, les deux autres romans, qui appartiennent de plein droit à la littérature populaire, et non pas à l’autre, la légitime, dessinent une ville que l’on ne peut saisir qu’au fil de la déambulation, par morceaux, dans une temporalité lâche qui n’a de consistance que par les actions de personnages dont le caractère héroïque est miné d’entrée de jeu. Cette domination de l’action sur l’histoire correspond au délitement du temps historique dont Marcotte avait déjà traité quinze ans plus tôt dans Le roman à l’imparfait. D’une certaine façon, le Montréal oublié qui vit au xixe siècle dans les marges de la littérature, à la fois à cause des ukazes d’une critique nationalisante qui exclut la ville et parce que dans l’ordre littéraire ces oeuvres feuilletonnesques ne sont pas véritablement légitimées, préfigure celui de maintenant, celui du « temps du Matou » (EM, 137-147), par exemple.
Gilles Marcotte, pour lequel il n’y a pas de commune mesure entre la ville de Rimbaud et celle de Berthelot, compose donc avec une aporie qu’il dévoile de deux façons. D’abord en renonçant à la fermeté des classifications usuelles, adoptant sans trop de culpabilité une attitude de déni à l’égard du principe logique de non-contradiction. Dans sa préface à la réédition du roman Les mystères de Montréal par M. Ladébauche d’Hector Berthelot, « Nos Mystères à nous », Marcotte écrit :
Faut-il vraiment rééditer Les Mystères de Montréal d’Hector Berthelot ? Oui, et non. Ou plutôt : non, et oui. Le roman est mal écrit, plein de fautes grossières […] ; ses personnages appartiennent à l’arsenal traditionnel du roman-feuilleton, mais dépourvus de cette vraisemblance minimale qui permettait aux lecteurs d’Eugène Sue d’intervenir dans le déroulement des Mystères de Paris alors qu’ils paraissaient en feuilleton. L’action est désordonnée, abracadabrante, faisant un usage abusif et de la coïncidence, et du hasard. « Roman de moeurs », dit le sous-titre ; et, dans le numéro du Vrai Canard où paraît en 1879 la première tranche du récit, sous le pseudonyme de M. Ladébauche, on précise : « roman de moeurs canadiennes ». Mais le roman de moeurs est un genre sérieux, presque l’équivalent du roman social. […] L’histoire littéraire ne s’y est pas trompée – pas plus que les premiers lecteurs sans doute –, qui n’a pas daigné considérer le roman de Berthelot comme une oeuvre de littérature de plein droit.
Mais on dira : oui, il faut rééditer Les Mystères de Montréal, pour les mêmes raisons. Parce que sa joyeuse, son incroyable vulgarité – oserais-je dire : vitalité ? – fait tache dans la production romanesque du dix-neuvième siècle québécois et contredit allègrement les leçons de bon maintien que la critique, l’abbé Casgrain en tête, ne cesse de donner aux écrivains[25].
Ces « mêmes raisons », ce sont celles de la littérature, de la liberté que s’arroge la littérature, pour le meilleur et pour le pire. La contiguïté des formes, qui est déni de hiérarchie, invitation à une circulation tous azimuts, est lieu de liberté et cette liberté, curieusement, n’est pas très éloignée de celle que se donnent les romanciers plus que modernes du Roman à l’imparfait.
Mais Marcotte suggère aussi autre chose, qui place la forme de cette littérature urbaine populaire au premier plan. En effet, ce Montréal, ville-mosaïque rigoureusement sans sens, c’est-à-dire impropre à quelque saisie synthétique que ce soit qui le définirait une fois pour toutes, je ne peux m’empêcher d’y voir aussi la forme du journal, dans lequel le monde se dit sur le mode de la contiguïté, récit instable, évanescent, toujours recommencé, toujours inachevé. McLuhan cité par Marcotte ne dit guère autre chose :
Les poètes d’après Baudelaire ont tout naturellement opté pour la formule du journal – c’est-à-dire ses caractéristiques structurales – pour susciter une conscience globale. Non seulement la page du journal est symboliste et surréaliste, mais c’est elle qui la première a inspiré le symbolisme et le surréalisme en art et en poésie[26].
Il y a en effet une relation spéculaire entre des romans montréalais du xixe siècle, publiés en feuilletons dans des périodiques, et les périodiques eux-mêmes, au moment où la forme du journal domine largement les inventions esthétiques de la littérature. Et l’on peut sans forcer la note poser que la forme du journal et la forme de la ville entretiennent le même type de spécularité.
Mais, par ailleurs, la pratique journalistique de Gilles Marcotte a sans doute marqué durablement sa lecture du monde, comme le révèle l’intérêt qu’il porte à McLuhan, aux médias en général, de même que sa prise en compte du caractère mosaïcal du journal, toutes choses qui l’engagent du côté du fragmentaire, du contradictoire, du rhyzomatique et de l’incomplet, bref du spatial. L’analyse des romans de Jacques Godbout dans Le roman à l’imparfait, mais aussi celle des romans du temps du Matou[27], permet de mesurer la richesse de cette voie heuristique.
La tentation de la ville
Revenons à Montréal. Gilles Marcotte a lu avec une passion peu commune les grands romans montréalais : Bonheur d’occasion, La bagarre, Salut Galarneau !, Le matou, Maryse, pour n’en donner qu’une liste trop courte, un peu injuste. Il a aussi lu ceux du xixe siècle, et un nombre considérable de romans déjà oubliés qui se passent, en tout ou en partie à Montréal, comme ce mystérieux Flic de Montréal, de Trevanian[28] qui sert d’entrée en matière de son article sur la Main. Montréal n’est jamais indifférent dans ces lectures. De fait, Montréal demeure une tentation même lorsqu’il est question d’une autre ville, comme Paris, et Rimbaud, ultimement, ramène Marcotte à Montréal. Montréal n’est réductible ni dans le temps, ni dans l’espace. Comment lire mieux Montréal qu’à travers Rimbaud ? dit Marcotte, analysant trois poèmes : « Ville », « Villes I » et « Villes II »[29]. Qu’y fait le poète ? Il « prend le texte urbain général au pied de la lettre » (ÉM, 123). Que fait le poème ? Il fait de la ville « ce que nous connaissons le mieux, notre seule habitation véritable, l’extrême du familier, et ce que nous connaissons le moins, ce qui se dérobe le plus subtilement au vieux désir de l’habitation. C’est à titre d’“éphémère[s] citoyen[s]” que nous habitons nos villes » (ÉM, 122).
À quoi tient ce tropisme, cette irrésistible tentation ? Marcotte s’en explique un peu dans l’autobiographie à l’emporte-pièce qui ouvre Écrire à Montréal :
J’y suis depuis cinquante ans, et pas plus aujourd’hui qu’alors je ne suis rassasié de cet étonnement, de cette étrange griserie. […] L’exaltation, ou la griserie dont je parlais tout à l’heure, avait une autre raison, plus secrète : celle de se perdre, de se perdre dans la foule. […] Un parmi cent, mille, un million. Un homme ordinaire, dans une grande ville ordinaire.
ÉM, 18-19
Montréal c’est donc l’anonymat, la solitude, mais aussi paradoxalement la participation à une communauté : « Je suis seul et je ne suis pas seul » (ÉM, 20). Cette immersion dans la ville est « disponibilité de mouvement », toujours renouvelée (« je suis encore de ceux qui arrivent à Montréal » ; ÉM, 18). Cette disponibilité, cette liberté pour tout dire, est la même que celle du cartographe ou du romancier : vivre à Montréal, écrire et même lire, voilà les manifestations les plus nettes de la liberté. Manifestations qui ne vont pas sans perte, comme le dit Michel de Certeau, longuement cité par Marcotte dans « Au centre, la Main » :
L’identité fournie par ce lieu [la ville] est d’autant plus symbolique (nommée) que, malgré l’inégalité des titres et des profits entre citoyens, il y a là seulement un pullulement de passants, un réseau de demeures empruntées par une circulation, un piétinement à travers les semblants du propre, un univers de location habité par un non-lieu ou par des lieux rêvés[30].
La ville se révèle donc un faire en mouvement, comme l’écriture – « la littérature agit dans la réalité » (LATC, 107) –, et aussi comme la lecture – « Puis vous plongez, vous vous immergez dans cet univers de mots […] vous les interrogez jusqu’à ce qu’ils fassent sens, non pas comme un simple message, un discours, un récit, mais comme un travail de poème[31]. » Car la lecture est aussi action sur le réel et ce réel est toujours déjà une action : « un travail ». Marcotte parle ici du lecteur de poème, mais on comprendra que le lecteur de roman a aussi fort à faire pour écarter le message, le discours, le récit afin d’atteindre au travail d’écriture. Mais ce faire en mouvement agit sur un réel abstrait, sur le réel de l’imagination, dévoilant le caractère symbolique des procès en cours.
J’en conclus que Montréal, la ville, si présente, obsédante presque dans l’oeuvre de Gilles Marcotte, en est le centre vif qui autorise la pensée théorique mêlant sujet, temps, espace, action dans un récit sans cesse défait, sans cesse ravaudé. En cela, bien sûr, elle ressemble à un livre inachevé, qui néanmoins se donne toujours à lire ou à écrire. Écrire, ou lire la ville, c’est avoir accès à l’universel tel qu’en lui-même l’éternité le change – « (la forme d’une ville/ change plus vite, hélas que le coeur d’un mortel) ».
Appendices
Note biographique
Micheline Cambron est professeure titulaire au Département des littératures de langue française de l’Université de Montréal. Elle est spécialiste de la littérature québécoise des xixe et xxe siècles et ses recherches ont principalement porté sur les formes de l’utopie, les relations entre presse et littérature et les questions d’histoire littéraire et culturelle (archives, récits, lecture et non-lecture) ainsi que sur l’épistémologie des sciences humaines. Depuis 2006, elle codirige, avec Denis Saint-Jacques et Lucie Robert, l’équipe interdisciplinaire Penser l’histoire de la vie culturelle et, depuis 2012, le projet « La presse montréalaise de l’entre-deux guerres, lieu de transformation de la vie culturelle et de l’espace public ». Parmi ses publications récentes : Quand la caricature sort du journal. Baptiste Ladébauche 1878-1957 (avec Dominic Hardy et la collaboration de Nancy Perron), Montréal, Fides, 2015 ; L’événement de lecture (avec Gérard Langlade), Montréal, Nota bene, coll. « Grise », 2015 ; L’héritage littéraire de Paul Ricoeur (avec Lucie Bourassa et Suzanne Foisy), 2013 (Actes édités sur le site Fabula.org).
Notes
-
[1]
Gilles Marcotte, Écrire à Montréal, Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 1997. Désormais abrégé en ÉM, suivi du numéro de la page.
-
[2]
Gilles Marcotte, « J’arrive en ville », Écrire à Montréal, p. 20.
-
[3]
Jean Racine, Athalie, Paris, Librairie Marcel Didier, 1969.
-
[4]
Gilles Marcotte a inséré dans son exemplaire une coupure du journal Le Devoir sur laquelle se trouve un court entrefilet (vraisemblablement de lui, mais anonyme et sans titre) dans lequel il raconte la première représentation d’Athalie qu’il ait vue au collège, avec des étudiants jouant les rôles féminins, et discute le titre qui coiffait le compte rendu d’une récente représentation d’Athalie à Paris : « Du riffifi chez les lévites : rien dont Racine serait sorti grandi ».
-
[5]
André Brochu et Gilles Marcotte, La littérature et le reste (livre de lettres), Montréal, Quinze Éditeur, coll. « Prose exacte », 1980, p. 148-149.
-
[6]
Pierre Popovic, Entretiens avec Gilles Marcotte. De la littérature avant toute chose, Montréal, Liber, coll. « De vive voix », 1996, p. 46. Désormais abrégé en LATC, suivi du numéro de la page.
-
[7]
« Je connais la part d’illusion que transportent ces sentiments, plus en ce qui concerne Paris que Sherbrooke, parce que la première, à cause de mon éducation, de mes premiers pas dans l’univers de la littérature et de ce que je lis encore maintenant, joue dans mon existence le rôle d’un mythe qui produit plus de rêverie que d’écriture » (Gilles Marcotte, Écrire à Montréal, p. 7).
-
[8]
Gilles Marcotte, La littérature et le reste, p. 148.
-
[9]
Gaston Miron, « Monologues de l’aliénation délirante », L’homme rapaillé, Montréal, Typo poésie, 1998 [Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1970, prix de la revue Études françaises], p. 92.
-
[10]
Citant Miron dans Écrire à Montréal (p. 123), Marcotte coupe le dernier vers : « débarras de l’Histoire – je la revendique ».
-
[11]
Michel de Certeau, distinguant « espaces » et « lieux », écrit et souligne : « l’espace est un lieu pratiqué ». Marcotte cite régulièrement de Certeau, qu’il a beaucoup fréquenté. Michel de Certeau, « Récits d’espace », L’invention du quotidien, Paris, Société générale d’édition, 1980, p. 208.
-
[12]
Gilles Marcotte, Une littérature qui se fait. Essais critiques sur la littérature canadienne-française, Montréal, BQ, coll. « Sciences humaines », 1994 [Montréal, HMH, coll. « Constantes », 1962].
-
[13]
Gilles Marcotte, « Lettre à Octave Crémazie » et « La tête de Patrice Lacombe », La vie réelle, Montréal, Boréal, 1989, p. 123-140 et p. 141-153.
-
[14]
Dans « Flâner rue Notre-Dame, en 1862 », Écrire à Montréal, p. 95-104, voir notamment p. 100-101.
-
[15]
Gilles Marcotte Littérature et circonstances, Montréal, L’Hexagone, coll. « Essais littéraires », 1989, p. 10. Désormais abrégé en LC suivi du numéro de la page.
-
[16]
Gilles Marcotte convoque alors Mallarmé, qui propose au poète de « donner un sens plus pur aux mots de la tribu » (Littérature et circonstances, p. 7).
-
[17]
Pierre Nepveu et Gilles Marcotte (dir.), « Introduction. Montréal, sa littérature », dans Montréal imaginaire. Ville et littérature, Montréal, Fides, 1992, p. 9. Désormais abrégé en MI suivi du numéro de la page. Gilles Marcotte cite cette « Introduction » dans celle d’Écrire à Montréal, p. 11.
-
[18]
Nathalie Fredette, Montréal en prose 1892-1992, Montréal, L’Hexagone, coll. « Anthologies », 1992.
-
[19]
Gilles Marcotte, « Jules Leboeuf et l’impossible roman », Le roman à l’imparfait. Essais sur le roman québécois d’aujourd’hui, Montréal, La Presse, coll. « Échanges », 1976, p. 24. Désormais abrégé en RI suivi du numéro de la page. La citation est de Gérard Bessette, La bagarre, Montréal, Cercle du livre de France, 1958.
-
[20]
Marcotte parle aussi des Plouffe. Si, pour lui, c’est Florentine Lacasse plutôt que Denis Boucher qui porte « la signification de la transition, c’est parce qu’elle arrive en ville et que cette ville est Montréal » (Le roman à l’imparfait, p. 42).
-
[21]
Gilles Marcotte, « “Restons traditionnels et progressifs”, disait Onésime Gagnon », Études françaises, vol. 33, no 3, 1997, p. 8-9.
-
[22]
Le relisant, j’ai soudainement compris pourquoi je me trouvais en pays familier chez les épistémologues de l’histoire comme François Hartog, dont le concept de « présentisme » me paraît déployer des perspectives très proches de la lecture « spatiale » du temps de Marcotte. Voir François Hartog, Régimes d’historicité : présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, coll. « Points Histoire », 2012.
-
[23]
Jacques Ferron, « Les provinces », dans Contes, Montréal, HMH, coll. « L’Arbre », 1968, p. 62-65.
-
[24]
Charles Lépine, « Mon premier voyage à Montréal », La Revue canadienne, mars 1875, p. 237-240, cité par Gilles Marcotte dans « Mystères de Montréal : la ville dans le roman populaire du xixe siècle », Montréal imaginaire, p. 97.
-
[25]
Gilles Marcotte, préface à Hector Berthelot, Les mystères de Montréal par M. Ladébauche, texte établi par Micheline Cambron, avec une préface de Gilles Marcotte et une postface de Micheline Cambron, Québec, Nota bene, coll. « NB poche », 2013, p. 7-8.
-
[26]
Marshall McLuhan, Pour comprendre les médias, trad. fr. Jean Paré, Montréal, HMH, coll. « Constantes », 1964, p. 238, cité par Gilles Marcotte, « La faute de François-Thomas Godbout », Le roman à l’imparfait, p. 201, note 20. C’est largement l’hypothèse partagée par les spécialistes de la presse actuellement. (Voir Alain Vaillant, L’histoire littéraire, Paris, Armand Colin, coll. « U », 2010, particulièrement les pages sur l’invention de la modernité dans la presse, p. 289-311 et aussi Marie-Ève Thérenty, La littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au xixe siècle, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 2007.)
-
[27]
Gilles Marcotte, « Le temps du Matou », dans Écrire à Montréal, p. 137-157.
-
[28]
Sur le roman de Trevanian, Le flic de Montréal, trad. fr. R. Bré, Paris, Robert Laffont, coll. « Best-Sellers », 1979, voir Gilles Marcotte, « La tentation de la Main », dans Madeleine Frédéric (dir.), Actes du Séminaire de Bruxelles (septembre-décembre 1991). Montréal, mégalopole littéraire, Bruxelles, Centre d’études canadiennes, Université de Bruxelles, 1992, p. 83-98.
-
[29]
Arthur Rimbaud, « Ville », « Villes I » et « Villes II », Illuminations, dans Poésies. Une saison en enfer. Illuminations, Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 1999, p. 221, 223, 224.
-
[30]
Michel de Certeau, « Récits d’espace », p. 188-189, cité par Gilles Marcotte, Écrire à Montréal, p. 58.
-
[31]
Gilles Marcotte, « Autobiographie d’un non-poète », Le lecteur de poèmes, Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 2000, p. 24-25.