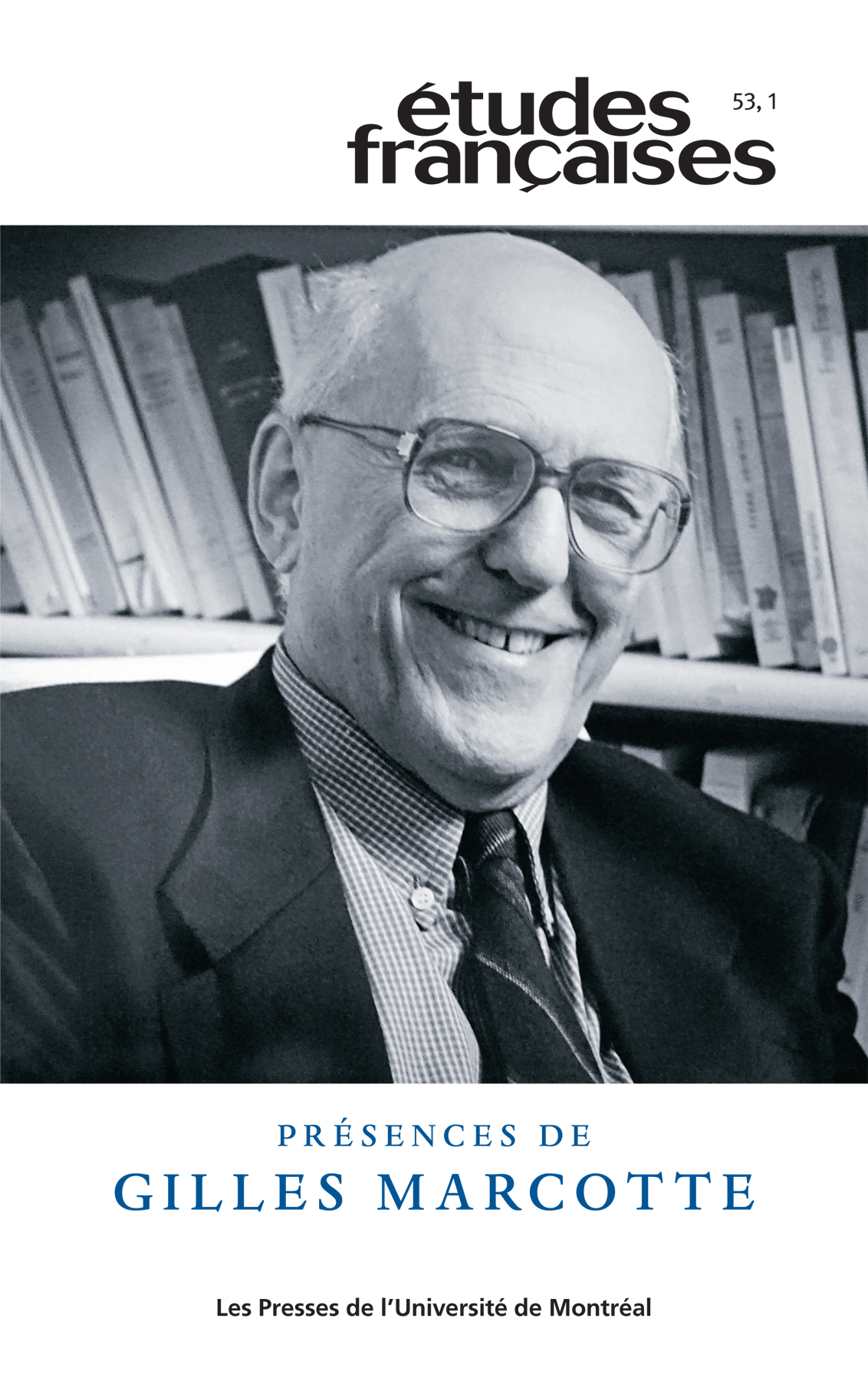Article body
Charlotte Melançon[1]J’aurai trouvé
dans les arbres et les livres
de justes raisons de vivre :
c’est qu’elles sont de même nature,
ces feuilles – libres, fraternelles –
qui donnent ombre et lumière.
Il suffit de peu de chose pour faire un écrivain. Mais en littérature il n’est vraiment pas facile d’assembler au mieux des choses, même de peu. D’où la relative rareté des écrivains qui sans devenir crispés ou laborieux à l’extrême se risquent à fond dans l’écriture en visant « la justesse aiguë de l’expression ». Telle m’apparaît l’exigence de Gilles Marcotte. Celle-ci se manifeste d’ordinaire avec simplicité dans l’emploi de la langue écrite courante, qu’on dirait moins acquise qu’héritée. Toutefois, la finesse et le naturel du style ne recouvrent pas toujours l’enjeu fondamental du texte qui alors peut apparaître à nu. Ainsi, dans un récit dont je parlerai tout à l’heure, un pianiste en proie à une émotion extrême s’exclame intérieurement : « Je le sais, malheur, ce qu’il faut de solitude, de désespoir, d’acharnement pour tenter de jouer une musique qui se dérobe, pour essayer d’y trouver un chemin pour sa vie, pour la vie. »
Et voici que dans Les livres et les jours, livre d’une intelligence déliée, je retrouve une demi-page qui indirectement me confirme dans mon propos :
Dans ma fenêtre – la gauche, encore – la lumière déclinante, celle de l’automne. Les autres lumières, celles des autres saisons, ne déclinent pas vraiment, elles n’ont pas ce mouvement d’une douceur, d’une tristesse infinie. Heureusement, le vent est tombé, les quelques feuilles rouillées qui restent aux arbres sont presque totalement immobiles, tremblantes un peu seulement, et tout juste assez rousses pour ne pas offenser le bleu du ciel par une couleur contrastante trop vive. Le paysage attend, il attend quoi, la nuit peut-être, je ne suis pas sûr, ou autre chose, autre chose qui ne pourra qu’être décevant, après le charme absolu de l’attente, du suspens – consentement peut-être – que donne novembre[2].
Voilà une juste et subtile réponse à un spectacle naturel maintes fois offert à notre observation et qui devrait éveiller en permanence notre capacité de contemplation. Pour ce qui me concerne, j’avoue avoir reçu de ces lignes si bien rythmées une leçon d’apaisement dans la beauté fugitive, comme si la vie machinale se libérait d’une certaine anxiété qu’impose depuis toujours la fin de l’automne. Et c’est vrai, là, qu’un écrivain qui n’insiste qu’en passant, juste pour signifier qu’il n’insiste pas trop, que cet écrivain trop caché par un critique exceptionnel et tenant avec ironie la littérature pour « inutile », ouvre celle-ci à notre autre vie, elle qui se tient en retrait et qu’on méprise presque, qui est désireuse d’adopter la perspective de la petite éternité que pourrait être le moindre arrêt dans le temps. Enfin… j’alourdis sans doute ce que Gilles Marcotte effleure de son écriture, laisse affleurer à la conscience. Malgré tout, je veux aller plus loin, si possible, dans la lecture de mon ami écrivain.
Parmi les récits que Gilles Marcotte a publiés au long des années, une courte nouvelle m’a remué de façon durable. Elle a paru en 2004 aux éditions artisanales Des Antipodes. Le tirage confidentiel (une trentaine d’exemplaires) l’a laissée inconnue du public (mais on peut en lire le texte ici même, aux pages 109-113).
Le titre, Clara, m’a comme alerté, d’abord sans que je sache trop pourquoi et ensuite, une fois terminée ma première lecture, je me suis perdu dans une longue songerie où la Clara d’Ellébeuse de Francis Jammes (lue pendant mon adolescence) confondait son image avec celle, plus ou moins inventée, d’une mystérieuse tante de ma mère, qui selon la légende familiale et ma libre interprétation aurait représenté dans sa jeunesse une émule de l’Yvonne de Galais, héroïne du Grand Meaulnes d’Alain Fournier (encore un favori de mes quinze ans) et, de fil en aiguille, devenue héritière-évocatrice de l’Aurélia de Nerval pour finalement me surprendre (plus tard) en compagnie d’Eurydice trahie par Orphée. Ouf… Qu’est-ce que certains écrivains ne font pas subir (avec délices) à leurs lecteurs trop impressionnables ? Mais justement, ils nous donnent en retour, ces quasi-enjôleurs, à réfléchir, à nous prémunir contre toute subjectivité abusive. Car il faudrait ajouter à mon fatras de lecteur encombré une surcharge d’évocations suscitées par le thème de La jeune fille et la mort qui se présentèrent lors du moment déclencheur dans la nouvelle de Gilles Marcotte. Fallait-il se laisser envahir par une émotion aussi bouleversante que celle du protagoniste ? Fallait-il de surcroît devenir fasciné par la présence de Schubert sous le prétexte que le narrateur est un pianiste chevronné, un musicien averti et le père, navré, blessé moralement, d’une jeune fille plus qu’aimée, disparue depuis longtemps mais toujours présente à la mémoire fidèle, etc. ? C’est à ce genre de questions cruciales sous des airs saugrenus qu’on peut reconnaître, si on reste un lecteur attentif et disponible, que la lecture littéraire d’une oeuvre littéraire ne va pas de soi, que seul le texte dans sa littéralité s’impose comme fondement et aboutissement non seulement du sens global mais aussi, bien sûr, des moindres significations. Nos pensées, nos sentiments et tout le reste qui nous est personnel se doivent de rester en retrait. Et c’est ainsi que cette Clara, toute simple, toute sobre, toute pudique, ouvre par suggestion langagière (y compris des silences parfois ténus) l’accès à une douleur sans fond. J’étais au bord d’ajouter « sans rémission », alors que non, ce n’est pas juste, ce n’est pas cela, c’est un autre monde, certes offert, par vertu poétique, à mon consentement lucide, à ma sympathie proprement littéraire qui enveloppe une douleur partagée sur laquelle finalement je ne peux que me taire.
Gilles Marcotte rappelait la « confiance dans la souveraineté de la littérature » qui animait Anne Hébert. C’était aussi son cas. Je relis à nouveau cette Clara qui m’obsède et dont l’achèvement formel ainsi que la souplesse expressive dans la densité suffisent à l’imposer comme une oeuvre de maître, un chief-d’oevre selon le Moyen Âge. J’ai à dessein négligé de résumer la nouvelle : le texte est bref, il ne présente aucune difficulté à la compréhension immédiate, il ne dépayse pas et ne comporte aucune énigme ; bref, il se ramène aux vertus de sa langue inspirante, orientée sans artifice vers un « fond » qui autrement resterait inaccessible.
J’aimerais conclure sur l’admirable courage, oui, qu’a trouvé un écrivain pour rendre hommage à un amour toujours vivant par-delà une immense perte. Je ne sors pas du texte en faisant cette remarque, je ne m’en éloigne que pour mieux le reconnaître au gré de ce qu’il suggère comme par nature. Enfin, je pense fraternellement à la finale sidérante d’« En bleu adorable », poème attribué à Hölderlin : « Vivre est une mort, et la mort elle aussi est une vie. » Voilà en quelques mots l’inextricable de la douleur dans l’âme à quoi pourrait répondre un souffle d’espérance : « Non, tu ne portes pas le deuil, c’est lui qui te porte – et plus loin que ta vie. »
Appendices
Note biographique
Professeur émérite, Jacques Brault a enseigné à l’Institut d’études médiévales et au Département d’études françaises de l’Université de Montréal de 1960 à 1996. Il est romancier (Agonie, Montréal, Boréal, 1984), essayiste (auteur, entre autres, de La poussière du chemin, Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 1989 ; Ô saisons, ô châteaux, Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 1991 ; Chemin faisant, Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 1994 ; Au fond du jardin, Montréal, Éditions du Noroît, 1996 ; Chemins perdus, chemins trouvés, Montréal, Boréal, coll. « Papiers collés », 2012) et poète (parmi ses recueils : Mémoire, Montréal, Librairie Déom, 1965 ; Suite fraternelle, Ottawa, Éditions de l’Université d’Ottawa, 1969 ; La poésie ce matin, Paris, Grasset, 1971 ; L’en-dessous, l’admirable, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1975 ; Moments fragiles, Montréal, Éditions du Noroît, 1984 ; Au bras des ombres, Montréal, Éditions du Noroît, 1997 ; L’artisan, Montréal, Éditions du Noroît, 2006). Récipiendaire à trois reprises du prix du Gouverneur général, Jacques Brault a reçu en 1996 le prix Gilles Corbeil pour l’ensemble de son oeuvre.