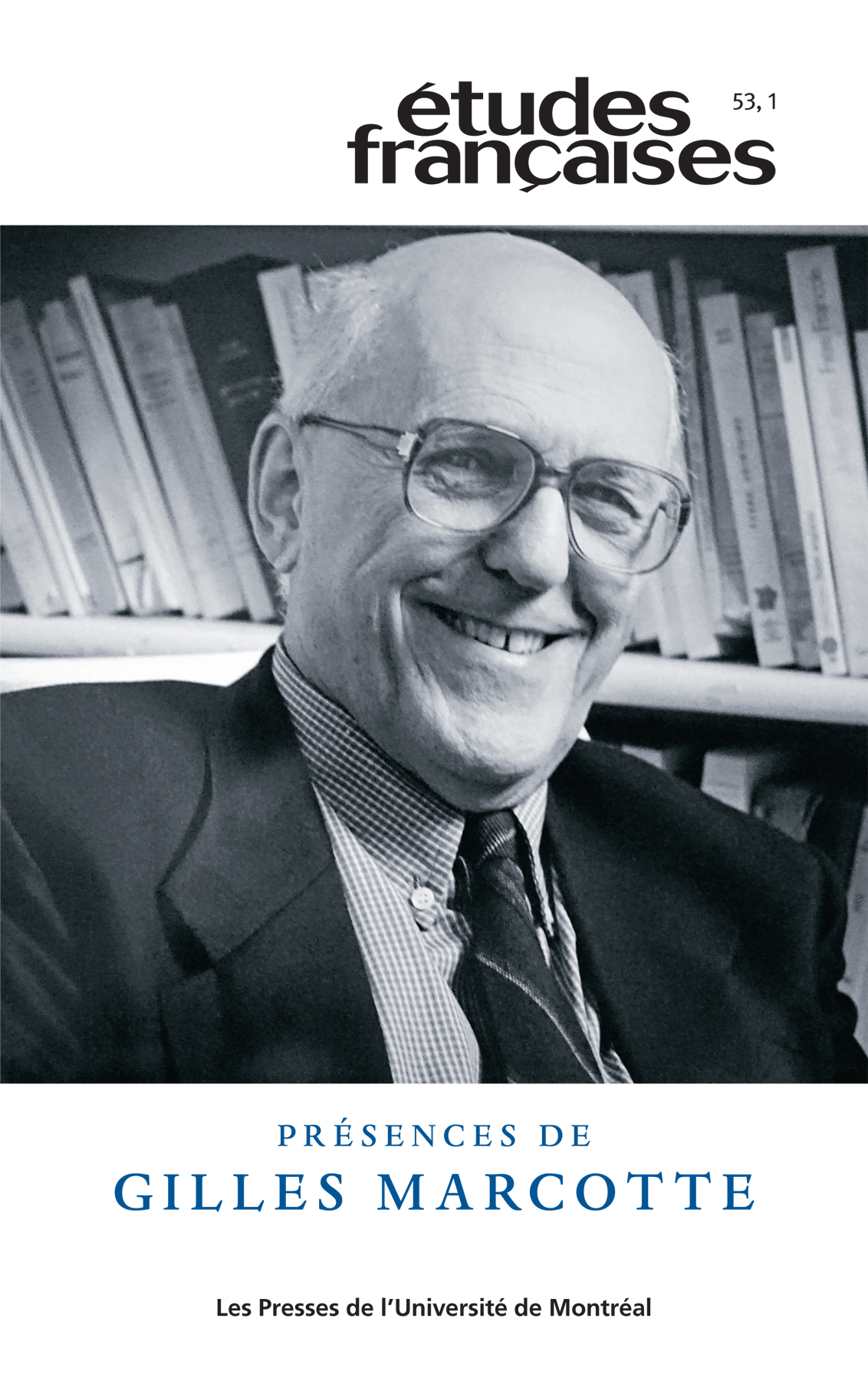Article body
L’amitié est un mot un peu ridicule, un peu désuet, avec « un coeur et les désirs de chardonneret » […], mais il désigne peut-être, quand semblent s’épuiser les charmes et les prestiges de la littérature, ce qui fut et demeure la raison de ses entreprises.
Gilles Marcotte[1]
Gilles Marcotte a publié à la revue Études françaises deux textes majeurs, parmi les plus cités de ceux qu’il a consacrés à Ducharme[2], « Réjean Ducharme contre Blasey Blasey » en 1975 et « Réjean Ducharme, lecteur de Lautréamont[3] » en 1990. De ce dernier article, je garde précieusement le tiré à part dédicacé qui m’attendait dans mon casier quand je suis arrivée au Département des littératures de langue française (qui ne s’appelait pas encore ainsi) à l’automne 1990. Dans l’ensemble des écrits de Gilles Marcotte sur l’oeuvre de Réjean Ducharme – ensemble qu’il faudrait prochainement réunir et éditer –, les deux articles d’Études françaises constituent, à quinze ans d’intervalle, les clés de voûte d’une lecture remarquablement fidèle à ses premières intuitions. Les échos qui se tissent d’une étude à l’autre révèlent d’abord une méthode critique, analytique : « Lisons, ne cessons pas de lire, de pratiquer cette lecture soupçonneuse, un peu maniaque, à laquelle on n’échappe pas quand on a parcouru les romans de Réjean Ducharme plus d’une fois » (LL, 89). Méthode également en ce que le second article apparaît clairement comme la reprise et l’approfondissement du premier, faisant retour sur ses principaux enjeux : la question du roman, l’extension dans l’oeuvre du motif de l’amitié, les intertextes dissimulés que sont les oeuvres de Saint-Denys Garneau et Lautréamont et leur rôle, la charge contre la modernité. Méthode enfin dans l’écriture même des articles qui avancent comme une conversation, prennent à témoin – « Vous n’avez pas tout vu… » (BB, 279) –, interpellent – « Vous n’avouez pas ? Essayons autre chose » (LL, 88) – et mettent en scène un dialogue avec cet autre lecteur, cette autre lectrice, également familiers de l’oeuvre et complices de son exploration, dont il s’agit de faire tomber un à un tous les a priori.
*
D’emblée centrés sur la dynamique de l’écriture, les deux articles suivent le fil d’Ariane de Lautréamont, auteur que la critique a associé à Ducharme dès la parution de L’avalée des avalés[4], mais dont personne, avant Gilles Marcotte, n’avait montré de manière précise l’impact décisif sur l’oeuvre : « Lautréamont qui équipe Iode Ssouvie d’un “Grand Coupable” [p. 75] et d’un Vieil Océan, mais dont le nom est occulté dans toute l’oeuvre de Ducharme, parce que son texte y travaille presque sans arrêt » (BB, 253 ; G. Marcotte souligne). Dès « Réjean Ducharme contre Blasey Blasey », consacré à la question des genres, l’auteur des Chants de Maldoror sert de référence théorique à une définition du roman :
Il y a quelques lunes, Isidore Ducasse écrivait : « Le roman est un genre faux, parce qu’il décrit les passions pour elles-mêmes : la conclusion morale est absente. Décrire les passions n’est rien : il suffit de naître un peu chacal, un peu vautour, un peu panthère. »
BB, 248 ; G. Marcotte cite Lautréamont, Oeuvres complètes. Poésies 1, Le Livre de poche, 1963, p. 372
Et une note de ce premier article annonce ce qui fera la matière du second :
Les rapports – d’emprunts, de transformation et cetera – entre l’oeuvre de Ducharme et le texte lautréamontien sont si nombreux et si complexes qu’il ne saurait être question de les inventorier ici : « allez-y voir vous-même, si vous ne voulez pas me croire »
BB, 253 ; G. Marcotte cite Lautréamont, op. cit., p. 365
L’hypothèse défendue, selon laquelle l’écriture de Ducharme est animée par un rapport paradoxal d’attirance et de résistance au genre romanesque[5] structure toute la lecture. Ce rapport est surtout perceptible dans Le nez qui voque, à ses yeux « le seul de[s] romans [de Ducharme] à être une véritable histoire d’amour » (LL, 114). Je me souviens d’une conversation avec Gilles Marcotte au cours de laquelle j’avais soutenu qu’au contraire, chaque roman ne raconte que des histoires d’amour, m’appuyant pour cela sur les oeuvres plus récentes. Il ne m’avait évidemment rien concédé, persuadé que la grande affaire chez Ducharme reste l’amitié :
l’amitié, privilège exclusif de l’enfance, demeure l’utopie de lecture de l’oeuvre de Lautréamont comme de celle de Réjean Ducharme. Elle est à la fois nécessaire et impossible, exigible et non due. « Je veux que ma poésie puisse être lue par une jeune fille de quatorze ans » ([p.] 380), proclame le Lautréamont des Poésies. Pour Ducharme, aussi bien, la lecture appartient essentiellement à l’âge tendre : « La plupart de ceux qui lisent ont entre neuf et seize ans. Les autres, ceux qui lisent et qui ont entre vingt et soixante ans, lisent parce qu’ils n’ont pas pu franchir le mur de la maturité ; ils sont assis à l’ombre du mur de la maturité avec un livre sur les genoux et ils lisent[6]. »
LL, 122 ; G. Marcotte souligne
Il aurait fallu discuter plus avant, expliquer ce qu’on entend par « amitié » et par « amour », dire à quel point il y a de l’un dans l’autre et réciproquement sinon à quoi bon, départager nos deux perceptions marquées par la génération et par le genre, et surtout disposer de la question du sexe. Prudemment, j’avais retraité.
Selon la lecture de Gilles Marcotte, Le nez qui voque est irrésistiblement entraîné vers le roman comme Mille Milles vers l’âge adulte et l’amitié vers l’amour : « On ne fait pas ce qu’on veut, quand on écrit un roman. On fait ce que veut le roman. Et le roman veut l’histoire, la ville, le sexe » (BB, 250). Pour le critique, Le nez qui voque s’approche au plus près du romanesque, avant de le saborder finalement, quand il y cède là où résistent davantage L’océantume, La fille de Christophe Colomb et surtout L’avalée des avalés avec la figure de repoussoir de Blasey Blasey, le pornographe que Bérénice va rencontrer et chez qui tout est faux (BB, 248). Il parachève son analyse en montrant comment L’hiver de force, sous-titré « récit », esquive finalement l’affrontement avec la littérature : « “récit”, c’est la fragilité et l’humilité d’une écriture qui se donne toute entière au présent, et qui accepte de mourir avec lui, s’il le faut » (BB, 283). Et Gilles Marcotte d’étendre la question de l’amitié de sa thématisation dans le roman à la projection d’une relation avec le lecteur :
De L’Avalée des avalées à L’Hiver de force, il [Ducharme] ne cesse de démonter les rouages du récit, de la littérature, de pratiquer à l’égard de ses formes la méfiance la plus aiguë ; mais aussi, il nous demande de lire avec les yeux de Constance Chlore, de Asie Azothe, de Colombe Colomb – et nous le faisons, bonnes bêtes à confiance, nous nous laissons prendre au jeu, nous croyons. Qui a peur des contradictions, n’entre pas chez Ducharme.
BB, 284 ; G. Marcotte souligne
Plus qu’à aucun autre écrivain québécois qu’il ait commenté, à Ducharme, Gilles Marcotte aura accordé inconditionnellement cette confiance-là.
Le second article s’attache à creuser les rapports esquissés dans le premier avec l’oeuvre de Lautréamont, remontant patiemment la piste des insultes originales comme « sale poule cochinchinoise » dans L’avalée des avalés, et celle des noms, Montevideo surgissant brusquement, dans L’océantume, avec Ammi-Moussa et Sémipalatinsk, mais aussi un certain « Soulier », apostrophé dans le roman, qui s’avère être l’auteur d’une étude sur Isidore Ducasse. Gilles Marcotte ne suit jamais un seul fil et revient ici sur Saint-Denys Garneau, dont les « chaises » (LL, 92) inconfortables et le passage d’« un torrent sur les roches » (LL, 102) refont surface dans le texte de Ducharme. Il reprend également « L’affaire du “comme” » (LL, 109) là où il l’avait laissée dans le premier texte. Dans « Réjean Ducharme contre Blasey Blasey » :
Comme est une danse, un débordement et un déportement ; il n’ajuste pas l’un à l’autre, dans une exactitude visuelle, les termes de la comparaison, mais il soumet le langage à l’empire du son. Comme est appel, invitation par entraînement sonore : « Viens ! Viens ! Viens ! Komm ! Komm ! Komm ! Komm ! »
BB, 275 ; G. Marcotte souligne
Dans « Réjean Ducharme, lecteur de Lautréamont » :
[N]ous verrons le « comme » ducharmien se transformer en un « Kommm ! » violemment érotique lorsque Mille Milles perdra l’espoir de vivre avec Chateaugué un amour purement platonique : « Viens ! Viens ! Viens ! Kommm ! Kommm ! Kommm ! Kommm ! » […] Le sexe parle franc, et c’est la supériorité qu’il a sur l’effusion romantique, qui joue sans cesse le double jeu de la chair et de l’esprit, du désir et de la pureté.
LL, 111-112
L’analyse que fait Gilles Marcotte, chez Lautréamont comme chez Ducharme, de l’usage de la comparaison comme arme de destruction massive de la représentation et de l’évidence du rapport entre le réel et la littérature a été reprise. Michel Biron, notamment, fonde sur elle une partie de sa lecture[7]. On s’est moins intéressé aux remarques, tout aussi éclairantes, et exemplairement sociocritiques, qu’il fait sur les attaques contre Dieu que Ducharme reprend aussi à Lautréamont :
On ne cogne pas sur Dieu, on n’a pas à se révolter contre lui, durant les années soixante, au Québec, sous le règne de la Révolution tranquille : il s’est retiré sur la pointe des pieds, sans faire d’histoires, laissant toute la place à ceux qui voulaient faire de l’histoire.
LL, 100 ; G. Marcotte souligne
Loin de s’arrêter à la conclusion d’une simple imprégnation de Lautréamont pour expliquer ce qui paraît au premier abord anachronique, Gilles Marcotte retrouve, dans ce dieu vilipendé, l’idée de « nature » et de « naturel » et la désigne comme la cible, historiquement circonscrite, des diatribes ducharmiennes :
Mais ne reste-t-il pas beaucoup de cet idéal de nature dans un naturel humain, défini par la spontanéité, la liberté des esprits, des instincts, du langage, auquel les nouvelles générations accordent toutes leurs faveurs ? […] Nous voici enfin devenus, dit la Révolution tranquille, une société normale ; […]. Dans une telle conjoncture, évidemment, les Grands Signes ne sont pas recevables. Si l’on veut s’en servir, il faudra les importer : Dieu-Yahveh, Dieu-Adonaï, Dieu-Capone, avec la cruauté, la violence qu’ils pratiquent eux-mêmes et inspirent à l’homme ; les grandes formes littéraires de l’ancien temps, de l’épopée à la chanson de geste ; ou encore, dans le passé québécois, l’extrême passé québécois, celui que tout le monde veut oublier, la figure étrange de Marie de l’Incarnation. Il ne s’agit pas de croire, de se redonner à croire. Ces grandes figures, aussi peu naturelles que possible, Réjean Ducharme les jette en travers d’une normalité qui, vouée au progrès tous azimuts, prétend faire l’économie de la souffrance, de la mort, du tragique. Le tragique ducharmien est « faux », comme celui de Lautréamont ; en cela, il porte un défi à la normalité, au naturel, qui ont dans le Québec contemporain une signification particulière.
LL, 104-105 ; G. Marcotte souligne
La dissonance de la voix de Ducharme, son refus obstiné d’adhérer à l’optimisme de la Révolution tranquille ne sont certes pas uniques ; au contraire, si l’on en croit Pierre Nepveu dans L’écologie du réel, c’est l’ensemble de la littérature québécoise qui donne à lire le négatif de ces années de foi dans le progrès[8]. L’originalité de l’interprétation de Marcotte consiste à relier la dissidence de Ducharme à ces glorifications du passé qui étonnent et détonnent dans ses romans : comme il l’a déjà montré en 1980 dans « La dialectique de l’ancien et du nouveau chez Marie-Claire Blais, Jacques Ferron et Réjean Ducharme[9] », autre signe du fonctionnement en quelque sorte rhizomatique de son oeuvre critique, il identifie ces « retours en arrière » (et on pense ici à un autre texte encore, daté de 1997, « En arrière, avec Réjean Ducharme[10] ») à une critique bien plus radicale :
C’est un modèle qui est récusé, plus que des oeuvres, des choses, des actions, des valeurs : le modèle de l’avancée continue, du progrès inévitable. Pour s’y opposer, on ne peut éviter d’évoquer l’image de l’ancienneté, de la tradition ; mais il s’agit d’autre chose, il s’agit de situer quelque part l’utopie – négative assurément – d’une impossible pureté, d’une absence à tous les arguments de la machine progressiste.
Le thème de l’enfance ou de l’adolescence, lieu commun obligé de toutes les rêveries nostalgiques, aura également dans l’oeuvre de Réjean Ducharme – et plus encore que dans celle de Lautréamont – cette fonction d’écartement, de distanciation.
LL, 117-118
Proche en cela du Ducharme l’inquiétant de Michel Van Schendel[11], Gilles Marcotte a toujours vu dans l’oeuvre de Ducharme la charge de désespoir, la violence de « la guerre apache » selon la formule de Le Clézio, le « “désastre” dont parle Maurice Blanchot, la perte ou le refus de l’astre[12] ». Il a aussi constamment rappelé le rôle de l’ironie et de l’auto-ironie dans cette machine à démolir les systèmes :
[I]nsistons sur le verbe : il joue, c’est-à-dire que de cette souveraineté, de cette originalité de grand écrivain, il fait un spectacle où l’évidence de l’emprunt, des plumes d’autrui, désamorce le recours à l’Autorité dans le texte même qui l’énonce.
LL, 126 ; G. Marcotte souligne
*
L’oeuvre de Ducharme qui, écrit Gilles Marcotte en 1997, « est prête à tout, pour échapper au destin idéologique qui attend tout discours […] et se livre aux instincts les moins recommandables[13] », sera-t-elle venue à bout de la patience du plus amical de ses accompagnateurs ? Sa recension de Gros mots dans L’Actualité le 1er février 2000 autorise à poser la question ; le texte s’ouvre en effet sur la citation d’une phrase du roman à la syntaxe improbable ainsi commentée par Marcotte : « On comprend, bien sûr, mais il faut que les neurones travaillent fort. Le plus clair, c’est que Réjean Ducharme fait tout pour nous compliquer la lecture, la vie » et se clôt sur ce jugement : « récit qui est à certains égards, disons-le, horrifiant, le plus étrange, le plus dérangeant que Réjean Ducharme ait écrit[14] ». Comme toute amitié digne de ce nom, celle de Gilles Marcotte pour l’oeuvre de Ducharme aura connu des soubresauts. « Horrifié », « dérangé », l’ami lecteur l’était aussi par HA ha dont il me disait que c’était la pièce la plus terrible jamais écrite au Québec. Qu’est-ce donc alors qui provoque chez lui ce « mouvement de recul » qu’il mentionne, dans les deux articles d’Études françaises (voir BB, 273 et LL, 102), chez Maurice Nadeau critiquant L’avalée des avalés dans La Quinzaine littéraire en 1966 et s’offusquant de la fin du roman ? L’un des points communs entre HA ha et Gros mots tient à la perversion et à la cruauté des rapports humains qui s’installent dans l’amour quand l’amitié l’a déserté pour n’y laisser qu’un marchandage sexuel et émotif donnant-perdant, bref, « des liens matrimaniaques[15] », disait Vincent Falardeau dans Les enfantômes. L’accueil que Gilles Marcotte avait réservé à Va savoir cinq ans plus tôt n’était pas non plus sans mélange :
Quant à l’écriture, à la langue, Réjean Ducharme pousse plus avant l’offensive qu’il mène contre elles depuis La Fille de Christophe Colomb et Les Enfantômes. Exemple : « Passé 30 ans, les nouveaux visages ont de plus en plus de quoi qui nous a déjà été et dont on ne reconnaît plus que l’effet. » Et il y a pis ailleurs…[16]
Si le critique admire « une galerie de beaux personnages, comme Ducharme n’en avait jamais réuni dans un seul roman[17] », à la fin de son texte, affleure cependant la bonne volonté qu’il lui a fallu :
Marasme dans la langue, donc, comme dans l’amour. La lecture de Va savoir n’est pas toujours facile, d’autant qu’à ces embarras syntaxiques l’auteur ajoute diverses manoeuvres d’égarement, dans le récit, qui plongent souvent son lecteur dans la perplexité. Mais quoi, un roman de Réjean Ducharme, ça se mérite[18].
Repensant à nos conversations sur ce roman, celui de Ducharme que je préfère, je ne me souviens pas d’avoir ébranlé l’avis de Gilles Marcotte qui me disait, fidèle toujours mais pas tout à fait convaincu donc : « un Ducharme raté, ce serait encore meilleur que la majorité de ce qui se publie ». La raison de ces demi- réticences tient-elle à ce que c’est désormais à la syntaxe que s’attaque Ducharme et plus seulement au lexique ou au niveau de langue ? Sans doute pas seulement. Et pourquoi la petite Fannie serait-elle plus « inquiétante parfois pour cause d’intensité[19] » que ne l’étaient Bérénice Einberg et Iode Ssouvie, sinon parce que Va savoir trouble les eaux pures de l’amitié même dans l’enfance ? Il n’est pas sans intérêt que, dans Le manuscrit Phaneuf, roman que Gilles Marcotte publie en 2005, une divergence d’opinion sur Réjean Ducharme oppose le personnage de l’éditeur, Julien Brossard, à son écrivain préféré, le discret Yvon Morin :
Yvon Morin admire intensément Réjean Ducharme, son contraire absolu, que Julien a tendance à croire un peu surfait. Trop de mots, trop d’effets, trop d’esprit. « Terminal cuteness » a-t-il lu quelque part. Une joliesse à mourir, à faire mourir. Il ne suffit pas d’être édité chez Gallimard[20].
L’éditeur sceptique, comme l’auteur qui joue ici à mettre en scène la critique, n’en reconnaît pas moins, chez Ducharme, la fréquentation périlleuse de la sentimentalité et de la mort.
*
Gilles Marcotte sera resté, comme d’autres lecteurs, l’accompagnateur privilégié du premier Ducharme, celui de l’amitié et, par conséquent, selon la logique de sa lecture, celui qui refuse le roman au profit du poème, même « potache » (BB, 258), de l’épopée, même « poubelle » (BB, 257), de l’utopie. Or, selon cette même logique, c’est le roman ou le récit et l’amour, si mal en point soit-il, qui se déploient dans les livres plus récents, Dévadé, Va savoir et Gros mots. Les deux articles d’Études françaises témoignent à cet égard, non seulement d’un savoir-lire singulier, mais aussi de la conception esthétique et éthique de la littérature qui était celle de Gilles Marcotte. Les études ducharmiennes, si proliférantes à une époque qu’on est autorisé à les nommer ainsi, reconnaissent évidemment le legs de Gilles Marcotte, mais trop souvent en le figeant respectueusement, en le cantonnant comme une épigraphe à l’orée des nouvelles lectures. Il me semble qu’on doit à son amitié pour l’oeuvre de reprendre avec ses textes la discussion qui désormais nous manque.
Appendices
Note biographique
Élisabeth Nardout-Lafarge est professeure au Département des littératures de langue française l’Université de Montréal et dirige la revue Études françaises depuis 2014. Parmi ses publications : Histoire de la littérature québécoise avec Michel Biron, François Dumont et la collaboration de Martine-Emmanuelle Lapointe (Montréal, Boréal, 2007 ; coll. « Boréal compact », 2009), Interférences. Autour de Pierre L’Hérault avec Alessandra Ferraro (Udine, Forum, 2010), Nom propre et écriture de soi avec Yves Baudelle (Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2011), L’hiver de force à pas perdus avec Gilles Lapointe et Sylvie Readman (Montréal, Éditions du passage, 2013), et Polygraphies. Les frontières du littéraire avec Jean-Paul Dufiet (Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », 2015).
Notes
-
[1]
Gilles Marcotte, « Réjean Ducharme contre Blasey Blasey », Études françaises : Avez-vous relu Ducharme ?, vol. 11, no 3-4, 1975, p. 283. Repris dans Le roman à l’imparfait. La « Révolution tranquille » du roman québécois, Montréal, L’Hexagone, coll. « Typo », 1989 [1976], p. 75-123. En ligne : http://id.erudit.org/iderudit/036612ar (page consultée le 12 décembre 2016). Désormais abrégé en BB, suivi du numéro de la page. Dans la citation, Gilles Marcotte cite Réjean Ducharme, La fille de Christophe Colomb, Paris, Gallimard, 1969, p. 91.
-
[2]
Le premier texte sur Ducharme paru à Études françaises est la recension que Jean Cléo Godin fait de L’avalée des avalés (vol. 3, no 1, février 1967, p. 94-101).
-
[3]
Gilles Marcotte, « Réjean Ducharme, lecteur de Lautréamont », Études françaises, vol. 26, no 1, 1990, p. 87-127. En ligne : http://id.erudit.org/iderudit/035806ar (page consultée le 12 décembre 2015). Désormais abrégé en LL, suivi du numéro de la page.
-
[4]
Voir, entre autres, Alain Pénel, « Au rendez-vous des Canadiens », La Tribune de Genève, 22-23 octobre 1966.
-
[5]
Gilles Marcotte publiera l’année suivante Le roman à l’imparfait et y déploiera toute sa réflexion sur le statut du genre dans la littérature québécoise.
-
[6]
Gilles Marcotte cite ici Le nez qui voque, Paris, Gallimard, 1967, p. 46-47.
-
[7]
Michel Biron, « Réjean Ducharme, loin du milieu », dans L’absence du maître. Saint-Denys Garneau, Ferron, Ducharme, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Socius », 2000, p. 197.
-
[8]
C’est l’une des thèses principales de l’essai L’écologie du réel. Mort et naissance de la littérature québécoise contemporaine (Montréal, Boréal, 1988).
-
[9]
Gilles Marcotte, « La dialectique de l’ancien et du nouveau chez Marie-Claire Blais, Jacques Ferron et Réjean Ducharme », Voix et images, vol. 11, no 1, automne 1980, p. 63-74. Repris sous le titre « La dialectique de l’ancien et du nouveau », dans Littérature et circonstances, Montréal, L’Hexagone, coll. « Essais littéraires », 1989, p. 165-177.
-
[10]
Gilles Marcotte, « En arrière, avec Réjean Ducharme », Conjonctures, no 26, automne 1997, p. 23-30. Repris dans La littérature est inutile. Exercices de lecture, Montréal, Boréal, coll. « Papiers collées », 2009, p. 15-21.
-
[11]
Michel Van Schendel, Ducharme l’inquiétant, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Conférences J-A. DeSève », 1969.
-
[12]
Gilles Marcotte, La littérature est inutile, p. 21.
-
[13]
Idem.
-
[14]
Gilles Marcotte, « Aimerez-vous le Ducharme nouveau ? », L’Actualité, 1er février 2000. En ligne : www.lactualite.com/culture/aimerez-vous-le-ducharme-nouveau/ (page consultée le 12 décembre 2016).
-
[15]
Réjean Ducharme, Les enfantômes, Paris, Gallimard, 1976, p. 28.
-
[16]
Gilles Marcotte, « Un Ducharme, ça se mérite », L’Actualité, 15 octobre 1994. En ligne : www.lactualite.com/culture/un-ducharme-ca-se-merite/ (page consultée le 12 décembre 2016).
-
[17]
Idem.
-
[18]
Idem.
-
[19]
Idem.
-
[20]
Gilles Marcotte, Le manuscrit Phaneuf, Montréal, Boréal, 2005, p. 53. Je remercie Richard Saint-Gelais d’avoir attiré mon attention sur ce passage.