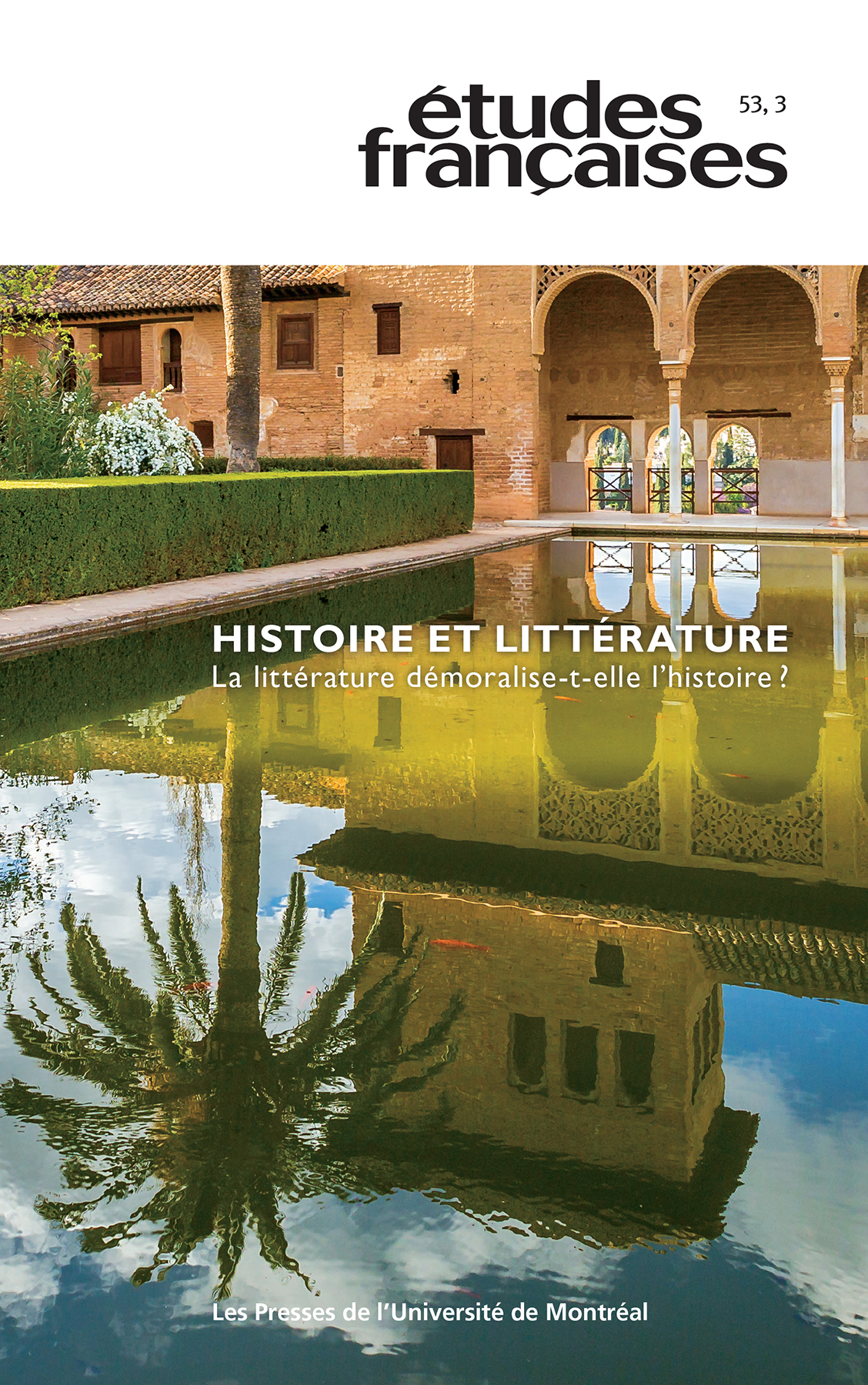Abstracts
Résumé
Vigny l’affirme clairement dans sa préface à la réédition de son roman, en 1829 : selon lui, la littérature a pour fonction de transfigurer le matériau historique en une leçon morale utile à l’édification du lecteur ; elle peut donc s’affranchir de la réalité des faits afin que la signification profonde de l’Histoire apparaisse de façon intelligible. Il opère ainsi, dans Cinq-Mars, une recomposition de la chronologie, afin de placer, notamment, au fondement de la conscience morale de son héros, l’épisode frappant du procès de Loudun – preuve éclatante de l’immoralité du gouvernement de Richelieu, et légitimation du bien-fondé de la mission de Cinq-Mars, conjuré coupable de haute trahison, ainsi élevé au rang de valeureux croisé au service de Dieu. Mais cette claire désignation des bons et des méchants de l’histoire permet-elle vraiment au lecteur de se rallier au projet d’une refondation réactionnaire, sur le modèle de l’idéal médiéval ? La mélancolie romantique, à l’oeuvre dans le roman, aurait plutôt tendance à le décourager…
Abstract
As stated in his 1929 preface, Vigny considers that Literature is meant to turn History into a morality lesson. And to do so, it is perfectly acceptable to change factual detail so long as the deep meaning of human destiny is made clearer to the reader. In the example of Cinq-Mars, Vigny re-writes history and alters the date of Loudun’s rigged witch trial, which in turn becomes the origin and legitimization of Cinq-Mars’s hatred for Richelieu. Rather than being considered guilty of high treason, the hero becomes a brave white knight serving God’s purpose. Yet, despite the fact that this retelling clearly indicates who are the “good” and the villains of History, the novel does not really encourage the reader to adopt its retrograde cause. On the contrary, its romantic melancholy tends to disillusion the reader about politics.
Article body
Cinq-Mars, le premier roman historique français, a dû essuyer, dès sa parution en 1826, les feux croisés de la critique, et en particulier des historiens de profession : par ignorance ou par franche malhonnêteté intellectuelle, Vigny aurait usé de l’affabulation romanesque avec un peu trop de désinvolture, et les contre-vérités criantes qu’il s’est autorisées pour construire sa trame romanesque contreviendraient non seulement à la dignité de ce genre nouvellement importé, qui se doit de ne pas trahir le matériau historique dont il s’empare, mais aussi, de façon plus générale, à l’exigence de vérité et à la mission pédagogique d’éducation du lecteur, que le « siècle de l’histoire » commençait à prôner[1]. Face à cette levée de boucliers scientiste, Vigny décide, en 1829, d’ajouter à la quatrième réédition de son ouvrage un lourd appareil de notes historiques, témoignant du sérieux de ses recherches – ainsi qu’une préface qui, semblant a priori démentir ces précautions méthodologiques, proclame « la liberté que doit avoir l’imagination […] de faire céder parfois la réalité des faits à l’idée que chacun d’eux doit représenter aux yeux de la postérité[2] ». Il faut entendre ici le verbe « devoir » dans son sens prescriptif : pour Vigny, le but de toute narration historique est de faire émerger, de la masse informe des événements, une leçon, politique mais surtout morale, à l’usage du lecteur.
Reste à voir si le fonctionnement narratif de son roman, et la recomposition[3] signifiante du matériau historique qu’il opère, permettent véritablement de souscrire à un tel programme. On verra, en effet, que, dans Cinq-Mars, deux dynamiques opposées, et en réalité difficilement compatibles entre elles, ne cessent d’innerver le récit : d’une part, un propos largement réactionnaire, qui appelle à une refondation du politique autour des valeurs de la chrétienté médiévale, et à la remoralisation de l’État ; de l’autre, la conscience aiguë d’un mouvement irréversible de l’Histoire, qui condamne fatalement à l’échec toute tentative de contrer le progrès de la sécularisation – c’est-à-dire, pour Vigny, le triomphe de l’immoralité. Démoralisation du héros romantique, dont l’idéalisme exacerbé se brise contre les murailles d’une société trop prosaïque où il ne peut trouver sa place, qui ne peut qu’atteindre le lecteur, et le décourager d’avance de toute action politique.
L’Histoire comme fable
Dans sa préface intitulée « Réflexions sur la vérité dans l’Art », Vigny ne fait pas mystère de la fonction qu’il assigne à la littérature, lorsque celle-ci réécrit l’histoire – et s’arroge, vis-à-vis d’elle, le droit d’effectuer de petits arrangements avec le réel. L’écriture historique seule, enfermée dans son exigence de fidélité factuelle, ne permet pas, pour lui, de donner du passé une image propre à répondre aux aspirations philosophiques et éthiques du présent :
Le jour où l’homme a raconté sa vie à l’homme, l’Histoire est née. Mais à quoi bon la mémoire des faits véritables, si ce n’est à servir d’exemple de bien ou de mal ? Or les exemples que présente la succession lente des événements sont épars et incomplets ; il leur manque toujours un enchaînement palpable et visible, qui puisse amener sans divergence à une conclusion morale.
CM, préface, 23
Dans une perspective dialectique – qui s’appuie très largement sur les réflexions canoniques d’Aristote dans la Poétique[4] – la littérature viendrait donc, selon Vigny, après l’histoire, pour lui redonner sens et la moraliser :
Il me semble donc que l’homme, après avoir satisfait à cette première curiosité des faits, désira quelque chose de plus complet, quelque groupe, quelque réduction à sa portée et à son usage des anneaux de cette vaste chaîne d’événements que sa vue ne pouvait embrasser ; car il voulait aussi trouver, dans les récits, des exemples qui pussent servir aux vérités morales dont il avait la conscience ; peu de destinées particulières suffisaient à ce désir, n’étant que les parties incomplètes du tout[5] insaisissable de l’histoire du monde ; l’une était pour ainsi dire un quart, l’autre une moitié de preuve ; l’imagination fit le reste et les compléta. De là, sans doute, sortit la fable.
CM, préface, 23-24
L’écrivain a donc pour mission de parachever le travail de l’historien – et de transformer, selon les catégories rhétoriques classiques énoncées notamment par Quintilien, l’événement passé en exemplum – en fable riche d’un enseignement moral, outil de réflexion intelligible, à l’usage des interrogations présentes.
Néanmoins, il serait certainement très caricatural de résumer la position que Vigny développe dans cette préface comme une simple reprise de l’opposition aristotélicienne entre Poésie et Histoire. Le mouvement ascendant qui mène de l’observation du fait à son interprétation, et à la mise en exergue de sa signification morale, résulte, en vérité, pour lui, de la dynamique inhérente à la construction de l’histoire elle-même – et est initiée dès que l’événement a eu lieu :
Pour achever de dissiper sur ce point les scrupules de quelques consciences littérairement timorées que j’ai vues saisies d’un trouble tout particulier en considérant la hardiesse avec laquelle l’imagination se jouait des personnages les plus graves qui aient jamais eu vie, je me hasarderai à avancer que […] dans beaucoup de ses pages, et qui ne sont peut-être pas les moins belles, l’histoire est un roman dont le peuple est l’auteur.
CM, préface, 25
Selon Vigny, en effet, et ce, depuis l’Antiquité[6], le processus de sélection, voire d’affabulation, qui compose un fait afin de lui conférer l’épaisseur d’un événement historique, le rendant ainsi mémorable, s’apparente à un travail collectif de création artistique – seule façon de tirer de l’histoire sa quintessence, sa substantifique moelle, qui seule justifie qu’on en garde le souvenir – autrement dit, son sens moral :
Ne voyez-vous pas de vos yeux la chrysalide du fait prendre par degré les ailes de la fiction ? Formé à demi par les nécessités du temps, un fait est enfoui tout obscur et embarrassé, tout naïf, tout rude, quelquefois mal construit, comme un bloc de marbre non dégrossi ; les premiers qui le déterrent et le prennent en main le voudraient autrement tourné, et le passent à d’autres mains déjà un peu arrondi ; d’autres le polissent en le faisant circuler ; en moins de rien il arrive au grand jour transformé en statue impérissable […] Et y perdons-nous ? Non.
CM, préface, 26
Ce qui se dessine à travers la revendication de moralisation de l’histoire, aux dépens de l’exactitude historique sourcilleuse, c’est le besoin impérieux de l’humanité de retrouver un sens à la vie en général, et à son devenir historique en particulier – besoin étouffé par un scientisme héritier de la rationalité des Lumières, en porte-à-faux avec l’intuition naturelle du peuple. Ce besoin est celui auquel répondait la religion ; mais puisque, en ces temps de désenchantement du monde, l’Église n’est plus en mesure de fournir un cadre englobant de compréhension du monde, c’est désormais le poète qui, parachevant la dynamique amorcée inconsciemment par le peuple lui-même, vient livrer au lecteur le sens profond de son existence :
Le fait adopté est toujours mieux composé que le vrai, et n’est même adopté que parce qu’il est plus beau que lui ; c’est que l’humanité entière a besoin que ses destinées soient pour elle-même une suite de leçons ; plus indifférente qu’on ne pense sur la réalité des faits, elle cherche à perfectionner l’événement pour lui donner une grande signification morale ; sentant bien que la succession des scènes qu’elle joue sur la terre n’est pas une comédie, et que, puisqu’elle avance, elle marche à un but dont il faut chercher l’explication au-delà de ce qui se voit.
CM, préface, 27
Vigny tente donc de construire, au travers de son paratexte, une légitimité auctoriale paradoxale. En un sens, il revendique le sérieux de ses recherches historiques, n’hésitant pas à comparer, d’ailleurs assez habilement[7], les diverses sources pour remettre en question, notamment, la figure élogieuse que Richelieu a orchestrée de lui-même à travers ses Mémoires[8]. Il reconnaît la nécessité, pour l’écrivain, de « commencer par connaître tout le vrai de chaque siècle, [et d’]être imbu profondément de son ensemble et de ses détails » (CM, préface, 24), et affirme ainsi avoir lu plus de trois cents livres pour préparer son roman. D’un autre côté, il demande à son lecteur un véritable acte de foi, une adhésion de nature religieuse, puisqu’il prétend qu’on doit s’affranchir de tout critère d’évaluation objectif pour juger de la « vérité de l’art » (CM, préface, 22) que renferme son roman. Il demande ainsi au lecteur de reconnaître, dans son génie poétique qui l’élève dans les sphères de l’Absolu, la capacité, au-delà du vertige baroque des apparences, d’entrevoir l’enchaînement invisible des événements – inaccessible au commun des mortels – et de le rendre intelligible par la fable qu’il propose. La littérature, prise en charge par l’écrivain du temps des prophètes[9], serait donc une voie d’accès au fin mot de l’histoire, par définition mystérieux et opaque, puisque « les actes de la famille humaine sur le théâtre du monde ont sans doute un ensemble, mais le sens de cette vaste tragédie qu’elle y joue ne sera visible qu’à l’oeil de Dieu, jusqu’au dénouement qui le révélera peut-être au dernier homme » (CM, préface, 23). Ainsi, en attendant l’Apocalypse, le lecteur est invité à comprendre, au travers de l’intrigue construite par Vigny, de quel côté de l’histoire française se situent le Bien et le Mal.
Moralisation réactionnaire
De fait, lorsque Vigny fait la peinture du xviie siècle français, il parle en permanence du présent. À grand renfort de prolepses narratives, le roman est là pour retracer les immortelles racines chrétiennes de la France postrévolutionnaire, et désigner au lecteur, dans une vision historique fortement orientée téléologiquement, les responsables de la chute de l’Ancien Régime. Dans son épilogue, notamment, il prophétise au futur simple, dans la bouche de Corneille, génie (déjà) romantique incarnant le progrès au sein même de l’âge classique[10], un avenir qui aura dépassé ce moment apocalyptique de crise pour rétablir l’harmonie perdue :
Un homme passe, mais un peuple se renouvelle. Celui-ci, Monsieur, est doué d’une immortelle énergie que rien ne peut éteindre : souvent son imagination l’égarera ; mais une raison supérieure finira toujours par dominer ses désordres.
CM, 486
Le roman fait, ainsi, de « l’usurpation » de l’autorité par Richelieu le moment clé de l’affaiblissement de la monarchie. Replaçant, à la suite de Chateaubriand[11], 1789 dans un mouvement historique plus large de dégradation de l’idéal médiéval, Vigny tend à minimiser l’événement révolutionnaire et la rupture que celui-ci a induite – afin de rendre possible la réinstallation définitive d’un « roi très chrétien[12] » sur le trône français, et, plus généralement, la reconstruction d’un ordre moral guidé par les valeurs de l’Église.
Dans le cadre de cet article, nous ne pouvons, comme nous avons tenté de le faire ailleurs[13], analyser l’ensemble des griefs que Vigny adresse au règne de Richelieu ; nous nous concentrerons donc sur l’articulation, dans le texte, entre la démonstration idéologique de Vigny et sa réécriture de l’histoire, au détriment de l’exactitude factuelle.
La recomposition des faits éclate, de façon flagrante, dès le début de l’intrigue, qui télescope des événements pourtant distants de plusieurs années. Les premiers chapitres rendent contemporains l’ascension de Cinq-Mars à la cour, en 1639, et le procès de Loudun, qui s’est en réalité déroulé cinq ans avant, en 1634 – alors que le personnage historique n’avait que quatorze ans, et qu’il ne s’est en aucun cas rendu dans cette ville à cette époque. Ainsi, dans la diégèse, le jeune Cinq-Mars passe par Loudun sur la route qui va le mener auprès du roi – et c’est cet événement qui motive, très largement, sa décision de conspirer contre Richelieu. L’idée que Vigny promeut par ce réagencement des faits est que le complot de Cinq-Mars – décrit ailleurs que dans ce roman comme un petit intrigant voulant se venger de Richelieu par pur dépit[14] – est une véritable croisade religieuse, visant à reconquérir les valeurs dévoyées par un pouvoir machiavélien, qui instrumentalise l’Église à des fins politiques. Le chapitre I avait mis en scène la relation amoureuse, sur le modèle courtois, du jeune homme à la noble Marie de Gonzague, future reine de Pologne – et sanctifiait son ambition par le désir de se montrer digne d’elle et de pouvoir l’épouser[15] ; le chapitre II va lui indiquer quel combat il doit mener pour servir la cause du Bien.
Placé en tête du roman (chapitres II à V), l’épisode de Loudun oriente profondément l’axiologie à l’oeuvre dans l’ensemble de l’intrigue. Il exhibe les mensonges éhontés et les manipulations orchestrées par les sbires de Richelieu, et jette d’emblée l’opprobre sur le gouvernement amoral d’un cardinal envahi par l’hybris, qui déclarera plus loin être « trop fort pour se servir du Ciel » (CM, 416), mais qui assure encore son emprise sur le peuple et le roi en se réclamant de la Loi divine. La narration du dernier grand procès en sorcellerie français, qui défraya la chronique à cette époque, est l’occasion d’insister sur la corruption du régime et la double usurpation qu’elle commet : usurpation temporelle, puisque Richelieu, cet « orgueilleux petit vassal » (CM, 39), règne à la place du roi ; usurpation spirituelle, puisque la parole de l’Église est détournée au profit d’un projet politique qui trahit profondément les enseignements christiques. Pour prouver la culpabilité d’Urbain Grandier, le prêtre soupçonné de connivence avec le diable et d’avoir permis la possession démoniaque de plusieurs nonnes, les stratagèmes les plus grossiers sont utilisés – « momeries » (CM, 80) sanglantes, « indigne comédie » (CM, 81) qui culmine au moment où l’on présente à l’accusé, sur le bûcher, une croix de métal chauffée à blanc (supercherie que le public bien évidemment ignore), et où on l’on prend acte, comme preuve de son impiété, de l’inévitable mouvement de recul du malheureux.
À cette parodie de justice s’oppose explicitement le verdict du « bon prêtre[16] », l’abbé Quillet, qui fut le précepteur de Cinq-Mars – qui désigne d’emblée comme « mauvais » prêtres et « imposteurs » (CM, 81) les exorcistes et les juges à la solde de Richelieu (et, par voie de conséquence, Richelieu lui-même). La dé-légitimation du pouvoir est d’autant plus totale chez Vigny qu’Urbain Grandier, que Michelet décrira comme « un fat, vaniteux, libertin, qui méritait, non le bûcher, mais la prison perpétuelle[17] », est présenté, dans la bouche du « bon prêtre », non seulement comme innocent de tout pacte diabolique, mais, au contraire, comme un être pieux, et comme le véritable représentant des valeurs chrétiennes.
Là encore, le titre choisi par Vigny pour le chapitre V ne laisse pas de place à l’ambivalence[18] : l’exécution d’Urbain Grandier n’est pas qu’une injustice ; elle constitue un véritable « martyre » – autrement dit, la souffrance exemplaire, utile à l’édification du lecteur, d’un saint homme mort d’avoir courageusement refusé de renier ses convictions religieuses profondes et justes. Les dernières paroles du condamné, sur le bûcher, l’affirment clairement : « J’ai beaucoup péché contre moi, mais jamais contre Dieu et Notre-Seigneur » (CM, 107) – ce que confirme symboliquement le fait que, le jour de l’exécution, une pluie torrentielle se mette à tomber, au risque de rendre impossible le bûcher (voir CM, 103 sqq.[19]), comme pour confirmer la réprobation divine devant cet échafaud érigé en son nom. Tout est ainsi fait, dans ces pages, pour attirer la pitié du lecteur : les larmes de compassion de l’abbé Quillet lorsqu’il relate les détails du procès à Cinq-Mars (voir CM, 81) ; le retournement du bon peuple qui assiste à la scène, et qui, malgré sa superstition religieuse, se met, en pleurant, à crier en coeur justice devant l’échafaud ; et, surtout, le détail macabre hautement symbolique, révélant la touchante et profonde piété du personnage, sur lequel se clôt le chapitre :
On disperse les planches, l’une d’elles brûlait encore, et sa lueur fit voir sous un amas de cendre et de boue sanglante une main noircie, préservée du feu par un énorme bracelet de fer et une chaîne. Une femme eut le courage de l’ouvrir ; les doigts serraient une petite croix d’ivoire et une image de sainte Madeleine.
CM, 109
La polarisation idéologique que Susan Rubin Suleiman identifiera comme la marque du roman à thèse[20] est ainsi en place dès les premiers chapitres ; et, même si la suite de l’intrigue complexifiera cette opposition binaire, proposant notamment du rôle de Richelieu une vision plus nuancée, ce cadre général ne sera jamais remis en question. S’exposant crânement d’entrée de jeu au reproche de la caricature, Vigny réalise ici fidèlement l’idéal d’épuration des caractères, et de mise en scène de types bien définis, qu’il revendiquait dans sa préface :
Eh ! Bon Dieu, nous ne voyons que trop autour de nous la triste et désenchanteresse réalité : la tiédeur insupportable des demi-caractères, des ébauches de vertus et de vices, des amours irrésolues, des haines mitigées, des amitiés tremblotantes […]. [L]aissez-nous rêver que parfois ont paru des hommes plus forts et plus grands, qui furent des bons ou des méchants bien résolus ; cela fait du bien.
CM, préface, 25
Cinq-Mars est donc le chevalier blanc au service de Dieu ; son action a pour but de contrer l’avancée du Mal historique qui a plongé durablement la nation dans les ténèbres, jusqu’à l’époque de l’écriture, incarnée par Richelieu. Le pathos du martyre d’Urbain Grandier ne peut que provoquer l’indignation de Cinq-Mars – et, bien évidemment, celle du lecteur. Il a de toute évidence pour but de mobiliser, après celle du jeune Cinq-Mars, les énergies contemporaines, afin de persuader le lecteur de la nécessité d’une refondation politique et morale du pays, sur les valeurs traditionnelles perdues depuis le xviie siècle – comme il le résume à Louis XIII :
Ah, Sire ! Que votre voix s’élève pour annoncer à la terre que le règne de la vertu va commencer avec votre règne […]. On n’a pas encore calculé ce que la bonne foi d’un roi de France peut faire de son peuple, ce peuple que l’imagination et la chaleur de l’âme entraînent si vite vers tout ce qui est beau, et que tous les genres de dévouement trouvent prêt.
CM, 323
De plus, inspiré par Joseph de Maistre, le texte désigne explicitement, à l’occasion d’une remarque sur l’avilissement moral de nombreux prêtres de l’époque, l’ère postrévolutionnaire comme le moment privilégié de ce retour à l’ordre, sous l’égide de notre sainte mère l’Église catholique :
Il est triste de voir que, dans ce grand siècle encore désordonné, le clergé […] eut ses ignorants et ses criminels, comme ses savants et vertueux prélats. Depuis ce temps, ce qui restait de barbarie fut poli par le long règne de Louis XIV, et ce qu’il eut de corruption fut lavé dans le sang des martyrs qu’il offrit à la Révolution de 1793. Ainsi, par une destinée toute particulière, perfectionné par la monarchie et la république, adouci par l’une, châtié par l’autre, il nous est arrivé ce qu’il est aujourd’hui, austère et rarement vicieux.
CM, 58
Encore faudrait-il que Vigny ne décourage pas d’avance, dans son écriture, toute velléité d’action politique… Les belles exhortations de Cinq-Mars resteront lettre morte, le roi demeurera sous la coupe de Richelieu, et, après avoir fini le roman, le lecteur n’a guère l’énergie d’entreprendre de changer la société.
Démoralisation romantique
Comme dans une tragédie, le lecteur, en effet, sait d’avance quelle est l’issue de l’histoire. Il n’est pas du ressort du roman historique de modifier les événements importants – ce que tentera ce champ étrange de la fiction qu’est l’uchronie quelques années plus tard[21]. La préface précise bien que l’esprit humain est « indifférent sur les détails » (CM, préface, 25), et suggère donc en même temps que le lecteur ne tolérerait pas, de la part de l’écrivain, un trop grand détournement de la « réalité des faits ». Ainsi, avant même de commencer le roman, le lecteur sait que, même si Cinq-Mars a Dieu pour lui, tout comme Grandier d’ailleurs, sa conspiration sera un échec. Il sait que le « martyre » d’Urbain Grandier préfigure celui du héros – et tout le dispositif symbolique du texte est conçu pour créer un effet de parallélisme entre les destinées des deux personnages : Marie, au premier chapitre, offre à Cinq-Mars en gage d’affection une petite croix en or ; Grandier périra en serrant dans sa main une petite croix d’ivoire, possiblement offerte par sa dulcinée. Jeunes, d’une « beauté angélique » (CM, 80), tous deux mourront d’aimer une femme qui partage leurs sentiments, mais que la société leur interdit d’épouser. Tous deux sont des héros romantiques, idéalistes et passionnés, et tous les deux se heurtent à l’intolérance d’un monde corseté par les conventions et l’hypocrisie. Lorsque l’abbé Quillet dit de Grandier que ses torts sont « ceux d’une âme forte et d’un génie supérieur » (CM, 80), l’expression désigne parfaitement, par avance, ce qui mènera Cinq-Mars à sa perte. Ainsi, le lecteur perçoit d’emblée que « les adieux » entre Cinq-Mars et Marie, qui occupent le chapitre I, sont définitifs – et l’épigraphe de Byron renforce cet effet tragique : « Adieu, et si c’est pour toujours, pour toujours encore adieu[22]. » Le lecteur sait donc que l’histoire penche irrémédiablement dans le sens inverse de l’idéal que promeut Vigny ; au point qu’il puisse paraître impossible d’envisager, dans l’avenir, ce retour en arrière que la morale réactionnaire appelle de ses voeux.
Politiquement, de la même façon, la dynamique textuelle suggère à plusieurs reprises que, au fil des évolutions historiques, le monde a changé de façon irréversible ; et, même si Vigny déplace et étend la ligne de rupture entre l’Ancien régime et le nouveau bien en amont de la Révolution française, à partir de Richelieu, il n’en demeure pas moins vrai que cette fracture est définitive, et qu’on ne peut pas, comme le rêvaient les ultra sous la Restauration, l’effacer. Ainsi, le grand poète Milton a raison de s’effrayer de la comptine de l’épiphanie, que chante un passant lors de l’épilogue : Les rois sont passés (CM, 481-482) et le paradis perdu.
Il en va de même de cette féodalité idéalisée, caste chevaleresque inspirée par Dieu, que le roman célèbre : elle n’est déjà plus une réalité sociale au moment de la narration. La présentation des terres de la famille d’Effiat, au premier chapitre, s’avère assez représentative de cette tension qui travaille le texte – entre mise en scène d’un modèle moral, et affirmation souterraine de son impossibilité. À première vue, tout est fait pour poser l’idée que le fief de Cinq-Mars, « seule province de France que n’occupa jamais l’étranger » (CM, 34), est l’incarnation même de la patrie éternelle – bastion de ses valeurs idéales, où communient dans la même harmonie, en miroir l’un de l’autre, le peuple et son roi :
Les bons tourangeaux sont simples comme leur vie, doux comme l’air qu’ils respirent, et forts comme le sol puissant qu’ils fertilisent. […] Leur visage a, comme leur caractère, quelque chose de la candeur du vrai peuple de saint Louis ; leurs cheveux châtains sont encore longs et arrondis autour des oreilles comme les statues de pierre de nos vieux rois ; leur langage est le plus pur français, sans lenteur, sans vitesse, sans accent ; le berceau de la langue est là, près du berceau de la monarchie.
CM, 34
Mais, très vite, on comprend que la noblesse modèle qu’incarne Cinq-Mars n’existe déjà pratiquement plus au xviie siècle : « les grands caractères […] sont à présent bien rares, car le grand niveleur a passé sur la France une longue faux » (CM, 291), remarque le Duc de Bouillon ; et qu’elle survit d’autant moins au xixe siècle, comme le révèle une notation, dans les premières pages du récit, à propos de l’habitude de dire le Benedicite à voix haute avant le repas ; coutume de moins en moins répandue, et qui, désormais, fait honte :
Cet usage s’est conservé en France dans beaucoup de familles jusqu’en 1789 ; quelques-unes l’ont encore, mais plus en province qu’à Paris, et non sans quelque embarras, et quelque phrase préliminaire sur le bon temps, accompagnés d’un sourire d’excuse, quand il se présente un étranger : car il est trop vrai que le bien a aussi sa rougeur.
CM, 38
Comme le dit l’épilogue, le roi est désormais seul face au peuple (voir CM, 482). Et la peinture que Vigny dresse dans le roman de Louis XIII, être faible et velléitaire, ne plaide guère en faveur de la légitimité royale, et vient confirmer la prophétie du duc de Bouillon : « si l’un d’eux trébuche, toute la monarchie s’écroulera » (CM, 195). On voit donc mal comment, à long terme, et faute de combattants, un processus aussi profond pourrait s’inverser. L’idéalisme de Cinq-Mars fonctionne ainsi comme une mise en abyme du besoin de rêve et d’héroïsme que Vigny revendique dans sa préface : Cinq-Mars est un Don Quichotte qui attire l’admiration et la compassion, et non le rire ; il veut à tout prix rêver que le monde peut être à l’image du merveilleux médiéval et du roman de chevalerie, plus fort et plus grand ; qu’il peut endosser le rôle du chevalier courtois, et épouser, après avoir accompli son exploit, la dame de ses pensées ; que la noblesse peut encore servir d’appui à la royauté ; que le roi peut être à la hauteur de saint Louis et d’Henri IV ; mais le monde est bien trop médiocre et calculateur pour lui faire une place. Projet romanesque, bien trop romanesque, même pour un monde de roman – obligé malgré tout, on l’a vu, de se conformer aux grandes lignes de la désenchanteresse réalité historique.
Le combat de Cinq-Mars apparaît donc, à la lecture, et de plusieurs points de vue, un combat perdu d’avance – à l’époque de la diégèse, comme à celle de la lecture. Perdu du point de vue historique, puisque l’État moderne à la Richelieu sortira renforcé de la conjuration, et que, à cela, Vigny ne peut rien changer ; perdu du point de vue social, puisque Cinq-Mars se fait le champion d’une caste en train de disparaître, et encore plus minoritaire deux siècles plus tard ; perdu du point de vue politique, puisqu’il vise à rétablir l’autorité d’une monarchie dont tout nous dit qu’elle est trop faible pour se maintenir sur le trône. Cinq-Mars développe sans conteste un propos (une idée, pour parler comme la préface) réactionnaire ; mais il distille avant tout une mélancolie typiquement romantique, qui exalte les perdants sublimes de l’histoire, ceux qui ont raison contre le monde entier, ceux qui ont l’âme trop grande pour la société – et auxquels le monde ne laissera fatalement d’autre choix que de mourir. Mais, comme le dira Cyrano de Bergerac, qu’on peut à bien des égards considérer comme le dernier grand héros romantique du théâtre français, avant de tirer sa révérence : « On ne se bat pas dans l’espoir du succès / […] C’est bien plus beau lorsque c’est inutile[23] ! »
D’une façon plus générale, le roman développe ainsi une critique profonde des affaires mondaines, pensées avant tout comme une contrainte qui empêche l’individu de s’épanouir. La dévalorisation de la sphère politique est manifeste dès le chapitre II : pour s’y jeter, et légitimer son ambition, Cinq-Mars a besoin de l’« ennoblir » (CM, 57) par une motivation amoureuse. En parallèle, Marie de Gonzague, déchirée par son devoir princier, fait entendre à quel point cette charge étouffe chez elle toute possibilité de bonheur – et à quel point son rêve, à elle, serait d’évoluer, non pas dans un roman historique, mais dans L’Astrée :
Est-ce ma faute si mon malheur a voulu qu’un prince souverain fût mon père ? Peut-on choisir son berceau ? Et dit-on « Je naîtrai bergère ? » Vous savez bien quelle est toute l’infortune d’une princesse ; on lui ôte son coeur en naissant […] et elle ne peut jamais pleurer. […] Vous le savez bien, j’ai désiré qu’on me crût morte ; que dis-je ? J’ai presque souhaité des révolutions ! J’aurais peut-être béni le coup qui m’eût ôté mon rang, comme j’ai remercié Dieu lorsque mon père fut renversé…
CM, 55
Difficile, après avoir pris connaissance de ces aveux déchirants, de considérer, de façon univoque, la Révolution et l’égalité des conditions comme le mal historique absolu… Pour Vigny, l’Enfer, ce serait plutôt la politique en général. Ainsi, quand on voit l’état de panique dans lequel se plonge le Roi à la perspective de gouverner, on se dit que l’usurpation de l’autorité politique est plutôt un service à rendre aux souverains :
Ce fut alors que Louis XIII se vit tout entier, et s’effraya du néant qu’il trouvait en lui-même. Il promena d’abord sa vue sur l’amas de papiers qui l’entourait, passant de l’un à l’autre, trouvant partout des dangers et ne les trouvant jamais plus grands que dans les ressources mêmes qu’il inventait. Il se leva et, changeant de place, se courba ou plutôt se jeta sur une carte géographique de l’Europe ; il y trouva toutes ses terreurs ensemble, au nord, au midi, au centre de son royaume ; les révolutions lui apparaissaient comme des Euménides ; sous chaque contrée il crut voir fumer un volcan ; il lui semblait entendre les cris de détresse des rois qui l’appelaient, et les cris de fureur des peuples […]. « Richelieu ! cria-t-il d’une voix étouffée, en agitant une sonnette ; qu’on appelle le Cardinal ! » Et il tomba évanoui dans un fauteuil.
CM, 429
Plus étonnant, même Richelieu, qui n’a pourtant a priori rien d’un héros romantique, et qui est avant tout défini par sa passion envahissante du pouvoir, exprime, au seuil de la mort, ses remords d’avoir emprunté une telle voie destructrice – pour le pays, mais aussi pour lui-même :
Grand Dieu, si tu m’entends, juge-moi donc, mais ne m’isole pas pour me juger. Regarde-moi donc entouré des hommes de mon siècle ; regarde l’ouvrage immense que j’avais entrepris ; fallait-il moins qu’un énorme levier pour remuer ces masses ? Et si ce levier écrase en tombant quelques misérables inutiles, suis-je bien coupable ? Je semblerai méchant aux hommes ; mais toi, juge suprême, me verras-tu ainsi ? Non ; tu sais que c’est le pouvoir sans borne qui rend la créature coupable envers la créature ; ce n’est pas Armand de Richelieu qui fait périr, c’est le premier ministre. Ce n’est pas pour ses injures personnelles, c’est pour suivre un système. Mais ce système… qu’est-ce que ce mot ? M’était-il permis de jouer ainsi avec les hommes, et de les regarder comme des nombres pour accomplir une pensée fausse, peut-être ? […] Simple foi ! pourquoi ai-je quitté ta voie ?… Pourquoi ne suis-je pas seulement un simple prêtre ? Si j’osais rompre avec l’homme et me donner à Dieu, l’échelle de Jacob descendrait encore dans mes songes !
CM, 212
*
Si, aux yeux des historiens, Vigny a paru s’accorder un peu trop de liberté avec la réalité, force est de constater que, au regard de l’idéalisme de ses héros, qui se rêvent dans un roman de chevalerie ou dans un pastoral, le genre qu’il a introduit en France ne lui permettait pas de moraliser suffisamment l’histoire pour que celle-ci cesse d’être, en tout point, démoralisante. Vigny, comme Cinq-Mars, ne peut changer le cours global des événements et enrayer les progrès galopants de l’immoralité moderne.
Cinq-Mars serait donc moins un appel concret à la moralisation de l’histoire future par la recomposition romanesque du passé, que le chant du cygne profondément nostalgique et démoralisé d’un monde sublime et chevaleresque, mais définitivement révolu, celui de ces « honnêtes gens qui ne feront jamais fortune[24] » à l’âge moderne – comme dit, à la fin des Chouans, de Balzac, Corentin, espion sans scrupules mais d’une remarquable efficacité, du genre de ceux qu’aimait déjà s’attacher le cardinal de Richelieu, en tout cas tel que le décrit Vigny ; Corentin, promis effectivement à un brillant avenir durant la Restauration, au moment où se déroule le cycle de La comédie humaine[25], et où Vigny fait paraître son roman.
Pas sûr d’ailleurs que Vigny croie vraiment à l’existence passée de ces valeurs idéales ; mais, comme il le dit dans sa préface : « Laissez-nous rêver que parfois ont paru des hommes plus forts et plus grands […] ; cela fait du bien » (CM, préface, 25). Le prophète romantique, chez Vigny, n’a pas d’autre fonction que de rappeler à l’âme « qu’elle vient de plus loin que ces origines connues et qu’un avenir lui est réservé dans d’autres espaces[26] », et de « ne pas [se] satisfaire de cette conscience de [soi] qui suffit à [son] comportement social et moral[27] » ; il suggère, en même temps qu’il avive ce supplément d’âme encombrant au sein du matérialisme moderne, que le bonheur ne peut se contenter de la médiocrité présente. Au-delà de tout postulat idéologique, il joue donc bien ce rôle de démoralisation inhérent à la littérature, gardienne de l’absolu, et que Vigny met en scène, dans la bouche de Robespierre, dans sa nouvelle Stello :
Tu sais, citoyen Chénier, mon opinion sur les écrivains. […] [E]n général, je les regarde comme les plus dangereux ennemis de la patrie. […] Les écrivains, les faiseurs de vers qui font du dédain rimé, qui crient Ô mon âme ! fuyons dans les déserts ; ces gens-là découragent[28].
Appendices
Note biographique
Caroline Julliot est maître de conférences en littérature française (xixe-xxe siècles) à l’Université du Maine – Le Mans et membre du Groupe Hugo (Université Paris Diderot). Spécialiste de l’imaginaire historique, en particulier sur la question de l’articulation entre le politique et le religieux à l’ère démocratique, elle a consacré deux ouvrages monographiques à des figures clé d’autorité dont le romantisme a fait de véritables légendes : Le Grand Inquisiteur, naissance d’une figure mythique au xixe siècle (Paris, Honoré Champion, coll. « Histoire culturelle de l’Europe », 2010) et Le Sphinx rouge, un duel entre le génie romantique et Richelieu (Paris, Classiques Garnier, coll. « Le siècle de l’Histoire », à paraître en 2018).
Notes
-
[1]
Le comte de Molé, lors de la réception de Vigny à l’Académie française, le 29 janvier 1846, réitérera ce grief en lui reprochant d’avoir souillé la mémoire de Richelieu – les grands hommes faisant, pour lui, partie d’un patrimoine national réservé : « De tels hommes, Monsieur, appartiennent à la Vérité, et non à l’Art. » Vigny lui-même, en 1859, avouera à Napoléon III que « Cinq-Mars est vulnérable sur un point, le réel des faits ». (Cité par Laurent Avezou, La légende de Richelieu, thèse de doctorat, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2004, p. 363 ; version remaniée à paraître aux éditions Champvallon.)
-
[2]
Alfred de Vigny, Préface à Cinq-Mars (éd. Annie Picherot), Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 1980, p. 22. Désormais abrégé en CM, suivi du numéro de la page.
-
[3]
Nous empruntons cette notion à l’étude fondatrice de Claudie Bernard, Le passé recomposé. Le roman historique français du xixe siècle (Paris, Hachette, 1996), qui propose, notamment, nombre d’analyses très éclairantes sur le Cinq-Mars de Vigny.
-
[4]
Aristote, Poétique, 1451 b, trad. fr. Michel Magnien, Paris, Le Livre de poche, 1990, p. 116-117 : « le rôle du poète est de dire non pas ce qui a réellement eu lieu, mais ce à quoi on peut s’attendre, ce qui peut se produire conformément à la vraisemblance ou à la nécessité. En effet, la différence entre l’historien et le poète […] vient de ce fait que l’un dit ce qui a eu lieu, l’autre ce à quoi l’on peut s’attendre. Voilà pourquoi la poésie est quelque chose de plus philosophique et de plus noble que l’histoire : la poésie dit plutôt le général, l’histoire le particulier. »
-
[5]
Dans cette citation et dans les suivantes, à moins d’indication contraire, les petites majuscules sont dans le texte cité.
-
[6]
Ibid., p. 28 : « Cette liberté, les Anciens la portaient dans l’Histoire même […]. [C]’est qu’à leurs yeux l’Histoire était aussi une oeuvre de l’Art. »
-
[7]
Sur cette question, voir notamment l’article d’Isabelle Hautbout, « Une légitimation critique du roman historique », Romantisme, no 152, Paris, Armand Colin, 2011-2012.
-
[8]
Les Mémoires de Richelieu sont publiés en 1823 et connaissent un large succès, notamment critique. Sainte-Beuve, par exemple, s’enthousiasme de l’« autorité » qui émane de ces pages, fidèles reflets du génie du grand cardinal (Causeries du lundi, 3e édition, Paris, Garnier Frères, t. VII, 1853, p. 177).
-
[9]
On fait bien sûr référence ici aux travaux fondateurs de Paul Bénichou sur la figure prophétique du poète romantique (Romantismes français, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2 t., 2004).
-
[10]
Sur le réinvestissement de la figure de Corneille comme précurseur du romantisme, voir notamment Myriam Dufour-Maître et Florence Naugrette (dir.), Le Corneille des romantiques, Rouen, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2006.
-
[11]
Chateaubriand, « Sur la Vendée », Le Conservateur, juillet 1819, t. 4, p. 197 : « L’ancienne constitution de la France fut attaquée par la tyrannie de Louis XI, affaiblie par le goût des arts et les moeurs voluptueuses des Valois, détériorée sous les premiers Bourbons par la réforme religieuse et les guerres civiles, terrassée par le génie de Richelieu, enchaînée par la grandeur de Louis XIV, détruite enfin par la corruption de la Régence et la philosophie du xviiie siècle. La Révolution était achevée lorsqu’elle éclata : c’est une erreur de croire qu’elle a renversé la monarchie ; elle n’a fait qu’en disperser les ruines. »
-
[12]
Titre réservé par décision papale aux souverains français depuis le règne de Charles V, au xive siècle, et réutilisé par les rois sous la Restauration, à l’époque où Vigny compose Cinq-Mars. Pour une histoire de la notion, voir notamment Jean de Pange, Le Roi très chrétien. Essai sur la nature du pouvoir royal en France, Paris, Fayard, 1949.
-
[13]
Caroline Julliot, Le Sphinx rouge, un duel entre le génie romantique et Richelieu, Paris, Classiques Garnier, coll. « Le siècle de l’histoire », à paraître en 2018.
-
[14]
Par exemple, Jules Michelet le décrira dans son Histoire de France comme « joli, fantasque, vicieux […] fou et traître […] enfant gâté » (t. XII [1858], Paris, Édition des Équateurs, 2008, p. 168-170), dont les motivations sont avant tout la vengeance : « Cinq-Mars, chassé par lui [Richelieu] du Conseil, et avec outrage, pleurait et sanglotait, et ne songeait qu’à le faire tuer » (p. 175). Michelet condamnera sa conspiration comme « criminelle » et relevant de la haute trahison, puisqu’elle s’appuyait sur une alliance avec l’Espagne, avec qui la France était en guerre (p. 177). Michelet, aux antipodes de Vigny, précise sa pensée : « On croyait à tort que la guerre c’était Richelieu, que l’Espagne voulait la paix […]. Ils ne sentirent pas assez, sans doute, que la France eût péri sans cette violente dictature » (p. 176).
-
[15]
Voir Alfred de Vigny, Cinq-Mars, p. 57 : « L’amour a versé l’ambition dans mon coeur comme un poison brûlant ; oui, je le sens, pour la première fois, l’ambition peut être ennoblie par son but. Adieu, je vais accomplir ma destinée. »
-
[16]
« Le bon prêtre » est le titre du chapitre III du roman.
-
[17]
Jules Michelet, La sorcière, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1966 [1862], p. 198.
-
[18]
Le chapitre V s’intitule « Le Martyre » ; il martèle cette reprise du paradigme religieux, notamment en s’achevant sur le syntagme « les reliques du martyr ». Alfred de Vigny, op. cit, p. 109.
-
[19]
Notamment p. 108 : « le bourreau, sans avoir le temps d’attacher sa victime, sa hâta de la coucher sur le bois et d’y mettre la flamme. Mais la pluie tombait par torrents, et chaque poutre, à peine enflammée, s’éteignait en fumant. En vain Lactance et les autres chanoines eux-mêmes excitaient le foyer, rien ne pouvait vaincre l’eau qui tombait du ciel. »
-
[20]
Susan Rubin Suleiman, Le roman à thèse ou l’autorité fictive, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Écriture », 1983.
-
[21]
La première uchronie de la littérature paraîtra en 1836. Napoléon et la conquête du monde, de Louis Geoffroy, raconte comment l’Empereur des français, après avoir mené victorieusement la campagne de Russie, a fondé une monarchie universelle et s’est élevé, comme dit la préface, « au faîte d’une toute-puissance au-delà de laquelle il n’y a plus que Dieu ».
-
[22]
Ibid., p. 34 : « Fare thee well, and if for ever / Still for ever fare thee well. Lord Byron. »
-
[23]
Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (éd. Patrick Besnier), Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 1999, p. 417 (acte V, scène VI).
-
[24]
Honoré de Balzac, Les Chouans, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1988 [1829], p. 394.
-
[25]
On le retrouve comme chef de la police politique dans Splendeurs et misères des courtisanes. C’est lui qui procède, notamment, à l’arrestation du beau Lucien de Rubempré.
-
[26]
Albert Béguin, L’âme romantique et le rêve, Paris, José Corti/Le Livre de poche, coll. « Essais », 1991 [1936], p. 539.
-
[27]
Ibid., p. 540.
-
[28]
Alfred de Vigny, Stello (éd. Marc Eigeldinger), Paris, Flammarion, coll. « GF », 1984 [1856], p. 176-177.