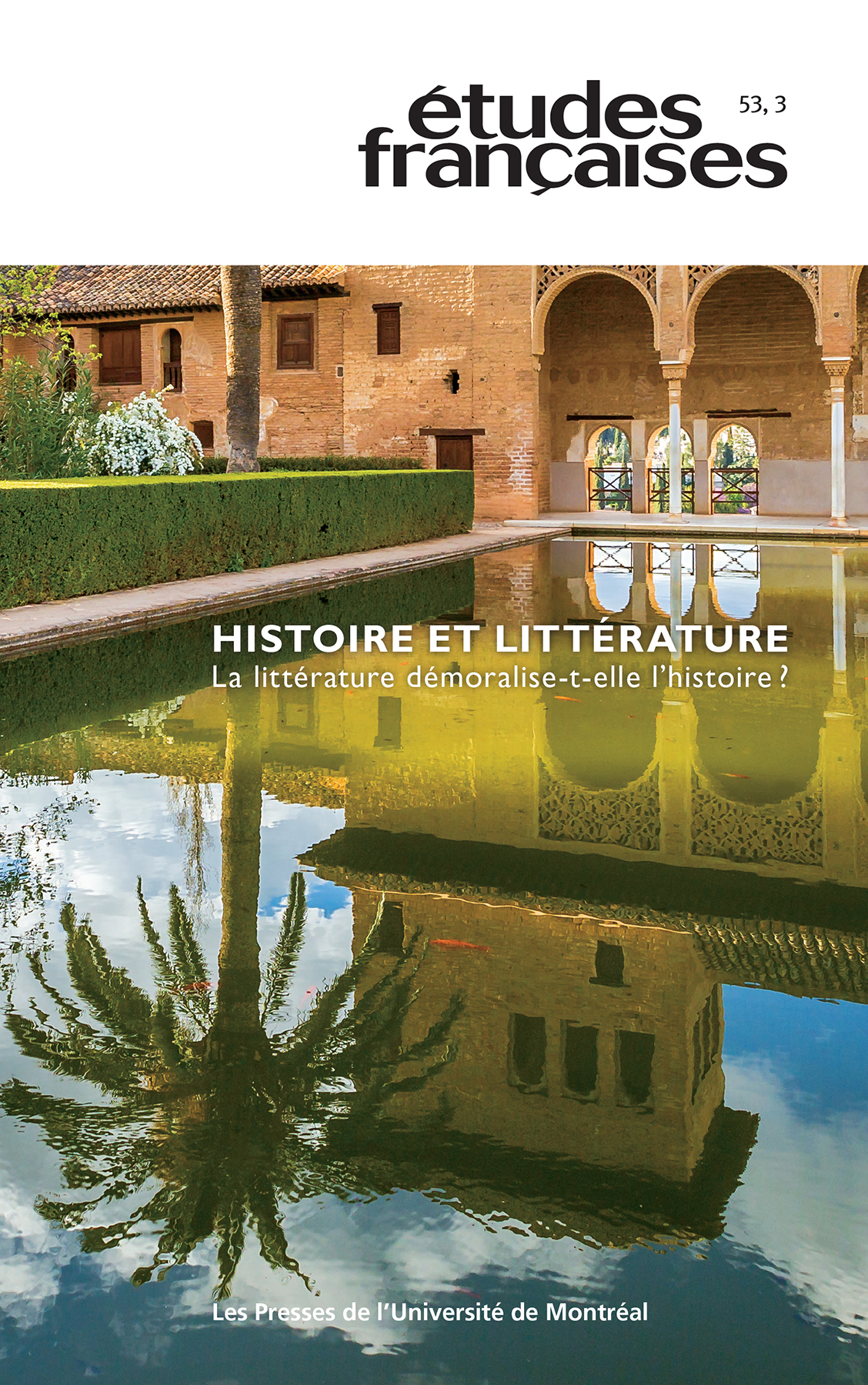Abstracts
Résumé
Cet article analyse la manière dont Salammbô, en déplaçant les enjeux de l’histoire du conflit de civilisations (Rome-Carthage) vers l’inexpiable Guerre des Mercenaires, porte atteinte à la fois à l’histoire (celle digne d’être racontée) et à la morale (emportant barbarie et civilisation dans la même débâcle). La poétique flaubertienne de l’histoire (fixer un mirage) confirme en ce sens la position impersonnelle et amorale qui constitue le point de vue de la littérature sur l’histoire.
Abstract
Salammbô shifts the perspective on ancient history by focusing on a secondary, inglorious and unatonable war (a war of mercenaries) rather than the famous glorious war between Rome and Carthage. This is an attack against History, and against morality – barbarism and civilization are considered to be equal. Flaubert’s poetic, deliberately mirage writing takes an amoral stance towards historical literature.
Article body
C’était à Mégara, faubourg de Carthage […]
Flaubert, Salammbô
En décembre 1862, Sainte-Beuve donne dans Le Constitutionnel un long article critique sur Salammbô de Flaubert. Il y éreinte le roman, de manière poliment féroce, méticuleuse, s’autorisant quelques ricanements ou badineries qui agaceront considérablement Flaubert. Baudelaire, dans une lettre qu’il adresse à Sainte-Beuve pour défendre le roman de Flaubert, pointe cette méchante ironie dans laquelle s’est complu le critique :
Notre excellent ami [Flaubert] a décidément raison de défendre gravement son rêve. Vous aviez raison de lui faire sentir en riant qu’il est quelquefois peu adroit d’être trop grave ; mais peut-être, en certains endroits, avez-vous ri un peu fort[1].
La fausse déférence émanant de la critique baudelairienne du rieur vaut comme riposte discrète à l’acidité de la critique beuvienne qui s’amuse des « bibelots carthaginois […] d’une chinoiserie exquise » qui encombrent le texte ou se demande si « c’était bien la peine d’aller nous ressusciter tout exprès une soeur d’Hannibal pour nous la montrer batifolant de la sorte, dans son belvédère, avec son serpent[2] » : on appréciera le ton familier, les babioles et le batifolage qui rabattent le roman du côté de la trivialité de la gaudriole – pareillement pour la périphrase désignant Mâtho – « ce beau drôle de Libyen » –, traité par-dessus (ou par-dessous) la jambe. Curieusement, Sainte-Beuve la joue « bonhomme », un peu « populaire », comme incapable de considérer d’un point de vue esthétique les choix de Flaubert, sujet, personnages, situations. À rebours de tout effort face à ce roman surprenant, historique à sa manière, il se lâche, dans un dénigrement étonnant chez ce très reconnu critique. Il introduisait son propos dans le genre franchouillard, avertissant qu’« on attendait [Flaubert] sur le pré chez nous, quelque part en Touraine, en Picardie ou en Normandie encore : bonnes gens, vous en êtes pour vos frais, il était parti pour Carthage[3] ».
L’histoire selon Sainte-Beuve…
Pourquoi pareille acrimonie ? De fait, un tel roman est à tel point irrecevable pour Sainte-Beuve qu’il en vient à proposer à Flaubert, dans une sorte de théorie des possibles, une autre forme pour « ce vieux monde punique » tel qu’il est pensable « dans l’état actuel de la science » :
tout bonnement une relation de voyage, un Itinéraire sur cette côte de l’Afrique, depuis les Syrtes jusqu’à Utique. On aurait décrit tout à son aise le pays et le paysage […], on en aurait refait l’histoire, en indiquant les lacunes, en restituant, à l’aide des fragments et du parti raisonnable qu’on en peut tirer, la religion, la politique, le caractère, les moeurs. L’écrivain pittoresque aurait même pu, dans un ou deux chapitres, nous livrer à l’état de rêve ou d’idéal rétrospectif sa reconstruction architecturale et morale, restitution imaginaire, mais devenue par là même plus plausible, puisqu’il n’aurait rien affirmé[4].
Les conceptions beuviennes s’inscrivent dans un périmètre explicitement marqué ici par Chateaubriand et son Itinéraire de Paris à Jérusalem mais aussi, plus largement, par une histoire pittoresque et explicative – à la Balzac par exemple, dont on peut rappeler le début des Chouans où se tissent le pittoresque et le folklore de la curieuse troupe progressant sur la route de Fougères et le savoir apporté au lecteur par un romancier rompu aux sources historiques, bulletins de l’armée et autres décrets napoléoniens ; dont on peut surtout rappeler le Sur Catherine de Médicis, oeuvre hybride tendue entre d’une part la longue et savante introduction énonçant avec autorité la nécessité d’une radicale réfection historique[5] (qui transforme l’ogresse Catherine en grand roi) et, d’autre part, le récit presque fantastique des rêves faits par Marat et (surtout) Robespierre, rêves par lesquels s’esquisse une reconstruction morale de la Saint-Barthélemy[6]. C’est de ce modèle balzacien que je partirai, pour aller vers ce qui en est la négation : l’écriture de l’histoire flaubertienne.
… et façon Balzac
La digression balzacienne peut être ici éclairante, l’articulation beuvienne entre réfection savante de l’histoire, pittoresque et délimitation d’une partie « rêveuse » où l’auteur peut délivrer son idéal « moral » recoupant le montage balzacien opératoire dans Sur Catherine de Médicis, oeuvre composite où les orientations historiographiques croisent le pittoresque romanesque des reconstructions architecturales et culturelles du Paris du xvie siècle et la part du rêve renouant dans une perspective morale passé, présent et avenir. Oeuvre à thèse (comme le Cinq-Mars de Vigny), Sur Catherine de Médicis construit une vision morale de la politique menée par Catherine de Médicis : Balzac fait pièce du dénigrement systématique de Catherine comme femme, comme italienne, comme machiavélique, pour imposer l’idée de sa volonté politique et de la finalité raisonnée de son projet – sauver l’unité du pouvoir[7], quel que soit le prix de sang à payer. Le roman se fait démonstration, la philosophie politique y est très présente : voilà donc bien une Histoire orientée, dans laquelle le devenir politique des guerres de religion est précisément et régulièrement rappelé. C’est une Histoire causaliste, qui autorise et exige l’interprétation historique, et les conclusions qu’il en faut tirer. La construction qui découle d’un tel projet propose une traversée du champ historiographique pour aborder à la fiction, laquelle peut à la fois se donner comme lestée par l’autorité des savoirs historiques, et comme lieu d’exercice de la critique raisonnée des interprétations historiques. Le Sur Catherine de Médicis est un cas d’espèce de cette démarche, puisque l’oeuvre s’ouvre sur une longue introduction qui tient du paratexte mais qui en même temps installe la préhistoire de Catherine de Médicis, avant d’entrer de plain-pied dans la fiction, laquelle se porte finalement aux limites des possibles de la chronologie et de la vraisemblance, quand le roman historique bondit jusqu’en 1786 et pénètre dans les territoires irrationnels du rêve. Mais c’est bien précisément depuis cette zone aberrante que le roman historique s’accomplit, dans la mesure où Balzac fait donner le sens[8] de l’histoiredans une contraction chronologique digne d’un dialogue des morts : revient alors, dans la bouche de Catherine réapparue comme fantôme pour Robespierre au seuil de la crise révolutionnaire, le propos auctorial de l’introduction. Autrement dit, la fiction a accompli le projet de correction de l’Histoire posé en préambule :
On crie généralement au paradoxe, lorsque des savants, frappés d’une erreur historique, essayent de la redresser ; mais pour quiconque étudie à fond l’histoire moderne, il est certain que les historiens sont des menteurs privilégiés qui prêtent leurs plumes aux croyances populaires, absolument comme la plupart des journaux d’aujourd’hui n’expriment que les opinions de leurs lecteurs[9].
La fin confirme par la fiction, et de la bouche même de Catherine, le bien-fondé du redressement historique auquel s’est employée l’oeuvre : « Quelque jour des écrivains à paradoxes se demanderont si les peuples n’ont pas quelquefois prodigué le nom de bourreaux à des victimes[10]. » La puissance et l’efficacité impressive de la mise en scène – formule choc (« Les vérités ne sortent de leur puits que pour prendre des bains de sang où elles se rafraîchissent[11] »), sensibilité inattendue de Robespierre (ses larmes devant la dureté de la realpolitik prônée par Catherine) – imposent avec toute la force de frappe de la fiction la thèse historique articulée au seuil de l’oeuvre. Confronté à un Robespierre bifrons (le tendre qu’il est, l’incorruptible que les circonstances vont le conduire à devenir), le lecteur est préparé à accepter la métamorphose de l’ogresse Catherine en grand roi.
Le roman historique balzacien, fortement idéologique, prend l’histoire à bras le corps, pour lui faire dire quelque chose : rien moins que la déploration des destinées démocratiques occidentales, au nom du refus éthique du libéralisme, de l’individualisme, de l’égoïsme. À dédiaboliser (comme on dit aujourd’hui) Catherine de Médicis et la Saint-Barthélemy, Balzac se porte à la frontière entre bien et mal, entre massacre et « saignée » prophylactique ; le caractère transgressif d’un tel déplacement de la morale de l’Histoire est d’ailleurs revendiqué par l’éditeur qui affriole le lecteur en quatrième de couverture : « Balzac lâche la bride à son aversion pour le protestantisme. Peu de romans sont aussi “politiquement incorrects”. Il devrait séduire, intriguer, indigner. »
Il ne s’agit pourtant que d’une proposition alternative de sens, de la substitution d’une morale (le maintien de l’hégémonie comme garantie politique) à une autre (la Réforme comme origine du libéralisme) ; et pas encore d’une démoralisation de l’histoire… Dans la perspective de la critique beuvienne de Salammbô, la Catherine de Médicis de Balzac représenterait assez bien ce roman d’histoire sérieux, appuyé sur les savoirs et conscient de leurs lacunes, à partir desquels peut se déployer une vision propre et cette « reconstruction architecturale et morale » admissible dès lors que la fiction se reconnaît adossée et liée à l’histoire, et dès lors que la morale est synonyme de construction prudente et argumentée d’un sens pour les événements considérés. À ce roman signifiant en diable, inscrit dans la logique et la mémoire de la marche de l’histoire, s’oppose du tout au tout le roman flaubertien.
« Fixer un mirage », ou un crime de lèse-histoire
Baudelaire, on s’en souvient, défendait le rêve de Flaubert contre Sainte-Beuve qu’agaçait la part trop grande qu’il prenait dans le roman : dans « un ou deux chapitres » passe encore, et à condition que l’imagination ne paraisse qu’accotée à la réalité documentée. Or chez Flaubert le projet est bien différent :
Moi, j’ai voulu fixer un mirage en appliquant à l’Antiquité les procédés du roman moderne, et j’ai tâché d’être simple. Riez tant qu’il vous plaira, oui ! Je dis simple, et non pas sobre. Rien de plus compliqué qu’un Barbare[12].
Le roman historique n’a pas mission archéologique, et s’il vise à ressaisir quelque chose, ce sera dans l’ordre du mirage : une fausse présence, une forme qui s’évanouit ; une illusion. D’ailleurs, de Carthage on ne sait quasiment rien, presque tout ayant été détruit. Les fouilles qui ont commencé dans les années 1830 sont lentes, et l’on sait que le choix de Flaubert sera de parier sur un monde antique global, ce qui lui permet d’aller chercher dans nombre d’auteurs anciens, d’Homère à la Bible de Cahen, notations, parfums, mets, noms de pierres, de peuplades, pour donner contour à son « mirage ».
Mais aucun de ces détails ou fragments d’Antiquité ne trouve grâce aux yeux de Sainte-Beuve, pas même le zaïmph, voile sacré de la déesse Tanit que Sainte-Beuve appelle « guenille sacrée » sans y reconnaître un équivalent de l’image de Pallas Athéna dérobée lors du sac de Troie, dans L’Énéide. Trop de mysticisme dans ce roman, trop de fable amoureuse ! « Qui serait étonné de voir ce qu’est devenu son Mâtho ou Mathos ? Ce serait Polybe assurément », car Mâtho est « du Polybe travesti[13] » gronde Sainte-Beuve, mécontent des entorses flaubertiennes à l’Histoire.
Le crime de lèse-histoire ne tient pas seulement aux retouches des personnages évoqués par Polybe, ou aux imaginations extrêmes (et jugées délirantes) de la société antique ; plus fondamentalement, il porte sur le choix d’un segment « d’histoire ingrate » : dans l’ensemble des guerres puniques, Flaubert a choisi l’unique épisode de la guerre des Mercenaires, sur laquelle Sainte-Beuve reprend à son compte le jugement de Polybe : une guerre horrible, inexpiable, qui porta bien loin « la barbarie et l’impiété ».
Sainte-Beuve se fait alors moral. Jusque-là, il s’est amusé, a joué la grivoiserie, a ri, a moqué ; à présent, il en vient au coeur du problème, à cet attentat à l’Histoire que Flaubert a commis :
L’art, nonobstant toute théorie, l’art dans sa pratique n’est pas une chose purement abstraite, indépendante de toute sympathie humaine : et je prends le mot de sympathie dans son acception la plus vaste. Comment voulez-vous que j’aille m’intéresser à cette guerre perdue, enterrée dans les défilés ou les sables de l’Afrique, à la révolte de ces peuplades libyennes et plus ou moins autochtones contre leurs maîtres les Carthaginois, à ces mauvaises petites haines locales de barbare à barbare ? Que me fait, à moi, le duel de Tunis et de Carthage ? Parlez-moi du duel de Carthage et de Rome, à la bonne heure ! j’y suis attentif, j’y suis engagé. Entre Rome et Carthage, dans leur querelle acharnée, toute la civilisation future est en jeu déjà ; la nôtre elle-même en dépend, la nôtre, dont le flambeau s’est allumé à l’autel du Capitole, comme celui de la civilisation romaine s’était lui-même allumé à l’incendie de Corinthe[14].
Le regard que porte Sainte-Beuve sur ces peuplades mesquines et barbares est marqué par l’orientalisme qui se développe au xixe siècle dans la culture occidentale[15], et qui repose sur l’opposition nette du barbare et du civilisé. Rome contre Carthage, c’est un conflit de civilisation, tandis que Carthage contre ses mercenaires s’écrit en quelque sorte dans les marges de l’histoire. Les conflits puniques intéressent l’Occident dans la mesure où Rome en sort vainqueur, Carthage ne prend donc sens que par ses rapports avec Rome. En soi, elle n’a aucun intérêt ; et les tensions entre Tunis et Carthage, où Carthage se barbarise (alors que le conflit avec Rome la frotte à la civilisation), entravent tout mouvement de sympathie pour la cité punique. Peu avant notre extrait, Sainte-Beuve moquait le choix flaubertien de l’Afrique, « pays de monstres et de ruines », et de Carthage, « nation éteinte dont le langage lui-même est aboli[16] ».
Le choix de la guerre des Mercenaires est un crime contre la civilisation ; Flaubert rompt le lien que doit au contraire préserver et renforcer l’histoire entre le présent et le passé – entre notre présent de civilisé et le passé civilisé d’où est issue la forme moderne de la civilisation. Aussi Sainte-Beuve continue-t-il :
en prenant même des sujets éloignés, il faut qu’il y ait communication vive et réverbération d’une époque à l’autre. Quand Virgile prenait Énée pour son héros, il était plein d’Auguste et plein aussi des souvenirs de la vieille Rome. Chateaubriand lui-même, dans ce sujet incomplet des Martyrs, avait chance de nous toucher par la fibre grecque ou romaine qui vit en nous, et à la fois par la fibre chrétienne qui n’est pas morte[17].
La suite de la civilisation exclut Carthage : nous avons pris à Rome, Rome a pris à la Grèce tout en l’écrasant – le flambeau de la civilisation passe entre celles-là ; Rome a écrasé Carthage, sans rien lui prendre – la civilisation n’est pas passée par Carthage[18], puisqu’il ne reste rien d’elle, de sa langue, de ses arts… Finalement, écrire Salammbô revient à interrompre la « communication vive et la réverbération » d’une époque dans une autre (communication qu’en revanche assurait parfaitement Sur Catherine de Médicis).
« Si vous voulez nous attacher, peignez-nous nos semblables ou nos analogues[19] », ajoute Sainte-Beuve. Pour le dire d’un mot : Salammbô, ce n’est pas notre histoire ; et c’est à peine de l’histoire, pour ce motif-là mais aussi en raison de la rareté des documents qui font de Carthage ce « mirage » qui répond si bien aux voeux de Flaubert.
Albert Thibaudet a souligné dans une belle image cette étrangeté radicale de Salammbô : « [c’est une oeuvre qui] au lieu de pencher l’histoire vers nous, la retir[e] violemment en arrière, sur le bord d’un désert, pour faire de ce morceau d’humanité un bloc de passé pur, une sorte d’astre mort comme la lune dont Salammbô subit l’influence[20] ». Sainte-Beuve, quant à lui, en homme de jugement et en garant de la moralité de l’art (il se plaignait déjà qu’il n’y ait pas un seul personnage sympathique dans Madame Bovary), dénonce les « monstres[21] », les « barbares », et rappelle Flaubert à l’impératif de liage dans une conception de l’histoire qui articule et oriente – la civilisation, le Progrès, aiguillons de la pensée historique du xixe siècle. Lequel ne souscrit aucunement à une telle conception de l’histoire :
C’est parce que je crois à l’évolution perpétuelle de l’humanité et à ses formes incessantes, que je hais tous les cadres où on veut la fourrer de vive force, toutes les formalités dont on la définit, tous les plans que l’on rêve pour elle. La démocratie n’est pas plus son dernier mot que l’esclavage ne l’a été, que la féodalité ne l’a été, que la monarchie ne l’a été. […] Ainsi chercher la meilleure des religions, ou le meilleur des gouvernements, me semble une folie niaise. Le meilleur, pour moi, c’est celui qui agonise, parce qu’il va faire place à un autre[22].
En lieu et place du goût balzacien pour la pensée et les grands principes politiques dans l’histoire (hégémonie, libéralisme…), Flaubert présente une tendance marquée pour l’agonie.
Contre un Sainte-Beuve qui pense l’histoire en termes de relais, transmission, héritage, progrès, Flaubert pense la mort des civilisations – sans se soucier de perfectibilité, il pense la mort pour elle-même, comme condition d’un mouvement perpétuel, mouvement qui est toujours relance vers et pour la disparition. Rythme singulier, création permanente de formes, qui suppose que les formes soient instables.
Et c’est bien sur ce mode-là qu’il écrit Salammbô ; et par ce mode-là qu’il dé-moralise l’histoire, la délie de toute orientation morale, à savoir tension vers une finalité consensuelle (la civilisation par exemple[23]). Par delà bien et mal, il ne juge ni ne réhabilite, et d’abord en n’opposant pas les barbares et les civilisés, mais en distribuant traits de barbarie et de civilisation alternativement dans les deux camps affrontés. Carthage n’est pas la Civilisée résistant à ses Barbares ; elle est la Cité, certes, et eux des nomades, mais cette différence est de peu d’utilité. Salammbô est le roman du grand balancement du même au même, changements de lieux, grandes marches, allers et retours, batailles gagnées et perdues, balancement entre Tanit et Moloch, avec au bout du compte une commune violence et une commune souffrance des hommes. Salammbô incarne à très grande échelle cette certitude stoïcienne[24] de Flaubert : « Je suis sûr d’ailleurs que les hommes ne sont pas plus frères les uns aux autres que les feuilles des bois ne sont pareilles. – Elles se tourmentent ensemble, voilà tout[25]. »
La seule communauté est celle du tourment ; éprouvé, infligé, quelle différence ? Alors que Polybe proposait un modèle d’intelligibilité historique, jugeant justes les punitions infligées par Carthage à ses Mercenaires révoltés, condamnant le cannibalisme ; alors que Michelet, dans son Histoire romaine que Flaubert avait lue avec délices au collège, ne se prive pas de juger lui aussi, mais négativement, cette Carthage châtiée par ses armées de Mercenaires, « Babel impie et sanguinaire sans loi, sans dieu, qu’elle avait poussée sur les autres peuples[26] », Flaubert ne distingue pas le juste de l’injuste, le mal du très mal, le cruel du plus cruel… Son objectif est plutôt de tenter de maintenir le plus possible « comme à égalité » les cultures, les religions, les violences, les forces en présence…
Comme à égalité
Comme à égalité, le chapitre final règle les comptes, dressant face à face les croix des barbares et celles des Carthaginois, sur lesquelles agonisent le suffète Hannon et les Anciens de Carthage d’un côté, les ambassadeurs et chefs des Mercenaires de l’autre : ils expirent en même temps.
Comme à égalité, la violence est guerrière (hurlements et boyaux) et civile – disons même « civilisée », pour catégoriser cette violence sacrificielle de la civitas destinée à sauver Carthage de la soif : rassemblé autour de Moloch, le peuple de Carthage (qu’il faut bien ici distinguer des hordes, groupes, tribus diverses des Barbares), uni et réuni, sacrifie ses enfants ; et des Barbares, épiant la ville et témoins de cet acte (fameux sous le nom de « grillade des moutards[27] ») « regardaient, béants d’horreur[28] ». La distinction barbare-civilisé est alors caduque, de sorte que tombe l’Histoire selon Sainte-Beuve, celle des conflits où la civilisation se retrempe, et se transmet – flambeau passant d’une culture à l’autre.
Comme à égalité, cela signifie aussi poser dans le roman les éléments du récit en tâchant de les cadrer, de les hiérarchiser le moins possible (puisqu’on veut « fixer un mirage ») : Flaubert avait écrit un chapitre explicatif qu’il avait jugé nécessaire pour éclairer cette si complexe et si lointaine Carthage. Mais il écartera finalement ce chapitre, préférant disséminer au fil des épisodes les traits explicatifs. Disséminer, laisser épars : modalités essentielles de l’écriture de Flaubert, extrêmement sensibles dans Salammbô. Laisser épars, de sorte que chaque aspect semble avoir valeur égale – dans le flux de la diversité comme loi du monde, tout s’équivaut.
Ainsi, races, tribus, langues s’agglutinent, se distinguant à peine avant de s’indifférencier, comme dans cette séquence exemplairement flaubertienne :
On entendait, à côté du lourd patois dorien, retentir les syllabes celtiques bruissantes comme des chars de bataille, et les terminaisons ioniennes se heurtaient aux consonnes du désert, âpres comme des cris de chacal.
S, 45
Une langue de Babel y est audible, faux ensemble couturé de dorien, de celte, d’ionien, de libyen ; pas plus que de communauté humaine il n’y a de communauté de compréhension via une langue. Qu’il s’agisse de mets (le festin), d’armes (les batailles), des richesses d’Hamilcar, des morts, des dieux (puisque tous ceux des Mercenaires y sont, aussi), tout, dans Salammbô, est indexé quantitativement ; c’est le roman des formes et du nombre. Jusque dans le zaïmph, voile sacré de Tanit, qui est ainsi décrit :
on aurait dit un nuage où étincelaient des étoiles ; des figures apparaissaient dans les profondeurs de ses plis : Eschmoûn avec les Kabires, quelques-uns des monstres déjà vus, les bêtes sacrées des Babyloniens, puis d’autres, qu’ils ne connaissaient pas. Cela passait comme un manteau sous le visage de l’idole, et, remontant étalé sur le mur, s’accrochait par les angles, tout à la fois bleuâtre comme la nuit, jaune comme l’aurore, pourpre comme le soleil, nombreux, diaphane, étincelant, léger. C’était le manteau de la Déesse, le zaïmph saint que l’on ne pouvait voir.
S, 140
Il s’agit pourtant du symbole de l’âme de Carthage, mais si les dieux fondateurs ou ancestraux y sont bien représentés, il y a de l’excès – que « nombreux » signifie. Sur le voile de la déesse comme dans le roman, rien n’est si tout n’est pas là, conjoint, accolé, accoté, constitutif du divers.
Le phénomène est reconduit à l’échelle géographique lorsque les Mercenaires alignent avec eux contre Carthage la grande foule des nations et tribus maltraitées par la cité. Le monde antique se déverse à pleines pages dans les rangs mercenaires : « les hommes des régions orientales », nomades, bandits, Zuaèces, Garamantes, Amoniens, Atarantes, Troglodytes… montés sur des animaux variés, bariolés – cavales peintes, ânes, onagres, buffles… Le texte démultiplie ses précisions compulsives ; ensuite ce seront « les hommes de l’Occident », du Garaphos, et les Gétules, les Pharusiens, les Caunes, les Macares, les Tillabares… Et encore les Nègres, du Harousch, d’Augyles, d’Agazymba… « et de plus loin encore ! » Le tout sur seulement trois pages (voir S, 323-325). Au bout de cette litanie de noms que nul lecteur ne peut prendre autrement que comme liste poétique de mots carambolés, musicaux, exotiques (inutiles, dirait Sainte-Beuve), et comme en guise de réserve formelle, se relancent les sans-noms et les informes, maladifs, ambigus, inachevés :
Enfin, comme si l’Afrique ne s’était point suffisamment vidée, et que pour recueillir plus de fureurs, il eût fallu prendre jusqu’au bas des races, on voyait, derrière tous les autres, des hommes à profil de bête et ricanant d’un rire idiot ; – misérables ravagés par de hideuses maladies, pygmées difformes, mulâtres d’un sexe ambigu, albinos dont les yeux rouges clignotaient au soleil ; tout en bégayant des sons inintelligibles, ils mettaient un doigt dans leur bouche pour faire voir qu’ils avaient faim.
S, 326
C’est alors que le texte opère une sorte d’assèchement de la description des foules assemblées, en allant se perdre dans les choses – dromadaires, couffes, sel, gomme, dattes, noix – puis en finissant par ce brusque écart, saisissant, après le fameux tiret flaubertien :
on écrasait en marchant des morceaux de sel, des paquets de gomme, des dattes pourries, des noix de gourou ; – et parfois, sur des seins couverts de vermine, pendait à un mince cordon quelque diamant qu’avaient cherché les Satrapes, une pierre presque fabuleuse et suffisante pour acheter un empire.
S, 327
Tout semble se résorber dans une remarque incidente rêveuse, où les gueux portent de fabuleux diamants, incidente esthétique qui invalide toute valeur matérielle dans l’effet de disparate produit[29].
D’immenses foules se voient ainsi évanouies, sans que puisse s’inscrire durablement dans le texte une mise en ordre, une logique guerrière d’alliances durables entre ces tribus convergeant provisoirement contre Carthage. Tout se passe comme si l’Histoire refluait, devant une évocation ethnographique qui produit un passé étrange et merveilleux – c’est en ces termes que Paul Veyne évoque « le monde de Salammbô[30] » – en même temps que volatile. Car au-delà de l’histoire, refluent également les éléments du roman, ces armées, masses d’hommes et de bêtes brassées par le récit, peu à peu broyées, effacées. Si Salammbô est le roman du recensement de tout, il est aussi le roman de la soustraction, du décompte : reflux du nombre de soldats Barbares, dans le défilé de la Hache, dévorés par les lions jusqu’au dernier – « Le lendemain, à la même heure, le dernier des hommes restés dans le défilé de la Hache expirait » (S, 417) –, ou dans les derniers combats – « Bientôt, ils ne furent que cinquante, puis que vingt, que trois et que deux seulement, un Samnite armé d’une hache, et Mâtho qui avait encore son épée » (S, 416), jusqu’à l’ultime, Mâtho, qui sera dépecé par la population lors de la cérémonie du triomphe de Carthage. Dans la mise en oeuvre de cette contraction historique qui réduit à néant les Barbares, il est possible de voir la préfiguration du futur de Carthage, son anéantissement programmé (que signalerait aussi la mort de Salammbô à l’acmé du triomphe). Il ne s’agit toutefois que d’une esquisse, d’un possible du texte, Flaubert se gardant de toute explicitation concernant la « réverbération » d’un événement historique sur un autre – réverbération d’un genre particulier, d’ailleurs, moins « réverbération d’une époque à l’autre[31] » comme le disait Sainte-Beuve qu’extension de l’ombre portée de la disparition des époques ; de sorte que la conception beuvienne classique de la transmission du flambeau de la civilisation s’enténèbre et se baroquise chez Flaubert.
Iliade mélancolique
Écriture du divers, du tout – et de la dissipation : cette littérature empruntant à l’histoire ne commente rien, n’apprend rien, n’inscrit pas la séquence historique traitée dans le grand cours de l’histoire, sinon dans celle de la disparition perpétuelle des formes et des pouvoirs. C’est pour cela qu’elle n’enseigne pas l’histoire[32] : la mort ne s’enseigne pas… Mais ce roman fait advenir les mirages de ces foules humaines[33], pressées, confuses, égales, puis floutées et dissoutes. Il brosse de vastes tableaux où rien ne fait véritablement saillie (trait mélancolique), tel celui des tribus de l’Afrique venues grossir les rangs mercenaires – à peine décrites, déjà dissipées, comme lâchées deux fois par le récit :
S, 339Les autres barbares, campés au loin sur l’isthme, s’ébahissaient de ces lenteurs ; ils murmuraient ; on les lâcha.
Alors ils se précipitèrent avec leurs coutelas et leurs javelots, dont ils battaient les portes. Mais la nudité de leurs corps facilitant leurs blessures, les Carthaginois les massacraient abondamment ; et les Mercenaires s’en réjouirent, sans doute par jalousie du pillage. Il en résulta des querelles, des combats entre eux. La campagne étant ravagée, bientôt on s’arracha les vivres. Ils se décourageaient. Des hordes nombreuses s’en allèrent. La foule était si grande qu’il n’y parut pas.
Un désordre absolu règne sur le champ de bataille, où les hordes se confondent et s’en vont – sans effet marquant ; cette écriture barbare de l’histoire indifférencie les acteurs et minore la causalité, se gardant de la causalité générale, celle qui fait l’histoire, lui préférant la micro-causalité parcellisée des dysfonctionnements (murmures, jalousie), impropre à créer le sens continûment. Proust a cette formule si frappante pour désigner le style de Flaubert : « nous les aimons ces lourds matériaux que la phrase de Flaubert soulève et laisse retomber avec le bruit intermittent d’un excavateur[34] » ; soulever, et laisser retomber, tel est bien le rythme profond de l’exhumation et de la dissipation de l’histoire antique dans Salammbô. Sur ce rythme, Flaubert brasse des mondes et les dissipe, produit et sape dans un double mouvement qui tient à la mélancolie constitutive de son écriture. « Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour entreprendre de ressusciter Carthage », écrit-il le 29 novembre 1859 : il vient de dire à Ernest Feydeau combien il se sent « épuisé et las jusque dans la moelle des os », pensant « à la mort avec avidité, comme un terme à toutes ces angoisses. Puis ça remonte tout doucement. Je me re-exalte et je retombe – toujours ainsi[35]. » Soulever et se soulever, laisser retomber et retomber, la double motion recouvre l’écriture et celui qui écrit.
La mélancolie frappe largement dans Salammbô, non seulement par cette écriture de la diversité égale, une diversité sans hiérarchie, sans point de fuite, sans mise en ordre, en perspective, en signification, mais également comme motif dans l’oeuvre[36]. Tout commence dans le roman avec la mélancolie de Mâtho – envers de la colère d’Achille : « [Mâtho est] irrésolu et dans une invincible torpeur, comme ceux qui ont pris autrefois quelque breuvage dont ils doivent mourir » (S, 81), « Mâtho, mélancolique comme un augure, s’en allait dès le soleil levant pour vagabonder dans la campagne. » (S, 82)
Mais elle frappe toutes les races, indifféremment, sorte de fond commun de l’humanité ; ainsi Autharite le Gaulois :
Souvent, au milieu du jour, le soleil perdait ses rayons tout à coup. Alors, le golfe et la pleine mer semblaient immobiles comme du plomb fondu. Un nuage de poussière brune, perpendiculairement étalé, accourait en tourbillonnant ; les palmiers se courbaient, le ciel disparaissait, on entendait rebondir des pierres sur la croupe des animaux ; et le Gaulois, les lèvres collées contre les trous de sa tente, râlait d’épuisement et de mélancolie. Il songeait à la senteur des pâturages par les matins d’automne, à des flocons de neige, au beuglement des aurochs perdus dans le brouillard ; et, fermant ses paupières, il croyait apercevoir les feux des longues cabanes, couvertes de paille, trembler sur les marais, au fond des bois.
S, 162
Mais aussi, et au même moment, les Carthaginois, assiégés sur une colline (car la mélancolie, comme la violence, confond Barbares et Carthaginois, confirmant l’impossibilité d’une partition entre barbarie et civilisation, de même qu’entre violence et mélancolie) :
Tous regrettaient leurs familles, leurs maisons ; les pauvres, leurs cabanes en forme de ruche, avec des coquilles au seuil des portes, un filet suspendu, et les patriciens, leurs grandes salles emplies de ténèbres bleuâtres, quand, à l’heure la plus molle du jour, ils se reposaient, écoutant le bruit vague des rues mêlé au frémissement des feuilles qui s’agitaient dans leurs jardins ;
S, 263
et les Barbares, mourant lentement dans le défilé de la Hache :
Ceux qui étaient nés dans les villes se rappelaient des rues toutes retentissantes, des tavernes, des théâtres, des bains, et les boutiques des barbiers où l’on écoute des histoires. D’autres revoyaient des campagnes au coucher du soleil, quand les blés jaunes ondulent et que les grands boeufs remontent les collines avec le soc des charrues sur le cou. Les voyageurs rêvaient à des citernes, les chasseurs à leurs forêts, les vétérans à des batailles ; – et, dans la somnolence qui les engourdissait, leurs pensées se heurtaient avec l’emportement et la netteté des songes.
S, 388
Et les Barbares encore, désolés devant leurs morts :
Les Latins se désolaient de ne pas recueillir leurs cendres dans les urnes ; les Nomades regrettaient la chaleur des sables où les corps se momifient, et les Celtes, trois pierres brutes, – sous un ciel pluvieux, au fond d’un golfe plein d’îlots.
S, 309
Salammbô est une Iliade mélancolique dans laquelle le déclenchement de la guerre ne tient pas aux dieux, mais à l’avarice de Carthage. Et l’on finit même par oublier les raisons de ces carnages, comme si la seule pulsion de mort menait les masses aux massacres, au-delà de toute partition entre bien et mal. Et c’est ainsi que l’on assiste à cette scène, dérèglement achevé de la morale – dé-moralisation accomplie de l’histoire épique par la littérature – : Hamilcar exige des Barbares qui se sont rendus à lui qu’ils se combattent en gladiateurs, sous prétexte de garder les vainqueurs pour les intégrer à son armée ; tous seront tués, de fait – les derniers « pendant qu’ils buvaient […], avec des stylets, dans le dos » (S, 398). Considérons l’image qui rend compte de cette transgression majeure des règles de la guerre et de l’indifférenciation qui en résulte, rendant caduques les notions d’ennemis ou de parole donnée – et caduques les formes du combat, vaine la force : « Quelques-uns s’étaient bandé les yeux, et leurs glaives ramaient dans l’air, doucement, comme des bâtons d’aveugle. » (S, 397)
Flaubert évoque ici les amitiés ou les amours de cette soldatesque, et les pleurs, et la folie qui se saisit d’eux quand ils doivent tuer l’ami ou l’amant, ou se tuer plutôt. La scène scandalise Sainte-Beuve parlant de « hideuses révélations de tendresse qui se déclarent à l’heure suprême entre les Hercule et les Hylas de ces bandes dépravées[37] ». L’image pourtant est sidérante : dans ces étranges combats d’aveugles, le motif, fréquent dans L’Iliade, des combattants aveuglés (par un brouillard, une nuée, la poussière) au gré des interventions des dieux pour la défense de l’un ou l’autre camp se voit mué en une scène bien différente, où, comme à égalité, et hors de toute raison dans l’histoire, se déroule une représentation de frères se tourmentant ensemble, soumis, quoique mollement, à l’injonction de mort – qui est in fine au fondement du roman.
Salammbô, roman historique singulier, pourrait se tenir entre deux formules, celle-ci où la mélancolie se déploie dans ces regards aveugles et ces gestes qui se voudraient pour rien mais dont la finalité reste opératoire – formule d’une histoire pour la mort, où il n’y a peut-être rien derrière le rideau noir[38], et surtout pas la longue perspective de la civilisation ; et cette autre, posée au commencement, lors du festin, porteuse quant à elle de l’esthétique de la disparate, de l’image-mirage, vacillante et éphémère, promettant non pas la « réverbération » chère à Sainte-Beuve, mais la prolifération et la diffraction : « Les cratères, à bordure de miroirs convexes, multipliaient l’image élargie des choses. » (S, 48)
*
Salammbô met en oeuvre la dé-moralisation, la dés-organisation de l’histoire (les deux phénomènes, étroitement liés, produisant leurs effets de conserve). Le regard porté sur l’histoire, déjà décentré en raison du choix de la guerre des Mercenaires, se décale encore – fiction, invention – par rapport aux sources (Polybe, Michelet), les enjeux se brouillent dans la durée et l’enchevêtrement des batailles et des combattants, les composantes mystique et amoureuse s’immiscent dans la trame guerrière, qui se relâche. Mais c’est l’écriture surtout qui travaille à délier les éléments du récit : arasement mélancolique, masses qui se défont, égalisation de tout, forces et valeurs…
Flaubert avait prévu, pour la fin de Bouvard et Pécuchet, d’amener ses copistes à prendre acte de « [l]’égalité de tout, du bien et du mal, du beau et du laid, de l’insignifiant et du caractéristique[39] ». Salammbô s’était déjà essayé à une telle option, à l’échelle d’un roman historique que Flaubert avait défini en ces termes aux Goncourt : « ça ne prouve rien, ça ne dit rien, ça n’est ni historique, ni satirique, ni humoristique. En revanche ça peut être stupide[40]. »
Bien loin de la composition à thèse de Balzac utilisée ici comme le modèle du roman historique à forte capacité interprétative de l’histoire, Flaubert vérifie son ambition de jeune homme de dix-huit ans : « Si jamais je prends une part active au monde, ce sera comme penseur et comme démoralisateur[41]. » Là où Balzac procède avec la virulence rhétorique et la violence idéologique d’un homme persuadé qu’il y a une vérité dans l’histoire et qu’il est en charge de son établissement, Flaubert au contraire porte l’interrogation sur l’ordre supposé des événements, sans en proposer aucun. Le Vrai Ordre, pour lui, se manifeste dans les bouleversements, grands ou petits, météorologiques ou littéraires – notamment ces espaliers détruits par une puissante grêle à l’été 1853, Berezina pour le bourgeois, mais que Flaubert arrange en philosophie sur le monde comme il va, sans cause ni but :
Ce n’est pas sans un certain plaisir que j’ai contemplé mes espaliers détruits, toutes les fleurs hachées en morceaux, le potager sens dessus dessous. […] [J]’admirais le Vrai Ordre se rétablissant dans le faux ordre. […] La Règle [c’est] le Mal-contingent qui n’est peut-être pas le Bien nécessaire, mais qui est l’Être, enfin, chose que les hommes voués au néant comprennent peu[42].
C’était au potager, alentours de Rouen…
Appendices
Note biographique
Maître de conférences en littérature française à l’Université Paul-Valéry Montpellier III, Sylvie Triaire est membre du Centre de recherches interdisciplinaires en sciences humaines et sociales (CRISES). Parmi ses publications : Une esthétique de la déliaison. Flaubert, 1870-1880, Paris, Honoré Champion, coll. « Romantisme et Modernités », 2002 ; « Pureté de Flaubert ? Art pur, compost et purin », dans Didier Alexandre et Thierry Roger (dir.), Puretés et impuretés de la littérature (1860-1940), Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », 2015 ; « “Tout était faux.” L’histoire au prisme de l’année terrible », Cahiers Flaubert-Maupassant, no 32, 2016. Elle a entre autres dirigé, avec Patricia Victorin, Deviser-diviser. Pratiques du découpage et poétiques du chapitre de l’Antiquité à nos jours, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, coll. « Le Centaure », 2011.
Notes
-
[1]
Charles Baudelaire, lettre du 3 septembre 1865 à Sainte-Beuve, citée par Didier Philippot dans sa préface à l’anthologie Gustave Flaubert. Mémoire de la critique, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, coll. « Mémoire de la critique », 2006, p. 43.
-
[2]
Charles-Augustin Sainte-Beuve, « Salammbô, par M. Gustave Flaubert », Le Constitutionnel, 8, 15, 22 décembre 1862, cité dans Didier Philippot, op. cit., p. 211 et 215.
-
[3]
Ibid., p. 199.
-
[4]
Ibid., p. 227. Je souligne.
-
[5]
« [O]n en aurait refait l’histoire », dit lui aussi Sainte-Beuve.
-
[6]
Pour rappel : Sur Catherine de Médicis réunit quatre textes composites – une longue introduction historiographique, deux récits historiques se déroulant au temps de Catherine et de Charles IX (de part et d’autre de la Saint-Barthélemy, qui échappe au récit), enfin un récit se déroulant en 1786, peu avant la Révolution : lors d’un dîner mondain et d’une conversation sur les pratiques médiumniques, un petit avocat de province (Robespierre) raconte un rêve durant lequel le fantôme de Catherine de Médicis lui est apparu, pour lui livrer une interprétation politique pour le moins hétérodoxe de la Saint-Barthélemy. (Marat, qui est du dîner, raconte à son tour un rêve, plus bref et sans lien direct avec Catherine.)
-
[7]
« Una fides, unus dominus », énonce-t-elle devant Robespierre, lointain successeur de ces protestants épris de liberté qui préfiguraient la révolution démocratique.
-
[8]
Comme on dit « faire donner l’assaut ».
-
[9]
Honoré de Balzac, Sur Catherine de Médicis, Paris, La Table ronde, coll. « La petite vermillon », 2006, p. 13.
-
[10]
Ibid., p. 388.
-
[11]
Ibid., p. 389.
-
[12]
Gustave Flaubert, lettre à Sainte-Beuve, 24 décembre 1862, citée dans Didier Philippot, op. cit., p. 233.
-
[13]
Charles-Augustin Sainte-Beuve, art. cit., p. 225.
-
[14]
Idem. Je souligne.
-
[15]
Voir Edward Saïd, L’orientalisme : l’Orient créé par l’Occident, Paris, Seuil, coll. « La couleur des idées », 2005 [1978].
-
[16]
Charles-Augustin Sainte-Beuve, art. cit., p. 199.
-
[17]
Ibid., p. 225.
-
[18]
Tout comme Le Christ s’est arrêté à Eboli (Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli, Turin, Einaudi, 1945).
-
[19]
Charles-Augustin Sainte-Beuve, art. cit., p. 226.
-
[20]
Albert Thibaudet, Gustave Flaubert, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1982, [1935], p. 145.
-
[21]
« [L]’art ne saurait être totalement indépendant de la sympathie, et portant tout entier sur des monstres. » Charles-Augustin Sainte-Beuve, art. cit., p. 226.
-
[22]
Gustave Flaubert, lettre du 18 mai 1857, Correspondance (éd. Jean Bruneau), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1980, p. 719.
-
[23]
Qu’il moque rapidement, sous ses aspects saint-simoniens, dans L’éducation sentimentale, avec le tableau de Pellerin montrant Jésus-Christ conduisant une locomotive dans une forêt vierge : « Cela représentait la République, ou le Progrès, ou la Civilisation… », Gustave Flaubert, L’éducation sentimentale, Paris, Flammarion, coll. « GF », 2001 [1869], p. 404.
-
[24]
Mi-stoïcienne, mi-sadienne… Sur Flaubert et Sade, voir Pierre-Marc de Biasi, « Flaubert avec Sade », et Florence Pellegrini, « Avatars flaubertiens de l’objet sadique », dans Anne Herschberg-Pierrot (dir.), Flaubert, éthique et esthétique, Paris, Presses universitaires de Vincennes, coll. « La Philosophie hors de soi », 2012, p. 187-213 et p. 215-233 respectivement, et l’article d’Éric Le Calvez, « L’horreur en expansion. Génétique de la “grillade des moutards” dans Salammbô », disponible en ligne sur le site de l’Institut des textes & manuscrits modernes : <www.item.ens.fr/index.php?id=187077> (page consultée le 16 août 2017).
-
[25]
Gustave Flaubert, lettre du 26-27 mai 1853, Correspondance, t. II, p. 335.
-
[26]
Jules Michelet, Histoire romaine, Paris, Flammarion, 1972, p. 453. Cité par Gisèle Séginger, Flaubert, une poétique de l’histoire, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2000, p. 158.
-
[27]
Gustave Flaubert, lettre du 25 septembre 1861 à Jules Duplan, Correspondance (éd. Jean Bruneau), Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. III, 1991, p. 176.
-
[28]
Gustave Flaubert, Salammbô (éd. Jacques Neefs), Paris, Le Livre de poche, 2011 [1862], p. 373. Désormais abrégé en S, suivi du numéro de la page.
-
[29]
Le passage de Salammbô cité ici rappelle évidemment ce souvenir de voyage de Flaubert, qui constitue pour lui tout l’Orient, en même temps que le fondement de son esthétique : « Je me rappelle un baigneur qui avait au bras gauche un bracelet d’argent, et à l’autre un vésicatoire. Voilà l’Orient vrai et, partant, poétique : des gredins en haillons galonnés et tout couverts de vermine », écrit-il à Louise Colet, le 27 mars 1853, Correspondance, t. II, p. 283.
-
[30]
Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire, Paris, Seuil, coll. « Points histoire », 1996, [1971] p. 233.
-
[31]
Voir supra, note 17.
-
[32]
À rebours, et fort ironiquement, l’article romans du Dictionnaire des idées reçues accordait une place au roman historique : « Seuls les romans historiques peuvent être tolérés parce qu’ils enseignent l’Histoire », Gustave Flaubert, Le dictionnaire des idées reçues (éd. Anne Herschberg Pierrot), Paris, Le Livre de poche, 1997 [1913], p. 118.
-
[33]
Qui doivent être ce qui porte littéralement l’oeuvre, arrachée à « l’éternelle personnalité déclamatoire » : « toi disséminée en tous, écrit Flaubert à Louise Colet, […] on verra dans tes oeuvres des foules humaines », lettre du 27 mars 1852, Correspondance, t. II, p. 61.
-
[34]
Marcel Proust, « À propos du “style” de Flaubert », dans Didier Philippot, op. cit., p. 739.
-
[35]
Gustave Flaubert, Correspondance, t. III, p. 59.
-
[36]
En décembre 1861, Flaubert écrit à Mme Roger des Genettes : « La mélancolie antique me semble plus profonde que celle des Modernes » – il attribue ce fait à l’absence de croyance dans l’immortalité « au-delà du trou noir », lequel était du coup pour les Anciens « l’infini même », Correspondance, t. III, p. 191.
-
[37]
Charles-Augustin Sainte-Beuve, art. cit., p. 222.
-
[38]
« Quand je regarde une des petites étoiles de la voie lactée, je me dis que la terre n’est pas plus grande que l’une de ces étincelles. […] Il me semble être devenu un grain de poussière perdu dans l’espace, et pourtant je fais partie de cette grandeur illimitée qui m’enveloppe. Je n’ai jamais compris que cela fût désespérant. Car il se pourrait bien qu’il n’y eût rien du tout, derrière le rideau noir », à Mlle Leroyer de Chantepie, 6 juin 1857, Correspondance, t. II, p. 731.
-
[39]
Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1999 [1881], p. 390.
-
[40]
Cité par Albert Thibaudet, op. cit., p. 145. Une crainte identique accompagne Flaubert au long de Bouvard et Pécuchet.
-
[41]
Gustave Flaubert, lettre à Ernest Chevalier du 24 février 1839, Correspondance, t. I, p. 37.
-
[42]
« Tu auras appris par les journaux la soignée grêle qui est tombée sur Rouen et alentours, samedi dernier », Gustave Flaubert, lettre à Louise Colet du 12 juillet 1853, Correspondance, t. II, p. 381.