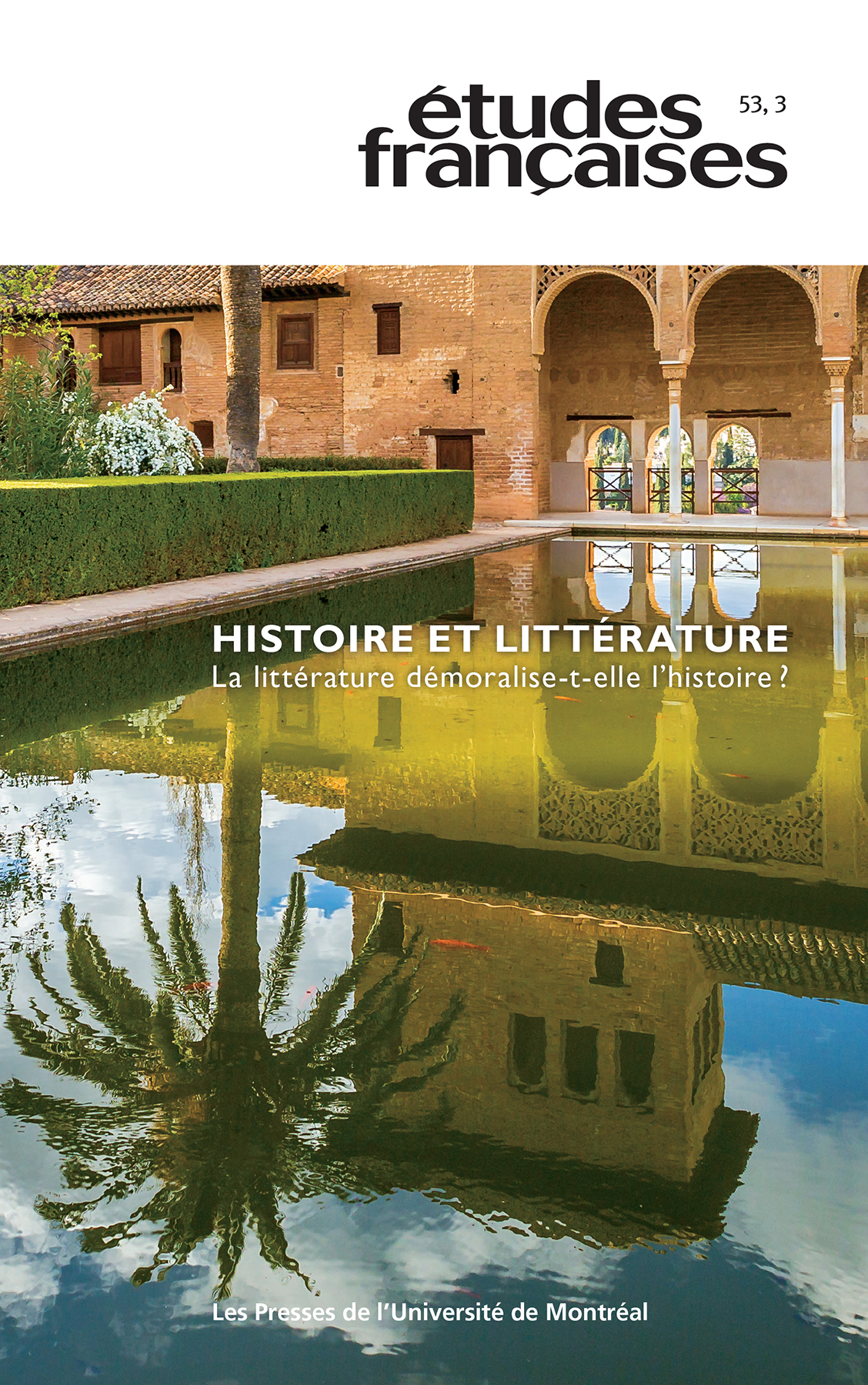Abstracts
Résumé
Marie-Hélène Lafon, Pierre Jourde : deux auteurs rattachés par leur origine familiale au Cantal. Leurs oeuvres sont en partie consacrées à cette France rurale dont ils sont issus, mais la réception de celles-ci ne va pas de soi auprès des habitants du Cantal. Pierre Jourde a même été victime d’agressions. Si Lafon s’est heurtée à quelque hostilité, elle a pris grand soin par la suite de « brouiller les pistes » et jouit désormais d’une relative immunité. Nous examinons ici deux ouvrages, dont les titres se font écho à neuf ans d’intervalle : Pays perdu de Jourde (2003) et Les Pays de Lafon (2012). Il s’agit de déceler les raisons factuelles, biographiques expliquant la différence de réception, et de comparer les partis pris d’écriture ainsi que les imaginaires.
Abstract
Marie-Hélène Lafon, Pierre Jourde: two authors linked by their family origin to the Cantal and whose work is partly devoted to this rural France from which they come. But these works are not wholly received among the inhabitants of the Cantal. Pierre Jourde has been the victim of assaults. Lafon also encountered some hostility: she subsequently took great care to “blur the tracks” and now enjoys a relative immunity. This article reviews two books, whose titles echo each other though nine years apart: Pays perdu by Pierre Jourde (2003) and Les Pays by Marie-Hélène Lafon (2012). It ferrets out the factual, biographical reasons explaining the difference in the reception of each text and compares the biases in the writing and the imaginary.
Article body
Pays perdu (Pierre Jourde, 2003) / Les pays (Marie-Hélène Lafon, 2012)[1] : les deux titres se font écho dans un paysage littéraire qui marque le tournant du millénaire – une littérature non pas du terroir, mais qui observe la fin d’un monde rural. Il y avait déjà eu Michon, Bergounioux, Millet que Lafon appelle son « triangle des Bermudes » ; dans des récits de filiation (Michon, Bergounioux) ou des sagas (Millet), ils prenaient plutôt en compte les générations qui avaient vu le jour à la fin du xixe ou au début du xxe siècle. Jourde, Lafon (et d’autres encore[2]) dressent un état du monde qui leur est contemporain dans une démarche proche de l’ethnologie. Or, s’il est communément admis d’évoquer frontalement l’usine (François Bon, Leslie Kaplan), le milieu médical ou la banlieue, la littérature à visée sociologique de la paysannerie ne va pas de soi. Pour sa première publication, Le soir du chien, qui pourtant était une fiction, Marie-Hélène Lafon s’était entendue dire qu’il ne fallait pas beaucoup aimer son pays pour en parler de la sorte[3] et avait été menacée d’assignation en justice. Cette assignation avait été effective pour Luc Baptiste qui, dans Le village et enfin (préfacé par la même Marie-Hélène Lafon), peignait un hameau de l’Allier. Quant à Pierre Jourde, il a été victime avec sa famille d’une violente agression sur les lieux mêmes du récit ; l’affaire est allée au tribunal et a de manière irréparable mis l’auteur au ban de son village. S’en était suivi dans les médias un débat national sur la liberté de l’écrivain et les puissances de l’écriture : de quoi démentir ceux pour qui la littérature serait devenue inoffensive et aurait perdu tout pouvoir sur le réel.
Dix ans plus tard, l’auteur raconte ce drame dans La première pierre[4], manière de justifier sa démarche d’écrivain – qui était de faire, « globalement, un éloge du pays » (LPP, 33) – et d’analyser les raisons d’une telle réception : le livre a le tort de « raviver les souffrances » (LPP, 106). Jourde comprend aussi que les gens lui « en veulent », « non pas de ce qu’ils croient [qu’il] n’aim[e] pas, mais bien plutôt de ce qu’ils n’aiment pas en eux-mêmes » (LPP, 128). Surtout
celui qui est handicapé, celui qui est pauvre, celui qui boit trop, on ne peut pas le désigner, même dans un texte littéraire, même avec empathie, même avec compassion, même avec complicité, ne serait-ce que pour en dresser un portrait exact, donner une idée de sa condition et de sa vie.
LPP, 130
En effet, s’il ne révélait pas dans Pays perdu le nom de Lussaud[5], il conservait tout de même les prénoms des personnes et « désignait » bien, de manière explicite, tout le voisinage. Marie-Hélène Lafon, forte de sa première expérience – et de celle très médiatisée de Pierre Jourde –, a pris grand soin dans les oeuvres ultérieures de « brouiller les pistes en inversant patronymes et toponymes, en déplaçant Fridières de Saint-Flour à Saint-Amandin et Montesclide de Saint-Amandin à Marchastel[6] ». Si elle bénéficie désormais d’une relative immunité, cela tient certes à cette prudence mais aussi, probablement, à des raisons factuelles, biographiques que l’on peut aisément décliner. Or il s’agit avant tout de littérature, et il se peut que la réception ait à voir avec des partis pris littéraires différents, des imaginaires fortement contrastés.
Parmi les explications factuelles, le contexte de l’habitat paraît déterminant : la maison familiale des Jourde est imbriquée dans un hameau – « une communauté humaine qui se compose d’une dizaine de foyers serrés sur un très petit espace » où il n’est « aucun interstice par où échapper un instant » (LPP, 60) aux regards. Au contraire, la maison familiale de Marie-Hélène Lafon est isolée dans un « fin fond du monde » comme celui de Claire dans Les pays : « On n’y passe pas, on ne traverse pas, on y va par un chemin tortueux et pentu » (LP, 13). Cette topographie installe d’emblée une distance spatiale entre l’écrivain et la communauté rurale qu’il prend pour objet, distance impossible chez Jourde. Le jeu subtil de la distance et de la proximité est compliqué par la configuration biographique. Bien que descendant d’une lignée paysanne, Jourde est né à Paris, et son père n’a travaillé la terre que pendant quelques années. Certes, dès son enfance, l’écrivain a partagé la vie du village à l’occasion des vacances et a participé aux travaux des champs – voire aux beuveries qui scellent une forme de fraternité[7] –, mais cela reste anecdotique aux yeux de ceux qui sont assignés à cette condition. En outre, même si cela ne recouvre pas une inégalité fondamentale de revenus :
la famille demeurait une famille de propriétaires, elle avait encore des fermiers, à qui elle louait terres et bâtiments, et dont la maison était mitoyenne à la maison de maître. Comment ne pas supposer a priori un sentiment de supériorité, de mépris chez celui qui est issu d’une telle famille ?
LPP, 108
Tel n’est pas le cas de Marie-Hélène Lafon qui est née et a grandi dans une famille de propriétaires exploitants[8] comparable au modèle le plus répandu dans le Cantal ; elle en retire aussi une plus grande légitimité à évoquer le monde dont elle est issue : « parce que les parents paysans, le frère resté à la ferme et pas de génération intermédiaire, pas d’aimables vacances au vert royaume des grands-parents[9] ». Le fait d’être devenue fonctionnaire[10] et de vivre à Paris peut toutefois passer pour une trahison du monde premier[11], trahison que le père avait pressentie dès l’enfance : « il le lui disait des fois à table, elle était une bourgeoise, elle faisait pas de bruit en mangeant sa soupe » (LP, 198). Pourtant ce départ – ou cette trahison – s’inscrit dans l’ordre naturel des choses, sinon historique ou économique : aussi inéluctablement que « les rivières s’en vont vers des ailleurs devinés », « Claire est partie, les filles partent, les filles quittent les fermes et les pays » (LP, 158). La démarche des deux auteurs est donc radicalement inverse – l’une est partie, l’autre vient –, déterminant la construction même des textes : on arrive par une route tortueuse au Pays perdu – c’est l’incipit du récit – et Les pays s’ouvre sur un départ en train vers la capitale[12]. La différence de réception des deux oeuvres tient donc aussi au genre de l’auteur, et ce sont les hommes (Jourde, Baptiste) qui ont été le plus durement confrontés à leurs concitoyens. On soupçonne dans la brutalité des agressions subies une archaïque hostilité mâle, qui se règle à coups de poing[13], comme cela arrive souvent dans Pays perdu : le coup de poing de François « n’est pas réputé pour sa tendresse » (PP, 30) et le grand-père « avait l’habitude de faire le coup de poing » (PP, 92). Rien de tel chez Marie-Hélène Lafon où les crimes restent secrets, où les hostilités sont tues, ou remâchées par les femmes à l’intérieur des maisons[14]. Il se peut aussi que les poncifs attachés à la virilité – violence physique – et à la féminité – sensibilité, penchant compassionnel – aient influencé la réception des oeuvres, à moins qu’ils ne déterminent véritablement le regard sur le monde et l’imaginaire de chacun.
Les choix narratifs et les projets littéraires surtout diffèrent. Pierre Jourde – par ailleurs aussi romancier – ne prend pas pour Pays perdu le détour de la fiction. Il se contente en apparence de décrire et raconter la communauté villageoise en une série de tableaux, ordonnés autour d’une circonstance particulière, qui détermine à la fois l’unité temporelle et l’atmosphère funèbre du récit : l’enterrement d’une adolescente. Le narrateur – Pierre Jourde lui-même – assiste à la veillée mortuaire et au défilé des voisins auprès du cercueil. Chaque visiteur est l’occasion d’un portrait et ravive une anecdote. Il y a aussi ceux « qui ne viendront pas », parce qu’ils sont morts : le livre accueille donc « dans la demeure tranquille des pages » ce peuple fantôme, « leur cortège harassé » (LPP, 107). Si le narrateur rapporte quelques souvenirs dont il fut partie prenante, il prétend être « à peine un “je” parmi tous ces êtres […] à qui il restitu[e], non pas son histoire, mais la leur » (LPP, 112). Cependant Pierre Jourde sait bien que « tout livre, quoi qu’il dise, dit “je” » (LPP, 113) et Pays perdu – on le comprend surtout dans le dernier chapitre – procède d’une hantise personnelle, obéit à une nécessité intérieure : « dire son fait à cette terre qui gardait en elle le père réduit au silence » (LPP, 112[15]). La description du monde rural révèle en filigrane une enquête sur le père, sur ce silence à l’origine du moi et probablement de l’écriture ; la nécessité d’écrire se fonde donc sur des sentiments paradoxaux, une affection sincère, intense pour la terre des aïeux, et une rancoeur souterraine, l’évidence de comptes à régler. D’emblée, ce pays « perdu » est donc abordé de manière passionnelle et contradictoire.
En recourant principalement à la fiction, Marie-Hélène Lafon atténue la charge autobiographique de ses romans. Bien sûr, il suffit de comparer les itinéraires de Claire dans Les pays[16] – ses allers-retours du Cantal à Paris – avec ceux de l’auteure pour constater qu’ils se recoupent en bien des points. Or elle emploie la première personne seulement pour Traversée, méditation ou poème en prose qui ne mentionne pas les êtres, seulement les choses, et les paysages[17]. Ses romans et nouvelles en revanche racontent les vies, fictionnalisées, de ceux qu’elle a connus ou côtoyés : Joseph, Mo, Gordana, un frère et une soeur dans Les derniers Indiens… Or la différence essentielle avec Pierre Jourde ne tient pas tant à la part plus ou moins grande d’invention qu’à la présence ou l’absence du narrateur et au système de focalisation. On entre par ces mots dans Joseph, c’est-à-dire dans le récit, et peu à peu dans sa manière d’être, de regarder, plutôt que dans une « conscience » :
Les mains de Joseph sont posées à plat sur ses cuisses. Elles ont l’air d’avoir une vie propre et sont parcourues de menus tressaillements. Elles sont rondes et courtes, des mains presque jeunes comme d’enfance et cependant sans âge. Les ongles carrés sont coupés au ras de la chair, on voit leur épaisseur, on voit que c’est net, Joseph entretient ses mains, elles lui servent pour son travail, il fait le nécessaire. Les poignets sont solides, larges, on devine leur envers très blanc, charnu, légèrement bombé. La peau est lisse, sans poil, et les veines saillent sous elle. Joseph tourne le dos à la télévision. Ses pieds sont immobiles et parallèles dans les pantoufles à carreaux verts et bleu marine achetées au Casino chez la Cécile ; ces pantoufles sont solides et ne s’usent presque pas, leur place est sur l’étagère à droite de la porte du débarras. La patronne appelle comme ça la petite pièce voûtée qui sépare la laiterie de la cuisine ; elle préfère que les hommes passent par là au lieu d’entrer directement par la véranda, c’est commode ça évite de trop salir surtout s’il fait mauvais ou quand ils remontent de l’étable avec les bottes.[18]
Écriture cinématographique, dirait-on, qui à première vue objective le personnage. Mais le gros plan sur les mains installe une proximité, et une lenteur, oblige à regarder, pénétrer. Petit à petit, Joseph devient transparent au lecteur : il a « fait le nécessaire » pour entretenir ses mains, les pantoufles ont été achetées « au Casino chez la Cécile », il faut se conformer aux usages de « la patronne » qui « préfère que les hommes passent par la petite pièce voûtée ». L’instance narrative est quasi invisible : il s’agit – auteur et lecteur – de faire d’abord table rase de soi pour comprendre le personnage, accompagner ses gestes et pensées ; « on » est au plus près, ce « on » indéterminé qui se fond dans le tableau, s’approprie le point de vue, le système de pensée de Joseph. La focalisation interne telle qu’elle est pratiquée ici, avec des moyens très discrets, impose de fait une empathie que ne permet pas le système narratif de Pays perdu. Dans le récit de Pierre Jourde, au contraire, le narrateur est en position d’observateur extérieur, à distance des personnages qu’il rencontre ou qui lui apparaissent :
Lorsqu’elle était toute petite, l’été, Lucie s’approchait prudemment de notre maison. […] Minuscule et ronde, dans ses vêtements très simples, elle intimidait par sa beauté.
PP, 25
Le père de Marie-Claude est adossé au mur, près de la porte d’entrée, mains derrière le dos. Quelque chose, dans son visage, rappelle le demi-sourire de la morte. Il n’exprime rien. Avec sa casquette, sa veste de grosse toile bleue et ses moustaches, c’est l’effigie du paysan en visite. Le travail de soixante années tombe sur cette silhouette neutralisée et la rive au sol.
PP, 39
Esquissés en quelques traits rapides, les êtres non seulement sont observés du dehors, mais ils restent impénétrables : Lucie « intimide » ; le visage du père « n’exprime rien ». Ici, pas de transparence intérieure : le personnage est objectivé dans une image fixe, voire un cliché : « l’effigie du paysan en visite ». Cela n’exclut pas l’empathie, et on éprouve bien avec le narrateur le sentiment d’écrasement du père dont la silhouette est « rivée au sol » par « le travail de soixante années ». Mais cette impression doit être expressément formulée, explicitée ; elle nécessite un surplomb par rapport au personnage. Très souvent, en effet, les portraits appellent une glose, et servent de tremplin à une méditation sur ce monde exténué, sur l’être et la mort, une méditation où l’auteur emprunte volontiers le ton du moraliste. Au contraire chez Marie-Hélène Lafon, il y a coïncidence entre la conscience narrative et celle du personnage ; jamais une voix ne s’élève au-dessus de la scène pour la commenter, ou en tirer des considérations générales. Elle reste à hauteur de ses créatures.
Présence-distance encore : la configuration narrative découlerait-elle de la topographie mentale, de la situation première qu’occupe chaque auteur par rapport au « pays » ? Marie-Hélène Lafon est depuis toujours et pour toujours au-dedans, comme elle est, presque invisible, dans le tableau qu’elle peint ; elle s’éprouve fermement enracinée :
Quand je commence d’être, je suis plantée au milieu de la vallée, […] et je sais, je sens, ça s’impose, que tout ce vaste corps du pays souple et couturé, avec la rivière, les prés, les bois, et par-dessus le ciel ciré tendu comme un drap changeant, je sens que tout ça était là avant moi, avant nous, et continuera après moi, après nous.
T, 11
Quand cette énumération lyrique chante une plénitude d’origine, l’oeuvre de Jourde ne cesse de clamer son défaut d’origine, formulé explicitement dans La première pierre :
Car dans Pays perdu, comment ne pas entendre la même chose que Défaut d’origine ? […] Et comment parvenir à faire comprendre que le même écrivain qui rédigeait Pays perdu recevait au même moment, des mains de son ami Oliver Rohe, germano-libanais, le manuscrit de Défaut d’origine, pour lequel il lui conseillait quelques menues corrections.
LPP, 90-91
De sorte que même en multipliant les tentatives de s’intégrer – inviter les voisins, accompagner les paysans dans leurs travaux, partager leurs soûleries –, il se sent condamné à rester au dehors, à ne jamais pénétrer le mystère des êtres. Dix ans après Pays perdu, La première pierre est une longue déclaration d’amour au « pays », une main tendue, une continuelle demande de reconnaissance. Or ce défaut d’origine procède et s’augmente de la faille qui a brisé l’histoire du père, longtemps dépossédé de sa propre filiation[19]. D’un côté le manque, la rupture irréparable et la mélancolie ; de l’autre la profusion, la certitude confiante d’une continuité harmonieuse : sur ces bases ne pouvaient s’édifier que deux imaginaires radicalement opposés.
« Déjà le jour faiblit, de grands pans de terre baignent dans l’ombre » (PP, 14) : sous cet éclairage mélancolique, le narrateur aborde le village, après avoir franchi « tant de vide ». Le récit tout entier resserré autour de la veillée mortuaire, est placé sous le signe du deuil : celui de la jeune Lucie que l’on va enterrer, le deuil remémoré du père, et le deuil d’un monde en train de disparaître. S’y ajoute la longue litanie des morts en quoi consiste le récit, si bien que le village semble habité par un peuple de fantômes. Creusant le trait, La première pierre glose ce retour au Pays perdu en descente d’Orphée aux Enfers… Or tel est aussi selon Pierre Jourde l’objectif même de la littérature, « remonter Eurydice des enfers […] sans qu’elle se défasse de ce que les profondeurs lui ont légué d’obscurité » (LPP, 147). De cette obscurité, l’auteur fait la tonalité dominante de Pays perdu, un choix esthétique et moral.
Frappe d’abord la noirceur du tableau, un monde en noir et blanc, en ombre et lumière[20], parfois dramatisé par un rouge violent : celui du vin, du sang – « rouge sur le corps de la bête noire fraîchement abattue ». C’est que l’auteur vise la « beauté sans mièvrerie, la beauté difficile, qui vous rejette et vous agresse » (LPP, 19). Pour Pierre Jourde, en effet, il faut « le noir pour traiter de l’Auvergne[21] », le noir de l’eau-forte, à quoi font penser les caricatures. S’il y a du Vialatte dans le croquis du « vieux petit homme sous un béret […] conservé dans les bocaux de ses grosses lunettes » (PP, 59) d’autres font plutôt songer à Daumier ou aux grotesques de Goya :
Alex était le possesseur d’une dent unique, la dernière, obstinée dans la cave noire de la mâchoire. […] [L]a dent d’Alex, visible en permanence, débordait largement sur la lèvre inférieure. Ce croc entaillait la symétrie du corps.
PP, 48
Car il faut la manière noire de Goya pour représenter les corps
travaillés par le froid, la neige, l’acidité du vent, le poids des bêtes écrasant une main contre le mur, cassant une jambe d’un coup de pied. Corps travaillés par la rudesse des objets de bois et de fer, par les machines froides qui les brisent sans pensée, avec exactitude.
LPP, 124
C’est aussi de l’esthétique baroque – baroque noir plutôt – que relève cette « excessive dépense de formes » : « Ces physionomies comme secouées de désastres telluriques se perforent, s’effondrent, gonflent, se soulèvent dans un silence d’astre mort » (PP, 110). Comme les baroques encore, Pierre Jourde peint plutôt le passage, en un tableau où les « christs agonisent, [l]es vierges pleurent » (PP, 121). Le cortège des morts-vivants[22] exécute une danse macabre et le spectacle de la mort culmine de manière obscène avec la descente du narrateur au tombeau :
Les cercueils que j’ai achevé de défaire par mon intrusion ont lâché une partie de leur contenu, morceaux de planches et d’ossements, au fond de l’eau. Un grand os brun rouge dépasse des ruines de l’un d’entre eux.
PP, 154
Puissants ou difformes, les êtres font songer à des héros ou monstres mythologiques, Zeus, Héphaïstos, les Titans[23] et le récit prend un air de légende dorée ou d’épopée. C’est, comme l’explique Pierre Jourde dans son exégèse de Pays perdu, « parce que la réalité n’est pas réaliste. Ou plutôt parce que le réalisme est impuissant à délivrer toute la charge d’imaginaire qui bonde le réel » (LPP, 135).
Ainsi l’écriture, saturée de références mythologiques, accompagne la catabase de l’auteur - c’est-à-dire à la fois l’exploration de son imaginaire, et la recherche du pays perdu. Or « on n’y parvient qu’en s’égarant », en se perdant soi-même. Traversant une sorte de waste land – des hameaux déserts –, une route labyrinthique mène au village, où tout fait signe vers l’origine, un Ur primitif : le monde encore peuplé d’êtres fabuleux a conservé la fureur du sacré, et on y devine « les restes d’une époque archaïque » (PP, 46). Cette impression de retour à la « matière première de l’univers » s’accentue à mesure que l’on approche la fin du récit – et le « point aveugle du livre » (LPP, 148). Jourde y multiplie les figures d’un « chaos originel », chaos fécond[24] dans lequel on s’enfoncerait avec délectation pour « se consoler de l’ordre grandissant du monde » (PP, 162). L’arrière-fond métaphysique devient alors prééminent, dans une méditation inspirée par le paysage car nous pensons « au moyen de certaines formes déposées en nous » (PP, 148). L’arborescence des hêtres, en particulier, allégorise le devenir spirituel inachevé de l’homme, son aspiration à l’effacement dans le ciel des idées, et son nécessaire enracinement :
Se dégageant si difficilement de la gangue du monde environnant pour devenir eux-mêmes, ils ne cessent de nous renvoyer à lui. […] Ce n’est pas seulement la terre qu’ils retiennent et empêchent de glisser, mais le réel même que leurs racines agrippent pour nous.
PP, 149-150
Les pays : le pluriel du titre montre assez que la perspective change ici du tout au tout ; le « pays » de Marie-Hélène Lafon n’est certainement pas « perdu ». Du reste, on ne s’y perd pas : les routes sont […] nombreuses, les apprivoisées et les autres » (T, 35). Et, des pays, Marie-Hélène Lafon en a au moins deux : le Cantal et Paris ; sans compter les « pays » – au sens de « compatriotes » – qu’elle rencontre dans sa vie seconde[25]. Il y a bien une rupture entre les deux mondes, le premier et le second ; les récits en multiplient les figures[26]. La formule lapidaire qui ouvre Traversée : « au commencement le monde est fendu » est aussitôt développée en ces termes : « Au commencement il y a la fente, la Santoire et sa mouillure vive au fond de la vallée qu’elle a creusée. » Même si on entend bien la connotation sexuelle de l’image, il ne s’agit pas seulement de cela : « La Santoire borne le pré de mes parents, elle borne le monde […]. [À l’école], je comprends que la Santoire coule ailleurs en France, s’en va rouler ses eaux ailleurs dans le monde » (T, 9).
Le monde est divisé, mais il y a un raccord possible : les rivières, les routes, les trains permettent de relier les deux bords, invitent à de multiples traversées ; de même l’écriture s’évertue à raccommoder la faille, à composer avec cette division première[27]. La phrase entrelace les images présentes et passées et Marie-Hélène Lafon ne cesse de tisser des liens entre les vies : la caissière Josette Rablot est fille de paysans, et son mari porte le même prénom, Michel, que le frère de Claire… Le Salon de l’agriculture transpose à Paris l’univers du père, et la télévision suppose le mouvement inverse : « La rivière partait, le ciel partait et le monde venait à nous par la télévision, dans son cadre rectangulaire » (T, 29). Une circulation vivante rend ainsi les mondes poreux l’un à l’autre. Enfin, le pays premier peut surgir à tout instant dans la vie nouvelle, souvent par le biais de la mémoire involontaire. Surtout, Claire le porte définitivement en elle : « dans son sang et sous sa peau, étaient infusées des impressions fortes qui faisaient paysage et composaient le monde, on avait ça en soi » (LP, 84).
Certes, Marie-Hélène Lafon a également le sentiment d’assister à la fin d’un monde, quand elle intitule un récit Les derniers Indiens. Et dans Les pays, le père pour qui « le temps c’est de la mort[28] » en prophétise « l’inévitable agonie » (LP, 20). Cependant, l’oeuvre entière se veut résistance à cette temporalité mélancolique : « Il ne fallait pas aimer la tristesse, on ne pouvait pas vivre comme ça », dit Claire (LP, 115) ; Marie-Hélène Lafon intitule significativement un autre roman L’annonce – l’annonce, comme une promesse de vie à venir. Dans Les pays, contrairement au père, Suzanne « prônait l’adaptation, l’innovation, l’invention » ; et face aux « derniers indiens » (le frère et la soeur sans descendance), la « tribu des voisins proliférait […] ils étaient puissamment vivaces » (DI, 68). L’horizon funèbre n’est donc pas le plus sûr : « Des hommes et des femmes, et quelques enfants, y vivent, y travaillent, ils habitent dans des maisons qui font corps autour d’eux, les routes sont nombreuses et vivaces[29]. » C’est dire que le pays de Marie-Hélène Lafon n’a rien de spectral ni de squelettique : il est charnel, sensuel et la vie y pullule en toutes ses espèces[30]. Même les chiens des voisins : « ça naissait de toutes parts, sans répit, ça grandissait au hasard » (DI, 137).
Marie-Hélène Lafon ne choisit pas non plus l’encre noire de la mélancolie pour peindre le monde premier. Il est au contraire chatoyant, rutilant, « inouï ». Si elle privilégie « le dais vert et bleu des étés », elle aime aussi l’hiver, « strié de brun, tavelé de jaunes éteints. La couleur de l’hiver n’est pas le blanc, pas toujours, pas tout le temps[31]. » C’est que le noir et le blanc sont des couleurs qui tendent vers l’abstraction, et qu’elle veut rester dans la « chair des choses » : car le pays est aussi « à entendre, écouter, deviner, humer, flairer, sentir, goûter, toucher, embrasser, à pleins bras, de toute sa peau » (T, 35). Ce parti pris des choses la protège enfin de tout vertige métaphysique : « il n’y avait pas de paradis », et par conséquent, ni mythologie des origines ni nostalgie d’un hypothétique Éden. Le monde est contenu dans le sensible, avec au-dessus « le ciel ciré tendu comme un drap changeant » (T, 11), ou comme un « dais ».
Cette opposition ne signifie pas que l’univers de Marie-Hélène Lafon ignore la souffrance et le tragique : il est aussi des morts violentes – celles d’Alice (Les derniers Indiens) ou de Roland, retrouvé pendu[32] – et des destins pathétiques (Joseph) dans ses pays. Ni que celui de Pierre Jourde ignore l’humour : il n’est pas pour rien l’auteur de L’opérette métaphysique d’Alexandre Vialatte[33], lui-même amoureux de L’Auvergne absolue[34]. L’un et l’autre fondent bien leur écriture sur un attachement profond au Cantal, mais pour des raisons et dans des perspectives très différentes, expliquant en partie les réceptions différentes qu’ils rencontrent : l’un présente un avenir singulièrement plus sombre que l’autre ! La peinture de Pierre Jourde, dramatisée par un combat de l’ombre et de la lumière, se situe dans la lignée d’écritures métaphysiques comme celle de Victor Hugo, ou plus proche de Richard Millet[35] ; il met en scène le grand opéra de l’humanité. Marie-Hélène Lafon, au contraire, n’est pas portée vers la dramatisation du « vieux pays plissé, raboté, […] élimé » (LP, 27) qu’elle restitue dans sa simple concrétude, avec des signes en direction de Flaubert[36]. Surtout, elle oppose aux sentiments négatifs, en particulier à la nostalgie, une « féconde incomplétude » (LP, 86). Le manque se convertit alors en écriture tonique[37] ; peut-être, comme elle le prétend, parce que « les volcans antédiluviens assoupis sous leur croûte épaisse et ronde font à qui veut, par sourde et sûre transfusion, ce don de l’élan organique, du feu vital » (LP, 156).
Appendices
Note biographique
Sylviane Coyault est professeure émérite à l’Université Clemont-Auverge et présidente de l’association Littérature Au Centre. Elle est l’auteure de La province en héritage. Pierre Michon, Pierre Bergounioux, Richard Millet (Genève, Droz, coll. « Histoire des Idées et Critique Littéraire », 2002) ainsi que de nombreux articles consacrés à divers auteurs contemporains (Marie-Hélène Lafon, Pierre Michon, Pierre Bergounioux, Marie NDiaye, Jean Echenoz, Maylis de Kerangal, entre autres) ainsi qu’à l’oeuvre narrative de Jean Giraudoux.
Notes
-
[1]
Pierre Jourde, Pays perdu, Paris, L’esprit des péninsules, 2003. Désormais abrégé en PP, suivi du numéro de la page ; Marie-Hélène Lafon, Les pays, Paris, Buchet-Chastel, 2012. Désormais abrégé en LP, suivi du numéro de la page.
-
[2]
Luc Baptiste, Le village et enfin, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Bleu autour, 1997.
-
[3]
Je tiens ces propos de l’auteure elle-même.
-
[4]
Pierre Jourde, La première pierre, Paris, Gallimard, 2013. Désormais abrégé en LPP, suivi du numéro de la page.
-
[5]
Lussaud est un hameau de la Haute-Auvergne, commune de Laurie (Cantal). Il est également évoqué dans les récits de Bernard Jannin : Le pays éperdu, Clermont-Ferrand, Page centrale, 2012 (qui fait écho à Pays perdu) et Rocheplanne après la pluie, Clermont-Ferrand, Page centrale, 2015.
-
[6]
Marie-Hélène Lafon, Traversée, Grane, Creaphiseditions, 2013, p. 33. Désormais abrégé en T, suivi du numéro de la page.
-
[7]
Voir Pays perdu, p. 132 : « Certains, j’en suis, ont abandonné des lambeaux de leur mémoire dans les débandades mentales qui ont suivi. Tenter de tenir fait partie du jeu. On sort des maisons ivre de convivialité, les artères chargées d’une humanité resserrée autour de la chaleur de la cuisinière et de l’alcool… »
-
[8]
Pourtant cantaliens, ses parents, installés dans cette ferme-là au début des années 1960, ont toujours été plus ou moins considérés comme « étrangers » ; ils ne diffèrent cependant pas fondamentalement par leur condition sociale. La situation de Marie-Hélène Lafon peut aussi rappeler celle de Raymond Depardon, qui a également passé son enfance dans la ferme parentale et dont les documentaires sur le monde paysan ont influencé l’écriture de L’annonce (Paris, Buchet-Chastel, 2009).
-
[9]
Marie-Hélène Lafon, Chantiers, Paris, Éditions des Busclats, 2015, p. 108.
-
[10]
Marie-Hélène Lafon est professeure de lettres classiques à Paris. Les deux écrivains enseignent la littérature.
-
[11]
Anne Ernaux parle de trahison à propos de sa propre expérience.
-
[12]
Figure de nombreux autres départs : celui de Suzanne, ou prélude à ceux de Claire.
-
[13]
Pierre Jourde affiche aussi sa combativité de diverses manières, surtout dans ses pamphlets sur la scène intellectuelle : La littérature sans estomac (Paris, Pocket, 2002), Petit déjeuner chez Tyrannie, (Lyon, La fosse aux ours, 2003), Le Jourde & Naulleau (Carcassonne, Mots et Cie, 2004) et, récemment, La littérature est un sport de combat (Clermont-Ferrand, Page centrale, 2015) où Naulleau définit l’auteur comme un « ferrailleur sachant ferrailler, à la réputation de “cogneur” pourtant spécialiste des préciosités huysmansiennes » (p. 9).
-
[14]
Voir l’hostilité entre les deux familles qui obsède la soeur dans Les derniers Indiens, Paris, Buchet-Chastel, 2008. Désormais abrégé en DI, suivi du numéro de la page.
-
[15]
L’auteur écrit plus loin : « […] ce point aveugle du livre […] celui qui en constituait le noyau était celui de ton père » (La première pierre, p. 148).
-
[16]
Voir aussi l’itinéraire de Rémi dans Sur la photo, Paris, Buchet-Chastel, 2003.
-
[17]
Elle exprime à la fin de Traversée une réticence à l’égard de la fiction, roman ou nouvelle – et une tentation du poème qui se réalise déjà dans le recueil de poèmes en prose qu’est Album (Paris, Buchet-Chastel, 2012) : « Si j’osais, si j’osais vraiment, si j’avais moins de peur et davantage de force, on ne passerait pas par les histoires, le roman, la nouvelle, on n’aurait pas besoin de ces détours et méandres charnus, on ne raconterait rien et le blanc monterait sur la page jusqu’à la noyer de silence. On ferait ça, on serait à l’os de l’étymologie, dans le poème des choses nues et révélées, le vent, les arbres, le ciel, les nuages, la rivière, les odeurs, le feu. La nuit. Les saisons » (Traversée, p. 35).
-
[18]
Marie-Hélène Lafon, Joseph, Paris, Buchet-Chastel, 2014, p. 9-10
-
[19]
Fils adultérin, le père avait été présenté au village comme le chauffeur de sa propre mère.
-
[20]
Voir la belle « note de lecture » de Christine Jérusalem dans Europe, no 897-898, février 2004, p. 326.
-
[21]
Il s’agit du noir de la linogravure, celle de Pio Kalinski illustrant le Voyage en Auvergne de Pierre Jourde, paru en 2012, aux éditions Page centrale, à Clermont-Ferrand.
-
[22]
Voir ce portrait : « Le sourire de M. Soubeyran faisait paraître une tête de mort à la place de son visage. Un squelette déguisé en homme » (Pays perdu, p. 78).
-
[23]
« C’était comme le reste incongru d’une époque archaïque, une trace d’ancêtres fabuleux nantis d’un seul oeil, d’une oreille, d’un bras, sautillant sur leur jambe unique » (Les pays, p. 46).
-
[24]
C’est tantôt la « rumeur de séisme » que fait le troupeau sortant de l’étable (Les pays, p. 89), l’alcool qui « travaille au lent retour vers la confusion des formes », le fumier et la bouse de vache « matière première de l’univers encore tiède au lendemain de la création » (p. 134) ou la « réserve de chaos » entassée dans la maison de Joseph (p. 162).
-
[25]
« Claire avait un pays ; elle avait adopté à son endroit ce singulier usage du mot pays qu’il avait employé la première fois pour lui parler » (Les pays, p. 78).
-
[26]
Voir mon article « Marie-Hélène Lafon à la croisée des temps et des mondes », Siècle 21, no 26, printemps-été 2015, p. 147-154.
-
[27]
« Le double jeu de l’écriture désigne autant qu’il recouvre [la division]. Usant de l’asyndète et de la parataxe, la prose n’est cependant en rien fragmentaire, ni haillonneuse. Pas de blancs, sinon pour marquer le clivage entre […] deux récits alternés, mais d’amples “coulées”. […] Pas de “coutures, d’ourlets ni rentraitures” (Quignard) : un art consommé du passage » (ibid., p. 150).
-
[28]
Chantiers, p. 41.
-
[29]
Traversée, p. 35.
-
[30]
Dans le grenier, « habité de bêtes furtives, souris, araignées », « les chattes font parfois leurs portées dans le coin des outils » (Sur la photo, p. 15-16).
-
[31]
Album, p. 51.
-
[32]
« Hier Roland s’est suicidé. Dans l’atelier. Avec ses bottes » (Histoires, Paris, Buchet-Chastel, 2015, p. 109).
-
[33]
Pierre Jourde, L’opérette métaphysique d’Alexandre Vialatte, Paris, Honoré Champion, coll. « Travaux et recherches des universités rhénanes », no 11, 1996.
-
[34]
Alexandre Vialatte, L’Auvergne absolue, Paris, Julliard, 1983.
-
[35]
Par exemple, La gloire des Pythre, Les trois soeurs Piale, Lauve le pur, Ma vie parmi les ombres, etc.
-
[36]
Le récent Joseph fait songer à la Félicité de Flaubert (Un coeur simple). Et Marie-Hélène Lafon consacre de belles pages à Flaubert dans Chantiers, p. 89 et suivantes : « Flaubert for ever ».
-
[37]
Voir Jean Kaempfer (dir.), Tensions toniques. Les récits de Marie-Hélène Lafon, Lausanne, Archipel, coll. « Essais », no 16, 2012.