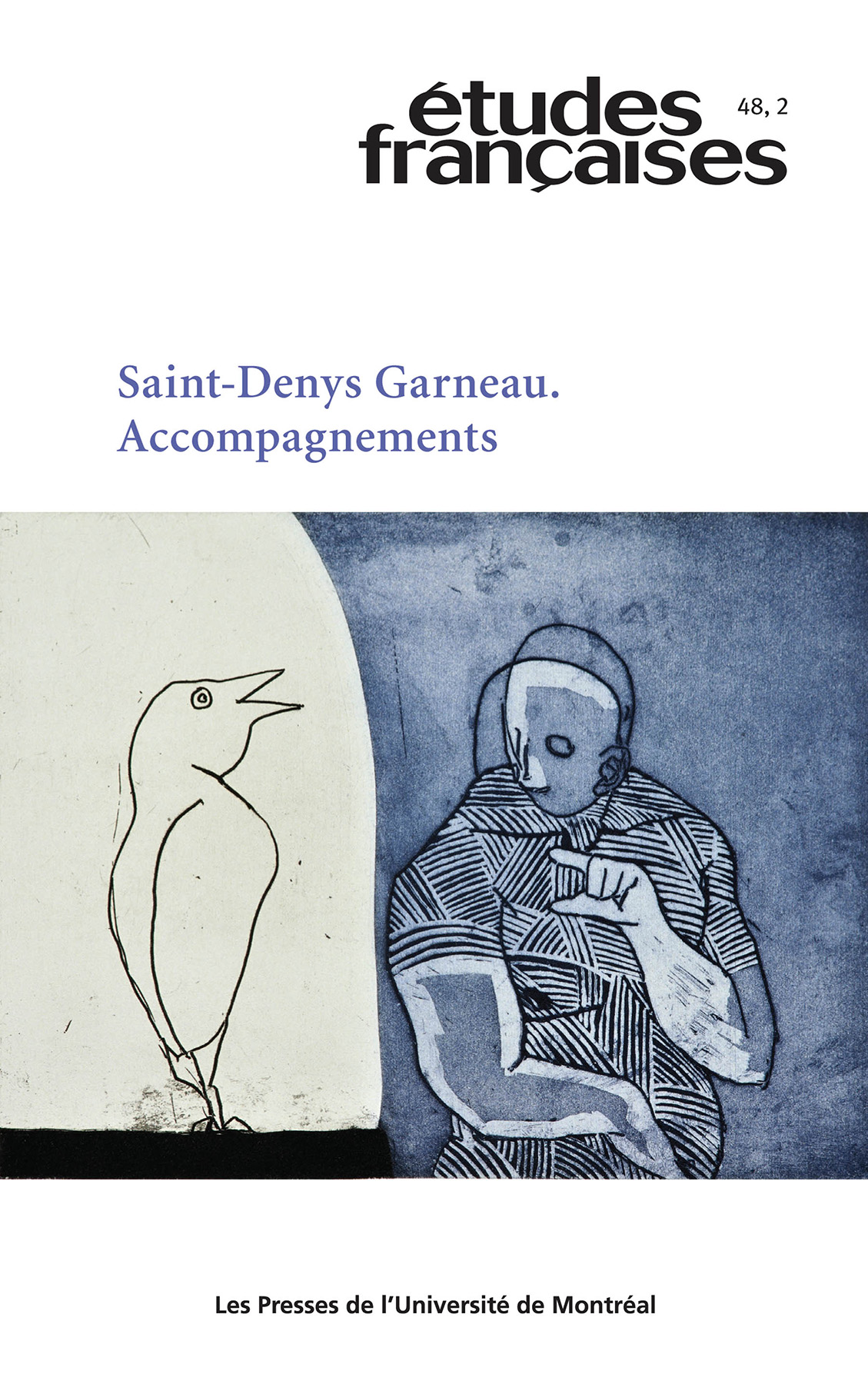Abstracts
Résumé
Bien que les poèmes de Saint-Denys Garneau aient attiré l’attention d’un bon nombre de traducteurs et de traductrices anglophones, les deux qui ont le mieux réussi sont F. R. Scott et John Glassco, deux poètes associés au groupe de McGill, lequel était actif à l’époque de Saint-Denys Garneau. Leur rapport avec le poète québécois sera abordé en deux volets. Dans un premier temps, je décris les contextes historiques reliés à l’émergence de la poésie de Saint-Denys Garneau. S’il a fallu plusieurs années pour que sa poésie soit dûment reconnue par les lecteurs francophones, son accueil par le milieu littéraire anglophone fut encore plus lent, et il est même frappant que ce dernier n’ait jamais accordé au poète le statut qui lui revient. En dépit du fait qu’une traduction complète de ses poésies par John Glassco soit disponible, son absence dans le monde littéraire anglophone serait due à la fois à ses traductions et à l’incapacité des lecteurs anglophones à comprendre sa poésie. Il y aurait une différence d’imaginaire entre les lecteurs canadiens et québécois. Pour éclaircir cette différence, je me sers, dans le second volet de la réflexion, de la distinction qu’établit Pascal entre l’esprit de géométrie et l’esprit de finesse, dont le premier caractériserait le lecteur canadien et le second, le lecteur québécois. Même si, en somme, Saint-Denys Garneau avait la bonne fortune de trouver une traduction vraiment réussie, ce qu’il n’a pas pour le moment, une telle traduction ne trouverait que peu de lecteurs.
Abstract
While many anglophone translators have shown interest in Saint-Denys Garneau’s poems over the years, the most successful were F. R. Scott and John Glassco, two members of the McGill group, a dynamic cluster of poets at the time when Garneau was writing. This article considers, from two different perspectives, the translators’ conceptions of the Québécois poet. First, it describes the historical contexts related to Saint-Denys Garneau’s emerging poetry. Although it took several years for his poetry to be duly recognized by francophone readers, his reception in the English-speaking literary milieu was even slower. In fact, the latter has never given the poet the status he deserves. Despite the fact that John Glassco’s complete translation of Garneau’s poems is available, his absence in the anglophone literary world may be due to the translations of his work as well as anglophone readers’ inability to understand his poetry. Such an assumption posits a difference between the imaginary realm of the Canadian reader versus that of the Québécois reader. To clarify this difference, I appeal, in the second part of this article, to Pascal’s distinction between the spirit of geometry and the spirit of finesse to characterize, respectively, the Canadian and the Québécois reader. But ultimately, even if a successful translation of Garneau’s work were to be published, which is not yet the case, it would reach only a small readership.
Article body
Dans la vie du couple texte/traduction, il y a deux moments ontogéniques de première valeur : le moment où l’auteur fait un appel à ses compatriotes, et le moment où le traducteur lui fait écho dans une langue qui lui était inconnue. C’est un processus complexe qui commence par un dialogue serré entre les deux textes, chorégraphié par le traducteur ou la traductrice, qui s’imagine que ses gestes sont autonomes, que la recherche du sens et des équivalents se rattache directement à sa seule évaluation. On aimerait que ce soit aussi simple ! Car aussitôt qu’on commence à examiner ce dialogue qu’on imagine se déroulant au-dessus de l’histoire, il faut constater que le rôle du traducteur ou de la traductrice n’est qu’un parmi plusieurs autres. Le cas de la poésie de Saint-Denys Garneau nous en apprend beaucoup à cet égard.
Mon texte se limite à ces deux volets du problème. Dans un premier temps, j’examine les contextes historiques de l’émergence de la poésie de Saint-Denys Garneau. Comme on le sait, les lecteurs francophones ont mis plusieurs années à reconnaître la grandeur de sa poésie, et sa lecture au Canada anglophone ne correspond aucunement à son envergure au Québec depuis les années 1980. Il va sans dire que la lecture des poètes francophones du Québec en anglais est rare, sauf peut-être celle d’Anne Hébert, dont les romans ont fait la réputation. Comme je vais le suggérer, il y a, cependant, d’autres raisons qui expliquent la difficulté que Saint-Denys Garneau pose pour ses lecteurs anglophones. La cause de cette difficulté, selon moi, ne réside pas dans la qualité des traductions, au contraire, mais plutôt dans l’imaginaire, si j’ose dire, de ses lecteurs anglophones. Dans un deuxième temps, j’examine les stratégies de traduction. Dans ma conclusion, je considère l’imaginaire anglophone, qui touche à une autre dimension des contextes historiques de cette poésie.
En dépit du fait que les poèmes de Saint-Denys Garneau se nourrissent du contexte de la revue La Relève — revue à laquelle ont collaboré les meilleurs jeunes intellectuels de l’époque et plusieurs écrivains français prestigieux —, la parution de Regards et jeux dans l’espace (à compte d’auteur) n’augurait pas un avenir insigne. Le poète a même essayé d’empêcher la vente de son livre, sans explication convaincante ; et il était resté presque inconnu jusqu’à l’édition de ses Poésies complètes, six ans après sa mort en 1949. La douleur que lui causa la parution de son recueil est bien connue, et ce n’est pas difficile de compatir à l’angoisse du jeune poète en train de surveiller « les journaux avec anxiété[2] ». Ce qui est plus curieux, c’est qu’il commence à remettre en question l’authenticité de son livre : « ça n’est pas de la poésie. Ou bien il a l’apparence d’exister, d’avoir une réalité poétique et humaine, et alors il procède de la même illusion, du même mensonge qui font que j’ai paru exister, aimer, etc. Il donne le change sur le néant[3]. » Ce contexte existentiel et premier du livre est suivi d’un autre aussi néfaste, notamment l’incompréhension de la critique extérieure au cercle de La Relève, qui empêchait son accueil par le système littéraire du Québec. Si le poète cherchait un public, ses efforts seraient vains aussi longtemps que régnerait une critique du type de celle de Camille Roy[4]. En d’autres mots, le monde littéraire ne parlait pas le langage de Saint-Denys Garneau.
Je formule le problème du poète ainsi parce qu’un poète n’est pas lui-même un discours : il est une parole, et tout d’abord dans sa propre langue. Mais si cette parole n’était pas encore reconnue au Québec même, le moment d’une reconnaissance double, dans sa langue et celle de futurs lecteurs anglophones, n’était pas propice. Pas loin de lui et des collaborateurs de La Relève, se trouvait un autre groupe d’écrivains, le groupe de McGill, qui se composait, comme les anciens élèves du Collège Sainte-Marie, des poètes et des intellectuels les plus prometteurs de la nouvelle génération. Ces poètes, en dépit de leur connaissance du français, n’étaient pas pour autant prêts pour Saint-Denys Garneau, surtout à cause de leur propre contexte discursif. Tout à fait enracinés dans le projet national anglo-canadien, ils étaient en train de suivre le trajet dominant de leur propre poésie, c’est-à-dire le désir adamique de saisir le territoire du Canada.
Quant à son contexte québécois, le poète écrit, selon Michel Biron, « en marge d’une tradition incertaine[5] », position qui le distingue nettement des poètes du groupe de McGill qui ont vite absorbé les leçons de la modernité littéraire. Heureusement pour eux, ils ont créé un public, surtout parmi les universitaires, sans avoir à lutter contre des idéologies puissantes. Ils n’ont pourtant pas mis de côté, comme Saint-Denys Garneau, la querelle entre régionalistes et exotiques, qui existe aussi dans la poésie anglophone. Ils ont reconnu, au contraire, que c’est justement cette querelle qui entraîne la tradition, et que, pour la maîtriser, il faut l’engager. Leur porte-parole le plus éloquent, A. J. M. Smith, confrontait les deux inlassablement, surtout dans l’introduction à sa célèbre anthologie, The Book of Canadian Poetry, qui a paru l’année de la mort de Saint-Denys Garneau. Loué par Northrop Frye, le point de vue de cette introduction est vite devenu la doxa de la critique anglophone, c’est-à-dire son horizon discursif[6]. C’était néanmoins un plaidoyer rusé, car tout en refoulant le régionalisme en faveur de la modernité anglaise et américaine, Smith change les conditions de leur rapport afin de permettre l’émergence d’un nationalisme renouvelé par les méthodes modernistes[7]. Ces poètes s’inséraient donc dans la tradition à un niveau plus politique, qui cherchait à faire coïncider l’autonomie du poème, notion chère à la nouvelle critique, avec l’autonomie du pays. Pour le système littéraire anglophone, c’était un coup double, dont l’effet perdure, et qui explique le silence qui entoure Saint-Denys Garneau parmi ses lecteurs anglophones potentiels, étrangers au personnalisme néo-thomiste des collaborateurs de La Relève.
Malgré le faible accueil accordé à sa poésie, Saint-Denys Garneau continue à être un des poètes les plus fréquemment traduits[8]. À partir des années 1950, soit juste après l’édition des Poésies complètes en 1949, un petit nombre de poèmes ont été traduits par une poignée de traducteurs, avec des résultats, il faut l’admettre, peu concluants. Comme l’a remarqué Thomas D. Ryan, ces traductions sont trop souvent l’oeuvre d’amateurs[9] qui privilégient surtout la traduction littérale. Dans les limites de cet article, les deux traducteurs que je retiens sont F. R. Scott et John Glassco, deux poètes associés au groupe de McGill, le plus jeune des deux, Glassco, étant sous la tutelle, dans une certaine mesure, de Scott. Les traductions de Scott ont paru dans un petit livre qui contient neuf textes de Saint-Denys Garneau et neuf de sa cousine Anne Hébert. La note qui préface le texte est courte et claire, et la phrase la plus significative se lit ainsi : « My principal aim in translating is to alter the poem as little as possible, and to let it speak for itself in the other tongue. » Il ajoute : « This means a preference for literalness… for one poem in two languages. » Cette décision est raisonnable, dit-il, car chaque poète préfère, d’une façon générale, « the rhythm of ordinary speech[10] ».
Cette note, cependant, ne révèle pas beaucoup de choses, surtout en ce qui concerne les motifs de son choix, sauf pour dire que ces deux poètes sont « representative of the best work of the two French-Canadian poets I most admire[11] », parmi tous ceux, nombreux, qu’il connaît. Dans un texte qui a paru quelques années plus tard (1965), il déclare que les années les plus déterminantes de sa carrière furent celles de la décennie 1930, époque bien connue pour « the emergence of revolutionary and reform political movements », auxquels il a réagi d’une façon négative et par conséquent, « turned easily to satire[12] ». Il s’emploie, en effet, à distinguer la poésie révolutionnaire de la satire ; l’attrait de la poésie francophone est la manière dont elle expose « the hollowness, hypocrisy, and immobility of French-Canadian society[13] » sous Duplessis. Bien que Saint-Denys Garneau ne fût pas un poète satirique, Scott le reconnaît comme l’un des poètes ayant inauguré la poésie moderne du xxe siècle au Québec[14].
L’aspect le plus frappant de ce texte est sa critique du mouvement naissant du séparatisme, dont il a considéré le caractère révolutionnaire d’une façon ironique. De plus, quand on se rappelle que Scott, quelques années plus tard, avait appuyé la mise en place de la Loi sur les mesures de guerre, n’est-il pas possible de relire sa préférence à « one poem in two languages » ? Qu’il est loin de la notion de non-traduction, si superbement élaborée par Jacques Brault[15] ! Suivant l’optique de Sherry Simon, pourtant : « Qui dit littéralisme dit désir de résister aux interprétations ou aux associations extérieures. » Et pire : « Le littéralisme manifeste un refus poli de prendre contrôle de l’autre texte, de le soumettre à un travail de projection, d’assimilation ou d’appropriation[16]. » Ensuite, elle invoque Gilles Marcotte qui note « l’ignorance totale de la tradition poétique française chez Scott[17] ». La distance que crée l’ignorance mène à cette conclusion : « Le littéralisme, le refus de prendre possession du poème, de le faire sien, est selon Marcotte le résultat d’une autre distance, cette fois-ci la distance entre les traditions poétiques. En intervenant le moins possible, Scott marque la distance infranchissable qui sépare les individus, les sensibilités, les traditions poétiques et les contextes socio-politiques de l’époque[18]. »
Comme Scott l’a fait remarquer d’une façon sommaire, « not till Saint-Denys Garneau can it be said that Quebec poets entered the twentieth century—and there is a touch of the fin de siècle about Garneau[19] ». La fin du siècle est exactement le moment aussi psychologique qu’ontogénétique où John Glassco entre dans l’histoire de ces traductions. Bien que Scott ait trouvé un certain aspect du modernisme laconique qu’il cherchait dans les poèmes de Saint-Denys Garneau, Glassco, en revanche, y a trouvé la décadence[20]. Néanmoins, il invoque et annonce le futur[21] en ce que, paraît-il, il n’a rien à faire avec la tradition de la poésie canadienne-française. Il est même possible de supposer que Saint-Denys Garneau n’était pas tout à fait canadien-français ou québécois, deux conditions, pour ainsi dire, que Glassco paraît mépriser ; il préfère présenter les poètes, tels Nelligan et Grandbois, « not as poets of Quebec but of the world[22] », et ce, malgré sa connaissance profonde du jansénisme du Journal. Un tel aveu révèle un changement de contexte significatif. Ainsi, Glassco esquive tout rapport politique entre les deux cultures — question discutée avec une délicatesse admirable par Jacques Brault — et la même manoeuvre lui permet d’éviter tous les pièges du poète québécois : « his anguish was not localized in any sense of a vulgar, emotional dépaysement, as in a Hertel or Miron, but in that of the universal human being[23] ».
Bien entendu, l’être humain universel n’existe pas, mais c’est un idéal recherché et désiré notamment par A. J. M. Smith, qui essayait de surmonter le régional par l’universel[24]. Autrement dit, Glassco était en train de présenter Saint-Denys Garneau d’une façon appropriée à un public anglophone transnational. Donc, traduire est transférer. Il affirme, en outre, que « [t]hese renderings are faithful but not literal[25] », fidélité qui essaie avant tout de reproduire « his verbal patterns, and particularly his rhythms[26] ». Dans le processus, il admet qu’il a suivi « a course that was bound to result in the intrusion of my own personality[27] ». Le résultat est un Saint-Denys Garneau qui convient aux désirs poétiques du groupe de McGill ou du moins aux normes de la critique anglo-américaine d’alors, mais c’est un poète qui est devenu encore plus dépaysé et toujours occulté dans sa traduction en anglais.
Avant de conclure, je voudrais, à titre d’exemple, examiner brièvement le poème « Cage d’oiseau », afin de montrer les différences de méthode des deux traducteurs :
Je suis une cage d’oiseau
Une cage d’os
Avec un oiseau
L’oiseau dans sa cage d’os
C’est la mort qui fait son nid
Lorsque rien n’arrive
On entend froisser ses ailes
Et quand on a ri beaucoup
Si l’on cesse tout à coup
On l’entend qui roucoule
Au fond
Comme un grelot
C’est un oiseau tenu captif
La mort dans ma cage d’os
Voudrait-il pas s’envoler
Est-ce vous qui le retiendrez
Est-ce moi
Qu’est-ce que c’est
Il ne pourra s’en aller
Qu’après avoir tout mangé
Mon coeur
La source du sang
Avec la vie dedans
Il aura mon âme au bec.
Comme nous le rappelle Pierre Nepveu, « le signe le plus sûr de sa grandeur » est « [l]a résistance de la poésie de Garneau à la mélodie accrocheuse[28] ». On trouve, pourtant, un certain penchant pour la rime, qui pose toujours des problèmes surtout pour un traducteur anglophone. On l’observe avant tout dans les strophes 4, 6 et 7. La préférence de Scott le mène à esquiver la rime et, par conséquent, « beaucoup, coup, roucoule » deviennent « lot, stops, cooing », et plus loin, dans la strophe pénultième, « aller, mangé » et « sang, dedans » deviennent respectivement « away, all » et « blood, inside ».
En revanche, Glassco[29] profite bien de ces occasions et voici, par exemple, la quatrième strophe :
And after laughing heartily
If you break off suddenly
You hear a cooing sound
Deep down
Il faut dire, bien entendu, que ces rimes, surtout celle en « ly », sont assez faciles. Elles n’ont pas la désinvolture de celles du texte de départ, et l’effet de « Deep down », avec son allitération, est assez déclamatoire. La traduction de la sixième strophe montre les mêmes écarts entre les deux traducteurs. Les mots rimés sont négligés par Scott, mais à la rime Glassco ajoute une question et une hypothèse :
If he’d like to fly away
Is it you who’ll make him stay
Is it I
Who can say ?
En anglais, la rime paraît un peu forcée, et l’ajout du point d’interrogation arrête surtout le ton rêveur qui conclut la strophe. S’il faut ajouter quelque chose, les points de suspension traduisent mieux ce moment du poème. Si on combine ces exemples avec d’autres chez Glassco, il est évident qu’il préfère l’artificiel au littéral de Scott, et parfois il surtraduit le texte. La comparaison qui se trouve à la fin de la quatrième strophe — « Comme un grelot » — est faussement chargée d’un sens trop lourd, notamment, « like a little funeral bell ». La traduction de Scott est plus exacte : « like a small bell », ainsi que sa traduction du dernier vers, « He will have my soul in his beak », qui, chez Glassco, est rendu par « And carry my soul off in his beak », dont le rythme, ̆ ʹ ̆ ̆ ʹ ׳ ̆ ̆ ʹ, c’est-à-dire, un iambe, deux anapestes et une syllabe forte qui sépare les anapestes tendent à diminuer le ton pensif et méditatif du poème. Il n’est pas difficile de conclure, donc, que, pour ces deux poètes anglophones, Saint-Denys Garneau reste, pour des raisons opposées, insaisissable, ce qu’illustre bien la première strophe que traduit ainsi Scott :
I am a bird cage
A cage of bone
With a bird
et que Glassco modifie de cette façon :
I am the cage of a bird (deux anapestes)
A cage of bone
Holding a bird (un anapeste)
La version du premier souffre de son manque de poésie, ses vers sont même plus plats que ceux de Saint-Denys Garneau, et le second essaie de trouver un rythme allègre quelque peu incongru pour suggérer que c’est de la poésie. Mais est-il possible de traduire un poète qui flotte à mi-chemin entre la poésie et la prose ?
Même si le système littéraire anglophone n’a pas su répondre à la poésie de Saint-Denys Garneau, on connaît un petit nombre de traductions réussies entre les deux langues, surtout s’il s’agit de collaborations entre ami(e)s-poètes. Néanmoins, il est possible de constater qu’en somme les pratiques discursives qui distinguent les deux systèmes au Canada se déroulent sur des registres qui se rencontrent rarement. Comme l’a dit W. H. New, le meilleur des historiens anglophones de la littérature au sujet du groupe de McGill et de ses contemporains francophones : « Anglophone poets tended to look outward at the political world, francophone poetry inward toward the personal one[30]. » Les grands poètes anglophones actuels, tels Al Purdy, Robert Kroetsch et Margaret Atwood, prolongent un aspect du groupe de McGill et considèrent la poésie comme l’acte de faire une carte du pays à travers la langue, projet adamique, pour ainsi dire. Bien que plusieurs grands poètes francophones modernes, tels Roland Giguère et Gaston Miron, soient des poètes du pays ou dans la mouvance de ceux-ci, leur manière les distingue profondément des poètes anglophones. Les premiers préfèrent les implications de l’esprit de géométrie, tandis que les seconds cherchent plutôt l’esprit de finesse. Dans ces circonstances, la traduction n’est possible qu’à certaines conditions, dont la meilleure est fournie par un dialogue soutenu au point où les mots commencent à s’entrelacer jusqu’à ce qu’on ne sache plus qui parle, sinon une troisième voix inventée par un échange continu.
Appendices
Note biographique
E. D. Blodgett est membre de la Société royale du Canada, professeur émérite et titulaire du professorat Louis Desrochers en études canadiennes à l’Université de l’Alberta. Deux fois récipiendaire du prix du Gouverneur général (poésie et traduction), il est l’auteur de 25 recueils de poésie. Ses publications incluent une traduction en anglais du roman provençal Flamenca (New York, Garland, coll. « Garland library of medieval literature », 1995) ; Five-Part Invention. A History of Literary History in Canada (Toronto, University of Toronto Press, 2003 [Invention à cinq voix. Une histoire de l’histoire littéraire au Canada, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Perspectives de l’Ouest », 2012] ; Phrases (Montréal, Éditions du Noroît, 2012).
Notes
-
[1]
Je voudrais exprimer ma vive reconnaissance à mes amis Patricia Godbout et François Dumont qui ont lu, revu et commenté ce texte.
-
[2]
Saint-Denys Garneau, Journal, préface de Gilles Marcotte, avertissement de Robert Élie et Jean Le Moyne, Montréal, Beauchemin, 1963, p. 122.
-
[3]
Ibid., p. 124.
-
[4]
Voir Jane Everett, « Regards et jeux dans l’espace et la critique cléricale », dans Benoît Melançon et Pierre Popovic (dir.), Saint-Denys Garneau et La Relève, Actes du colloque tenu à Montréal le 12 novembre 1993, Montréal, Fides, coll. « Nouvelles études québécoises », 1995, p. 83-84.
-
[5]
Michel Biron, L’absence du maître. Saint-Denys Garneau, Ferron, Ducharme, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Socius », 2000, p. 22.
-
[6]
Voir E. D. Blodgett, Five-Part Invention : A History of Literary History in Canada, Toronto, University of Toronto Press, 2003, p. 81-85.
-
[7]
Voir Desmond Pacey, « The Writer and his Public (1920-1960) », dans Carl F. Klinck (dir.), Literary History of Canada. Canadian Literature in English, 2e éd., Vol. II, Toronto, University of Toronto Press, 1976, p. 7-8.
-
[8]
Voir Thomas D. Ryan, « The Textual Presence of the Translator : A Comparative Analysis of F. R. Scott’s and John Glassco’s Translations of Saint-Denys Garneau », mémoire de maîtrise, Montréal, Université Concordia, Faculté des arts et des sciences, Département d’études françaises, 2003, p. 16.
-
[9]
Ibid.
-
[10]
F. R. Scott, Saint-Denys Garneau & Anne Hébert, Vancouver, Klanak Press, 1962, p. 9.
-
[11]
Ibid.
-
[12]
F. R. Scott, « The Poet in Quebec Today », repris dans Louis Dudek et Michael Gnarowski (dir.), The Making of Modern Poetry in Canada, Toronto, Ryerson Press, 1967, p. 266.
-
[13]
Ibid.
-
[14]
Il faut dire que l’histoire que Scott fait de la poésie canadienne-française laisse un peu à désirer : elle saute sans la moindre gêne de Bibaud, qu’il admire, à Saint-Denys Garneau (ibid.).
-
[15]
Voir Jacques Brault, Poèmes des quatre côtés, Montréal, Éditions du Noroît, 1975, p. 14-16.
-
[16]
Sherry Simon, Traverser Montréal. Une histoire culturelle par la traduction, Montréal, Fides, coll. « Nouvelles études québécoises », 2008, p. 82.
-
[17]
Ibid.
-
[18]
Ibid., p. 84-85.
-
[19]
F. R. Scott, « The Poet in Quebec Today », p. 266.
-
[20]
Voir Thomas D. Ryan, op. cit., p. 62-66.
-
[21]
Saint-Denys Garneau, Complete Poems of Saint-Denys Garneau, translated with an introduction by John Glassco, Ottawa, Oberon Press, 1975, p. 5.
-
[22]
Ibid., p. 7.
-
[23]
Ibid., p. 9.
-
[24]
Voir A. J. M. Smith, The Book of Canadian Poetry, Chicago, University of Chicago Press, 1943, p. 5.
-
[25]
Ibid., p. 17.
-
[26]
Ibid.
-
[27]
Ibid.
-
[28]
Pierre Nepveu, L’écologie du réel. Mort et naissance de la littérature québécoise contemporaine, Montréal, Boréal, 1988, p. 28.
-
[29]
Sur cet aspect de la traduction de Glassco, voir l’article magistral de Patricia Godbout, « L’expérience de l’origine. John Glassco, traducteur de Saint-Denys Garneau », Recherches sémiotiques, à paraître.
-
[30]
W. H. New, A History of Canadian Literature, Londres, Macmillan Education, 1989 [1988], p. 185.