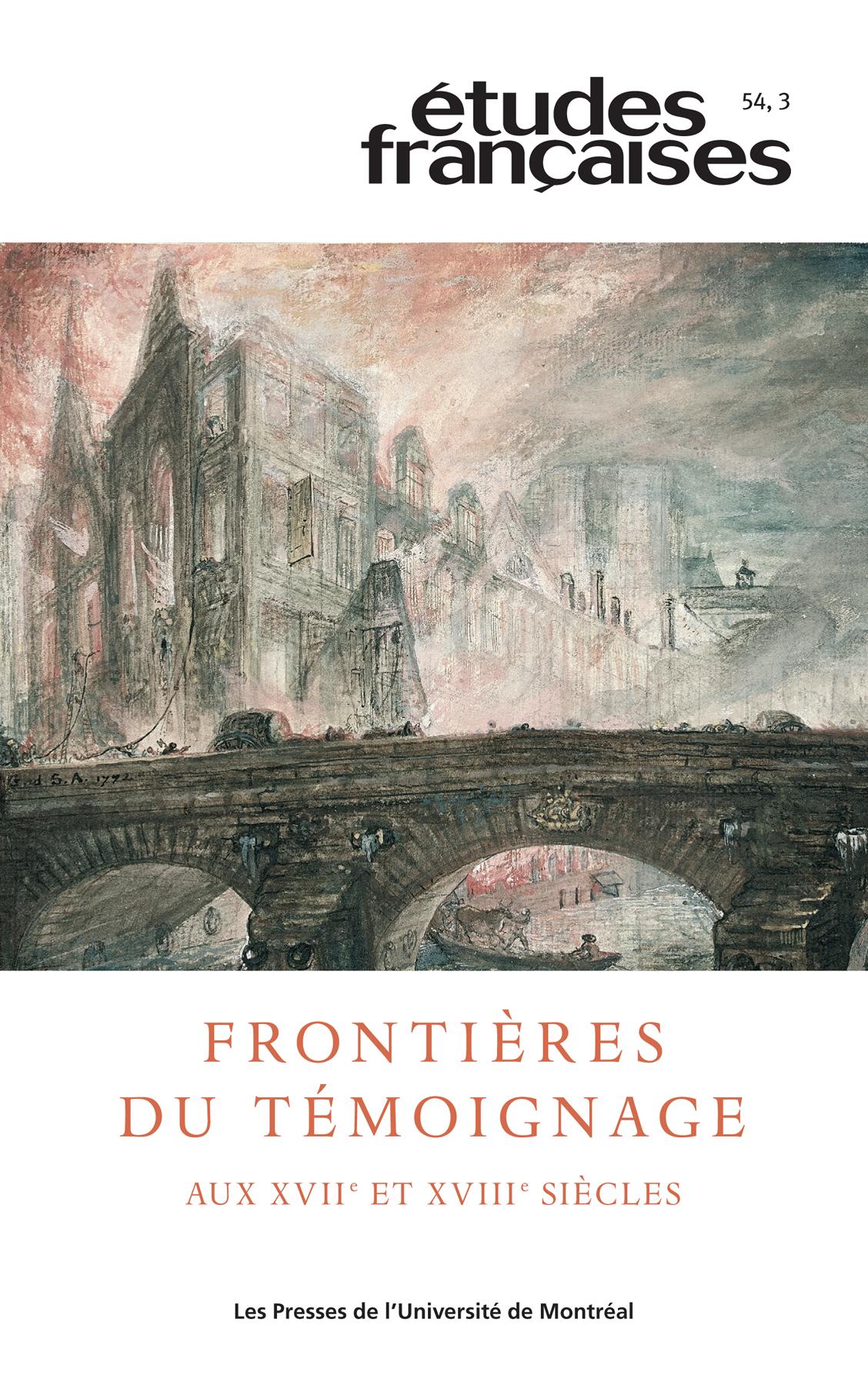Qu’est-ce donc qu’un témoignage ? quelle est sa place, quel est son rôle en littérature ? Sans circonscrire entièrement l’objet de ce dossier, de telles questions doivent sans doute en former le socle. Au début de la modernité, sous ce qu’il est en France convenu d’appeler l’Ancien Régime, au cours des xviie et xviiie siècles en particulier, qui fournissent aux articles ici rassemblés leur cadre chronologique et leur matière première, le monde de l’écrit est encore déterminé par l’héritage humaniste. Ce que l’on appelle alors les lettres – comme dans l’expression République des Lettres – ou les belles lettres embrasse aussi bien la poésie, les ouvrages d’éloquence et la critique, que les histoires vraies ou fausses, les dialogues philosophiques, les genres moralistes et même les sciences exactes. « Les vraies belles lettres, affirmait ainsi Furetière en 1690, sont la physique, la géométrie et les sciences solides » (s.v. lettres). Or ce sont les accointances des lettres avec l’histoire et avec le droit – par le biais de la rhétorique et de l’art oratoire, comme par la formation juridique fréquente des écrivains, de Corneille à Marivaux et à Sénec de Meilhan – qui éclairent en son sein le jeu des témoignages. Les anciens lexicographes définissaient le témoignage comme « attestation, relation d’une vérité », et particulièrement comme « passage d’un Auteur, ou autre personne notable, qui dit ou affirme avoir vu ou cru quelque chose » (Furetière, s.v.) ; ou bien comme le « [r]apport d’un ou de plusieurs témoins sur un fait, soit de vive voix, soit par écrit » (Acad., 1762, s.v.). On lui donnait également le sens de signe, de marque, de preuve : « se dit aussi des indices, des preuves qu’on tire souvent des choses inanimées » (Fur., s.v.). Enfin, il pouvait prendre le sens atténué de « simple recommendation, ou asseurance » (ibid.). Si le rapport du témoignage à la preuve, si les emplois juridiques et religieux – martyr, par exemple, vient de márturos (témoin) – donnent au témoignage à l’âge classique une coloration particulière, il possède aussi d’autres champs d’application, au premier rang desquels figure l’histoire. Depuis l’Antiquité, en effet, l’histoire est définie, dans les traités qui lui sont consacrés, les artes historicae, par le rappel de formules reprises de Cicéron : « Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis » (De Oratore, II, 9, § 36) : « L’histoire enfin, témoin des siècles, flambeau de la vérité, âme du souvenir, école de la vie, interprète du passé. » De tels éloges, l’éminence de son objet, le lustre de ses modèles ont fait de l’histoire le plus noble des genres en prose, suscitant l’ambition d’écrivains doués – Racine, Voltaire, Chateaubriand furent tous trois décorés en leur siècle du titre d’historiographes de France. Les notions étroitement associées de témoignage et de vérité précisent ensemble la visée de l’histoire et ses moyens : ce sont les témoignages authentiques et dignes de foi qui lui fournissent presque seuls ses informations, le recours aux archives n’étant devenu un réflexe que bien plus tard. Longtemps, le témoignage, dans lequel s’extériorise « la mémoire déclarative », est resté au fondement de la vérité historique, jusqu’à la révolution de méthode et d’esprit qui devait placer la critique des sources au principe du travail de l’historien. À ce titre, il remonte à l’autopsie (attesté en français dès 1573) par laquelle les historiens grecs assuraient avoir vu de leurs propres yeux (autos + opsis) ce qu’ils rapportaient : « je suis allé et j’ai …