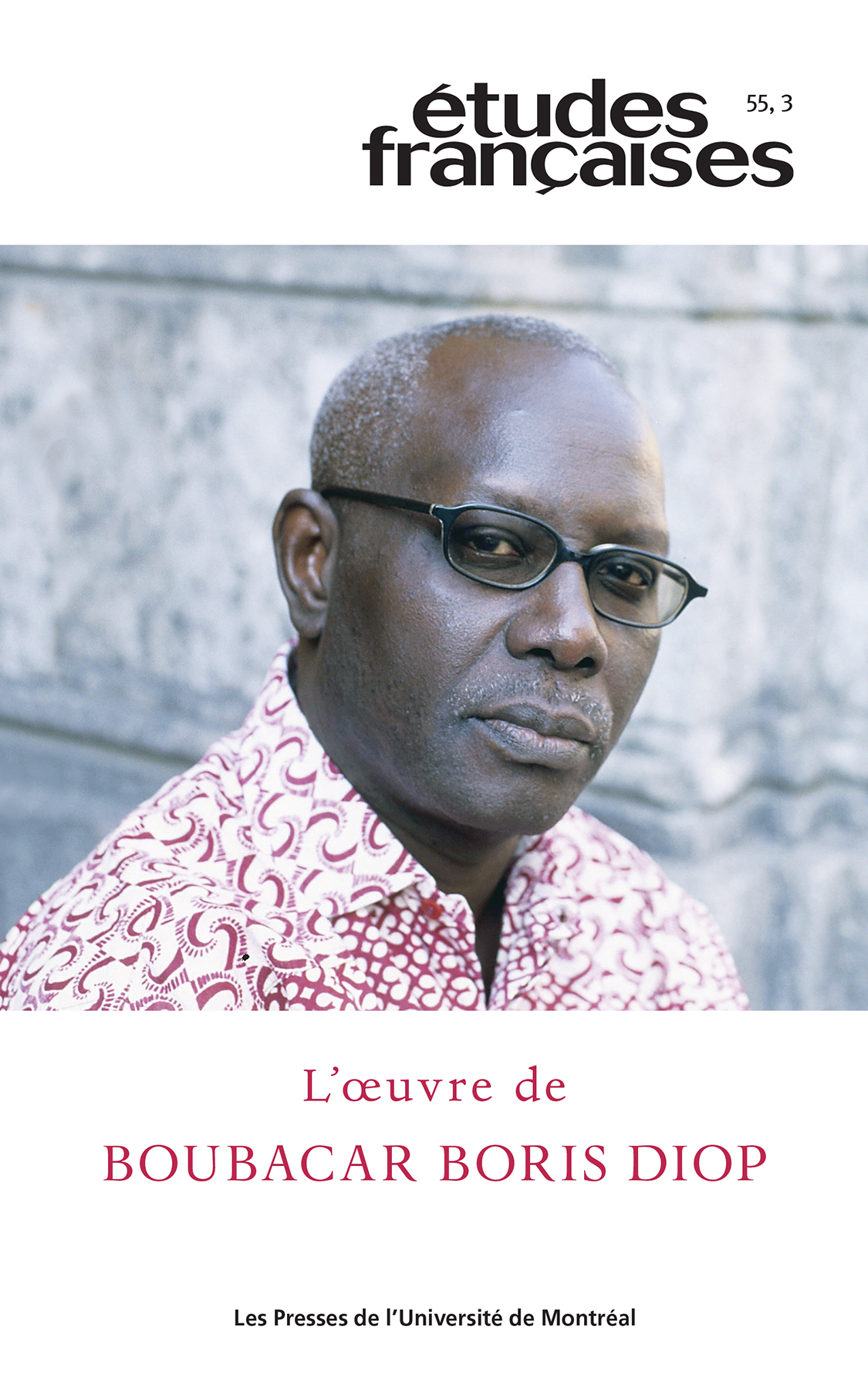Abstracts
Résumé
Les études sur les génocides et la Shoah privilégient le témoignage, au détriment des mécanismes narratifs mis en oeuvre. Cet article propose une analyse de la mise en abyme du jugement dans Murambi, le livre des ossements de Boubacar Boris Diop, roman-reportage sur le génocide des Tutsi au Rwanda. Je suggère que sa dimension testimoniale relève non seulement de son champ sémantique, mais également de ses plans narratif et énonciatif. Des procédés narratifs y sont déployés, mettant en scène une situation de procès où bourreau, victime et juge se font face. Dans ce roman d’horreur, Siméon Habineza émerge, figure du juste opposé à toute forme d’extrémisme, comme le véritable héros du roman. Au contraire des autres membres de sa tribu, il refuse de participer au génocide, et, après la guerre, combat la vengeance. À la différence des autres romans de l’auteur, qui sont des tragédies dont aucun héros n’émerge, dans Murambi, héros et antihéros sont identifiés. Cette forme mélodramatique suggère qu’un roman sur un génocide ne saurait rester neutre sur le plan des valeurs.
Abstract
Genocide and Shoah studies give a great importance to the testimony, neglecting the narrative devices at work. This article proposes an analysis of the mise en abyme of judgement in Murambi, the Book of Bones by Boubacar Boris Diop, a novel and reportage about the genocide of the Tutsi in Rwanda. I suggest that its testimonial dimension arises not only from its semantic field, but also from its narrative and enunciative situations. Narrative devices are deployed to stage a trial situation where executioner, victim and judge face each other. In this horror novel, Simeon Habineza emerges, figure of the righteous opposed to all forms of extremism, as the true hero of the novel. Contrary to the other members of his tribe, he refuses to participate in the genocide, and, after the war, he fights against revenge. Unlike the author’s other novels, which are tragedies where no hero emerges, in Murambi, heroes and anti-heroes are identified. This melodramatic form suggests that a novel about genocide cannot remain neutral in terms of values.
Article body
« Il était essentiel à mes yeux non seulement d’accumuler le maximum d’informations sur le génocide mais aussi de trouver la clef de l’énigme […]. Comment peut-on se dire un intellectuel capable, pour parler comme Cheikh Hamidou Kane, de “brûler au coeur des choses” si on ne sait même pas se demander pour quelle raison et par qui tant de corps mutilés de Tutsi ont été du jour au lendemain lâchés sur le Nyabarongo ou jetés aux chiens ? »
Boubacar Boris Diop[1]
Par ces mots, Boris Diop décrit l’atmosphère de désarroi moral dans lequel il se trouvait lorsqu’il a décidé d’écrire son roman Murambi, le livre des ossements[2]. Devant ce que l’auteur qualifiait lui-même d’« énigme » à résoudre, du moins par la voie de la littérature, en 1998, quatre ans après le génocide des Tutsi du Rwanda, Fest’Africa (Festival des arts et des littératures d’Afrique) a réuni un groupe d’écrivains africains en résidence d’écriture à Kigali dans le projet « Rwanda : écrire par devoir de mémoire »[3]. C’est dans ce cadre qu’a été écrit Murambi. Si ce roman occupe une place particulière dans l’oeuvre de Boubacar Boris Diop, c’est surtout parce que les autres romans de l’auteur se caractérisent, comme ceux des romanciers de sa génération, par une recherche de techniques narratives innovantes, depuis Le temps de Tamango jusqu’au plus récent Les petits de la guenon, en passant par Kaveena[4]. Dans ces récits, des personnages et des narrateurs sont de pures créations de l’imaginaire, même si, parfois, le lecteur averti devine une référence subtile au contexte historique et social du Sénégal moderne. Dans Murambi, Diop a opté pour une écriture journalistique, d’enquête, sur une réalité connue de tous, la part d’invention étant limitée au minimum :
M, 231Ce roman a vu le jour grâce à l’initiative prise par Fest’Africa, animé par Maïmouna Coulibaly et Nocky Djedanoum, d’impliquer une dizaine d’écrivains africains dans la réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda. [… E]lle a permis aux auteurs de séjourner sur place pendant deux mois.
[…]
Les nombreux ouvrages et documents disponibles sur le sujet m’ont aidé à mieux cerner les témoignages des victimes et, parfois, des bourreaux.
Ma gratitude va aussi […] aux Rwandais de toutes conditions qui ont accepté de me parler des choses épouvantables qu’ils avaient vues et vécues. Beaucoup d’entre eux trouvaient pour la première fois la force de le faire.
J’espère n’avoir pas trahi leurs souffrances.
Le thème du génocide avait été traité par Boubacar Boris Diop dans un livre publié juste après les événements, Le cavalier et son ombre[5]. Dans une narration complexe et symbolique, à l’instar d’autres romans de l’auteur, le massacre des Tutsi du Rwanda est évoqué de façon allusive, comme s’il s’agissait d’une autre simple guerre civile africaine. Ce roman a paru bien avant que l’auteur ne visite le Rwanda et ne se documente sur le pays et son histoire au point que, si on lit les deux romans ensemble, tout se passe comme si le journal d’enquête, Murambi, prenait le relais du roman, Le cavalier et son ombre, et le détruisait, et que le rabattement de la société réelle sur la société du texte permettait d’atteindre l’horizon d’attente du lecteur, dans Murambi. Avec ce roman, en effet, l’invention de personnages imaginaires, et de prouesses esthétiques qui ne sont qu’« une vue de l’esprit » selon les termes de l’auteur[6], n’ont plus de place dans un récit de génocide. Devant les rescapés du Rwanda, avec leurs récits effroyables, l’écrivain récuse sans ambages ses anciens principes esthétiques. Il a dû, comme ses collègues, faire preuve d’ingéniosité pour trouver les formes appropriées afin de dire l’indicible du génocide, tenter de rendre intelligible des actes ignobles et inimaginables. Tel est le contexte dans lequel les récits africains du génocide des Tutsi ont été écrits. Leurs auteurs avaient compris qu’il « n’était plus question de collecter froidement des faits mais d’écouter des récits de vies détruites et de s’en faire fidèlement l’écho[7] ».
Il existe plusieurs travaux sur ce corpus, qui posent, entre autres, la question du positionnement des écrivains dans le champ littéraire africain et celle de leurs esthétiques[8]. De nombreuses études se focalisent surtout sur les dimensions testimoniales des récits, se demandant même si ce corpus n’annonce pas un nouveau sous-genre « témoignage » au sein de la littérature africaine contemporaine. On peut, en effet, lire Murambi comme un roman de témoignage dans la mesure où les temporalités se chevauchent à la bordure de l’histoire coloniale et des indépendances du Rwanda. Le narrateur étire constamment ces temporalités en convoquant, en amont, les figures de la politique des années 1960 et leurs liens avec les germes de la haine ethnique ayant conduit au génocide. En aval, il évoque les événements du temps du génocide, avec la société et les acteurs du conflit. Il zigzague à travers l’histoire contemporaine du pays.
Si cet article s’inscrit dans le prolongement de ces études critiques, il innove, cependant, par le fait qu’il explore certains aspects oubliés que, moi-même, je n’avais pas vus dans mes premiers articles sur ce roman[9]. Il s’agit d’étudier le genre du génocide par le biais du roman d’enquête en se limitant au seul cadre général, puisque l’objectif n’est pas d’entrer dans les méandres des définitions générales propres aux récits d’enquête mais de montrer que le choix d’une telle forme narrative pour raconter un génocide est inédit dans ce genre de récits : c’est ce qui fait l’originalité de Murambi. Ce roman déploie, en effet, comme tout récit d’enquête, les modalités narratives du procès où le narrateur principal met en scène les personnages du bourreau, de la victime et du juge. C’est dire que la dimension énonciative contribue à créer non seulement une histoire réaliste, mais aussi symbolique (notamment dans la mise en scène du procès). On démontrera également que cette stratégie narrative se double d’un procès axiologique : l’enquête se termine sur la condamnation du bourreau et la reconnaissance du juste que représente Siméon Habineza, le vieux sage hutu, qui a refusé de participer aux massacres et qui conseille dorénavant aux jeunes Tutsi et Hutu de rejeter la voie de la vengeance.
Le récit d’enquête
Sur le plan narratif, le roman s’inscrit dans la tradition du roman d’investigation, ou d’enquête, avec le suspense d’une mort annoncée dès le début du récit, laissant immédiatement entrevoir, sur le plan symbolique, la question de savoir comment juger les crimes de masse. Au fur et à mesure que le récit avance, le lecteur en saura davantage sur les origines et les causes, et on appréciera, ici, les modalités narratives et énonciatives à travers lesquelles l’histoire est racontée. Murambi est un roman où alternent de nombreuses histoires dans une polyphonie généralisée, au point que chaque récit semble autonome et sans lien nécessaire avec ceux d’autres personnages-narrateurs. Un tel mécanisme narratif permet au narrateur principal de maîtriser la parole et de la donner aux différents protagonistes témoins de la tragédie pour, enfin, arriver à la scène de jugement mettant face à face trois acteurs : les témoins, les accusés, les victimes – et la voix de l’énonciateur juge. Il use également de certains procédés « réalistes », comme l’usage des noms propres (évoquant le contexte culturel du lieu de la tragédie, le Rwanda et les pays limitrophes) qui abondent dans le récit.
Par la voix d’un rescapé, Michel Serumundo, le récit s’ouvre donc sur une énigme. Ce personnage raconte comment il a assisté, d’abord sans comprendre, aux signaux annonciateurs du drame dont il allait pourtant être victime :
Hier, je suis resté à la vidéothèque un peu plus tard que d’habitude. Il faut dire qu’il n’y avait pas eu beaucoup de clients au cours de la journée, ce qui est plutôt surprenant à cette période du mois. Pour m’occuper, je me suis mis à ranger les films sur les rayons, dans l’espoir que quelqu’un viendrait m’en louer un au dernier moment. Ensuite, je suis resté debout pendant quelques minutes sur le seuil du magasin. Les gens passaient sans s’arrêter.
M, 11
Ayant finalement compris les enjeux de la situation, Michel rapporte que l’accident d’avion du président du Rwanda aurait été l’élément catalyseur des événements : « Apparemment, j’étais le seul à ne pas savoir que l’avion de notre président, Juvénal Habyarimana, venait d’être abattu en plein vol par deux missiles, ce mercredi 6 avril 1994 » (M, 16). Son pressentiment se transforme en peur réelle d’un danger imminent, mais non encore nommé :
J’ai trouvé les enfants au salon. En jouant avec eux, je me suis souvenu du monsieur qui pleurait silencieusement dans l’autocar. Je suis ensuite ressorti pour aller à la recherche de Jean-Pierre. Je comptais aussi faire un saut au magasin pour mettre à l’abri certains objets précieux que l’on m’avait confiés.
M, 21
Désigné par le narrateur comme « Tutsi » (M, 12), il fait partie du groupe visé par le massacre que projettent les « miliciens Interahamwe » (M, 15)[10].
Puis, tout d’un coup, Michel disparaît du récit sans que le lecteur sache ce qu’il devient une fois son témoignage terminé. Est-il mort ? Ce qui est sûr, c’est que le récit de Michel – la victime – vise à créer, chez le lecteur, de la sympathie pour celui-ci, et de l’antipathie pour le bourreau, figuré par le personnage du milicien Faustin Gasana. Contrairement à Michel, Faustin n’a ni peur ni pressentiment du danger. Il fait partie des organisateurs du génocide. La scène du jugement est campée et le lecteur est le juge. On verra que le jugement a une portée pragmatique : il sert d’exemple à suivre. Toutes les personnes sont égales devant la loi, et ce principe sert de tradition à transmettre aux générations suivantes.
Le jugement
Déféré à la barre, Faustin, le milicien hutu Interahamwe, raconte, sans état d’âme, comment il se prépare à jouer de la machette :
Je me suis assis à côté du chauffeur. Il a mis le moteur en marche […].
M, 23
[…]
Cela fait quarante-huit heures qu’il me conduit d’une réunion à l’autre. La nuit dernière, j’ai d’ailleurs dû lui dire de rentrer sans moi, car il était clair que notre rencontre avec les préfets et les bourgmestres n’allait pas prendre fin avant l’aube.
Faustin détaille les éléments du projet des massacres en montrant que ces violences découlent de la mémoire de vieux antagonismes non résolus que les parents ont transmis à leurs enfants. Il commente ainsi l’attitude de son père : « La politique a toujours été son sujet de conversation favori, mais je ne l’ai jamais entendu prononcer le mot “Tutsi”. Il les appelle toujours “ils” ou les “Inyenzi”, littéralement les “cancrelats” » (M, 26). Il note que pour rallier les plus récalcitrants, la propagande recourait aux figures historiques dont se nourrissaient les idéologies du ressentiment antitutsi depuis les années 1960 et 1970 : « Deux photos sont collées au mur, juste au-dessus du montant du lit. Sur l’une d’elles, Grégoire Kayibanda, le premier président du Rwanda, serre la main du roi Baudouin de Belgique. Kayibanda paraît très fier de vivre ce moment historique […]. L’autre photo est le portrait officiel du major-général Juvénal Habyarimana » (M, 25). Faustin avoue comment il a participé au projet collectif des massacres, de son propre gré, comme s’il répondait à un enquêteur ou à un avocat du Ministère public :
Moi, j’ai toujours su en devenant Interahamwe que j’aurais peut-être à tuer des gens ou à périr sous leurs coups. Cela ne m’a jamais posé de problème. J’ai étudié l’histoire de mon pays et je sais que les Tutsi et nous, nous ne pourrons jamais vivre ensemble. Jamais. […] Je vais faire correctement mon travail.
M, 31
Dans son rôle d’avocat général instruisant le dossier de l’accusation, le narrateur principal commente alors pour le juge (le lecteur) cette propagande de la haine enseignée par les parents à leurs enfants durant le temps sombre des massacres. Il évoque aussi les informations et le rôle des médias dans l’horreur rwandaise[11]. Faustin peut alors entonner la chanson de la mort des Tutsi ânonnée toute la journée sur les ondes de la Radio hutu dite des Mille Collines : « “Tubatsembatsembe !” Il faut les tuer tous ! » (M, 32) Il explique un aspect troublant des événements : pourquoi de nombreux massacres ont-ils eu lieu dans des lieux publics et administratifs ? C’est que les maires et les conseillers communaux appelaient les Tutsi à se réfugier dans ces espaces pour qu’ils soient protégés par la police. Ils y sont allés nombreux. Rares sont ceux qui en sont ressortis :
À Kibungo comme dans le reste du Rwanda, nous allons juste aligner les Tutsi aux barrières et les tuer. Ce sera chacun son tour. Beaucoup d’entre eux sont en train de se réfugier dans les lieux de culte et les édifices publics. Ils croient ainsi se tirer d’affaire comme les autres fois, à l’époque de mon père.
M, 33
Sur le plan de l’énonciation, le narrateur pose les questions de la justice. Le bourreau, qui se définit d’un point de vue tribal (« nous » / « eux »), est jugé comme individu et ses actes sont liés à l’intention de commettre les massacres en étant conscient de la gravité de ses gestes. La dimension éthique du roman est que l’individu doit répondre de ses actes envers la société. Faustin constitue la figure de bourreau sans remords nourri par l’idéologie du rejet de l’autre ayant conduit à un monde dichotomisé (« nous » / « eux ») et qui, entré dans l’âge adulte, a le pouvoir de faire exploser la violence absolue. La désignation « eux » lui permet de ne pas s’inquiéter de la souffrance subie par ses victimes tutsi.
Une autre question juridique surgit aussitôt. Comment juger un crime de masse et « populaire »[12], qui n’a pas été seulement l’affaire de l’armée et de la police, mais celle de tous les citoyens hutu valides ? Marina Nkusi raconte ainsi le désarroi de son père hutu lorsqu’on l’oblige à participer au génocide. Celui-ci avait caché ses amis tutsi menacés et refusé d’aller chasser les victimes. Son ami devenu milicien Interahamwe vient le voir et le met face au dilemme de choisir entre sa vie et celle de sa famille ou tuer les Tutsi comme les autres Hutu le font. Tout en reconnaissant que le geste de son père procède « de la sauvagerie » (M, 114), Marina raconte qu’il savait que, s’il n’obéissait pas aux ordres, « les Interahamwe allaient venir tuer tout le monde dans la maison » (M, 114). C’est dire que les gens ordinaires ont tué leurs voisins de peur de subir le sort des victimes s’ils n’obéissaient pas aux ordres des miliciens : « Le troisième jour, n’en pouvant plus, il [son père] a pris sa machette. […] Il est allé sur les barrières. On nous a dit que là-bas il manie la machette comme un forcené » (M, 114-115).
Fille de bourreau, Marina a été choisie par l’auteur comme le témoin emblématique qui dit que le génocide a lieu quand la dictature détruit la conscience morale des citoyens par la terreur. Tout à l’heure avocat général, le narrateur endosse ici l’habit de l’avocat de la défense du menu peuple victime des errements des élites corrompues responsables du génocide, et recourt aux thèses développées sur les mécanismes de destruction de la personne morale dans un régime dictatorial, comme celles de Hannah Arendt démontrant comment, dans un système totalitaire, le citoyen ordinaire n’a pas la possibilité, dans ses actions politiques, de choisir « entre le bien et le mal, mais entre le meurtre et le meurtre[13] ». Par une telle défense du pauvre devenu criminel malgré lui, le roman fait écho aux différents mécanismes juridiques du procès des crimes de ces massacres dans le Rwanda post-génocide, comme les tribunaux gacaca (gatʃtʃa)[14].
Figures contrastées qui agissent et pensent différemment, Faustin et Marina ont pourtant tous deux des parents hutu qui ont grandi sous le régime dictatorial prêchant la violence contre les Tutsi. Grâce à elles, le narrateur ouvre le débat du droit selon lequel la loi s’applique à tous, tout en faisant référence à la restitution de l’intention et à la hiérarchie des responsabilités. Il aborde aussi la question de la transmission de la mémoire collective par les parents à leurs enfants. Entre Faustin et son père, on reconnaît ce que Tzvetan Todorov appelle la transmission littérale de la mémoire[15]. Le père de Faustin a enseigné à son fils que les Hutu et les Tutsi sont des ennemis irréconciliables. Les effets d’une telle mémoire-ressentiment instruisent les grands drames de l’histoire du pays (1959, 1973, 1994). Le narrateur insiste sur la transmission du ressentiment du père au fils : le premier a fait du second un bourreau sans remords qui déteste et tue sans cause personnelle, qui défend la pureté raciale. Chez Marina, la transmission de la mémoire est exemplaire[16]. Ayant été éduquée à considérer les gens comme égaux, dotée d’une ouverture d’esprit léguée par un père qui ne lui a jamais transmis la haine, elle peut s’interroger sur le rôle de l’État, qui a le monopole de la violence dans le génocide, et tenter de s’approprier le passé par sa propre réflexion.
Complicité des étrangers, guerre civile
Quand il est question de la complicité des étrangers dans les massacres, le narrateur reprend son habit d’avocat général pour instruire le dossier à charge contre l’État français. Il appelle à la barre le colonel Étienne Perrin, qui dirigeait les troupes françaises au Rwanda entre fin juin et fin août 1994, pour que le lecteur comprenne le rôle ambivalent de ce pays dans le génocide des Tutsi. Le colonel Perrin admet lui-même que sa mission n’a pas été, pour le moins, du goût de tous les participants :
Je me suis souvenu de Jean-Marc Gaujean. Un jeune du ministère, assez idéaliste et tourmenté, qui aime se confier […]. « […] Mais nous, Jean-Marc, nous n’avons rien fait pour empêcher ces massacres. Nous étions les seuls au monde à le pouvoir. » […] « [… N]ous avons du sang jusque-là dans cette affaire. » [… Jean-Marc] a dit […] : « Et nous voilà obligés d’aider les tueurs à échapper à la justice de leur pays… »
M, 160-161
Il précise avec force détails le principal rôle de sa mission : faire fuir les témoins de la sinistre collaboration entre la France et le Rwanda au lieu de les arrêter en tant que criminels[17]. En bon officier obéissant aux ordres militaires de sa hiérarchie, il explique clairement ses responsabilités :
Depuis quelques jours, mon travail consiste à évacuer sur Bukavu des ministres, des préfets et des officiers supérieurs. Ces messieurs n’ont qu’une idée en tête : ne pas être sur place à l’arrivée du FPR. Ils ont fait main basse sur les réserves de la Banque centrale et emporté ou détruit les documents et les biens de l’administration. Voyant leurs chefs prendre la fuite, des centaines de milliers de citoyens quittent eux aussi le pays en direction du Zaïre, de la Tanzanie ou d’autres pays voisins.
M, 150
Par ce témoignage, le roman fait allusion à la mission militaire dite humanitaire française censée protéger les victimes[18]. Or, selon Jean-Paul Gouteux, « [l]a zone “humanitaire sûre” ne l’a été que pour les miliciens, les forces gouvernementales et les animateurs de la Radio Mille-Collines. Cette dernière a ainsi continué à émettre son message génocidaire pendant toute l’occupation française[19] ». Mais le roman va plus loin. Il évoque la responsabilité morale d’un État qui, dans ce cas d’espèce, ne peut s’exonérer de son action même si, d’un point de vue strictement juridique, la France n’est pas responsable des massacres. Il fait sans doute écho aux débats d’une autre époque et pour un autre génocide[20].
Autre dossier du génocide : la guerre civile qui ravage le pays depuis 1990. Elle oppose les soldats de l’État rwandais et les maquisards du Front patriotique rwandais[21]. Cet épisode est raconté lors du passage à la barre de Jessica Kamanzi, une espionne de ce mouvement (elle s’est procuré une fausse carte d’identité nationale avec mention ethnique « hutu »). Choisie par l’auteur pour informer le lecteur du rôle du FPR, elle évoque d’abord la vie des exilés des années 1960 puis les circonstances de son engagement dans le maquis : « Tout me revient avec précision. Nous étions quinze jeunes gens à faire par la route, de nuit, le trajet de Bujumbura au camp de réfugiés de Mushiha. […] Plus tard, ce fut Mutukura et Kampala où nous avons cessé de nous voir » (M, 44-45). Elle rappelle ensuite, sobrement, les noms des camarades morts sur le champ de bataille, comme celui de « Patrick Kagera [qui] devait tomber plus tard en première ligne pendant notre offensive d’octobre 1990 » (M, 44-45). Elle évoque enfin les chants de guerre au maquis pour se donner de la force au coeur des massacres dont elle fut témoin : « Tout en marchant, je pense à nos veillées nocturnes. Nous chantions : “Si les trois tombent au combat, les deux qui restent libéreront le Rwanda” » (M, 46). Elle sait que les troupes du FPR font mouvement sur Kigali, se demande si elles arriveront à temps pour sauver les victimes, et ne doute pas qu’une fois son rôle d’agente du FPR découvert, elle risque d’être lynchée par la foule :
Près de Kyovu, je vois des centaines de cadavres à quelques mètres d’une barrière. Pendant que ses collègues égorgent leurs victimes ou les découpent avec leurs machettes tout près de la barrière, un milicien Interahamwe vérifie les pièces d’identité. […] Il demande à voir mes papiers. Pendant que je les sors de mon sac, il ne me quitte pas des yeux. Au moindre signe de panique, je suis perdue. Je réussis à garder mon sang-froid.
M, 46-47
Porte-parole de l’auteur s’agissant de l’utopie de la libération des pays sous emprise tyrannique, elle se montre quelque peu désabusée en ce qui concerne les guerres qui débouchent le plus souvent sur une nouvelle impasse. Jessica multiplie ainsi les mises en garde pour que la guerre de libération du FPR ne soit pas perçue comme héroïque. Certes, elle est convaincue que la victoire arrivera tôt ou tard, mais elle surviendra dans un pays en ruine. Ce sera sans doute une victoire à la Pyrrhus.
En relativisant la victoire du FPR, le roman s’attaque en définitive à l’un des aspects importants du récit fondateur et messianique de la gauche africaine : tous les malheurs de l’Afrique lui viennent de l’Occident. Avec la figure du Noir africain milicien tronçonnant son compatriote Noir africain rwandais, la théorie du bouc émissaire paraît dorénavant discutable et relative. Le roman développe l’idée que les conditions préalables à la paix en Afrique seront l’oeuvre des Africains qui développeront leur propre pensée sur le devenir de leurs sociétés. Le FPR a engagé la guerre pour venger l’humiliation subie par les Tutsi dans les massacres des années 1960 et 1970, et que le régime suivant n’avait pas réparée. Les vaincus d’hier pensent laver l’humiliation subie dans les guerres de maintenant. Comment briser le cercle des conflits ? Écartant les moyens militaires comme solution aux problèmes politiques, le roman privilégie la voie individuelle pour la paix sociale. On verra que le personnage de Siméon Habineza, qui veut participer à la création d’une société nouvelle post-génocide dont le socle serait les droits et les devoirs de l’individu dans la société qui primeraient sur ceux de la tribu, est au centre de cette démonstration.
Vers une tradition de justice
Une fois la justice rendue, le narrateur propose une éthique de la responsabilité individuelle pour contenir les violences à venir et fonder une tradition de justice où nul ne sera au-dessus de la loi. Sur le plan de l’énonciation, une nouvelle réflexion porte sur la dialectique historique des voies et des moyens de résoudre les problèmes de la société, débat sans lequel une société sombre dans la violence. Comment débattre ? Une telle méditation se met en place grâce au personnage de Cornelius, qui agit comme intermédiaire entre plusieurs protagonistes. Ayant fui les massacres des Tutsi de 1973 et quitté le pays, il revient avec le statut de l’étranger voulant s’informer sur le génocide dont il ne sait rien, dans un pays qu’il ne connaît pas bien. Il a une posture double, celle d’un personnage et celle de l’auteur dont il semble être l’homologue. N’a-t-il pas un interprète, Gérard, qui est aussi son informateur, comme s’il ne connaissait pas la langue du pays ? D’entrée de jeu, il se présente : « Je m’appelle Cornelius Uvimana et je suis le fils du docteur Joseph Karekezi » (M, 200). Il apprendra que son père, médecin et notable hutu, a planifié le massacre de quarante-cinq mille personnes dans une École technique du village de Murambi au sud du pays – l’un des sites du génocide qu’a visité Boubacar Boris Diop.
Au cours de ses nombreux dialogues avec les autres personnages, Cornelius nous apprend que les massacres des Tutsi, périodiques avant la solution finale du printemps 1994, commencèrent en 1959 avec l’avènement du parti Parmehutu (M, 66). Didactiquement, il explique que le génocide découle des politiques tribalistes et ségrégationnistes de ce parti car, à cette époque, déjà, les Tutsi qui n’avaient pas fui le pays avaient été tués, et les rescapés confinés dans les zones insalubres du pays et marginalisés par les politiques discriminatoires qui les frappaient dans tous les domaines de la vie publique. Cornelius comprend difficilement comment son père, un homme autrefois respecté de tous, opposé aux politiques de ségrégation contre les Tutsi, et qui fut même emprisonné sous le régime hutu du général Habyarimana pour ses idées libérales, s’est transformé en bourreau.
Ici, le narrateur réfléchit sur les limites du langage et de la pensée à dire le génocide. Le rôle du transmetteur de la mémoire du génocide est donné à Siméon, l’oncle et père par substitution de Cornelius : « Sans avoir jamais écrit une seule ligne de toute sa vie, Siméon Habineza était à sa manière un vrai romancier, c’est-à-dire, en définitive, un raconteur d’éternité » (M, 226). Sur le plan symbolique, Siméon est le philosophe qui raconte l’histoire éternelle de l’être humain face au mal, à la violence et aux craquements de l’histoire, et c’est à lui que Cornelius s’adresse pour essayer de trouver de nouvelles réponses :
Et si ce châtiment radical – le génocide – était la réponse à un crime très ancien dont plus personne ne voulait entendre parler ? « À présent que je suis au Rwanda, je vais poser toutes ces questions à Siméon Habineza », songea-t-il. Il n’avait pas peur de la vérité, il était aussi revenu pour la connaître.
M, 88
Personnage fondamental du roman, Siméon explique très largement le génocide au lecteur. Figure de l’auteur enquêteur, de celui qui veut savoir, Cornelius, lui, est le personnage auquel s’identifie le lecteur. Son parcours pour savoir la vérité dissipe le doute. Lorsque Stanley tente de dire au monde entier les raisons du génocide, Cornelius a cette interrogation : « Tu arrivais à leur expliquer ? C’est parfois à devenir fou… » (M, 64). Son interlocuteur concède que le génocide dépasse effectivement tout entendement, toute explication rationnelle : « Je ne comprends d’ailleurs toujours pas cette débauche de sang, Cornelius » (M, 64-65). Ce doute sur l’indicible du génocide est aussi celui du narrateur rapportant le propos désabusé de Gérard : « Si tu préfères penser que j’ai imaginé ces horreurs, tu te sentiras l’esprit en repos et ce ne sera pas bien. Ces souffrances se perdront dans des paroles opaques et tout sera oublié jusqu’aux prochains massacres » (M, 222).
On voit ici le traitement que Diop réserve à l’histoire. D’un côté, il lui arrache son rôle de simple narration des faits dont la connaissance n’empêche pas le retour des massacres. De l’autre, il plaide pour une histoire non seulement réaliste, mais également symbolique car la fidélité aux faits ne garantit pas totalement la vérité. Il voudrait une histoire du génocide soumise à la fiction. Est-ce pour cela que le roman se termine sur un univers fantastique où la réalité côtoie le merveilleux dans une scène macabre : une silhouette de femme se lève au milieu des ossements de Murambi ? Le narrateur s’interroge lui-même :
Il lui fallait voir son visage, écouter sa voix. Elle n’avait aucune raison de se cacher et lui avait le devoir de se tenir au plus près de toutes les douleurs. Il voulait dire à la jeune femme en noir […] que les morts de Murambi faisaient des rêves, eux aussi, et que leur plus ardent désir était la résurrection des vivants.
M, 229
De Fanon à Levinas : dialogue sur la sortie de la violence
Murambi est loin de n’être qu’une simple profession de foi, un témoignage que certains critiques ont longtemps voulu y voir. La complexité et l’ambivalence de certains personnages réfutent cette lecture. C’est un roman des voix discordantes. L’écrivain cherche à comprendre l’esprit du temps de cette Afrique qui peine à retrouver son souffle après les soubresauts de la colonisation, au point de se retourner contre elle-même par des violences scabreuses comme les massacres du Rwanda. Cette interrogation passe par le double choix de modalités narratives et énonciatives appropriées. Les deux dimensions sont juxtaposées. Le choix des motifs du roman d’enquête mettant en place la scène du procès sert en même temps sur le plan énonciatif à débattre des valeurs en cours. Le roman convoque les idées en circulation dans la société sur le droit pénal, sur les statuts du coupable et de la victime, et opte pour la condamnation du criminel.
En suggérant le rétablissement de l’ordre et de l’harmonie de la société d’avant le chaos du génocide, Murambi fait partie de ces fictions avec une fin consolatrice qu’on rencontre dans le roman d’enquête. Cette prise de position s’inscrit dans la doxa contemporaine sur la résilience des sociétés après les catastrophes. En cela, ce roman, comme nombre d’autres sur le même sujet, procède du mythe de la marche en avant de l’histoire. Une telle dimension est portée par des héros exemplaires, comme Siméon. Cependant, sur le plan narratif, il existe une différence entre le roman d’enquête et le récit du génocide, malgré la scène du procès dans Murambi ; si dans le premier, c’est le détective qui découvre le criminel après une longue enquête, dans le roman du génocide, le héros, si l’on peut dire, est le narrateur. On a vu que ce dernier joue le rôle d’avocat du Ministère public – lorsqu’il fait témoigner, et condamner aux yeux du lecteur, le bourreau (Faustin) ou le complice (le colonel Perrin) – aussi bien que celui d’avocat de la défense quand il prend le parti des gens du menu peuple qui ont participé aux massacres sous la contrainte (le père de Marina). Une seconde différence notable est celle du protocole éditorial : le paratexte d’un roman d’enquête insiste souvent sur le genre adopté tandis que celui d’un roman de génocide ou de crimes de masse met davantage l’accent sur le contexte historique des atrocités. Une manipulation de la lecture est donc en cours avant que le lecteur n’ouvre le livre. Enfin, dans le roman d’enquête, deux histoires se chevauchent, celle de l’investigation et celle du crime qui commence quand celle du détective est terminée ; dans le roman du génocide, l’histoire du criminel – l’État qui a organisé le massacre – est connue, le narrateur raconte la scène du procès.
Sur le plan de l’énonciation, le roman est au diapason des autres textes de l’auteur dans lesquels on lit en filigrane une idée récurrente : l’Afrique renaîtra de ses cendres. Ce roman expose ainsi les idées des essais de Diop : même si elle a subi le choc de la colonisation, l’Afrique finira néanmoins par reprendre son chemin. L’écrivain reste fidèle à son engagement politique pour l’Afrique, et dans Murambi, cette espérance est portée par Cornelius, dont la mère tutsi, les frères et les soeurs ont été assassinés par son propre père qui voulait effacer tous ses liens avec les Tutsi. Cornelius entend le dire « plus tard aux enfants de Zakya » (M, 229), sa fiancée de Djibouti, avec laquelle il partage le projet d’écrire une pièce de théâtre pour leur transmettre cette mémoire douloureuse. Ce projet étrange demeure pour l’auteur le symbole d’une Afrique qui renaît de ses cendres et que rien ne peut détruire.
À la fin du roman, le narrateur veut montrer qu’après le génocide, après la désagrégation d’une société qui a perdu son centre de gravité et qui peine à trouver l’espoir dans les figures guerrières traditionnelles, survient une société irrémédiablement nouvelle dans laquelle le héros n’est ni le génocidaire ni le maquisard de la rébellion du FPR, mais le vieux sage Siméon qui avait refusé de participer au génocide comme le firent ses compatriotes hutu, qui refuse la vengeance des jeunes Tutsi contre les bourreaux, qui prône le pardon. La fin du roman insiste donc sur les actions et les pensées de Cornelius et de son oncle Siméon, gens de bonne volonté qui militent pour une mémoire exemplaire de la tragédie. Tous deux incarnent les figures emblématiques de l’espoir. Le premier par son projet de témoigner des événements au moyen du théâtre et de la littérature, le second par sa posture morale qui refuse l’humiliation de l’autre, fût-il criminel. Siméon milite pour une justice qui réhabilite le coupable et la victime dans une société réconciliée. Cette utopie se fonde sur une société métisse. Siméon a une double ascendance, hutu et humaniste, comme son neveu, Cornelius, dont le père est hutu et la mère tutsi.
Certes, le narrateur rend hommage au combat de libération du FPR auquel il accorde la supériorité morale sur le régime qui a commis le génocide, mais il doute du projet de libération de la tyrannie par la guerre. Hantée par le spectre du sang versé, sa narratrice-déléguée, Jessica Kamanzi, l’espionne du FPR, hésite désormais à clamer le slogan fanonien de la liberté ou la mort en vogue sur les campus des universités africaines des années 1960 et 1970[22]. Selon Achille Mbembe, le temps est venu « pour sortir du cul-de-sac fanonien – celui de la circulation et de l’échange généralisé de la mort comme condition de la montée en humanité –, il importe d’examiner dans quelle mesure donner la mort à la mort serait, en fait, le noyau de toute véritable politique de la vie et, partant, de la liberté[23] ». Le roman plaide donc pour une société unifiée autour de la justice, pour le débat au lieu de la violence par les armes. Il suggère qu’il existe un au-delà du politique, qui juge les acteurs politiques, car ni les vies ni les événements ne se résument à la seule dimension politique du monde (sauf le cas du milicien doctrinaire Faustin, réincarnation du président Kayibanda, qui utilise les moyens d’avant). Cornelius et Zakya incarnent le rêve d’un bonheur personnel au-delà des affres de l’Histoire.
C’est pourquoi Murambi aborde les questions de la transmission de la mémoire collective des parents aux enfants (Faustin, Marina, Cornelius, les enfants de Zakya) de l’éducation à la tolérance, au respect de l’autre ; questions que pose Siméon qui se méfie de toute position extrême, hors du politique. Que l’enfant soit autonome, qu’il se réapproprie l’histoire conflictuelle du passé et puisse la penser à partir de ses propres valeurs. Le roman de témoignage se termine ainsi sur une éthique de la responsabilité et un dialogue avec Emmanuel Levinas pour qui vivre c’est se sentir responsable de l’humanité de l’autre homme[24]. Tel est le propos de Siméon Habineza – Que vive la bonté – pour qui sortir du génocide exige moralement d’en finir avec la vengeance. Cette exigence passe par la décision de l’humilié d’hier, en position de force aujourd’hui, de refuser d’humilier à son tour son ancien bourreau, pour que celui-ci retrouve une certaine dignité. Belle utopie, que le roman suggère à la fin, après la description des horreurs.
Appendices
Note biographique
Josias Semujanga est professeur au département des Littératures de langue française de l’Université de Montréal. Ses travaux portent sur les théories du roman, les rapports entre l’histoire et le roman et les récits de génocide. Ses principales publications sont Le roman francophone et l’archive coloniale (2019, avec Philippe Basabose), Narrating Itsembabwoko. When Literature becomes Testimony of Genocide (Peter Lang, 2016), Intertextualité et adaptation dans les littératures francophones (Athena, 2013, avec Isaac Bazié), Le génocide, sujet de fiction ? Analyse des récits du massacre des Tutsi dans la littérature africaine (Nota bene, 2008), Origins of the Rwandan Genocide (Humanity Books, 2003), Dynamique des genres dans le roman africain. Éléments de poétique transculturelle (L’Harmattan, 1999), Les récits fondateurs du drame rwandais. Discours social, idéologies et stéréotypes (L’Harmattan, 1998), Configuration de l’énonciation interculturelle dans le roman francophone (Nuit blanche, 1996). Il a dirigé ou codirigé des numéros des revues Études françaises : « Ahmadou Kourouma ou l’écriture comme mémoire du temps présent » (vol. 42, no 3, 2006), « La littérature africaine et ses discours critiques » (vol. 37, no 2, 2001), « La représentation ambiguë : configurations du récit africain » (vol. 31, no 1, 1995, avec Lise Gauvin et Christiane Ndiaye) ; Présence francophone : « Les figures de l’écrivain et de l’écrit dans le roman africain » (no 91, 2018, avec Kodjo Attikpoé), « Le témoignage d’un génocide ou les chatoiements d’un discours indicible » (no 69, 2007), « La réception des littératures francophones » (no 61, 2003), « Sony Labou Tansi » (no 52, 1998, avec Fernando Lambert) ; Protée : « La rumeur » (vol. 32, no 3, 2004), « La réception » (vol. 27, no 2, 1999, avec Emmanuel Pedler) ; Tangence : « Les formes transculturelles du roman francophone » (no 75, 2004), « Les littératures francophones de l’Afrique et des Antilles » (no 49, 1995).
Notes
-
[1]
« Postface » à Murambi, le livre des ossements, Paris, Zulma, 2011 [Stock, 2000], p. 239.
-
[2]
Boubacar Boris Diop, Murambi, le livre des ossements, Paris, Stock, 2000.
-
[3]
De ce projet ont été publiés des récits, par Boubacar Boris Diop (Murambi, le livre des ossements, voir note précédente), Tierno Monénembo (L’aîné des orphelins, Paris, Seuil, 2000), Koulsy Lamko (La phalène des collines, Paris, Le Serpent à Plumes, 2002), Monique Ilboudo (Murekatete, Bamako / Lille, Le Figuier / Fest’Africa Éditions, 2000), Véronique Tadjo (L’ombre d’Imana. Voyages jusqu’au bout du Rwanda, Arles, Actes Sud, 2000), Abdourahman A. Waberi (Moisson de crânes : textes pour le Rwanda, Paris, Le Serpent à Plumes, 2000) ; un recueil de poèmes de Nocky Djedanoum (Nyamirambo, Bamako / Lille, Le Figuier / Fest’Africa Éditions, 2000) ; un essai de Jean-Marie Vianney Rurangwa (Le Génocide des Tutsi expliqué à un étranger, Bamako / Lille, Le Figuier / Fest’Africa Éditions, 2000). – Ces textes ont connu une adaptation théâtrale et musicale intitulée « Corps et voix, paroles rhizome » par Koulsy Lamko, l’un des auteurs du projet, qui a été jouée au Rwanda et en Europe. Ce spectacle se déroule sous la forme de dix tableaux, chacun évoquant un moment du génocide, racontant l’horreur avec une retenue singulière, symbolisée par une minute de silence en début de représentation. La musique charme les acteurs dans leur récitation des textes et la danse simule ce qui ne peut pas se dire. – Un second spectacle, texte de Marie-France Collard, Jacques Delcuvellerie, Yolande Mukagasana, Jean-Marie Piemme et Mathias Simons, a été présenté par la compagnie Groupov : Rwanda 94. Une tentative de réparation symbolique envers les morts à l’usage des vivants (Montreuil, éditions Théâtrales, 2002). Créé au festival d’Avignon en 1999, plusieurs fois primé depuis, ce spectacle a été joué en France, en Allemagne, en Belgique et au Canada (à Montréal). Selon l’expression des auteurs, la pièce se propose de rendre voix et visages aux victimes, d’interroger les motifs de leur assassinat. La pièce est aussi une oeuvre littéraire remarquable que son caractère polymorphe inscrit magistralement dans l’écriture dramatique contemporaine.
-
[4]
Boubacar Boris Diop, Le temps de Tamango suivi de Thiaroye terre rouge, Paris, L’Harmattan, « Encres noires », 1981 ; Les petits de la guenon, Paris, Philippe Rey, 2009 ; Kaveena, Paris, Philippe Rey, 2006.
-
[5]
Boubacar Boris Diop, Le cavalier et son ombre, Paris, Stock, 1997. Avec ce roman, comme avec ceux qui l’ont précédé, l’auteur s’inscrit dans une tradition romanesque en Afrique après 1968 qui cherche davantage les mécanismes narratifs complexes que l’engagement politique des années antérieures. Dans Murambi, il procède tout autrement avec un récit de témoignage. Ce parti pris engagé caractérise également ses essais, dans lesquels il fait des massacres du Rwanda l’emblème du mal rongeant l’Afrique, et qui s’appelle tribalisme et domination néocoloniale. On peut citer Négrophobie (avec Odile Tobner et François-Xavier Verschave, Paris, les Arènes, 2005), L’Afrique au-delà du miroir (Paris, Philippe Rey, 2007), La gloire des imposteurs : Lettres sur le Mali et l’Afrique (avec Aminata Dramane Traoré, Paris, Philippe Rey, 2014).
-
[6]
Boubacar Boris Diop, « Postface » à Murambi, le livre des ossements, op. cit., p. 238.
-
[7]
Ibid., p. 248.
-
[8]
Entre autres articles et ouvrages sur la fiction du génocide des Tutsi, on peut citer les études suivantes : Africultures, no 30 (« Rwanda 2000 : mémoires d’avenir », dir. Boniface Mongo-Mboussa ; disponible en ligne : africultures.com/revue/?numb=1862, page consultée le 22 octobre 2019) ; Daniel Delas, « Écrits du génocide rwandais », Notre librairie, no 142, octobre-décembre 2000, p. 20-29 (disponible en ligne : gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64948383/f20.image, page consultée le 22 octobre 2019) ; Pierre Halen, « Écrivains et artistes face au génocide rwandais de 1994. Quelques enjeux », Études Littéraires Africaines, no 14, 2002, p. 20-32 ; Josias Semujanga, « Les méandres du récit du génocide dans L’aîné des orphelins », Études littéraires, vol. 35, no 1, hiver 2003, p. 101-115, Le génocide, sujet de fiction ? Analyse des récits du massacre des Tutsi dans la littérature africaine, Québec, Nota bene, 2008, Narrating Itsembabwoko. When Literature becomes Testimony of Genocide, Berne, Peter Lang, 2016 ; Éloïse Brezault, « Raconter l’irracontable : le génocide rwandais, un engagement personnel entre fiction et écriture journalistique », Éthiopiques, no 71, 2e semestre 2003, p. 1-25 ; Jean-Pierre Karegeye, « Rwanda. Le corps-témoin et ses signes », dans Catherine Coquio (dir.), Histoire trouée : négationnisme et témoignage, Nantes, l’Atalante, 2003, p. 753-776 ; Catherine Coquio, Rwanda, le réel et les récits, Belin, « Littérature et politique », 2004. On peut également citer des thèses soutenues, notamment celles d’Aimable Mugarura Gahutu, Afropessimisme et génocide rwandais : clinique, voyeurisme et cannibalisme (Université Western Ontario, 2005), de Monique Gasengayire, L’écriture du génocide dans le roman africain : comment témoigner de l’indicible ? (Université de Montréal, 2006) et de Zakaria Soumaré, La représentation littéraire négro-africaine francophone du génocide rwandais de 1994 (Université de Limoges, 2010 ; publ. : Le génocide rwandais dans la littérature africaine francophone, Paris, L’Harmattan, 2013).
-
[9]
Voir, par exemple, « Murambi et Moisson de crânes [Abdourahman A. Waberi] ou comment la fiction raconte un génocide », Présence francophone, no 67 (« La traversée dans le roman africain », dir. Justin K. Bisanswa et Susanne Gehrmann), 2006, p. 93-113 ; « Murambi. La métaphore de l’horreur ou le témoignage impossible », dans Kanaté Dahouda et Sélom Komlan Gbanou (dir.), Mémoires et identités dans les littératures francophones, Paris, L’Harmattan, « Critiques littéraires », 2008, p. 85-101 ; « La dimension testimoniale du récit du génocide dans Murambi », dans Le génocide, sujet de fiction ?, op. cit., p. 125-150 ; « La fiction du génocide ou le partage des émotions », Présence francophone, no 83 (« Lieux discursifs du génocide au Rwanda », dir. Jean-Pierre Karegeye), 2014, p. 80-103 ; « Murambi, The Book of Bones. Polyphonic Voices and Testimony », dans Narrating Itsembabwoko, op. cit., p. 99-114.
-
[10]
Dès le rabat de la première de couverture (Paris, Zulma, 2011), le lecteur est informé des acteurs du récit. Les victimes sont les Tutsi et les bourreaux sont les miliciens Interahamwe, groupe composé de jeunes Hutu recrutés et encadrés par la police et l’administration préfectorale et communale pour un sinistre travail : massacrer leurs compatriotes.
-
[11]
Voir Jean-François Dupaquier, Marcel Kabanda et Joseph Ngarambe sous la dir. de Jean-Pierre Chrétien, Les médias du génocide, Paris, Karthala, « Hommes et sociétés », 1995. Ce livre, que convoque le roman de Boris Diop, résume la propagande antitutsi dans les journaux écrits et radio-télévisés, comme Radio Mille Collines. Celle-ci diffusait à longueur de journée, en kinyarwanda, langue nationale, les mots et les moyens pour tuer les Tutsi, entre le 7 avril et fin juin 1994.
-
[12]
Voir Jean-Paul Kimonyo, Rwanda. Un génocide populaire, Paris, Karthala, 2008.
-
[13]
Hannah Arendt, Le système totalitaire, trad. par Jean-Loup Bourget, Robert Davreu et Patrick Lévy, Paris, Seuil, 1972, p. 192.
-
[14]
Ces tribunaux de villages ont été réactualisés à partir du modèle précolonial de règlement de conflits. Ce modèle avait été abandonné au profit du tribunal de type occidental qui, dans le cas du génocide, manqua des ressources nécessaires pour être efficace tant le nombre de suspects était élevé : plus de trois cent mille dans le pays au sortir de la tragédie. – La synthèse sur ce mode de tribunaux se trouve, entre autres études, dans le livre de Phil Clark, The Gacaca Courts, Post-Genocide Justice and Reconciliation in Rwanda. Justice without Lawyers, Cambridge, Cambridge University Press, « Cambridge Studies in Law and Society », 2010.
-
[15]
Tzvetan Todorov, Les abus de la mémoire, Paris, Arléa, 1998, p. 15. Selon Todorov, la mémoire peut être lue soit de manière littérale, soit de manière exemplaire. Dans le premier cas, l’événement est envisagé par le témoin dans sa littéralité, c’est-à-dire que le témoin découvre le groupe qu’il peut rattacher à l’auteur initial de sa souffrance et l’accable à son tour. Au contraire, dans la mémoire exemplaire, il s’agit d’évoquer les violences du passé pour qu’elles servent comme souvenir d’un mal à ne plus commettre pour n’importe quel être humain.
-
[16]
Voir note précédente.
-
[17]
Au moyen de ce personnage, le roman convoque le discours social sur la Françafrique. Voir François-Xavier Verschave, La Françafrique : le plus long scandale de la République (Paris, Stock, 1999) et Noir silence. Qui arrêtera la Françafrique ? (Paris, les Arènes, 2000), et la « Postface » à la réédition de Murambi, op. cit., p. 235-269, dans laquelle Boubacar Boris Diop condamne le rôle de la France avant, pendant et après le génocide. Le pays de Voltaire a armé les soldats qui ont commis le génocide, soutenu les politiciens qui l’ont pensé et mis sur pied une propagande de négation après. Il cite les mots terribles du président socialiste François Mitterrand sur ce sujet : « Dans ces pays-là, un génocide ce n’est pas trop important » (ibid., p. 260).
-
[18]
Ce fut l’opération « Turquoise ».
-
[19]
Jean-Paul Gouteux, Un génocide secret d’État : la France et le Rwanda, 1990-1997, Paris, Éditions sociales, 1998, p. 83.
-
[20]
Sur ce sujet de la culpabilité collective voir le livre de Karl Jaspers, La culpabilité allemande (trad. par Jeanne Hersch, Paris, Minuit, « Arguments », 1990), dans lequel l’auteur examine la culpabilité de l’Allemagne comme entité dans les crimes nazis et dit avoir été déçu que le peuple allemand n’ait pas accompli ce retour sur soi de façon collective. On peut lire aussi le livre de Marie de Solemne (Innocente culpabilité, Paris, Dervy, « À vive voix », 1998) composé d’une série d’entretiens avec plusieurs philosophes, dont Paul Ricoeur.
-
[21]
Le Front patriotique rwandais (désormais FPR) est un mouvement rebelle qui, de 1990 à 1994, combattit l’armée rwandaise au service du dictateur de l’époque, le général Juvénal Habyarimana, dont l’assassinat, le 7 avril 1994, sera considéré comme le début du génocide. Le FPR a fini par vaincre l’armée rwandaise, début juillet 1994, après tant d’atrocités. Considéré par ses partisans comme un mouvement de libération politique, il était notamment composé d’opposants au régime pour des raisons politiques, et des Tutsi, en général, à cause de la ségrégation ethnique et des massacres périodiques que ce groupe subissait depuis les années 1960.
-
[22]
Tout se passe, dans ce roman, comme si Boubacar Boris Diop, jadis admirateur des idées de Frantz Fanon sur les guerres révolutionnaires en Afrique et dans le Tiers Monde, comme toute la gauche africaine, révisait sa position depuis le génocide au Rwanda. Voir les théories de Frantz Fanon exprimées dans Les damnés de la terre, Paris, La Découverte, 2002 [Maspero, 1961], et dans Pour la révolution africaine, Paris, La Découverte, 2006 [Maspero, 1964].
-
[23]
Achille Mbembe, De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine, Paris, Karthala, 2000, p. XVI.
-
[24]
Emmanuel Levinas, Humanisme de l’autre homme, Paris, Fata Morgana, 1972.