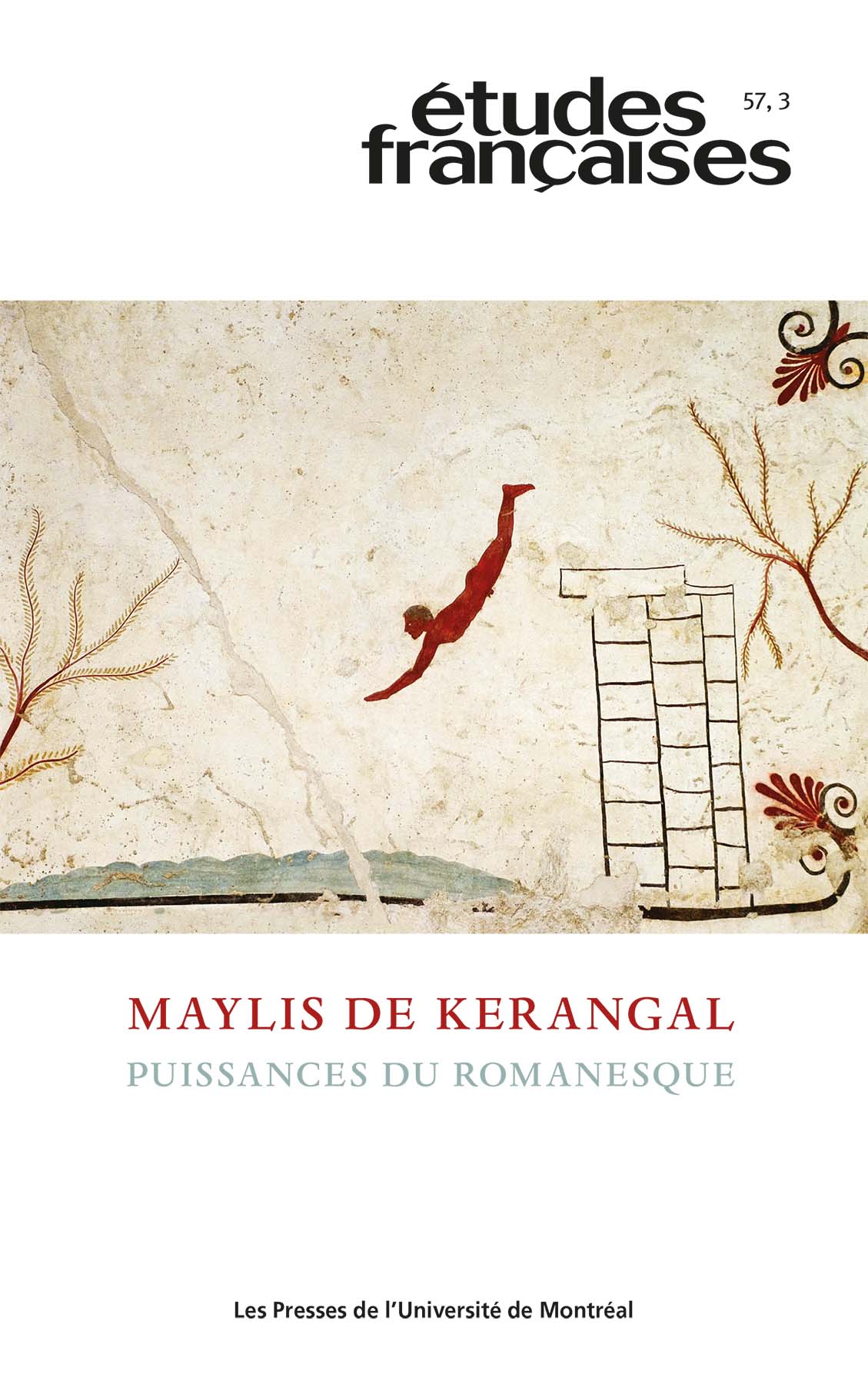Article body
Ce numéro, consacré à Maylis de Kerangal, souhaite explorer plus avant ses affinités avec le romanesque. Il nous apparaît en effet que la plasticité de la catégorie du romanesque permet de « relier » cette oeuvre en cours, de mieux prendre la mesure de sa force d’entraînement et de ses modes d’expansion. D’un livre à l’autre, le romanesque se profile de manière insistante et cohabite avec un ancrage réaliste qui, a priori, s’en écarte. L’inscription du romanesque dans des fictions engagées sur le terrain du « réel » le plus concret constitue un aspect singulier de l’oeuvre de Maylis de Kerangal que ce dossier entend approfondir.
Maylis de Kerangal est aujourd’hui l’un des modèles contemporains d’une « littérature en relations », ouverte sur le monde et les savoirs[1]. « La littérature construit un savoir », écrit-elle, « elle a pour moi des vertus exploratoires et spéculatives[2] ». Ses deux premiers romans, Je marche sous un ciel de traîne (2000) et La vie voyageuse (2003) nous entraînent dans un parcours hanté par le passé. Racontées à la première personne et au passé composé, ces fictions croisent recherche intime et mémoire collective ou familiale dans un geste rétrospectif. Les deux récits brefs de son troisième recueil marquent une inflexion. Ni fleurs ni couronnes et Sous la cendre (2006) placent l’action au coeur de fictions faisant la part belle aux paysages, aux corps et à l’accomplissement d’un désir : quitter l’Irlande pour l’un, faire l’ascension du Stromboli pour l’autre. Avec Dans les rapides (2007), l’action se greffe au périple de trois adolescentes sur les traces de la chanteuse du groupe Blondie. La revendication d’une esthétique embrassant le monde contemporain fait entrer dans la littérature des éléments, tel le rock, restés dans ses marges. Dans ce contexte, le temps verbal du présent s’impose : « Dire cette histoire au présent, c’est un temps qui contient tous les autres, apte à faire respirer le passé autrement que comme le temps toujours un peu crapuleux du souvenir, capable de lui donner du volume, du volume c’est-à-dire de l’espace et du son […] » (DR [3], 19). Prise dans un contexte plus large, la déclaration montre en quoi le parti pris de l’action ne consiste pas à oblitérer le passé. Il s’agit plutôt de l’incorporer au présent des personnages et de l’écriture pour lui donner, comme en écho, plus de « volume », à l’instar de la voix de l’auteure sortie d’un transistor Grundig : voix à la fois présente et passée, intime et étrangère, dont Maylis de Kerangal suit les vibrations et les décalages dans « Placard Grundig », texte inédit qui accompagne ce dossier[4].
Le parti pris du contemporain, de l’action et des sensations physiques se retrouve dans Corniche Kennedy (2008), roman qui s’attache au rituel des plongeons extrêmes[5] d’une bande de jeunes adolescents, à Marseille. Avec Naissance d’un pont (2010), l’arrimage entre un collectif de personnages et l’accomplissement d’une entreprise de grande envergure – construire un pont dans la ville imaginaire de Coca – s’affirme avec force. Dans ce « roman-fleuve » (NP, 4e de couverture) faisant converger technique et poésie, l’intrigue se construit en même temps que le pont suspendu. Réparer les vivants (2014) poursuit dans la même veine chorale, une transplantation cardiaque structurant l’histoire dans une fiction contemporaine où se relaient surf, opérations médicales, émotions, paysages et méditations. Dans Un monde à portée de main (2018), Maylis de Kerangal s’empare de la peinture en trompe-l’oeil en suivant l’apprentissage de Paula Karst, ce qui la mène de l’école de la rue du Métal, à Bruxelles, jusqu’à la légendaire grotte de Lascaux.
De Corniche Kennedy à Un monde à portée de main, le parti pris de la fiction narrative amarrée à des savoir-faire a valu à Maylis de Kerangal attention critique et renommée auprès d’un large public. Sa réputation d’auteure « en prise directe avec le réel[6] », résolue à faire entrer dans le roman des domaines étrangers à la littérature, s’est construite sur cette base. Son exploration du réel tient à l’attention documentée aux lieux comme aux matériaux, aux gestes comme aux glossaires, et s’allie aux expériences pratiques, physiques, d’un « faire », transposées dans la fiction. En ce sens, du roman à l’enquête de terrain, il n’y a qu’un pas que Maylis de Kerangal franchit avec Un chemin de tables (2016), qui suit le parcours d’un jeune chef cuisinier, et Kiruna (2019), reportage littéraire nous transportant dans la mine de Kiruna, en Suède. Notre esquisse d’une oeuvre en plein essor laisse de côté l’exploration plus intime de la voix dans Canoës (2021), « un roman en pièces détachées » (4e de couverture) composé de huit récits brefs, et plusieurs autres récits et essais[7]. L’ensemble témoigne d’une multiplicité d’approches et d’une curiosité féconde. Sans prétendre faire le tour d’un tel ensemble, ce dossier vise à faire ressortir la convergence, dans les fictions contemporaines de Maylis de Kerangal, de l’attention au réel et de la « fantaisie » romanesque. En effet, si l’exploration documentée du réel ressort de façon insistante, les enjeux épistémologiques de l’oeuvre ne se construisent pas contre le plaisir du récit ni n’excluent les « extravagances » imaginaires bannies du roman moderne[8]. Bien au contraire, elle met en relations – puisque relations il y a – savoirs techniques, sciences humaines, poésie et imaginaire romanesque dans des fictions visant à intriguer le lecteur, pariant autant sur le plaisir et l’émotion que sur la curiosité. C’est là, sans doute, le trait le plus contemporain de cette auteure : elle fait du romanesque un matériau d’écriture au même titre que le rock, les bandes de jeunes ou le lexique culinaire. L’« autre planète » (CT, 31), c’est ici et maintenant qu’elle se trouve : dans la découverte de la cuisson du foie gras ou encore « la terra incognita » (RV, 85) du corps de Simon Limbres dont l’activité cérébrale a disparu. Si la découverte et le dépaysement se passent, en l’occurrence, d’exotisme, leur force de nouveauté réactive un imaginaire romanesque puisé dans les films comme dans les livres. La tension féconde entre science, poésie et fiction que Maylis de Kerangal revendique[9] embrasse la « tentation romanesque » à bras le corps, sans mise à distance ludique[10].
Au coeur du romanesque se trouve toujours le désir assumé de raconter (et de lire) des histoires : « Je suis toujours très attachée d’ailleurs à cette idée qu’un livre “raconte” quelque chose[11]. » Pour le dire avec Georges Perec, on trouve, chez Maylis de Kerangal, « le goût des histoires et des péripéties, l’envie d’écrire des livres qui se dévorent à plat ventre sur son lit[12] ». La catégorie du romanesque renvoie dès lors à un ensemble de traits : multiplication des événements sortant de l’ordinaire, personnages héroïques souvent extrêmes, intensité affective ou passionnelle[13]. Cependant, à partir de ces caractéristiques relativement statiques, il faut insister sur l’importance de la tension narrative, qui intègre les affects comme autant d’effets de lecture susceptibles d’exalter les lecteurs[14], de les « transporter » hors d’eux-mêmes[15]. L’« élation vers l’éventuel », que Gilles Declercq et Michel Murat empruntent à Julien Gracq, libère la portée euphorique du romanesque dont le roman moderne se serait, avec Proust et après lui, détourné :
Je n’ergote en rien sur l’admiration que je porte comme tout le monde à la Recherche du Temps perdu, si je remarque que la précision miraculeuse du souvenir, qui de partout afflue pour animer ses personnages, leur donner le rendu du détail vrai avec lequel aucune imagination ne peut rivaliser, les prive en même temps de ce tremblement d’avenir, de cette élation vers l’éventuel qui est une des cimes les plus rares de l’accomplissement romanesque […]. Ce lâchez-tout de ballon libre, dont la sensation nous est donnée de loin en loin dans nos lectures romanesques préférées, et qui est peut-être le couronnement de la fiction, parce qu’il est comme la matérialisation même de la liberté, Proust se l’interdit[16].
La « sensation » que Gracq épingle avec justesse relèverait à la fois d’une mobilisation narrative imaginaire et d’une tension expressive de l’écriture susceptibles d’entraîner le lecteur dans « cette poussée d’avenir […] que rien jamais ne peut figer[17] ». Le romanesque qui nous retient ici pointe vers cette « échappée dans l’imaginaire[18] » mobilisée dans la fiction et dans la langue, dont Maylis de Kerangal s’empare tout en le remodelant à sa main.
La réception critique de Maylis de Kerangal s’est beaucoup intéressée aux romans – en particulier à partir de Corniche Kennedy –, à leur « appréhension liante et collective du monde réel », dont l’approche « socio-ethnologique » relèverait d’une « éthique » fondamentale, celle de « “restituer les expériences”[19] ». Le premier ouvrage collectif consacré à Maylis de Kerangal – dont nous venons de citer la présentation – porte autant sur sa vision du monde que sur ses procédés d’écriture. La « m[ise] en évidence d’une articulation très singulière d’un registre de langue et d’un point de vue sur le monde[20] » montre en quoi l’euphorie romanesque concerne aussi bien les personnages « emportés dans une histoire[21] » que les transgressions grammaticales[22] ou le recours à l’hypotypose[23]. L’ouvrage dégage ainsi des aspects essentiels de l’oeuvre dans le souci constant d’articuler thématique et écriture. La revue Roman 20-50 a, pour sa part, consacré un dossier à trois romans : Corniche Kennedy, Naissance d’un pont, Réparer les vivants. Orientés sur le « roman choral », les articles font ressortir l’importance du collectif, de l’apprentissage, de l’imaginaire des lieux et du monde matériel, là où le roman absorbe et croise les énergies de la prose et la poésie. Caecilia Ternisien trouve, dans « l’image de l’onde », « un point de convergence entre le thème, l’écriture et la composition des oeuvres[24] ». Cette « dynamogénie kerangalienne[25] » recouvre « le choix assumé du romanesque[26] » visant à exalter le lecteur, à le toucher et à provoquer chez lui « la jouissance de connaître[27] ».
Cette énergie coïncide avec la conduite intrigante d’une histoire tendue vers l’horizon d’une fin, mais l’échappée romanesque travaille aussi le texte de l’intérieur : elle démultiplie, ramifie, creuse les lieux, les gestes ou les personnages. Le fantasme américain, très présent dans l’oeuvre, participe de cette échappée : « Coca ! Coca ! Coca ! The Brand New City ! Une zone de prolifération où pullulent entre autres businessmen fébriles, dealers de toutes sortes, adolescents fourbes, dandys opiomanes, usuriers, usurières, filles nyctalopes et assassins en perruque » (NP, 169). Le romanesque s’insère ici dans un foisonnement d’images stéréotypées énumérées en rafale. Une voix lyrique quasi publicitaire proclame, en anglais, le fantasme américain de la ville de Coca, avec son lot de figures extrêmes au relent d’aventure. Ou encore, à propos de l’espace de la réanimation dans l’hôpital, l’imaginaire emboîte le pas au « réel » :
Révol évolue là, au revers du monde diurne, […] oeuvre au creux de ce territoire comme on trafique à l’intérieur d’un grand manteau, dans ses plis sombres, dans ses cavités. […] Il aime […] la fatigue comme un excitant subreptice qui monte graduellement dans le corps, l’accélère et le précise, toute cette érotique trouble ; […] et encore cette physique de la garde, ce climat d’enclave, cette étanchéité, le service comme un vaisseau spatial lancé dans les trous noirs, un sous-marin en plongée au plus profond des abysses, dans la fosse des Mariannes.
RV, 32-33
Ce passage cumule les figures de comparaison. Ces figures nous transportent, au galop, dans une prolifération imaginaire qui stratifie le réel, le creuse pour lui donner volume, résonance, densité. Le recours à l’analogie et aux images frappantes réactivant une mémoire en partie romanesque est assurément l’un des traits de l’écriture de Maylis de Kerangal. L’incorporation du passé dans le présent des personnages que nous avons déjà rencontrée concerne aussi l’encyclopédie romanesque qui, tout comme celle des sciences, confère au récit de l’épaisseur sans nuire à son élan.
Énergie énonciative, réactivation d’une histoire, catalyse des savoirs, stimulation des passions et échappées imaginaires font bel et bien du romanesque une puissance qui canalise, absorbe et lie une diversité d’expériences. Sur la base des études critiques déjà riches et nombreuses consacrées aux romans de Maylis de Kerangal[28], les articles du présent dossier retraversent l’oeuvre dans son ensemble afin de dégager des gestes fondamentaux et des aspects singuliers. L’ouverture du corpus aux reportages littéraires comme aux fictions courtes, la mise en relief des explicit et des personnages secondaires, l’examen des gestes ethnographiques d’écriture ou encore la reconsidération du récit sous l’angle de l’exploration du vivant approfondissent la saisie du romanesque chez cette auteure.
Laurent Demanze ouvre le dossier par une réflexion sur « l’épaisseur du présent » (Ch, 31), justement, qui s’inscrit dans le prolongement de l’ancrage contemporain des récits relevé par la critique. « L’intensité du présent qui arrime l’individu à l’effervescence de se sentir vivant » se double ainsi d’une épaisseur donnant, à ce présent, une expansion (une résonance) inactuelle. À côté d’un romanesque intensif, porteur de « ce tremblement d’avenir » dont Gracq a fixé la formule, s’instaure un romanesque densifié, stratifié, ramenant l’archaïque sous le présent. C’est ce « sillon anthropologique » que Laurent Demanze envisage à partir de trois gestes fondamentaux d’écriture : « se frotter au terrain, décrire densément et s’ouvrir au vivant ».
Poursuivant dans la veine anthropologique, Dominique Viart attire notre attention sur l’élaboration d’une poétique donnant, aux personnages secondaires, une épaisseur telle que la notion même de « personnage secondaire » est remise en question. Ce faisant, Dominique Viart déplace la dynamique de la description kerangalienne en se tournant du côté des figures furtives. L’attention – toute ethnographique – portée à ces figures passe par des micro-scènes et des sommaires susceptibles de condenser, en détail et en vitesse, des existences comme autant de corps à voir, à imaginer, à déchiffrer, et de ressaisir des identités en mouvement sans perdre de vue leur complexité ni les réduire à des types. Un romanesque exigeant trouve, dans le traitement de ces figures marginales, une double force de concentration et d’expansion qui porte la signature de l’auteure.
Le romanesque, cependant, n’est pas l’apanage des fictions. L’« échappée dans l’imaginaire » (Gracq) concerne aussi les reportages littéraires (Un chemin de tables, Kiruna) auxquels Émile Bordeleau-Pitre et Julien Lefort-Favreau s’intéressent. Prolongeant l’exploration des rapports entre la littérature contemporaine et les sciences sociales et humaines, leur article se déplace du côté de la sociologie. Si, dans l’oeuvre de Maylis de Kerangal, « le réel se fait […] matériau privilégié de l’écriture de la fiction », Émile Bordeleau-Pitre et Julien Lefort-Favreau montrent que, à l’inverse, « la fiction peut […] se faire à la fois matériau et méthode privilégiés de l’écriture du réel ». Implication énonciative et émotive de l’enquêtrice ; superposition de la fabulation, de l’imagination et de l’observation ; puissance descriptive des paysages et expansion émotive ou imaginaire de la perception du réel permettent de toucher du doigt les principales modalités de la dynamique entre fiction et enquête de terrain dans les reportages littéraires de l’auteure.
Maïté Snauwaert place le romanesque au coeur de son article. Le romanesque ne serait autre que le « terrain d’exploration » et d’intensification du vivant, et d’un vivre que l’auteure repère selon quatre « dynamiques » en s’intéressant principalement à Un monde à portée de main. D’abord celle qu’elle nomme l’« ingénierie humaine » : les corps de métiers, leurs techniques, leurs gestes et leurs langages fabriquent des mondes ; ensuite les rencontres et les relations « sur le point » de se nouer, qui donnent à l’aventure du vivre une portée considérable. En se tournant vers l’épaisseur temporelle du présent et des personnages, Maïté Snauwaert montre à son tour que Maylis de Kerangal « fait communiquer […] deux échelles de temps » et réactive « l’immémorial » dans « l’immédiat ». Enfin, la narration kerangalienne ne dissimule ni sa présence ni son « émerveillement face au vivant » dont les actions, le devenir et les moments de bascule sont chargés d’une très haute intensité.
Synonyme d’aventure, le romanesque recouvre le récit lui-même dans Ni fleurs ni couronnes, que Marie-Pascale Huglo analyse de près. Dans cette fiction brève, l’histoire du parcours initiatique du personnage adolescent s’avère indissociable d’une poétique narrative. Le jeu croisé de l’intrigue, des scènes, des portraits et des inflexions tour à tour lyriques ou conteuses de la voix narrative, entraîne les lecteurs de façon immersive dans l’histoire qui s’initie. L’exaltation romanesque tient autant à la dramatisation de seuils décisifs qu’à une écriture efficace. Dans cette fiction brève, le « tremblement d’avenir » (Gracq) passe par une mise en oeuvre narrative et poétique particulièrement dense, là où anthropologie, catastrophe historique, imaginaire romanesque et mémoire du conte s’incorporent au récit du garçon pauvre décidé à fuir son village natal.
Il fallait bien évidemment clore ce dossier avec les « dernières images » sur lesquelles Sylviane Coyault se penche. Partant de l’idée que les récits de Maylis de Kerangal renouent avec le romanesque au sens fort (avec des personnages, du suspense et un récit dont l’intrigue trouve à se résoudre), Sylviane Coyault s’arrête sur les « fins superlatives », le plus souvent en « mode scène ». Les images sur lesquelles les romans se bouclent, les phrases (brèves ou longues) qui ramassent les derniers gestes, la sensation d’une ultime ouverture, d’un effacement ou d’un envol font ressortir, outre les emprunts au cinéma, une « confiance humaniste » détonante qui « ose la tendresse » et l’espoir. La scansion de la prose et la force des images reconduisent jusqu’au bout « ce tremblement d’avenir » avec lequel, manifestement, nous n’avons pas fini.
De la force d’entraînement à la force d’approfondissement donnant aux instants comme aux personnages un empan remarquable, le romanesque densifie et intensifie des « échappées » qui trouvent, dans l’image, une modalité exemplaire. Car si le romanesque est d’abord affaire de récit et d’intrigue, c’est aussi sous l’effet des descriptions, des scènes et des analogies qu’il trouve cette puissance de capture qui, dans l’oeuvre de Maylis de Kerangal, s’impose. L’élan romanesque, avec la force imaginative qu’il comporte, donne au réel comme aux fictions un surcroît de présence et d’épaisseur que l’attention aux gestes, aux espaces et aux corps tour à tour précipite, creuse ou dilate.
Appendices
Note biographique
Professeure au département des Littératures de langue française de l’Université de Montréal. Son enseignement et ses recherches portent sur les littératures française et québécoise contemporaines et la création littéraire. On trouvera plusieurs de ses travaux dans Le sens du récit. Pour une approche esthétique de la narrativité contemporaine (Presses universitaires du Septentrion, 2007) et dans Robert Dion et Andrée Mercier (dir.), La construction du contemporain. Discours et pratiques du narratif au Québec et en France depuis 1980 (Presses de l’Université de Montréal, 2019). Elle a dirigé des dossiers pour les revues Études françaises, Voix et images, Textimage, Protée, Temps zéro, SubStance et a participé à plusieurs ouvrages collectifs, dont le plus récent, dirigé par Stéphane Bikialo, porte sur Lydie Salvayre (Classiques Garnier, 2021).
Notes
-
[1]
« À l’inverse des dernières Avant-gardes qui, radicalisant le geste moderne, avaient constitué la littérature en clôture (sur elle-même, dans son intransitivité), en césure (dans une recherche de singularité indépendante des autres espaces de la pensée) et en rupture ; avec les esthétiques du passé), la littérature contemporaine française fait au contraire montre de son ouverture à de nouveaux champs : au monde extérieur et aux disciplines qui l’envisagent. Elle développe des relations » (Dominique Viart, « Comment nommer la littérature contemporaine ? », Fabula, « Atelier de théorie littéraire », décembre 2019 ; disponible en ligne : fabula.org/atelier.php?Comment_nommer_la_litterature_contemporaine, page consultée le 3o novembre 2021).
-
[2]
Maylis de Kerangal, « Fictions du réel et réalité de la fiction », conférence dans le cadre des « Rencontres littéraires » de la Bergische Universität Wuppertal, 14 décembre 2017, p. 2 (disponible en ligne : romanistik.uni-wuppertal.de/fileadmin/romanistik/Rencontres_littéraires/Maylis_de_Kerangal/Conférence_avec_Maylis_de_Kerangal.pdf, page consultée le 3o novembre 2021).
-
[3]
Pour les abréviations des titres des oeuvres de Maylis de Kerangal, voir la « Liste des sigles utilisés dans ce dossier », p. 15.
-
[4]
Voir p. 121-123.
-
[5]
À propos desquels Laurent Demanze évoque avec sagacité le plongeur du Paestum (voir p. 19), à tel point que nous avons voulu que cette silhouette illustre la couverture de notre dossier.
-
[6]
« Travaux publics, je suis ingénieur béton. […] C’est exactement ce que j’aurais voulu faire, un métier fort, concret, un métier en prise directe avec le réel » (NP, 85).
-
[7]
Voir la première section de notre bibliographie, « Oeuvres de Maylis de Kerangal (2000-2021) », p. 125-131.
-
[8]
Alain Schaffner a montré qu’à partir des années 1980, Georges Perec puis Jacques Roubaud font cohabiter le romanesque et les contraintes formelles dans le roman de manière ludique, sans « fai[re] du romanesque l’ennemi à abattre » (« Le romanesque mode d’emploi », dans Wolfgang Asholt et Marc Dambre [dir.], Un retour des normes romanesques dans la littérature française contemporaine, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, « Fiction / Non fiction XXI », 2010, p. 60 ; disponible en ligne : books.openedition.org/psn/2074, § 27, page consultée le 30 novembre 2021).
-
[9]
« [P]lus je suis documentée, plus je suis en phase avec le langage par exemple d’un métier, […] plus l’imaginaire du livre s’enrichit et plus mon imagination se développe, s’active » (« Fictions du réel et réalité de la fiction », loc. cit., p. 3).
-
[10]
Alain Schaffner parle du « retour en grâce » du romanesque dans la littérature contemporaine. Il mentionne trois auteurs contemporains (Hédi Kaddour, Jean Rouaud, Anne-Marie Garat) qui allient le romanesque d’aventures à une recherche, ce qui revient à évacuer les hiérarchies littéraires tenant le romanesque en mépris : « D’une part le goût pour le “romanesque” devient avouable, ce qui conduit à citer comme sources d’inspiration, sur le même plan ou presque, Dumas et Thomas Mann, Gaston Leroux et Marcel Proust […]. D’autre part, l’alternative entre le roman “romanesque” sans grande valeur littéraire et le roman non romanesque, plus exigeant[,] est niée par les trois auteurs, qui veulent réconcilier l’émotion avec la lecture et la qualité d’écriture » (Alain Schaffner, loc. cit., p. 64 ; ou § 38).
-
[11]
« “Remobiliser des lexiques, les réanimer […], repousser, résister à la pression qui voudrait que tout le monde se dirige vers les mêmes mots, vers les mêmes imaginaires” », entretien de Carine Capone et Caecilia Ternisien avec Maylis de Kerangal, Roman 20-50, no 68 (« Maylis de Kerangal. Corniche Kennedy, Naissance d’un pont, Réparer les vivants », dir. Carine Capone et Caecilia Ternisien), décembre 2019, p. 117.
-
[12]
Georges Perec, « Notes sur ce que je cherche », Penser / classer, Paris, Hachette, « Textes du xxe siècle », 1985, p. 10.
-
[13]
Si la catégorie du romanesque ne cesse de se redéfinir, s’il est bel et bien « le “furet” obsédant et fuyant des poétiques et théories du roman » (Gilles Declercq et Michel Murat, « Avant-propos », dans Gilles Declercq et Michel Murat [dir.], Le romanesque, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2004, p. 7), plusieurs traits se dégagent : « [L]’amour (exalté, pathétique), l’événement (inattendu, multiple), le merveilleux (de l’extraordinaire au surnaturel) » ainsi que « l’importance du personnage héroïque, à l’axiologie transparente » (Alain Schaffner, « Le romanesque : idéal du roman ? », dans ibid., p. 268).
-
[14]
Je renvoie ici à la tension narrative dans les termes de Raphaël Baroni : « [L]a tension est le phénomène qui survient lorsque l’interprète d’un récit est encouragé à attendre un dénouement, cette attente étant caractérisée par une anticipation teintée d’incertitude qui confère des traits passionnels à l’acte de réception. La tension narrative sera ainsi considérée comme un effet poétique qui structure le récit et l’on reconnaîtra en elle l’aspect dynamique ou la “force” de ce que l’on a coutume d’appeler une intrigue » (La tension narrative. Suspense, curiosité, surprise, Paris, Seuil, « Poétique », 2007, p. 18). Sans exclure l’intrigue, les auteurs de l’ouvrage collectif Le romanesque (op. cit.) ne l’abordent pas de façon distinctive.
-
[15]
« Quelque chose arrive, “aventure”, qui nous transporte hors de nous-même et qui pourtant satisfait par “conjointure”, au-delà de toute attente, notre désir de causalité » (Gilles Declercq et Michel Murat, « Avant-propos », loc. cit., p. 8).
-
[16]
Julien Gracq, « Proust considéré comme terminus », En lisant en écrivant, Paris, Corti, 1991 [1980], p. 95-96.
-
[17]
Ibid., p. 96.
-
[18]
Bruno Blanckeman, Les récits indécidables. Jean Echenoz, Hervé Guibert, Pascal Quignard, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, « Perspectives », 2000, p. 29.
-
[19]
Maylis de Kerangal citée par Mathilde Bonazzi, Cécile Narjoux et Isabelle Serça, « Une écriture “avitaillée au multiple” », dans Mathilde Bonazzi, Cécile Narjoux et Isabelle Serça (dir.), La langue de Maylis de Kerangal. « Étirer l’espace, allonger le temps », Dijon, Presses universitaires de Dijon, « Langages », 2017, p. 8.
-
[20]
Ibid., p. 9.
-
[21]
Ibid., p. 12.
-
[22]
Stéphane Chaudier et Joël July, « Des corps et des voix : l’euphorie dans le style de Maylis de Kerangal », dans Mathilde Bonazzi, Cécile Narjoux et Isabelle Serça (dir.), op. cit., p. 131-142.
-
[23]
Claire Stolz, « Poésie et fiction, l’hypotypose chez Maylis de Kerangal », dans ibid., p. 159-169.
-
[24]
Caecilia Ternisien, « L’onde. Corniche Kennedy et Réparer les vivants de Maylis de Kerangal », Roman 20-50, no 68 (« Maylis de Kerangal. Corniche Kennedy, Naissance d’un pont, Réparer les vivants », dir. Carine Capone et Caecilia Ternisien), décembre 2019, p. 87.
-
[25]
Ibid., p. 80.
-
[26]
Cécile Yapaudjian-Labat, « Lire Maylis de Kerangal, “c’est dingue” ! », Roman 20-50, no 68, déjà cité, p. 11.
-
[27]
Ibid., p. 14.
-
[28]
Voir la deuxième section de notre bibliographie, « Bibliographie critique (2009-2021) », p. 131-138.