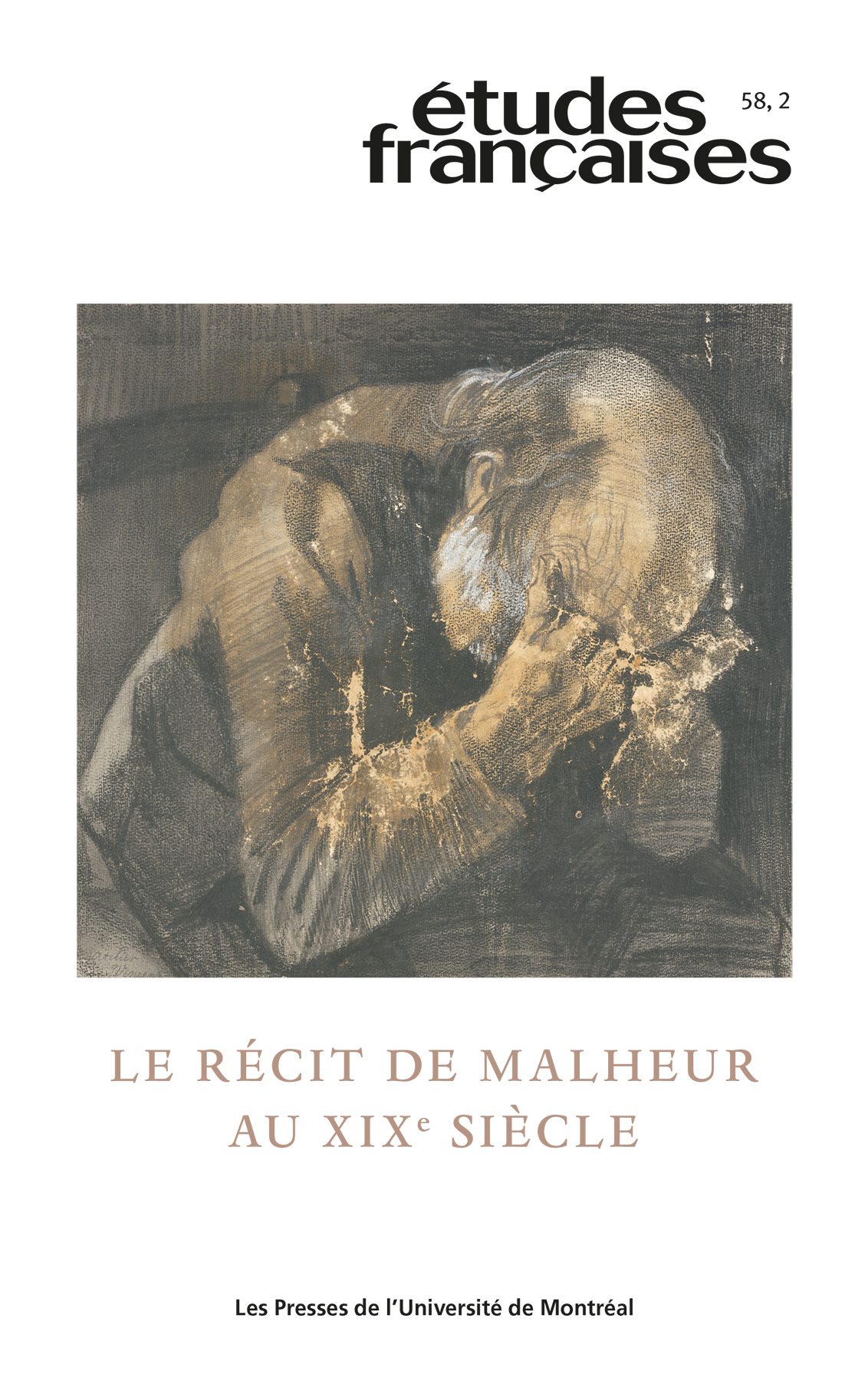Abstracts
Résumé
Cet article montre comment Jeanne, roman champêtre et roman social, est aussi un roman tragique et un roman du malheur. Son héroïne, une jeune paysanne analphabète qui vit en symbiose étroite avec la nature, meurt en se jetant d’une fenêtre. Ce roman du malheur se construit à partir des représentations du milieu paysan dans la France du premier xixe siècle, en comparaison avec d’autres classes sociales – notamment la bourgeoisie. C’est le conflit entre ces différentes sphères et leur idéologie respective qui fait malheur. Mais cette expression du malheur rehausse finalement les valeurs incarnées par Jeanne et, paradoxalement, ici, fait poésie.
Abstract
This article shows how Jeanne, a pastoral novel and a social novel, is also a tragic novel and a novel of misfortune. Its heroine, a young illiterate peasant who lives in symbiosis with nature, dies jumping from a window. This novel of hardship builds upon the representations of the rural society in France, in the first 19th century, compared with other classes—notably the bourgeoisie. It is the conflict opposing these different spheres and their respective ideology that brings about misfortune. But this expression of misfortune ultimately emphasizes the values embodied by Jeanne, and paradoxically, here, brings about poetry.
Article body
Roman de 1844, Jeanne précède et annonce la série des romans champêtres de George Sand, La Mare au Diable, François le Champi et La Petite Fadette, comme le précise la romancière dans la « Notice » qu’elle rédige en 1852. Le texte cependant se distingue de ceux qui le suivront quelques années plus tard par sa dimension fortement symbolique, puisqu’il s’agit de réfléchir à la « société moderne[1] » en mettant en scène en contrepoint une anhistoricité idéale incarnée par la protagoniste. Car cette société se définit d’emblée par ce qu’elle exclut, à savoir les qualités du personnage éponyme, présenté non pas comme un simple type – ce qui reviendrait à l’inclure dans la sphère sociale –, mais comme une entité complexe : c’est la « femme primitive », la « vierge de l’âge d’or[2] », délibérément située en dehors de l’Histoire et pourtant facteur de cohésion de l’intrigue. À rebours de ce qu’avance la préfacière, qui dit chercher à « oublier et faire oublier à [s]on lecteur le monde moderne et la vie présente » (J, 45), le roman propose ainsi une réflexion sur ce monde.
L’oeuvre fonde en effet la diégèse sur l’articulation du devenir de Jeanne et celui des trois protagonistes masculins qui décident sans le savoir de leurs destins croisés, comme le montre la scénographie du « Prologue », situé en 1816, quatre ans avant le début de l’histoire. Une jeune pastoure endormie (Jeanne) y est montrée au centre des regards et des observations des trois hommes qui la découvrent sur la « montagne aux pierres » (J, 48) lors d’une partie de chasse. Amorce d’une fiction qui se déploiera ultérieurement (en 1820, à partir du chapitre I), cette ouverture met au jour le clivage social qui fera socle à l’argument de l’oeuvre et tout aussi bien au traitement philosophique et symbolique qui en est proposé. Les « trois jeunes gens » (J, 48), un « jeune licencié en droit » (J, 49), Léon Marsillat, type même du bourgeois, un jeune baron, Guillaume de Boussac, et un riche lord anglais, sir Arthur, examinent une paysanne endormie et par là même réduite à l’état d’observable, tour à tour désignée comme un objet (« Cela » ; J, 52) et comme un animal : « La race du pays est comme cela », énonce Marsillat, « [c]’est la même chose pour les poulains et les taureaux » (J, 52). À cette dichotomie qui oppose trois sujets actifs à un objet passif s’en superpose une deuxième, qui fait contraster « monde moderne » et monde primitif. La jeune fille – anonyme à ce stade – est assimilée à deux modèles littéraires antinomiques : la Lisette de Béranger[3] et la druidesse Velléda de Chateaubriand[4]. Le narrateur, quant à lui, choisit d’extraire le personnage féminin du temps : la dormeuse est à ses yeux une représentante du « pur sang de la race gauloise primitive » (J, 53), assimilable à un pur produit de la nature[5] mais tout aussi bien à « ces beaux types que l’art grec a immortalisés » (J, 53). Jeanne, simple paysanne (et paysanne simple), illettrée et dévolue à des tâches prosaïques, cristallisera une rêverie mythologique dont l’une des fonctions sera précisément – on le verra – de transformer le personnage de roman en symbole. Semblable à « l’effet papillon », cette rencontre en apparence insignifiante détermine aussi bien le devenir des observateurs que celui de la jeune fille. Une phrase du « Prologue » annonce cette double prédictibilité : les trois jeunes gens ayant déposé chacun un don dans la main de la bergère (une pièce d’or, une pièce d’argent et cinq sous) s’éloignent, « croyant avoir porté bonheur à l’enfant, chacun à sa manière, et ne se doutant guère que leurs aumônes allaient devenir dans sa petite main l’instrument de leurs destinées » (J, 55 ; je souligne).
Un déterminisme magique s’inscrit alors dans le texte dont il oriente la lecture, indissociable du double paradigme bonheur / malheur. La modalisation verbale (« croyant avoir porté bonheur ») suggère de fait une réversibilité de la formule, que confirme par la suite la reprise de cette scène initiale, qui sera élucidée dans le chapitre XVI du roman[6], et son dénouement dans le chapitre XXIV intitulé « Malheur » (J, 302). Il s’agira de suivre la trajectoire de ce bonheur fallacieusement annoncé jusqu’au malheur finalement proclamé qui clôt le parcours de la vie de Jeanne et des trois hommes qui ne cesseront de l’accompagner, à la lumière de la réflexion politique et sociale qui sous-tend l’écriture de la fiction dont se dégagera in fine la poétique.
Le scénario du malheur ou le réemploi de topoï éprouvés
Ce roman du bonheur annoncé se transforme donc en roman du malheur dès ses premiers chapitres, où le personnage de Jeanne, soeur de lait de Guillaume de Boussac de retour au pays, subit successivement les aléas d’une « sérialité malheureuse[7] ». Alors qu’il s’apprête à rendre visite à sa nourrice longtemps délaissée, Tula, sans savoir qu’il s’agit de la mère de Jeanne, Guillaume apprend la mort imminente de cette femme. C’est d’abord sur un mode mineur que s’annonce l’épreuve, portée par la voix des paysans, telle la mère Guite qui s’afflige, alors que le père Léonard, le sacristain-fossoyeur, prépare la fosse au cimetière : « [C]’est un grand malheur pour nous, qu’elle s’en aille comme ça, tout d’un coup… Elle avait des secrets » (J, 71). Les retrouvailles espérées par Guillaume se font ainsi avec une morte, ce qui « frapp[e] le jeune homme d’une émotion sinistre » (J, 76). Pourtant, l’épreuve du deuil concerne avant tout la fille de Tula, Jeanne, que Guillaume découvre prostrée, les joues ruisselantes, saisie par « l’immobilité de sa consternation » (J, 79), figée dans « l’apparence d’une statue » (J, 79) dans « [l]a maison de la morte » (titre du chapitre III). Le thème du deuil permet d’évoquer le rituel funéraire en même temps qu’il rapproche opportunément Guillaume de Jeanne, assurant les assises de la fiction, car c’est le secours que le jeune baron de Boussac accordera à l’orpheline qui rapprochera leurs deux destinées sur le plan romanesque et qui motivera l’analyse sociale que ne manquera pas de susciter cette situation : « [J]e prends tant d’intérêt à votre malheur, que je voudrais pouvoir au moins vous prouver que vous avez trouvé aujourd’hui un appui » (J, 94), promet le jeune homme que sa soeur de lait qualifie naïvement de « parrain » (J, 89). Ce premier malheur assure donc une fonction diégétique majeure car il dévoile l’échiquier des relations interpersonnelles et l’axiologie qui leur est inhérente en distinguant notamment la sincérité (la douleur muette de Jeanne) de la feinte (les sanglots que la Grand’Gothe, la tante de Jeanne, fait entendre « d’une manière criarde et forcée » ; J, 84), ou de l’hypocrisie (celle de Marsillat qui tente de séduire Jeanne alors qu’il prétend l’aider). Le malheur est d’abord un agent discriminant qui détermine les forces en présence et assure la dynamique du récit, comme se plaît à le souligner le texte : « [L]e concours de circonstances romanesques qui l’avait amené [Guillaume] auprès de Jeanne, juste à point pour conjurer les dangers qui la menaçaient, lui causait une sorte de satisfaction généreuse » (J, 91). Mais pour rendre possible la déterritorialisation de l’héroïne, qu’il faut arracher à son milieu pour faire jouer à plein les forces de la fiction et dévoiler l’ampleur des enjeux sociaux du roman, la dramatisation croissante et le redoublement du malheur qu’assurent les premiers chapitres sont nécessaires.
La séquence suivante est consacrée à l’incendie qui dévore la maison de Jeanne, frappée par la foudre, le même jour, et joue comme réduplication dramatique de la structure mise en place. Ayant tout perdu, la jeune fille est victime d’un double deuil et comme privée d’identité (elle a grandi dans cette maison, qui contient ses maigres souvenirs), sur quoi insiste le texte : « Cette pauvre Jeanne, c’est trop de malheur comme ça pour elle dans un jour ! » s’exclame le fossoyeur (J, 118). Ce double malheur a pour effet de faire de Jeanne un personnage vacant, ouvert aux choix multiples de la fiction et d’autant plus intéressant que cette nouvelle épreuve a mis en évidence son caractère « sublime » lorsqu’elle s’élance dans les flammes pour préserver le corps de sa mère défunte. Les propos des témoins : « Non ! le pauvre monde est trop malheureux ! Alas ! mon Dieu ! alas ! faut-il ! alas ! Jésus ! » s’assimilent à « un choeur de gémissements comme celui des captives de la tragédie grecque » (J, 122). Dès lors, la matrice de la tragédie surdétermine explicitement la fiction, comme le suggérait déjà le titre du chapitre VI, « Le feu du ciel » (J, 112), ce que corrobore l’acte insensé mais idéalement motivé de Jeanne, qui révèle dans l’action la dimension sacrée, et donc autre, du personnage. Le jeune paysan, Cadet, assure, alors même qu’elle s’est précipitée dans les flammes : « [L]a Jeanne n’attrapera pas de mal. Alle a ce qu’il faut et alle sait les paroles de la chouse » (J, 123). Cet « acte de piété farouche et sublime » (J, 124) concède à Jeanne, désormais digne d’accéder au rôle d’héroïne tragique, une envergure d’exception. C’est pourquoi elle dérèglera bien malgré elle les transactions sociales – notamment matrimoniales – censées réguler la vie des habitants du château de Boussac, où elle est accueillie sur la proposition du curé Alain et de Guillaume. À Boussac, l’étrangeté de Jeanne, mais aussi sa grande beauté, font d’elle le centre de gravitation des actes et des pensées des trois protagonistes masculins – les mêmes qui étaient apparus dans le « Prologue » quatre ans plus tôt : Guillaume, Marsillat et sir Arthur. Le détraquement engendré par cette configuration est responsable de l’éviction de la jeune fille, qui la confrontera à un troisième malheur, produit cette fois d’une situation narrative explosive[8], lorsqu’elle échouera en s’enfuyant à la tour de Montbrat, le repère de Marsillat. C’est le malheur ancillaire qui menace alors de s’abattre sur l’innocente pastoure que Léon s’emploie à séduire.
Si les acteurs du roman agissent pour le bien ou à l’inverse pour le malheur de Jeanne, les lieux qu’elle traverse au cours de son périple, qui prend la forme de l’exil, puis de la fuite, sont fortement connotés. Dans les chapitres XXI et XXII, la tour de Montbrat, définie en tant que « quelque chose comme la petite maison des champs d’un bourgeois libertin » (J, 276), fait surgir les réminiscences gothiques chères à George Sand, dont étaient antérieurement apparus les signes météorologiques disrupteurs avec le fatal orage[9]. Le château de Montbrat, « une ruine imposante située sur une montagne » (J, 273), a en effet tout de la forteresse noire où sera persécutée la victime innocente[10] :
Quoiqu’il ne restât pas un corps de logis, pas une seule tour entière, le préau, encore entouré de grands pans de murailles […] formait un enclos très bien fermé, grâce au soin que l’on avait eu de barrer le portail qui avait autrefois renfermé la herse, par de fortes traverses en bois brut, solidement cadenassées.
[…]
[…] La porte étroite et basse et le couloir étranglé entre les murailles de quinze pieds d’épaisseur conduisaient à une petite pièce ronde […]. Mais il faisait trop sombre pour que Jeanne se livrât à aucune remarque, et quoiqu’elle se sentît un peu effrayée du silence et de l’obscurité de cette demeure, elle était encore loin de se douter qu’elle fût dans la chambre de Marsillat […].
J, 274-275
Traquée, la jeune fille s’échappe en sautant par la fenêtre de la tourelle[11] et passe d’abord pour morte : « Il n’y a qu’un petit malheur, c’est que la fille est morte !… » constate Raguet « avec un accent d’indifférence atroce » (J, 303). Jeanne survivra pourtant quelque temps mais finira par s’éteindre des suites d’une commotion cérébrale conformément, semble-t-il, au programme annoncé par le titre du chapitre XXIV, « Malheur », qui précède la conclusion du roman, centrée sur l’agonie de l’héroïne. Peut-on pour autant définir Jeanne comme un roman du malheur en considérant ce dernier comme un simple ingrédient romanesque générateur d’action ?
Sociopoétique et ethnopoétique du malheur
En réalité, l’avènement du malheur dans Jeanne est lié à deux facteurs déterminants : la confrontation des classes sociales et l’étude des croyances et rituels propres au monde paysan. Le roman requiert ainsi une double lecture complémentaire, sociopoétique et ethnopoétique. De même que la sociopoétique s’intéresse à la façon dont l’écriture des représentations sociales dans un texte littéraire induit des choix spécifiques en matière de poétique, nous considérons qu’une approche ethnopoétique interroge la réappropriation littéraire par l’auteur de composantes ethnologiques. Dans son chapitre « L’ethnographie poétique sandienne, fabrique d’idéal. Regards sur les fêtes populaires du Berry », Simone Bernard-Griffiths précise ainsi que « l’ethnographie sandienne s’inscrit dans un sillage de fiction et se veut ethnopoétique, c’est-à-dire création littéraire issue de représentations ethnographiques[12] ».
On constate en premier lieu que la confrontation des classes contribue fortement à faire de cette oeuvre un roman du malheur, comme le laisse attendre la scène inaugurale du « Prologue ». La mise à distance de l’objet « paysan » – et plus encore « paysanne », la question du genre étant primordiale dans la fiction où les amours ancillaires sont évoquées à plusieurs reprises et incarnées par Marsillat – augure en effet d’un traitement polémique de la question sociale, qui dénonce l’inertie des représentations de classe. De fait, le retour de Guillaume de Boussac introduit dans un premier temps un regard fortement dépréciatif : l’antique cité gauloise de Toull-Sainte-Croix est à ses yeux un « pays inculte, dépeuplé et presque sauvage » (J, 58) car le jeune baron « aimait la campagne et les pays de loin », « [d]e près, il les trouvait rudes, malpropres et cyniques » (J, 65). Si l’appréciation de ce personnage est amenée à évoluer au contact de Jeanne, qui opère en la matière une sorte de conversion, le narrateur n’en multiplie pas moins les situations qui rendent incompréhensions et dissensions saillantes entre petite noblesse, bourgeoisie de province et paysans, reflétant ainsi les réflexes tributaires des représentations sociales de l’époque. La question sociale joue d’ailleurs à tous les niveaux de la narration puisqu’elle divise le groupe en réalité fragile et traversé de tensions multiples formé par les trois protagonistes masculins. On apprend ainsi que Guillaume croit « faire acte de courage et de libéralisme en attirant quelquefois à Paris son ancien camarade [Marsillat], le licencié en droit, à la table et dans le salon de sa mère. Mais, malgré ses avances, le jeune baron s’était refroidi chaque jour davantage à l’égard de son ancien camarade » (J, 86[13]). La difficulté de communication entre lettrés et non-lettrés souligne plus encore les écarts de classe. La parlure des paysans (composante ethnographique de l’écriture[14]) importe moins en l’espèce que le jeu sur les signifiés : Jeanne, ignorante du sens figuré, n’accède qu’au premier degré, ce qui plonge Guillaume dans une réelle perplexité, voire une certaine gêne, quand il ne s’agit pas de vrais quiproquos[15]. Les codes de la comédie qui informent la fiction sont alors au service d’une lecture critique de la prégnance des stéréotypes – ces « clichés mentaux stables, constants et peu susceptibles de modification », qui « sont constitutifs de l’opinion d’un groupe[16] » – ici dévoilés.
De cet écart infranchissable témoigne encore la difficile interpénétration des espaces, socialement marqués, phénomène auquel un personnage caricatural comme Mme de Charmois, la sous-préfète, est particulièrement sensible. Le narrateur dit de Jeanne lorsqu’elle est installée dans la ville de Boussac qu’elle est « [t]ransplantée brusquement de sa vie sauvage à un état de civilisation » (J, 195), expression qui met au jour les clivages insolubles qui divisent la société et séparent les simples des bourgeois. Car ces espaces sont mentalement et socialement prédéterminés et régis par des lois intériorisées, incompatibles entre elles. Le savoir-vivre interdit ainsi de partager une même monture : « Une paysanne sur le même cheval qu’un paysan, n’a jamais fait jaser personne. Avec un bourgeois, c’eût été bien différent » (J, 148). De même Mme de Charmois s’émeut-elle de la présence de servantes dans la chambre des demoiselles Marie et Elvire dès lors qu’il s’agit de partager un espace intime sur un pied d’égalité : « Eh ! croyez-vous que ce soit bien convenable de laisser nos filles se divertir dans la compagnie de ces servantes ? » (J, 157) Les interactions sociales sont régies par des codes et des usages jugés incompatibles par ceux des personnages qui incarnent l’immobilisme condamnable de la doxa dans la sphère de la petite noblesse et de la bourgeoisie.
C’est pourquoi le thème du retournement carnavalesque et plus largement celui du travestissement importent sur un plan structurel et symbolique. « Le poisson d’avril » (chapitre XI) qui transforme les deux paysannes, Claudie et Jeanne, en « dames de la ville » (J, 164) a fonction de révélateur. Là encore, Sand se réapproprie une composante ethnographique qu’elle fictionnalise (la tradition du poisson d’avril[17]) et convertit en ressort comique, et qui révèlera l’emprise des réflexes de classe, ce qui est une façon de renforcer plaisamment l’étude au demeurant fort sérieuse et à l’issue tragique – on le verra – de ces représentations groupales. Si Claudie reste rivée à sa condition, que dénonce son type aisément reconnaissable, la belle pastoure, quant à elle, « était aussi belle en demoiselle qu’en villageoise » (J, 165). Pour autant, cette possible translation d’une catégorie à une autre n’est pas envisageable dans une société fondée sur la partition et l’ostracisme, ce qu’affirme avec vigueur la sous-préfète qui n’entend pas diffuser la supercherie : « Dans ma position, je ne puis me permettre de rire avec mes administrés. [… Cela] les mettrait avec moi sur un pied d’intimité […] » (J, 166). Le travestissement a donc pour effet de distinguer les différents spectateurs : offusqués comme la Charmoise ; figés dans leur complexe de classe comme Cadet qui « baiss[e] modestement les yeux » en croyant voir « deux dames de plus au fond du salon » (J, 167) ; lucides comme Marsillat qui se fie de façon instinctive à sa seule reconnaissance des corps, au-delà de toute considération sociale[18] ; ou généreux et sensibles comme l’Anglais sir Arthur qui se laisse prendre de bonne foi au subterfuge redoublé lorsqu’il croit voir en Jeanne une gouvernante anglaise, miss Jane, comme le lui fait croire Marie de Boussac. Si sir Arthur adhère jusqu’au bout à l’illusion, c’est parce que Jeanne lui apparaît, non pas à travers son identité sociale, mais à travers les qualités qui lui sont inhérentes. Cette scène du roman permet dès lors d’évaluer la capacité de certains personnages à se délester du poids des idées reçues, à la façon d’élus insensibles à la pression du groupe.
Dans la « Notice » de 1852, Sand regrette d’avoir mêlé Jeanne « à des types de notre civilisation », ce qui selon elle a nui à la parfaite exploitation du personnage dont n’apparaîtrait pas « la vraie grandeur » (J, 44). « Je fis un roman de contrastes », poursuit-elle, « mais je me sentis dérangé de l’oasis austère où j’aurais voulu oublier et faire oublier à mon lecteur le monde moderne et la vie présente » (J, 44-45). Ce sont précisément ces contrastes qui, en renforçant la dimension idéologique et politique du roman, permettent d’engendrer une fiction sous-tendue par la dialectique fortement symbolique du bonheur et du malheur. Si la perméabilité sociale s’avère impossible « [à] cette époque [… où] le mélange qui s’était heureusement établi entre les gens de mérite de toutes les classes n’était encore qu’un fait exceptionnel » (J, 86), le choix du « contraste » permet d’interroger de plus près la nature de ces incompatibilités.
La dimension ethnographique du roman vient compléter cette étude en rendant palpables les spécificités de la classe paysanne, portées à leur point culminant par la personnalité hors norme de Jeanne. Les clivages précédemment soulignés reposent en effet sur une apparente dépréciation de l’héroïne qui se distingue de ses semblables par un mutisme et une asocialité exacerbés dont l’origine n’est dévoilée que tardivement ; ainsi, « Jeanne passait aux champs pour une fille très-bornée » (J, 92), position que traduit le narrateur en d’autres termes en la qualifiant d’« être ignoré, inaperçu » (J, 94). Ce caractère est toutefois tributaire d’un milieu dont sont décrits les us et coutumes et, on l’a dit, la parlure, ce « patois marchois » qui « devient inintelligible aux oreilles non exercées à cause de ses brusques élisions et de la volubilité que les femmes surtout mettent à le débiter » (J, 69). Sand explique en note avoir choisi de ne mettre dans la bouche de ses personnages qu’une « traduction libre » (J, 69) de ce langage, mais il n’en reste pas moins que sa particularité détermine un territoire fortement imprégné des croyances qui lui sont propres. Guillaume de Boussac saisit ainsi, dans les propos échangés par la paysanne et le fossoyeur, « des paroles étranges qui le frappèrent », moins par leur formulation que par les référents énigmatiques auxquels elles renvoient : « Il était toujours question de boeuf d’or, de veau d’or, de trésor, de trou à l’or […] » (J, 69). Légendes, superstitions et idolâtrie caractérisent cette population, comme le déplore le curé Alain. La ligne de la croyance fait fracture et détermine deux univers inconciliables. De rares personnages, comme Marie de Boussac, font état sans moquerie ni ostracisme de ces croyances. Elle explique ainsi à Jeanne connaître l’histoire du boeuf d’or et l’existence des fades tout en prenant soin de se distancier des croyances qu’elle évoque, ce que traduit la médiation répétée des tournures impersonnelles : « On dit aussi qu’il y a un veau d’or […] » (J, 225), « [o]n dit encore que si quelqu’un […] vient à rencontrer le boeuf, le boeuf l’épouvante […] » (J, 225), etc. Marie joue dans la scène du chapitre XVII le rôle de l’analyste et fait état, en rapportant les propos de Marsillat, d’une situation de profonde incommunicabilité : « [P]resque tous les habitants de Toull et des environs cro[ient] fermement à cette folie, quoiqu’ils ne l’avouent pas aux bourgeois » (J, 226). Le plus souvent, c’est sur le mode de la méfiance que s’évoque cette partition radicale, revendiquée de part et d’autre. Jeanne ignore ainsi les vertus de la médecine : « [N]ous ne croyons pas à ça, nous autres » (J, 96 ; je souligne). De telles expressions – « nous autres », « chez nous » (J, 104) – marquent la césure ethnologique et sociale qui fait l’objet qu’étudie ce roman. Il s’agit en effet pour George Sand de mettre en fiction la confrontation et l’éventuelle interaction de ce que Marie Scarpa nomme « cosmologies culturelles » :
Nous faisons l’hypothèse que les traits de culture présents dans l’oeuvre littéraire (ce qu’on pourrait nommer des culturèmes) s’organisent en systèmes discursifs et en cosmologies culturelles, toujours métissés et pluriels. Notre objet est donc l’analyse de cette dialogisation, au sein de l’oeuvre, d’univers symboliques plus ou moins hétérogènes et hybrides (à savoir les jeux incessants entre culture orale et culture écrite, culture folklorique et culture officielle, populaire et savante, religieuse et profane, féminine et masculine, légitime et illégitime, endogène et exogène, etc.)[19].
Cette différence de culture et cette propension à adhérer à ce que Sand nommera plus tard la « merveillosité » des campagnes[20] génèrent une réflexion sur les facultés d’esprits différents : « L’ingrate Rhéa frappe- t-elle de stupidité ses enfants et ses serviteurs ? » (J, 98) feint de se demander le narrateur. Cette question rhétorique débouche néanmoins sur une apologie de la singularité exemplairement incarnée par Jeanne, ce qui conduit à réévaluer sous un autre angle la question du malheur.
La poésie du malheur, une écriture paradoxale
Le malheur ordinaire (deuil, perte, menace de viol) joue dans le roman, on l’a vu, un rôle diégétique majeur. Mais il est parallèlement, dans ce contexte, une autre conception du malheur, a priori tributaire de pouvoirs occultes. Les croyances populaires précédemment évoquées, en effet, tirent leur force de leur lien avec bonheur et malheur, conçus comme justes rétribution ou châtiment, comme l’explique Jeanne à Claudie : « Il y a des personnes que les esprits ne tourmentent jamais. Mais il y en a d’autres qui sont bien forcées de savoir de quoi il s’agit, et le moyen de se garer des mauvais pour être bien avec les bons » (J, 209). Et, de façon plus explicite encore, à Marie de Boussac : « Eh ! Mam’selle, c’est bien simple ; elles [les fades] sont filles de Dieu ou filles du diable. Elles nous aiment ou nous haïssent, nous soulagent ou nous tourmentent, nous conservent dans le bien ou nous jettent dans le mal […] » (J, 225). Pour autant, ces pouvoirs supposés n’ont rien de surnaturel mais dépendent de la qualité intrinsèque du sujet : « Quand une personne a la connaissance, elle fait son salut en restant sage. Quand elle ne connaît rien, il lui vient des mauvaises pensées, et elle se laisse aller au mal sans savoir comment » (J, 225). De même, le boeuf légendaire ne génère bonheur ou malheur qu’en fonction de la nature de la personne qui croise son chemin : « [S]i quelqu’un, coupable d’une mauvaise action, vient à rencontrer le boeuf, le boeuf l’épouvante, le poursuit, et peut le tuer ; au lieu que si la personne est en état de grâce, et marche droit à lui, elle n’a rien à craindre » (J, 225). Ces quelques exemples montrent qu’en réalité ces croyances en des figures fabuleuses n’ont d’incidence sur la destinée du sujet qu’en tant qu’elles déterminent son comportement en fonction de ses convictions morales et spirituelles. La connaissance dont il est fait mention désigne une forme de sagesse, qui consiste à respecter les préceptes d’une vie humble et juste, ainsi qu’une faculté supérieure, moins intellectuelle qu’intuitive, j’y reviendrai. La notion recouvre aussi un ensemble de savoirs, qui s’appuie sur le respect de codes symboliques partagés par la communauté. Revient ainsi à plusieurs reprises l’affirmation que l’or porte malheur, en vertu d’une association entre le métal précieux et la richesse, indissociable de vices multiples (stupre ou abus de pouvoir par exemple) : « L’or, on croit chez nous que ça porte malheur » (J, 104), explique Jeanne à Guillaume en refusant son argent dans le chapitre V. La jeune fille réaffirme de la sorte son appartenance à une communauté dont elle choisit de respecter les codes. Elle s’en expliquera plus clairement à Marie de Boussac dans la conversation déjà évoquée sur les croyances paysannes :
— […] Est-ce qu’on ne vous a pas dit que pour n’être pas en danger, il faut n’avoir jamais eu de l’or tant seulement un brin en sa possession ?
— C’est vrai, on me l’a dit aussi. Vous pensez donc que l’or porte malheur ?
— Ça, j’en suis bien sûre ! Toutes les fois qu’un bourgeois en a montré à une fille, elle a quasiment perdu l’esprit, et elle s’est rendue à lui, quand même il était vieux, méchant et vilain. Eh bien ! le jour où je trouvai de l’or dans ma main, je commençai par le jeter bien loin de moi.
J, 226
Cet échange suit la découverte par Jeanne du mystère de la triple aumône dont elle hérita quatre ans plus tôt au mont Barlot. C’est en effet dans le chapitre précédent que Guillaume, Léon et sir Arthur découvrent la jeune fille « abritée contre une grosse roche, […] profondément endormie » (J, 217), et prennent conscience à cette occasion que la jeune Velléda assoupie dans la nature, longuement examinée par eux autrefois et finalement dotée de trois pièces, dont un louis d’or, était Jeanne. Et c’est à cette occasion qu’ils lui révèlent l’origine de ce don, qui avait suscité en elle une profonde méfiance. « [J]e savais que l’or portait malheur », répète-t-elle à Marie, lui racontant comment elle s’est promptement séparée de la pièce d’or, avant que sa mère ne l’instruise de la probable action des fades, auréolant de sacré ce simple épisode. On voit que Sand oppose dans le roman deux classes sociales et deux modes de pensée distincts, qu’elle n’hésite pas à rattacher à deux origines différentes. Comparant ces deux classes, Isabelle Hoog-Naginski écrit : « L’une, dominant par son pouvoir politique, son argent, son savoir […], est représentée par les citadins “modernes” […]. L’autre, démunie de pouvoir politique et économique, muette et invisible dans le discours bourgeois qui prédomine, a été négligée dans les campagnes[21]. » Dans Jeanne, la crainte associée à l’or, réputé porter malheur, traduit ce clivage et met en lumière deux systèmes de pensée, l’un affilié à la productivité économique viciée (les citadins, les bourgeois, fils d’Ève, héritent du Mal originel qu’ils perpétuent), et l’autre caractérisant une classe exploitée et analphabète – celle des paysans dont Jeanne figure la quintessence idéale – « réhabilitée par Sand comme la preuve d’un savoir plus authentique et plus valable[22] ».
Mais le chapitre XVI, qui reprend en l’élucidant le « Prologue », loin de substituer une explication rationnelle à une lecture surnaturelle de l’épisode, confirme le fonctionnement de l’esprit paysan, un esprit non pas entaché de stupidité mais mû par une juste intuition des choses. Ainsi Jeanne, alors même qu’elle détient désormais l’ensemble des informations qui lui permettent de démystifier cet épisode inquiétant, explique à Marie : « Les fades peuvent bien s’en être mêlées et avoir fait choisir à ces trois monsieurs, sans qu’ils le sachent, la pièce qui pouvait me porter malheur ou bonheur » (J, 227). Une lecture rationaliste verra là le signe d’une obstination obscurantiste, mais une autre interprétation semble privilégiée par la construction même du texte, qui consiste à faire de Jeanne une figure supérieure, déchiffrant le monde en fonction d’une sorte de déterminisme spirituel, apte à en éclairer les arcanes. C’est de cette double herméneutique que procède l’ensemble du roman : si les « fées » du mont Barlot (ces trois hommes qui prodiguent chacun un don à la belle enfant) sont évoquées de façon humoristique dans les premières pages du roman, c’est en réalité pour mieux introduire l’idée qu’un sens supérieur préside bel et bien à la destinée des protagonistes. Jeanne, donc, qui finit par mourir, victime de la société viciée des bourgeois, serait-elle figure de l’impuissance et du malheur, comme le suggère le paratexte du roman ?
À cet égard, le roman est plus complexe qu’il n’y paraît car Jeanne est traitée comme un personnage d’exception qui, on l’a dit à l’ouverture de cette analyse, dépasse le statut de simple type social tout comme celui de simple personnage. Très vite sacralisée, sublimée dans ses actes, elle s’assimile à la Nature même, une Nature agentive régie par des forces harmonieuses. En ce sens, elle fait partie de cette collectivité paysanne dont elle incarne les vertus les plus élevées tout en s’en distinguant – un personnage faillible et rationnel comme Claudie, par exemple, fonctionne à la façon d’un double réaliste. Jeanne, quant à elle, est une figure quintessenciée. Elle incarne les grands principes de la Nature, elle-même sacralisée par le narrateur. De simples images disent çà et là son appartenance ; à Boussac, elle n’est plus guère qu’une « [p]lante sauvage » déracinée qui aspire à retrouver son milieu : « [E]lle n’avait fait que végéter depuis qu’elle s’était laissé transplanter dans une région cultivée. Elle avait soif de reprendre racine dans son véritable élément, et d’embrasser son rocher natal » (J, 268). Il ne faut pas s’y tromper : il ne s’agit pas là d’exprimer une simple nostalgie mais bien de rendre à celle que le texte n’hésite pas à hausser au rang de figure mythique[23] sa pleine efficience : « Elle oserait chanter sans craindre d’être écoutée par les bourgeois ; elle pourrait prier et croire sans être raillée par les esprits forts. Jeanne s’était sentie, jour après jour, refroidie et gênée à la ville. Elle ne se disait pas qu’elle avait failli y perdre la poésie ; mais elle se sentait vaguement redevenir poète, à mesure qu’elle s’enfonçait dans le désert » (J, 268). On voit que le contraste dont George Sand déplore la présence dans sa « Notice » est en réalité fondamental. Il porte l’opposition de deux sphères sociales mais plus encore de deux régimes de pensée. L’exemple du chant – thème important du roman – en donne un aperçu. Quelques pages auparavant, le narrateur explique que « tandis que les demoiselles chantent au piano les plus plates et les plus détestables nouveautés d’opéra, les pastours font redire aux échos des champs des mélodies naïves et pures, que nos plus grands maîtres eux-mêmes voudraient avoir trouvées » (J, 265). Cette opposition entre l’artifice et l’apprentissage d’une part, le naturel et l’intuitif d’autre part, valorise une vision idéaliste des moeurs rustiques. Toutefois, cet idéalisme, loin de ressortir d’une forme de sentimentalisme naïf, procède d’une vision sensible du monde naturel, exemplairement incarnée par Jeanne : si ses expressions sont vulgaires – relevant d’une parlure paysanne –, « le son de sa voix suppléait à l’insuffisance de sa parole » (J, 95) car elle « était douée comme celle du ruisseau » (J, 134). Or cette osmose fréquemment soulignée entre Jeanne et les éléments naturels auxquels elle s’identifie traduit une vision spiritualiste de l’être-au-monde, radicalement opposée à la perception matérialiste des représentants du « monde moderne ».
Il est de fait souvent question d’âme dans ce roman, en corrélation avec la notion de « sublime », et le terme rassemble autour de Jeanne une poignée d’élus aptes à faire rupture avec les idées reçues. Jeanne, explique ainsi Marie de Boussac, dont il est dit qu’elle « port[e] une âme de feu » (J, 193) et rêve « au sein de l’humanité, une vie à part, toute de renoncement aux vanités du monde, toute de lutte contre ses lois iniques » (J, 193), lui a « révélé des vérités sublimes que [s]es lectures [lui] avaient fait seulement pressentir » (J, 185). Sir Arthur de même, « exempt de […] préjugés », se distingue par son « âme, supérieure au monde et à ses vanités frivoles » (J, 184). Quant à Jeanne, qui ne fait qu’un avec la nature, elle incarne une foi inébranlable, fondée sur l’harmonie des choses et un sens inaltérable de la transcendance. « [Q]uand on ôte au paysan sa foi au prodige, il semble qu’on lui enlève une partie de son âme » (J, 224), indique le narrateur pour rendre compte de la commotion dont Jeanne souffre après la révélation du faux mystère du mont Barlot alors qu’elle demeure « comme étourdie et consternée sous le coup de la froide réalité » (J, 224). Mais, on l’a vu, la force et la conviction de la jeune pastoure lui permettent de réinjecter du merveilleux dans la plate réalité, signe de la force de son âme. C’est en ce sens que l’on peut dire d’elle qu’elle est « une âme poétique sans manifestation, un de ces types purs comme il s’en trouve encore aux champs, types admirables et mystérieux, qui semblent faits pour un âge d’or qui n’existe pas, et où la perfectibilité serait inutile, puisqu’on aurait la perfection » (J, 195). Cette pureté et cette perfection, qui englobent une vision égalitaire de la société, représentent donc le pôle idéal du roman.
Roman du malheur, disions-nous. La mort de Jeanne scelle en réalité son refus des compromis et des vices du monde moderne. La conclusion du roman, le chapitre XXV, centré sur l’agonie de la jeune fille, invite à nuancer la réception du dénouement. Sur un plan clinique en effet, le genre de commotion dont souffre Jeanne annonce une fin « violent[e] et affreus[e] » : « Le sang-froid terrible du médecin glaçait le malheureux Arthur d’horreur et de désespoir » (J, 322). Or contre toute attente, « le docteur s’était trompé. La fin de Jeanne devait être aussi douce et aussi résignée que sa vie » (J, 322). C’est en chantant et en appelant ses bêtes que Jeanne s’éteint : « Elle avait cessé de vivre… » (J, 323) La dramatisation croissante du texte, marqué de climax tragiques, fait place à une forme de déflation qui crée un climat d’apaisement relatif. Le malheur perd en intensité pour désigner un ailleurs de ce présent déprécié et sert en dernier ressort à dénoncer les manquements de ce que Sand appelle « notre civilisation » (J, 44). En définitive, si malheur il y a, c’est bien plutôt celui de « la vie présente » (J, 45), privée d’âme et de poésie, travaillée d’intérêts et de tensions matérialistes. Jeanne, on le sait, montre exemplairement l’incompatibilité de deux modes de pensée. Jean Delabroy explique que ce roman « ne sera pas proposition d’un mode d’accommodation du regard moderne à l’origine, mais l’histoire de l’impossibilité de cette accommodation[24] », ce qui invite à retourner la perspective : Jeanne transcende ce qui est désigné comme son malheur tandis qu’en réalité ce dernier frappe les contemporains, citadins cultivés, à qui manquent les compétences nécessaires pour avoir accès « à l’archaïque[25] ».
Construire le roman sur l’histoire tragique de l’éviction inéluctable de Jeanne, figure de l’idéal, sur fond de critique sociale, n’implique pas pour autant de privilégier une écriture réaliste, comme on pourrait le supposer[26]. Certes, les données ethnographiques abondent (parlures et rites paysans) et s’intègrent à la fiction pour s’y convertir en scènes de comédie ou, au contraire, de tragédie[27], à des fins critiques. Cette réappropriation de données légitime la démonstration du narrateur, analyste des mécanismes qui déterminent les représentations sociales à la jonction de deux mondes, bourgeois et paysan[28]. En outre, c’est plus que tout en multipliant les excursus poétiques, pauses descriptives ou méditatives, que George Sand fait le choix d’inscrire dans son roman une ode à la nature et à l’âme paysanne, une ode aussi à une conception merveilleuse, c’est-à-dire transcendante, dans un tableau stigmatisant le monde contemporain. Seul le paradoxe de ce que l’on peut dès lors considérer comme une poésie du malheur permet de porter dans un même mouvement littérature critique et prose poétique.
Appendices
Note biographique
Professeure de littérature française du xixe siècle à l’Université Clermont Auvergne, spécialiste de George Sand et de Barbey d’Aurevilly, Pascale Auraix-Jonchière s’intéresse à l’écriture des représentations sociales dans les fictions romanesques du xixe siècle et aux réécritures des contes. Elle dirige la revue en ligne Sociopoétiques (Université Clermont Auvergne), la série « Barbey d’Aurevilly » de la Revue des lettres modernes et la série « George Sand » dans la collection « Études romantiques et dix-neuviémistes » chez Classiques Garnier. Dernier ouvrage paru : George Sand et le monde des objets, codirection avec Catherine Masson et Brigitte Diaz (Classiques Garnier, 2021).
Notes
-
[1]
En l’occurrence, celle de la Restauration, période dans laquelle s’ancre l’histoire, où se devinent des considérations tournées vers le temps du récit, ces années 1840 qui s’acheminent vers le point climatérique que constituera la révolution de 1848.
-
[2]
George Sand, Jeanne (1844), Saint-Cyr-sur-Loire, Christian Pirot, 2006, p. 44. Désormais abrégé J suivi du numéro de la page.
-
[3]
Lisette est une héroïne des chansons de Pierre-Jean de Béranger (1780-1857), célèbre chansonnier français politique. Béranger a fait de Lisette, personnage créé par les chansonniers et les poètes, le type de la grisette parisienne. Voir ce qu’en dit Bernard Thalès dans La Lisette de Béranger. Souvenirs intimes : « Béranger marque le milieu de cette période [celle des bohèmes]. Sa Lisette […] est une création imaginaire bien calquée sur les moeurs du temps. [… Béranger] a affecté même d’établir une différence physique entre la Lisette de son imagination et sa maîtresse chérie. […] / La Lisette idéale de Béranger, c’est une femme sans prétentions, comme son nom l’indique ; c’est la grisette parisienne de 1820, travaillant la semaine dans sa mansarde, et, le dimanche, mettant une robe d’indienne et un joli bonnet pour s’en aller dîner à la butte Montmartre ou au pré Saint-Gervais » (Paris, Librairie de Mme Bachelin-Deflorenne, 1864, p. 8-9). Il s’agit donc d’un personnage populaire.
-
[4]
La druidesse Velléda, vierge et symbole de la femme gauloise, est un personnage des Martyrs de Chateaubriand (livre X). Voir Ferdinand Gohin, Étude historique et littéraire de l’épisode de Velléda (« Les Martyrs », livre X), Vannes, imprimerie de Lafolye, 1899, 16 p.
-
[5]
« La dormeuse était donc blanche comme l’aster des prés et rosée comme la fleur de l’églantier » (J, 53).
-
[6]
« La Velléda du mont Barlot » (J, 214).
-
[7]
Je reprends l’expression employée dans la « Présentation » de ce dossier (voir p. 11).
-
[8]
Ce sont la jalousie et le ressentiment de la sous-préfète, dont la grande beauté de Jeanne gêne les stratégies matrimoniales, qui provoquent la fuite de la jeune fille.
-
[9]
L’orage est un thème qui accompagne volontiers les scènes plus angoissantes du roman gothique. Voir plus largement à ce sujet Marilyn Mallia, Présence du roman anglais dans les premiers romans de George Sand, Paris, Classiques Garnier, « Études romantiques et dix-neuviémistes », 2018.
-
[10]
Pour plus de détails sur l’imaginaire de la forteresse, voir Pascale Auraix-Jonchière (dir.), Ô saisons, Ô châteaux. Châteaux et littérature des Lumières à l’aube de la Modernité (1764-1914), Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, « Révolutions et romantismes », 2004.
-
[11]
Dans Mauprat (1837), dans un lieu et une situation analogues (dans le repaire des Coupe-Jarrets à la Roche-Mauprat), Edmée parvient à se rendre maîtresse de la situation : « Elle s’enfuit à l’autre bout de la salle, et s’efforça d’ouvrir la fenêtre ; mais ses petites mains ne purent seulement en ébranler le châssis de plomb aux ferrures rouillées » (Romans, édition publiée sous la direction de José-Luis Diaz, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 2019, p. 690). C’est par la force de son intelligence, au service de sa puissance de séduction, qu’Edmée convaincra Bernard de la libérer et de la respecter.
-
[12]
Simone Bernard-Griffiths, Essais sur l’imaginaire de George Sand, Paris, Classiques Garnier, « Études romantiques et dix-neuviémistes », 2018, p. 267.
-
[13]
Voir aussi : « Les nobles de cette époque […] se regardaient encore comme supérieurs par leur naissance aux autres hommes […] » (J, 87).
-
[14]
Voir sur ce point le questionnement auquel se livre l’auteur dans les textes préfaciels de ses romans champêtres. Il est justement question de Jeanne dans l’« Avant-propos » dialogué de François le Champi (1848) où R***, l’interlocuteur du « je » auctorial, critique l’« effet disparate » produit par les paroles de l’héroïne en comparaison de l’expression symbolique privilégiée par la romancière (Romans, op. cit., p. 1275).
-
[15]
Voir le chapitre V, sur les sens propre et figuré du verbe « récompenser » (J, 100) ou le chapitre XIX qui exploite la polysémie du verbe « aimer » à laquelle Jeanne, à qui le sentiment amoureux semble inaccessible, voire interdit, est étrangère (J, 245).
-
[16]
Pierre Mannoni, Les représentations sociales, Paris, Presses universitaires de France, « Que sais-je ? », 7e éd. mise à jour, 2016 [1998], p. 22.
-
[17]
D’après Nadine Cretin : « Le 1er Avril, (April Fool’s day, “fête du Fou d’avril”, dit-on en Grande-Bretagne) est une journée qui dérive des fêtes d’inversion propres au Carnaval, une parodie des fêtes du début d’année » (Fête des fous, Saint-Jean et belles de mai. Une histoire du calendrier, Seuil, « L’univers historique », 2008, p. 36). Toujours selon Nadine Cretin, l’ethnologue Arnold Van Gennep rapproche les farces faites ce jour des « “farces de réception” » jouées « au moment du Carnaval, lors des veillées et des fêtes patronales ou professionnelles », et qui « représentaient une épreuve d’admission, forme de bizutage pour les jeunes apprentis qu’on envoyait chercher des objets introuvables » (ibid., p. 38 ; voir également Arnold Van Gennep, Le folklore français [1943], Paris, Laffont, « Bouquins », t. I, 1998, p. 930-933). La situation romanesque correspond à cette pratique tout en la retournant, puisque c’est sir Arthur qui est finalement pris au piège.
-
[18]
Il « reconnaissait la nuque hâlée de Claudie sous sa crinière mal domptée » (J, 170).
-
[19]
Marie Scarpa, « L’ethnocritique de la littérature. Présentation et situation », Multilinguales, no 1, 2013, § 12 (disponible en ligne, doi : org/10.4000/multilinguales.2808).
-
[20]
Voir par exemple George Sand, Légendes rustiques (1858), Saint-Cyr-sur-Loire, Christian Pirot, 2000, p. 17.
-
[21]
Isabelle Hoog-Naginski, « Préhistoire et filiation. Le mythe des origines dans Jeanne », George Sand mythographe, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, « Cahiers romantiques », 2007, p. 122-123. (Une version préliminaire de ce chapitre a paru dans Romantisme, no 110, 2000-4 [« De la représentation »], p. 63-71.)
-
[22]
Ibid., p. 123.
-
[23]
Jeanne est volontiers assimilée à des figures mythiques ou associée à quelque divinité dans ses actions les plus prosaïques – « belle canéphore » lorsqu’elle sert à table (J, 178), « Isis gauloise » à plusieurs reprises, « grande prêtresse » lorsqu’elle plie le linge (J, 202) –, voire comparée à toute une pléiade de divinités : « Junon ou Pallas », « Hébé » ou de nouveau « Isis » (J, 241). Au sujet de l’expression « Isis gauloise », voir Pascale Auraix-Jonchière, « Modalités et fonctions du syncrétisme mythologique dans Jeanne et Isidora de George Sand », dans Maria Benedetta Collini et Pascale Auraix-Jonchière (dir.), Syncrétismes, mythes & littératures, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, « Croisée des SHS », 2014, p. 205-221, et « Jeanne, “Isis gauloise” », dans Histoire(s) et enchantements. Hommages offerts à Simone Bernard-Griffiths, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, « Révolutions et Romantismes », 2009, p. 551-561.
-
[24]
Jean Delabroy, « Homère en rébus : Jeanne ou la représentation aux prises avec la question de l’origine », dans Simone Vierne (dir.), George Sand. Actes du colloque de Cerisy, Paris, CDU-SEDES, 1983, p. 57.
-
[25]
Ibid, p. 56.
-
[26]
Sur la tension entre réalisme et idéalisme, voir l’ouvrage fondateur de Naomi Schor, George Sand and Idealism, New York, Columbia University Press, 1993. Voir aussi Damien Zanone (dir.), George Sand et l’idéal. Une recherche en écriture, Paris, Champion, « Littérature et genre », 2017. L’ouvrage offre en annexe la traduction française de l’article de Naomi Schor, « Idealism in the Novel : Recanonizing Sand », Yale French Studies, no 75 (« The Politics of Tradition : Placing Women in French Literature »), January 1988, p. 56-73, qui fut recueilli dans Joan DeJean and Nancy K. Miller (dir.), Displacements. Women, Tradition, Literatures in French, Baltimore / Londres, John Hopkins University Press, 1990, sous le titre « L’idéalisme dans le roman. Pour la recanonisation de Sand », p. 427-447, traduit de l’anglais par Marie Baudry.
-
[27]
La séquence de l’incendie, voire celle, inaugurale, des « fées » du mont Barlot, prennent un sens tragique, alors que le traitement de la tradition du poisson d’avril, on l’a vu, prend les contours de la comédie.
-
[28]
C’est en quoi ce roman propose une double lecture concordante du monde observé, ethnopoétique et sociopoétique.