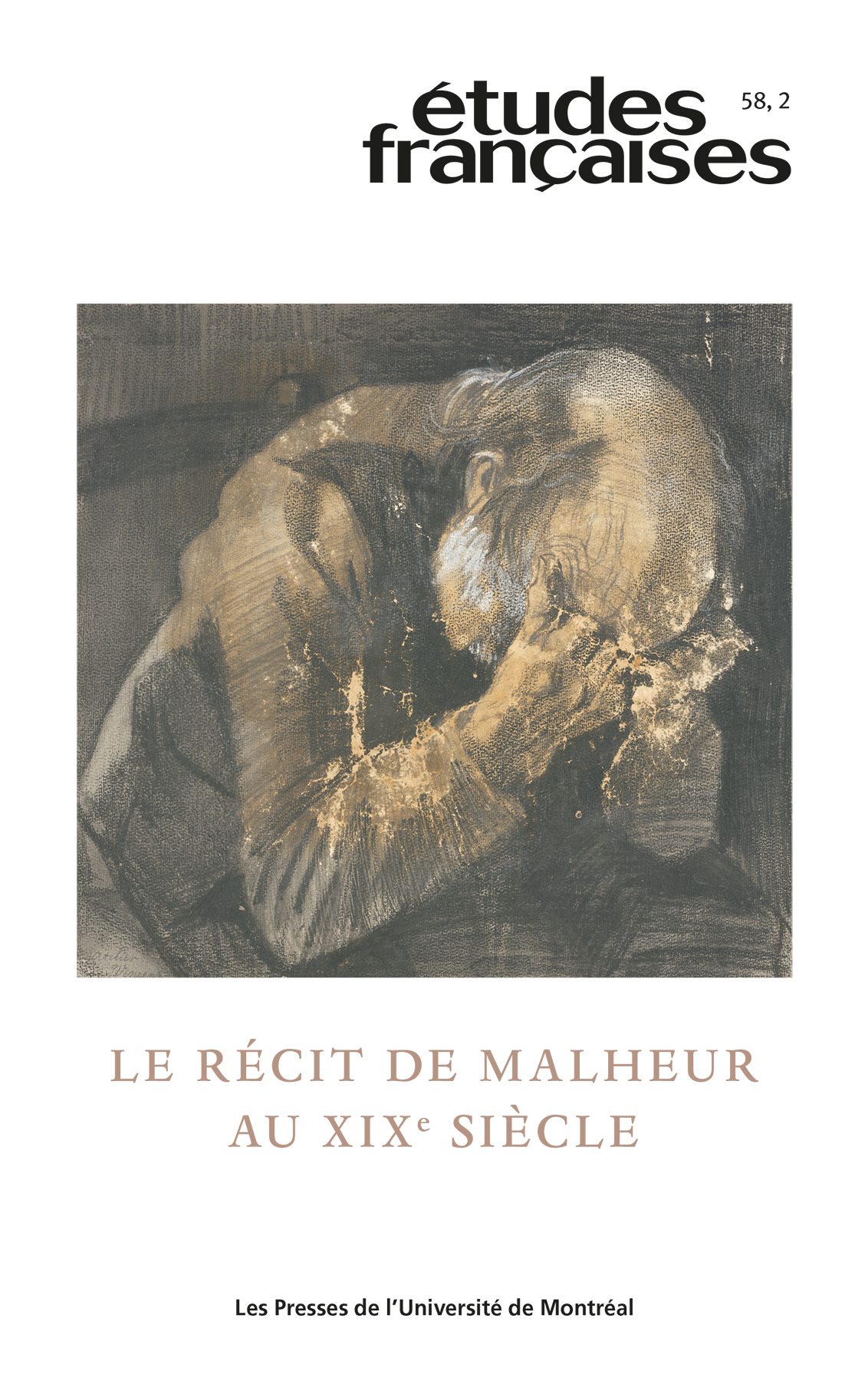Abstracts
Résumé
J’examine l’interaction entre quelques éléments typiquement surréels présents dans le roman Les Méduses ou les orties de mer (1982) de l’écrivain congolais Tchicaya U Tam’si – le rêve, la magie, les prémonitions, le surnaturel – et des données historiques très précises qui éclairent le contexte. Les grèves et les révoltes contre les conditions pénibles des travailleurs de la colonie semblent être une des préoccupations majeures de Tchicaya U Tam’si. Comment ces éléments si divers peuvent-ils coexister et s’allier dans l’univers diégétique du roman ? Ce mélange de rationalité et de fantaisie, de réalisme documentaire et de magie fait des Méduses ou les orties de mer une oeuvre singulière, encore mal connue et peu étudiée par rapport aux autres romans congolais de la même époque ou postérieurs.
Abstract
I examine the interaction between several typically surreal elements present in the novel Les Méduses ou les orties de mer (1982) by the Congolese writer Tchicaya U Tam’si—the dream, the magic, the premonitions, the supernatural—and some very precise historical data which explains the context where it happens. Strikes and revolts against the arduous conditions of the workers of the colony seem to be one of the major concerns of Tchicaya U Tam’si. How can such diverse elements coexist and come together in the diegetic universe of the novel? This mix of rationality and fantasy, of documentary realism and magic, makes Les Méduses ou les orties de mer a singular work, still poorly known and little studied compared to the other Congolese novels of the same period or later.
Article body
Né à Mpili (République du Congo) en 1931 et décédé à Bazancourt (Oise) en 1988, Tchicaya U Tam’si est l’auteur d’une oeuvre riche et complexe qui le place au premier rang parmi les écrivains francophones contemporains[1]. Poète, dramaturge et romancier, il publie une tétralogie romanesque consacrée à la représentation du Congo français de l’ère coloniale et postcoloniale : Les cancrelats (1980), Les méduses ou les orties de mer (1982), Les phalènes (1984), Ces fruits si doux de l’arbre à pain (1987). Ses recueils poétiques, dans lesquels Tchicaya a su exprimer les souffrances de la tragédie congolaise, comprennent Le mauvais sang (1955), Feu de brousse (1956), À triche-coeur (1960), Épitomé (1962), Le ventre (1964), Arc musical (1970).
Les méduses ou les orties de mer, second volet de la tétralogie romanesque, met en scène une histoire ténébreuse et énigmatique : la mort de deux amis, le conducteur de locomotive Elenga et le scieur de bois Muendo, et le coma mystérieux d’un troisième personnage, Luambu. Le titre fait référence à des mollusques aux propriétés urticantes qui constituent une nuisance pour l’homme : ils se reproduisent en eau trouble et envahissent toute la côte de Pointe-Noire et ses alentours, ce qui symbolise un univers social inquiétant, obscur et dangereux.
Le roman transporte le lecteur dans le passé le plus ancien des trois amis, employés autochtones de l’administration coloniale, et relate leurs cinq derniers jours, du mardi 20 juin au samedi 24 juin 1944, à la veille du vote dans la colonie pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale de Paris. Le narrateur s’interroge sur les causes de ces morts suspectes et sur la signification exacte du drame : s’agit-il d’un meurtre voulu par le régime politique de l’époque ? Ou bien les trois amis sont-ils victimes de la magie traditionnelle et de l’obscurantisme de certaines pratiques ? Les pistes policières rationnelles se mêlent à plusieurs signes occultes qui plongent le lecteur dans le désarroi et dans le mystère.
Nous nous proposons d’examiner l’interaction entre, d’une part, quelques éléments typiquement surréels présents dans le roman – le rêve, la magie, le surnaturel, les prémonitions – et, d’autre part, des données historiques très précises qui indiquent le contexte dans lequel se déroule l’action. En particulier, les grèves et les révoltes contre les conditions défavorables et pénibles des travailleurs de la colonie apparaissent comme l’une des préoccupations majeures de Tchicaya U Tam’si. Comment ces éléments si divers peuvent-ils coexister, former un tout organique et s’allier dans l’univers diégétique du deuxième roman de l’écrivain congolais ? Ce mélange de rationalité et de fantaisie, de réalisme documentaire et de magie fait des Méduses ou les orties de mer une oeuvre singulière, encore mal connue et peu étudiée par rapport aux autres romans congolais de la même époque ou postérieurs.
Parmi les écrivains congolais qui ont marqué l’histoire du roman en Afrique dans la seconde moitié du xxe siècle, on peut citer Jean Malonga (1907-1985), le premier écrivain du Congo, auteur de deux romans, Coeur d’Aryenne (1953) et La légende de M’Pfoumou Ma Mazono (1954) ; Sylvain Bemba (1934-1995), auteur, entre autres, du roman Rêves portatifs (1979), récit des rêves suscités par la joie passagère des indépendances ; Guy Menga (né en 1935), qui obtint le premier Grand Prix littéraire de l’Afrique noire avec La palabre stérile (1969), focalisé sur les rapports violents et humiliants entre les matswanistes et les colonisateurs. On ne peut pas oublier Jean-Pierre Makouta-Mboukou (1929-2012) qui publie en 1970 En quête de la liberté, roman centré sur la dénonciation du racisme à l’égard des Noirs et sur les violences des pouvoirs politiques africains, et en 1974 Les exilés de la forêt vierge, axé sur les indépendances. Emmanuel Dongala (né en 1941) est l’auteur de plusieurs romans épiques tels que Un fusil dans la main, un poème dans la poche (1973) et Les petits garçons naissent aussi des étoiles (1998) ; Henri Djombo (né en 1952) s’interroge, à travers ses quatre romans, sur la place de l’homme honnête dans un monde corrompu et cruel : Sur la braise (1990), Le mort vivant (2000), Lumière des temps perdus (2002), La traversée (2005). De tous les romanciers, Sony Labou Tansi (1947-1995) et Henri Lopes occupent une place à part car ils ont bousculé la structure linéaire du roman congolais en utilisant des techniques non traditionnelles comme la juxtaposition des intrigues et des récits secondaires. Sony Labou Tansi, auteur de La vie et demie (1979), a obtenu en 1983 le Grand Prix littéraire de l’Afrique noire grâce à son roman L’anté-peuple ; Henri Lopes (né en 1937), auteur de Le pleurer-rire (1982), a reçu en 1990 le Prix Jules Verne et le Grand Prix littéraire de l’Afrique noire après la publication de son roman Le chercheur d’Afrique. Le plus fécond des écrivains congolais de la nouvelle génération est certainement Alain Mabanckou (né en 1966) : son oeuvre romanesque se compose de nombreux romans, parmi lesquels Bleu-Blanc-Rouge (1998), Et Dieu seul sait comment je dors (2001), Les petits-fils nègres de Vercingétorix (2002). Ce bref tour d’horizon de l’histoire du roman congolais ne se veut pas exhaustif, mais il nous permet de mieux comprendre la tradition dans laquelle se situe la production romanesque de Tchicaya U Tam’si[2].
Le monde surréel des Méduses ou les orties de mer : entre rêve et magie
Dans Les méduses ou les orties de mer, le surnaturel et la magie, la consultation des voyants, les rencontres mystérieuses dues au hasard, en bref tous les éléments qui relèvent de l’irrationnel[3] font loi. Le récit prend souvent la forme d’un conte ou d’une fable dont il est difficile de définir une temporalité précise ou une chronologie des faits relatés, comme nous pouvons le remarquer dans l’incipit du roman : « L’histoire que voici », dit le récitant, « se passe à peu près à l’époque où, disait-on, un Blanc parcourait de nuit le Village Indigène de Pointe-Noire et qu’avec une baguette magique, il transformait hommes, femmes, enfants et chiens en viande de corned-beef, communément appelée singe[4]. »
C’est un monde où émergent naturellement le merveilleux et la magie, et où les incursions du devin dans l’au-delà n’aident pas à percer les mystères[5] ; un univers où les animaux communiquent avec les habitants de Pointe-Noire et entrent en symbiose avec eux ; c’est un espace mythique et atemporel où la nature participe à la douleur des hommes et leur transmet des messages importants.
La rencontre des trois personnages principaux, Muendo, Elenga et Luambu, lors d’une promenade sur la plage de Pointe-Noire, est placée sous le signe du hasard et du mystère. Un étrange prédicateur, appelé le « fou », arrive par la mer et jette à pleines mains de l’eau salée et des méduses sur la foule, provoquant la fureur des pêcheurs du village et les pleurs des enfants. L’aspect monstrueux de ce personnage alimente la peur et la panique : son buste avec « plus de côtes que de chair », ses mâchoires et ses yeux « grelott[ants] », sa bouche « qui sembl[e] édentée » (M, 456) constituent autant de traits particuliers qui relèvent du domaine de l’horreur et du macabre. C’est Luambu qui sauve le fou de la violence des villageois, gênés et terrifiés par les prédictions de l’homme mystérieux. Le prédicateur, qui disparaît sans laisser aucune trace, évoque un monde obscur, impénétrable, alors que les méduses, témoins de cette rencontre, peuvent être considérées comme le symbole négatif d’un présage funeste, d’une malédiction qui se déchaîne contre les trois amis : « “On se souviendra toujours comment on s’est rencontrés, dit Muendo.” “Ça, c’est vrai [répond Elenga]. On dira quand on s’est rencontrés, il y avait des méduses partout ; à cause des paroles d’un fou qui se prenait pour un prêtre !” » (M, 460)
Dans ce contexte, il n’est pas étonnant de retrouver une forte présence du rêve, élément central dans les traditions africaines. Le rêve sert de filtre pour explorer, voire comprendre, la réalité et constitue un lien intermédiaire entre l’homme et la connaissance du monde. Dans le passage suivant qui décrit la marche onirique de Luambu dans l’obscurité de la nuit, il est possible de constater l’interaction constante entre rêve et réalité et leur frontière poreuse, voire muable. L’élément onirique est lié à la vie et se révèle un moyen précieux pour entrer au coeur de la réalité :
La lune était immobile et proche, curieuse. Pas enjouée mais curieuse. Il la regarda. Elle sentit le regard du voyageur. Pourquoi soudain ce râle de honte ? Était-elle complice d’une machination ? Elle n’avait pourtant pas mauvais genre. La lumière qu’elle répandait était trop nette pour laisser croire le contraire. On se croirait même en plein jour, n’étaient le faux silence, cette fraîcheur si bonne qu’on aimerait la faire partager.
Pour la première fois il pensa avec tristesse à la raison qui l’avait mis en route. Arrivera-t-il à temps pour porter secours ? Il se dit qu’il ne fallait pas douter, il trouvera la force de marcher. Le chemin durera toute la nuit. Mais où est la nuit ? […] Le principal c’est d’arriver, à temps. Il n’y a qu’une route. Il n’avait qu’à suivre, suivre à pied. Quelle expression ! Et pourtant il eut bien l’impression que ce n’était pas lui qui conduisait sa marche. « Où » le portait pas aussi vite que tout autre moyen de locomotion. Et pourquoi n’était-ce pas lui-même qui marchait ?…
M, 618-619
Le narrateur présente Luambu en proie à des inquiétudes, dans une promenade nocturne sans répit qui évoque celle de Gaston Poaty dans Ces fruits si doux de l’arbre à pain[6]. La marche est caractérisée par des cauchemars et des hallucinations qui accompagneront ce personnage jusqu’à la fin du récit. Le paysage naturel exerce un pouvoir de fascination grâce à la dimension symbolique de ses composantes : c’est une nature qui acquiert le statut d’être vivant, éprouvant des sensations et des sentiments, capable de communiquer avec l’univers des hommes. Ce paysage sobre et symbolique devient un personnage à part entière, se lie étroitement avec les humains et reflète une situation incertaine. Le brouillard, qui prend la couleur du sang, devient une figure humaine à l’aspect inquiétant qui suit Luambu, l’entoure et l’emprisonne : « Tenu par le bouillard. Pétrifié des genoux aux pieds. N’était vivant en lui que le haut du corps » (M, 620). La lune, « languissante et fiévreuse », occupe la scène, apparaît et disparaît en provoquant un sentiment de peur et de désespoir chez Luambu : troublante, moqueuse, elle prend l’aspect d’une « bouillie blanchâtre et glaireuse », « presque un vomi de nourrisson » (M, 620). La forêt obscure revêt une valeur particulière chez Tchicaya ; elle devient une prison dangereuse, un lieu d’isolement qui étourdit et laisse dans le doute. Ce rêve, espace merveilleux où se rencontrent deux états, la vie et la mort, fait écho au voyage tragique de Luambu avec sa femme et son enfant. L’homme est responsable de la mort de sa famille : son épouse Julienne et leur fils finissent noyés dans une rivière et il ne leur portera pas secours, peut-être par lâcheté.
L’élément surnaturel est encore largement présent dans le passage du roman qui relate l’aventure de Victorine, femme de l’enquêteur André Sola, au marché. Elle assiste à une scène que l’on peut difficilement comprendre d’un point de vue rationnel :
« C’est lui, c’est lui ! » « C’est l’homme du coma ! » Nos yeux cherchent celles qui accusent et celui qu’elles accusent : elles accusent le vendeur, un homme de grande taille. Le visage d’un homme franc. Elles, deux jeunes femmes, qu’on prend d’abord pour des hystériques. Mais la stupeur de ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe grandit quand, prises de convulsions, elles les transmettent à celles qui essaient de les calmer. « N’achetez pas, ne touchez pas ! Ces poissons ne sont pas des poissons, ces poissons sont des vers, ces vers sont ceux d’un cadavre, des morceaux de cadavre ! » Elles se prennent la gorge, luttent avec quelqu’un qu’on ne voit pas, qui les étrangle. Elles se débattent, jettent des coups de pied, des coups de main, se roulent par terre, crient, bavent, se contorsionnent, roulent des yeux.
M, 506-507
Le récit de Victorine est axé sur « l’homme du coma » (Luambu) que les femmes du marché reconnaissent dans le vendeur de harengs. Après avoir été découvert, l’homme se serait déchaîné contre elles et aurait tenté de les étrangler avant de disparaître mystérieusement. Les femmes, « prises de convulsions » et agitées comme des possédées, « transmettent » cet état d’anxiété aux gens du marché. Cette situation est accompagnée de présages alarmants : « chauves-souris en plein jour, qui s’élèvent », et « un nuage qui s’enfuit » (M, 507). On se rend compte assez aisément que le témoignage de Victorine, malgré la précision des détails, est miné dans son objectivité, car « l’homme du coma » s’échappe sans que personne, à part ce groupe de femmes, ne l’ait vu. À ce propos, le commentaire du narrateur au tout début du roman est révélateur et pourrait bien s’appliquer à cette scène du roman : « Quand on raconte ce que l’on rapporte, chacun ajoute une part d’invraisemblance pour faire vrai » (M, 405).
Dans ce contexte irrationnel apparaît l’élément religieux avec des références à Dieu, à la Vierge Marie et plus généralement à la religion chrétienne : « [N]ous n’arrêtions pas de nous signer et moi de montrer mon scapulaire et de dire des Ave Maria, des Notre Père, des Pater Noster ; c’est ça qui nous a sauvées […] » (M, 508), ou encore : « [J]’ai eu l’idée de sortir mon scapulaire que j’ai fait bénir à Pâques et j’ai avancé fermement » (M, 507). Dans ce passage du roman, on remarque une tendance à tourner en dérision ce qui est associé à la croyance religieuse. En effet, une phrase introduit le doute sur la puissance de Dieu : « Je me demande si on peut encore aller au marché sans se demander… Et si le chapelet, le signe de croix n’allaient plus suffire ? » (M, 509) En outre, le Credo que Luambu, avant de tomber dans le coma et de disparaître, offre à André Sola est défini comme un papier, « ce papier c’est de la magie qui chasse l’esprit qui te fait bégayer » (M, 509). On pourrait donc voir dans la scène de Victorine au marché une parodie de l’épisode de la Bible sur la multiplication des poissons : dans Les méduses ou les orties de mer, les poissons deviennent des vers avant de disparaître. Dans l’oeuvre de Tchicaya s’affiche un malaise concernant la religion chrétienne, un sentiment de trahison face au Christ, un rejet et une haine que l’on retrouve notamment dans la production poétique de l’écrivain[7].
Le monde réaliste des Méduses ou les orties de mer
Tchicaya offre au lecteur dans Les méduses ou les orties de mer une description intéressante de Pointe-Noire et de ses différentes composantes. Plusieurs scènes du roman pourraient être comparées à des « cartes postales[8] », à des instantanés qui restituent le paysage urbain et naturel de Pointe-Noire dans la seconde moitié du xxe siècle : « l’habituelle foule à la gare » avec des gens fatigués « qui arrivent d’un voyage » et ne savent pas s’ils ont « pris la bonne direction » (M, 547) ; « les odeurs lourdes, épicées, irritantes » (M, 639) du marché qui se mêlent aux cris et aux appels insistants des marchands. On pourrait encore citer l’aspect désolant du cimetière du village, « mal entretenu », où les tombes des plus pauvres sont des « monticules de terre » avec des fleurs « sales, mal assorties au désordre du lieu » (M, 637-638) ; ou bien « les nouvelles maisons du quartier chic » à côté des « premières maisons en dur » (M, 649). Mais le roman de Tchicaya U Tam’si est également un acte de dénonciation d’une société coloniale violente et impitoyable : la peinture réaliste et sans filtre des conditions des travailleurs congolais en est un exemple éloquent.
En 1899, le Congo français est cédé à des compagnies concessionnaires qui exploitent les ressources naturelles comme le caoutchouc et l’ivoire et versent des impôts à l’administration française. Ces compagnies détiennent une bonne partie de la superficie de la colonie et s’adonnent à un véritable pillage du territoire sans aucun souci de l’avenir des Africains[9].
La construction du chemin de fer Congo-Océan, reliant Pointe-Noire à Brazzaville et inauguré en 1934, a soulevé un grand nombre de polémiques, car sa réalisation a coûté des milliers de vies humaines en raison de conditions de travail déplorables. L’écrivain français André Gide, qui a passé près d’un an dans les possessions françaises d’Afrique équatoriale (de juillet 1926 à mai 1927) a décrit la misère et la pauvreté des Africains, et a rédigé un véritable réquisitoire contre l’administration coloniale et les compagnies concessionnaires. Son Voyage au Congo relate avec une grande minutie de détails les mauvais traitements, les sévices et les cruautés des gouverneurs coloniaux, les exécutions d’hommes, de femmes et d’enfants qui ne travaillaient pas assez ou qui osaient se révolter :
L’on ne peut en dire autant du régime abominable imposé aux indigènes par les Grandes Compagnies Concessionnaires. Au cours de notre voyage, nous aurons l’occasion de voir que la situation faite aux indigènes, aux « Saigneurs de caoutchouc », comme on les appelle, par telle ou telle de ces Compagnies, n’est pas beaucoup meilleure que celle que l’on nous peignait ci-dessus ; et ceci pour le seul profit, pour le seul enrichissement de quelques actionnaires.
Qu’est-ce que ces Grandes Compagnies, en échange, ont fait pour le pays ? Rien. Les concessions furent accordées dans l’espoir que les Compagnies « feraient valoir » le pays. Elles l’ont exploité, ce qui n’est pas la même chose ; saigné, pressuré comme une orange dont on va bientôt rejeter la peau vide[10].
Tchicaya introduit ainsi le lecteur dans un monde de misère et de violation de tout droit à travers l’histoire des trois amis : Elenga, le mécanicien de locomotive du chemin de fer Congo-Océan, tué par les balles des soldats lors d’une grève ; Muendo, mort sur son lieu de travail, massacré par une scie ; Luambu, dans un état comateux, retrouvé entre les tombes de ses deux amis. La première partie du roman, qui ressemble à un véritable rapport de police, introduit le mystère sur les circonstances de ces décès successifs : « “Deux hommes sont morts dans la dernière semaine de juin 1944.” “Ils étaient trois à mourir…” Mais le troisième ne mourut pas, par miracle peut-être. Qui peut savoir ? » (M, 391) Les conditions des travailleurs sous le régime colonial et les tensions sociales sont illustrées par le biais des souvenirs de Malonga, l’oncle d’Elenga, qui évoque les travaux forcés lors de la construction du chemin de fer Congo-Océan :
Il passait ses journées à jeter des briques noires dans des foyers voraces, à étancher la soif phénoménale de ces monstres qu’on aurait toutes les peines du monde à imaginer si on ne les avait déjà vus, effrayants, sortis de quelque cauchemar. D’ailleurs, mal venus sur cette terre, combien n’avaient-ils pas laissé leur peau, son père lui-même, tant d’autres. Avant et après, le tribut sera toujours à payer, les deuils ne se comptaient pas, des pans de familles entières étaient précipités dans les gouffres que les génies du Mayombe violentés de jour comme de nuit…
[… C]’est sur le chantier du chemin de fer qu’il a pris du galon et s’est aguerri dans son métier, il a vu des poitrines défoncées, des ventres déchirés, des pieds, des bras, des têtes en bouillie…
M, 424-425
Le travail forcé imposé par l’administration française colonisatrice a provoqué des milliers de morts : les indigènes travaillaient sous la contrainte, dans la peur et sans aucun salaire. Ils mouraient souvent épuisés par la charge de travail et par une alimentation inadéquate. C’est un état de guerre et les trois amis le savent bien : « Et nous sommes en guerre. En guerre, pas en grève. En guerre, on ne ménage pas sa peine, on se tue au boulot, on ne comprend pas, on a peur… » (M, 449-450) Tchicaya dénonce également une absence de volonté, de la part de leurs frères africains, dans la recherche de la vérité, et même une attitude de lâcheté face au pouvoir colonial :
En fait qui veut y voir clair ? Personne, personne, c’est moi qui vous le dis. Les gens ont peur. Les gens sont lâches. Parce que rien qu’avec la mort de ce gars du C.F.C.O… [Chemin de Fer Congo-Océan] (C’est vrai qu’il n’avait pas plus de vingt ou vingt-quatre ans ?…) Ce gars du chemin de fer Congo-Océan, sa mort appelle la révolte. Je dis bien la ré-vol-te ! Et qu’est-ce qu’on fait ? On dit des fables ! C’est le coma de l’autre, qui intéresse, parce que sans conséquences pour nous tous.
M, 467-468
Au lieu de se révolter et de réclamer leurs droits, ils préfèrent croire à la version magique mise en avant par le régime colonial pour rendre les indigènes dociles et soumis, et sont persuadés que le drame des trois amis relève de la sorcellerie : Luambu, transformé en démon au service du diable, deviendra le suspect principal et la cause des drames de Pointe-Noire car il aurait ensorcelé ses compagnons avant de disparaître. Le narrateur ne partage pas ces opinions superstitieuses et retrace, comme dans une enquête judiciaire, les derniers moments des trois hommes dans la semaine, nous l’avons dit, du 20 au 24 juin 1944.
Dans Les méduses ou les orties de mer, le narrateur souligne la crédulité des habitants du village indigène de Pointe-Noire et tourne en dérision la colonisation : « Et pourtant, la peur de tomber ou de retomber dans un cannibalisme de mauvais aloi – on était civilisé que diable ! –, les gens résistèrent aux imprécations, aux injures : “Sales nègres superstitieux, sauvages et ignorants.” Le plus drôle c’est qu’on ne pouvait plus les traiter de cannibales, puisqu’ils s’y refusaient – à être cannibales, bien sûr. Les progrès de la civilisation bien sûr » (M, 389-390). Comme Gérard Clavreuil l’a fait remarquer, ce roman permet à l’écrivain de retracer les responsabilités des sociétés africaines à travers « une peinture sans concession de la société coloniale pendant la Seconde Guerre mondiale, tant du point de vue des Noirs que des Blancs[11] ».
Un équilibre parfait
Une lecture superficielle des Méduses ou les orties de mer pourrait inviter à penser à une dichotomie entre fiction et réalité, entre scènes de magie et faits historiques documentés. Tchicaya fait coexister d’une manière équilibrée et habile les deux éléments, en construisant un ensemble narratif cohérent où le surnaturel et l’histoire contemporaine du Congo s’inscrivent tous deux dans l’univers diégétique. La scène de la mort du mécanicien Elenga est un exemple significatif qui retiendra notre attention.
La disparition violente de l’homme, provoquée par le système colonial, bouleverse la communauté de Pointe-Noire qui entonne des lamentations funèbres dans la langue locale, échantillon pittoresque d’un parler spontané et vivant : « Elenga-hé ! miana mama, nié ké sé ! Na léli yo-o, moana mama, nié ké sé ! Elenga zongà to bonguisa zoto ! » (M, 567[12]) Le village reçoit l’ordre de ne pas pleurer le défunt, de ne pas déplacer le corps, car il ne faut pas en faire un martyr : « On ne pleurera pas. On veillera dans le silence. Un silence qui voudra dire qu’on est mort avec lui » (M, 569). En effet, les régimes coloniaux et postcoloniaux ont toujours vu avec suspicion les cérémonies funèbres et les cultes autour des défunts, et les considéraient comme un risque concret de désordre public. Dans certains cas, ils décidaient de faire disparaître le corps – comme nous l’apprend l’expérience de Patrice Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo de juin à septembre 1960, enlevé et massacré la nuit du 17 janvier 1961 : son corps, dépecé à l’aide d’une hache et dissous dans l’acide sulfurique, n’a pu être retrouvé ni rendu à sa famille. De façon similaire, dans Les méduses ou les orties de mer, Luambu, dont le nom est à peu près l’anagramme de Lumumba, disparaît mystérieusement et son corps ne sera jamais retrouvé.
Nous connaissons l’importance des veillées mortuaires dans la tradition congolaise : aucun parent, aucun ami ne peut s’y dérober car il s’agit d’un signe de respect et d’amour à l’égard de la personne disparue. Comment faire face à cette situation et permettre aux habitants de Pointe-Noire d’accompagner doucement leur défunt Elenga vers l’autre monde ? C’est alors qu’interviennent, de manière rusée, le surnaturel et les animaux, société presque humaine[13], qui prennent la place des hommes pour pleurer ce meurtre atroce, puisque l’homme blanc l’a sévèrement interdit :
[I]ls (les grenouilles, les crapauds de tous âges) firent fi de la consigne d’une veillée sans pleurs, coassèrent un chant funèbre d’une tristesse à faire mourir deux fois et même plus le pauvre Elenga que l’on voyait, l’âme sur le qui-vive, près des débris de sa poitrine qui suppurait déjà ! […] Les chiens errants aussi vinrent et hurlèrent. Les moustiques aussi.
[…] Qui le lendemain ne considéra pas une grenouille comme une soeur, un chien comme un frère, êtres de compassion, plus que l’homme ! C’est un homme qui a tué le fils de l’homme, ce n’est pas la grenouille, ce n’est pas le chien !
M, 573
Grâce à un procédé de personnification des animaux et des éléments naturels, Elenga aura droit à une veillée funèbre digne de l’homme qu’il était et les habitants de Pointe-Noire pourront pleurer leur ami et le purger de tous ses péchés, selon la tradition locale. Les rapports entre les hommes et les animaux sont solidaires et cette solidarité leur permet de s’allier en cas de danger. La réflexion du narrateur à la fin de notre citation est un acte explicite de dénonciation à l’égard des hommes, jugés incapables de compassion et de pitié, à la différence des animaux qui ont su manifester leur soutien en un moment dramatique pour le village. La nature participe aussi à l’immense souffrance qui suit la mort d’Elenga : « Le ciel savait qu’Elenga devait mourir, le ciel a su qu’il était mort, mais nous, nous doutions ; le ciel nous a laissés douter et il s’est mis à pleurer à notre place, avec une rage » (M, 596). La faune et la flore auraient davantage de compassion que les hommes.
Comme Danielle Cooper Chavy le souligne dans une excellente étude sur l’émergence du surnaturel dans la prose de Tchicaya U Tam’si, « derrière le visible et le palpable, derrière ce qui est immédiatement accessible, il y a l’impénétrable, l’insondable[14] ». La communication entre la réalité sensible et le surnaturel est constante dans Les méduses ou les orties de mer : les deux états s’entremêlent et fusionnent en abolissant toute catégorisation. Le travail de réécriture de l’histoire coloniale se traduit par cette imbrication du réel et du surnaturel, car la magie et le merveilleux puisent leurs pouvoirs directement dans les souffrances engendrées par le monde vécu et dans la nécessité de l’engagement social et politique, évoquée de manière discrète à travers la grève des cheminots du chemin de fer Congo-Océan.
Tchicaya ancre son récit magique dans un contexte réel et « apporte […] dans le champ littéraire africain les spécificités d’une voix qui se réclame, elle, de l’objectivité historique[15] » : l’écrivain traduit, dans son roman, le malaise politique du Congo et porte un regard lucide sur l’histoire de l’Afrique, et principalement sur celle de son pays. L’expression « réalisme magique », utilisée par la critique littéraire et la critique d’art dans la première moitié du xxe siècle, s’adapte bien aux Méduses ou les orties de mer, histoire politico-magique du Congo français des années 1944-1945.
Appendices
Note biographique
Spécialiste de Flaubert et de critique génétique, chercheur associé à l’équipe « Flaubert » de l’Institut des textes et des manuscrits modernes (ITEM, CNRS-ÉNS, Paris), Biagio Magaudda a dirigé le numéro 19 de la Revue Flaubert : « Flaubert, le Dictionnaire et les dictionnaires » (flaubert.univ-rouen.fr/revue/sommaire.php?id=21, 2021) et collaboré à la rédaction du Dictionnaire Gustave Flaubert dirigé par Éric Le Calvez (Classiques Garnier, 2017 ; soixante-trois articles). Ses publications portent sur l’oeuvre de Gustave Flaubert et sur la littérature du xixe siècle. Il s’intéresse depuis quelques années à la littérature francophone africaine, en particulier à la production romanesque de l’écrivain congolais Tchicaya U Tam’si.
Notes
-
[1]
Pour une présentation complète de l’écrivain et de son oeuvre, voir Arlette Chemain-Degrange et Roger Chemain, De Gérald Félix Tchicaya à Tchicaya U Tam’si. Hommage, « Préface » de Jean-Baptiste Tati Loutard, Paris, l’Harmattan, 2009. Voir aussi Boniface Mongo-Mboussa, Tchicaya U Tam’si. Le viol de la lune. Vie et oeuvre d’un maudit, La Roque-d’Anthéron, Vents d’ailleurs, 2014.
-
[2]
Pour un tableau critique complet de la littérature congolaise, voir Arlette Chemain-Degrange et Roger Chemain, Panorama critique de la littérature congolaise contemporaine, Paris, Présence Africaine, « Critique littéraire », 1979. Pour une étude axée sur l’histoire du roman congolais, voir en particulier Alpha Noël Malonga, Roman congolais. Tendances thématiques et esthétiques, Paris, l’Harmattan, « Critiques littéraires », 2007. Malonga fait un bilan intéressant de l’écriture romanesque en République du Congo depuis sa naissance jusqu’à nos jours. Malheureusement, il consacre peu de place (deux pages) à Tchicaya U Tam’si.
-
[3]
Voir, à ce propos, l’étude de Xavier Garnier sur la présence de la magie dans le roman africain, La magie dans le roman francophone, Paris, Presses universitaires de France, « Écritures francophones », 1999.
-
[4]
Tchicaya U Tam’si, Les méduses ou les orties de mer, dans La trilogie romanesque. Les cancrelats, Les méduses, Les phalènes, Oeuvres complètes, publié par Boniface Mongo-Mboussa, Paris, Gallimard, « Continents noirs », t. II, 2015, p. 389. Désormais abrégé M suivi du numéro de la page.
-
[5]
Pour mener à bien sa mission, l’enquêteur André Sola décide de consulter plusieurs fois un devin afin de connaître la biographie des victimes du drame. Les consultations n’apportent pas de solutions et le mystère s’épaissit : « Quant à savoir ce qui s’était passé les derniers jours, le devin ne put rien dire, ni montrer. Il étendit pourtant encore, mais en vain, ses mains au-dessus de l’eau de son canari divinatoire, rien n’y parut à la surface » (M, 427).
-
[6]
Tel un personnage de la littérature fantastique, Gaston Poaty se présente comme un zombie qui erre à travers les collines, sans paix, tourmenté par ses pensées et ses douleurs (Tchicaya U Tam’si, Ces fruits si doux de l’arbre à pain, dans Oeuvres complètes, op. cit., t. III, 2018, p. 336). Voir Biagio Magaudda, « Foyers de violence extrême dans le roman francophone postcolonial : Ces fruits si doux de l’arbre à pain de Tchicaya U Tam’si », Bérénice. Rivista di studi comparati e ricerche sulle avanguardie, no 61, dicembre 2021, p. 9-20.
-
[7]
L’ambiguïté de la position de Tchicaya à l’égard de la religion chrétienne a fait l’objet de plusieurs études. Voir en particulier : Dominique Ngoïe-Ngalla, « Le Christ dans l’oeuvre poétique de Tchicaya U Tam’si », dans Arlette Chemain-Degrange et Roger Chemain (dir.), Imaginaires francophones, « Centre de recherches littéraires et pluridisciplinaires », Association des publications de la Faculté des Lettres de Nice, 1996, p. 31-37 ; Roger Chemain, « Genèse de l’imaginaire U Tam’sien. Le mauvais sang », dans Arlette Chemain-Degrange et Roger Chemain (dir.), Imaginaire et littérature. II. Recherches francophones, même éditeur, 1998, p. 285-297 ; Pierre Leroux, Figure christique et messianisme dans les oeuvres de Dambudzo Marechera et Tchicaya U Tam’si, thèse, Université Sorbonne Nouvelle, 2016, 380 p.
-
[8]
Voir, à ce propos, Laté Lawson-Hellu, Roman africain et idéologie. Tchicaya U Tam’Si et la réécriture de l’Histoire, Québec, Presses de l’Université Laval, 2004, p. 64. L’auteur fait une analyse socio-discursive convaincante de l’oeuvre romanesque de Tchicaya U Tam’si. Son ouvrage constitue un point de repère important pour quiconque s’intéresse aux romans de l’écrivain congolais.
-
[9]
Voir Catherine Coquery-Vidrovitch, « Les abus », dans Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires 1898-1930, Paris, École des hautes études en sciences sociales, 2001, t. I, p. 171-195 (disponible en ligne, doi : 10.4000/books.editionsehess.379).
-
[10]
André Gide, Voyage au Congo (1927), suivi de Le retour du Tchad (1928), Paris, Gallimard, « Folio », 2016 [1995], p. 92-93.
-
[11]
Gérard Clavreuil, « Tchicaya U Tam’si : Les cancrelats (1980), Les méduses (1982), Les phalènes (1984) », Notre librairie, nos 92-93 (« Littérature congolaise »), mars-mai 1988, p. 236.
-
[12]
Elenga est comparé à un enfant, symbole d’innocence et de pureté : « C’est la mort d’un enfant, pas d’un homme ! » est un refrain répété maintes fois dans ce chapitre du roman.
-
[13]
Voir à ce propos Sylvie André, « Le riche bestiaire de Tchicaya U Tam’ si », Francofonía, no 17 (« L’animal »), 2008, p. 11-29.
-
[14]
Danielle Cooper Chavy, « Le monde invisible dans les romans de Tchicaya U Tam’si », Revue francophone de Louisiane, vol. 3, no 2, automne 1988, p. 78-86.
-
[15]
Laté Lawson-Hellu, op. cit., p. 3.