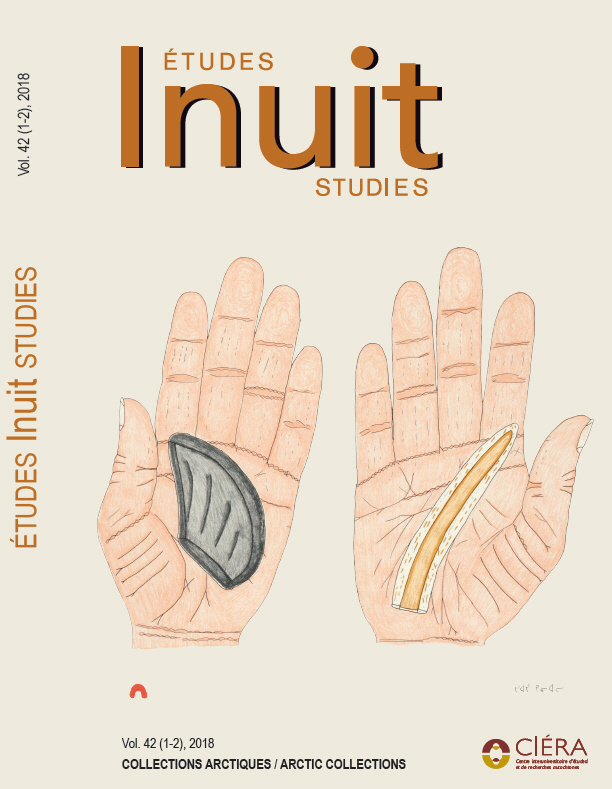Abstracts
Résumé
Dès le XIXe siècle, des artefacts arctiques figurent dans les inventaires des premiers musées publics français. Un certain nombre provenait de cabinets de curiosités privés, nationalisés lors de la Révolution française. Si la France n’a jamais manifesté d’intérêt particulier et encore moins de velléité territoriale sur les zones arctiques, on trouve néanmoins des objets Inuit conservés dans nombre d’institutions muséales sur le territoire. Ces collections sont arrivées sur le sol français grâce à l’intérêt de particuliers, collectionneurs et voyageurs, ainsi qu’aux échanges avec des institutions étrangères. En petit nombre au sein des musées encyclopédiques, elles ne furent que très rarement étudiées, bien qu’exposées régulièrement au public. Achetées à des intermédiaires et souvent vendues sous le terme de pièces « eskimos », malgré quelques exceptions notoires, une grande majorité fut enregistrée dans les inventaires sans que le contexte d’origine n’apparaisse. Il faut véritablement attendre le dernier tiers du XIXe siècle pour découvrir, en France, des artefacts reproduits dans des revues scientifiques à travers le prisme de l’anthropologie physique et surtout de l’archéologie. La collection la plus vaste et la plus connue se trouve aujourd’hui conservée au musée du quai Branly-Jacques Chirac, à Paris. Pourtant, une dizaine de villes françaises possède également des collections issues des régions polaires. La majorité de ces objets est arrivée en France avant la Seconde Guerre mondiale. Il faut cependant attendre les années 2000 pour appréhender l’ampleur de ces collections sur tout le territoire français, malgrés des recherches isolées et des initiatives particulières qui ont mis en lumière localement ces objets. Cet article vise à analyser et documenter les collections arctiques du XIXe siècle en France, dans une perspective historique.
Mots-clés:
- Artefacts,
- collection muséale,
- contact interculturel,
- patrimoine culturel inuit,
- coopération,
- culture matérielle,
- histoire
Abstract
As early as the nineteenth century, Arctic artifacts were included in the inventories of the first French public museums. A number of them came from private curiosity cabinets, nationalized during the French Revolution. Although France has never shown any particular interest and even less territorial interest in the Arctic regions, there are nonetheless Inuit objects preserved in many French museum institutions. These collections have arrived on French soil thanks to the interest of individuals, collectors and travellers as well as exchanges with foreign institutions. In small numbers within encyclopedic museums, they were only very rarely studied, although they were regularly displayed to the public. Purchased from intermediaries and often sold under as “Eskimo” pieces, despite some notable exceptions, a large majority were recorded in the inventories without the original context appearing. It was not until the last third of the nineteenth century that artefacts reproduced in scientific journals were discovered in France, through the prism of physical anthropology and especially archaeology. The largest and most famous collection is now kept at the Quai Branly-Jacques Chirac Museum in Paris, but about ten French cities also have collections from the polar regions. The majority of these objects arrived in France before the Second World War. However, it was not until the 2000s that the scope of these collections was understood throughout France, despite isolated research and specific initiatives that brought these objects to light locally. This article aims to analyse and document the nineteenth century Arctic collections in France from a historical perspective.
Keywords:
- Artifacts,
- museum collections,
- cross-cultural contact,
- Inuit cultural heritage,
- cooperation,
- material culture,
- history
Article body
Le travail que j’ai effectué dans le cadre d’un mémoire de 3e cycle à l’École du Louvre, de 1999 à 2006, fut consacré à un corpus d’artefacts identifiés comme inuit et kalaalit conservés sur une période, de 1800 à 1934[1]. Une synthèse de l’histoire des collections arctiques françaises au XIXe siècle n’avait, jusqu’à alors, jamais été réalisée. Ce travail inédit a permis de regrouper des artefacts qui n’avaient jamais été mis en contact les uns avec les autres et de retracer, dans la mesure du possible, leur histoire[2].
Les pôles ont, depuis l’Antiquité, été une source d’inspiration. Néanmoins, c’est véritablement au XIXe siècle que se généralise un intérêt scientifique pour les régions arctiques. Si les savants français n’en font pas grand cas jusqu’à la fin du XIXe siècle, il n’en est rien des voyageurs qui ont pénétré dans ces zones, qu’ils soient pêcheurs, trappeurs, navigateurs, de simple condition ou de statut social élevé.
Au début du XIXe siècle, les termes « régions arctiques » ou « régions septentrionales », si souvent employés, intègrent tous les peuples nordiques et ne se restreignent pas aux Inuit. Les textes des naturalistes et des géographes ont pour sujet principal l’économie, la géographique et le système climatique de ces contrées encore peu explorées.
Au cours du XIXe siècle, force est de constater qu’il n’y avait pas une vision du monde inuit, mais plusieurs visions, lesquelles cohabitent et s’interpénètrent. Sans donner lieu en France à une réflexion collective, les Inuit ne sont pourtant pas des inconnus. Ils trouvent leur place dans des récits de voyages, mais aussi, à partir de la deuxième moitié du siècle, dans des revues à caractère scientifique[3]. On peut dire qu’au XIXe siècle, les Inuit[4] apparaissent bien souvent comme des personnages secondaires voire des faire-valoir appuyant un propos scientifique ou romanesque.
L’impact des expéditions anglaises sur le public français
Déjà en 1777, dans l’Histoire naturelle, générale et particulière, Buffon[5] mentionne l’impact de l’Angleterre et des pays scandinaves dans la découverte des terres arctiques :
Cette voie [passage du Nord-Ouest] a cependant été vainement tentée par la plupart des nations commerçantes, & surtout par les Anglois & les Danois ; & il est à présumer que ce fera par l’orient qu’on achèvera la découverte de l’occident, soit en partant de Kamtfchatka, soit en remontant du Japon ou des îles des Larrons, vers le nord & le nord-est. Car l’on peut présumer, par plusieurs raisons que j’ai rapportées ailleurs, que les deux continens font contigus, ou du moins très voisins vers le nord à l’orient de l’Asie.
Je n’ajouterai rien à ce que j’ai dit des Esquimaux, nom sous lequel on comprend tous les sauvages qui se trouvent depuis la terre de Labrador jusqu’au nord de l’Amérique, & dont les terres se joignent probablement à celles du Groënland. […] Ceci me paroît prouver seulement que le Groënland a toujours été peuplé, & qu’il avait comme toutes les autres contrées de la terre ses propres habitans, dont l’espèce ou la race se trouve semblable aux Esquimaux, aux Lappons, aux Samojedes & aux Koriaques, parce que tous ces peuples sont sous la même zone, & que tous en ont reçu les mêmes impressions. La seule chose singulière qu’il y ait par rapport au Groënland, c’est comme je l’ai déjà observé, que cette partie de la terre ayant été connue il y a bien des siècles, & même habitée par des colonies de Norwège du côté oriental qui est le plus voisin de l’Europe ; cette même côte est aujourd’hui perdue pour nous, inabordable par les glaces, & quand le Groënland a été une seconde fois découvert dans des temps plus modernes, cette féconde découverte s’est faite par la côte d’occident qui fait face à l’Amérique, & qui est la seule que nos vaisseaux fréquentent aujourd’hui. [sic] (Buffon 1777, 534)
Les Britanniques sont les premiers à envoyer régulièrement des missions dans l’Arctique canadien, dans un but économique et probablement pour le prestige. Des contacts de plus en plus réguliers sont établis entre les officiers de l’amirauté et les Autochtones canadiens. Des écrits mentionnent ces échanges à de maintes occasions (Parry 1822-1824 ; Lyon 1824 ; Ross 1835a, 1835b). Cependant, progressivement en Europe, les cercles scientifiques portent un intérêt aux peuples habitant les zones septentrionales du globe. En France, les sources anglaises sont le passage obligé pour qui veut appréhender ces régions lointaines. Dès 1827, des Français expatriés rendent compte des avancées britanniques quant à la reconnaissance des terres du Grand Nord qui ne font pas encore partie du Canada. Les Anglais se concentrent à nouveau sur leurs colonies au Canada et aux États-Unis, après s’être opposés aux ambitions territoriales de Napoléon. Des missions partent régulièrement à la recherche du légendaire passage du Nord-Ouest, route supposée plus rapide vers les Indes.
Grâce aux baleiniers, de nouvelles informations sur les côtes groenlandaises et canadiennes parviennent en Europe. Sous l’impulsion de John Barrow (1764-1848), secrétaire de l’Amirauté et fondateur de la Royal Geographical Society en 1830, plusieurs expéditions trouvent des financements. Lui-même a effectué un voyage dans les mers arctiques à bord d’un baleinier. Il est indéniablement l’un des instigateurs à l’origine de l’engouement britannique pour les régions polaires.
Les nouvelles des officiers de marine comme Edward Parry (1790-1855), John Franklin (1786-1847) et John Ross (1777-1856), dont on trouve les exploits relatés dans de nombreux journaux, périodiques et ouvrages scientifiques, ont un retentissement international. Pour les Français, les principaux acteurs des exploits arctiques sont britanniques[6]. Nombreux sont les jeunes officiers de marine à vouloir embarquer sur des navires en partance pour l’Arctique :
Mais curieux de partir au plus vite, ayant contracté des engagements particuliers avec les pilotes dunkerquois, muni à ses frais de cartes, de livres et d’instruments, il [Jules de Blosseville] avait hâte d’être sur le théâtre qu’ont illustré les Parry, les Ross, les Beechey, les Franklin.
Lesson 1837
John Franklin est d’ailleurs le premier lauréat, en 1829, de la médaille d’or décernée par la Société de géographie de Paris, dont il devient l’un des correspondants. Le but de cette Société, créée en 1821, est de contribuer à la découverte de nouvelles contrées. Ses modes d’action sont multiples : patronage et réalisation de voyages, lien avec des correspondants à l’étranger, attribution de prix sous forme de médailles, sans oublier la publication d’ouvrages et de cartes (Lejeune 1993). En 1834, l’explorateur écossais John Ross est médaillé, à son tour, pour avoir découvert le pôle magnétique. Lui aussi est correspondant. On remarque que la Société de géographie de Paris ne fait pas grand cas des conflits passés : John Franklin est un ancien officier de Trafalgar, quant à John Ross, il fut blessé à de nombreuses occasions et emprisonné en France lors des guerres napoléoniennes. En 1837, George Back reçoit une médaille pour son expédition à la recherche du passage du Nord-Ouest.
La Société de géographie de Paris n’est pas l’unique lieu favorable aux nouvelles découvertes. Dès le milieu du XIXe siècle, de nombreuses sociétés savantes se constituent en province. Il est certain que parmi celles-ci, notamment sur la côte atlantique française, des navigateurs ont eu une expérience arctique, voire des contacts avec les populations. Dans la première moitié du XIXe siècle en France, les pêcheurs sont sans aucun doute les premiers Français à pouvoir parler des mers du Nord, de l’Europe à l’Amérique. Mais, à l’inverse des pêcheurs anglais, leurs récits ne semblent guère pris en considération par les autorités scientifiques de leur pays. En cette première moitié du XIXe siècle, les informations provenant du Grand Nord canadien sont anglaises et pour cause.
La France et les peuples arctiques
Aucune expédition française à caractère scientifique dans les régions arctiques n’a été soutenue par la Monarchie avant la Révolution française. Cela ne veut pas dire qu’aucun Français ne se rendit au Groenland ni dans l’Arctique oriental canadien. Deux groupes distincts émergent en France dès le XVIIIe siècle et jusqu’à la fin du XIXe siècle : d’un côté, les voyageurs, négociants ou officiers de marine qui sont sur le terrain et accumulent les faits bruts ; et de l’autre, les géographes « de cabinet » qui analysent les données. Dans le contexte des régions polaires, ce fait est très important car la liaison entre connaissance par procuration et vécu sur le terrain, en ce qui concerne les Inuit, n’aura lieu véritablement qu’au début du XXe siècle. En outre, la France, suite au traité de Paris de 1763, se sépare définitivement de ses colonies canadiennes[7] (Veyssière, Joutard et Poton. 2016). La chute de la Monarchie et les troubles révolutionnaires l’éloignent du problème canadien. L’instabilité politique qui marque le siècle a probablement freiné la curiosité de l’État qui favorise des voyages dans l’hémisphère sud.
D’autre part, l’État français, contrairement à l’Angleterre, prend conscience très tardivement de l’importance des colonies. À partir des années 1850, les missions à caractère scientifique se portent principalement sur le Proche-Orient, l’Afrique et l’Asie. Peu d’explorations sont réalisées par l’État français. En réalité, des entreprises individuelles les financent.
L’opinion publique s’intéresse pourtant, à travers les journaux, aux exploits des conquérants des pôles. Toutefois, la valorisation de l’exploit humain passe sous silence l’apport des Autochtones. Les prouesses des explorateurs sont relatées avec moults détails dans les journaux. Les plus connus sont L’Illustration fondé en 1843, suivi du Monde illustré en 1857 et surtout, LeTour du Monde en 1860, lesquels tiendront en haleine les lecteurs par des récits d’aventures dans des contrées lointaines et mystérieuses. Des voix s’élèvent pourtant pour mettre en garde contre les exploitations romanesques des données scientifiques[8].
Cet attrait du grand public pour les régions septentrionales est à rattacher au courant romantique en littérature. Si peu d’écrivains en France ont mis en scène des Inuit, beaucoup, à l’image de Jules Verne, ont choisi comme thème central les paysages arctiques en y transposant une dimension exotique et futuriste.
L’Arctique et les sciences humaines en France
Des institutions savantes existent dès le début du XIXe siècle, mais elles ont des moyens plus que modestes et doivent leurs succès à la personnalité de quelques particuliers. Le terme « anthropologie », dont le sens oscille au cours du XIXe siècle, englobe à la fin du siècle, la linguistique, l’archéologie, l’ethnologie et l’ethnographie qui s’émancipent ainsi de la tutelle naturaliste.
En moins d’un siècle, toutes les disciplines relatives aux sciences humaines se structurent pour connaître une forme peu éloignée de celle que nous leur connaissons aujourd’hui. Pourtant, les fructueuses collaborations internationales de la première partie du siècle se transforment en compétition dans le domaine politique et scientifique. Sous le Second Empire, la reconnaissance de la préhistoire par l’empereur Napoléon III et l’importance croissante de l’archéologie nationale engendrent, indirectement, un autre regard sur les peuples à tradition orale. Les progrès en archéologie et en ethnologie, doublés d’une envie d’évasion, ainsi que les prises de positions des gouvernements successifs, incitent à acquérir une meilleure connaissance des peuples. Longtemps, l’Allemagne est apparue comme un exemple dans le domaine de l’archéologie (Gran-Aymerich 1998, 141). La victoire de la Prusse en 1870[9], fait naître un véritable sentiment d’identité nationale. Par réaction, l’enseignement et la recherche française se modernisent.
Du cabinet au musée
À la fin du XVIIe siècle, les collections sont, en général, de plus en plus spécialisées et scientifiques. L’admiration et l’émerveillement ne sont plus les moteurs uniques de la réflexion. Jusqu’alors, il n’y avait pas de système de classification généralisé. Les milieux scientifiques qui se constituent insistent sur l’amateurisme des collections privées où priment la singularité et l’esthétique dans leur présentation. Ils prônent la nécessité de constituer des séries complètes concernant toutes les espèces terrestres. En fait, à travers la botanique, s’opèrent les premières tentatives de classification. Les objets de la nature collectés, preuves de l’existence de Dieu, dans un premier temps, deviennent un moyen pour leur propriétaire d’affirmer sa position sociale et sont parfois signe de vanité et d’orgueil. Beaucoup de « cabinets de curiosité »[10] en Europe s’ouvrent aux visiteurs qui, grâce à des publications, prennent connaissance des collections les plus prestigieuses.
On voit s’affirmer petit à petit une différenciation entre les collections privées et les collections reliées à des institutions. À partir du XVIIIe siècle, chaque Nation voit l’intérêt de constituer et d’assurer la conservation de collections afin de les rendre accessible au public. En France, la fin brutale de l’Ancien régime accélère ce processus.
Dès le début du XIXe siècle, la France se dote de musées. Les cabinets de curiosités des riches notables et des princes, confisqués durant la Révolution, sont à l’origine de la création de nombreux musées municipaux à travers toute la France. Plus de 600 musées sont aménagés sur le territoire (Georgel 1994, 35). À bien des égards, ce siècle fut une période de mutation, de gestation intellectuelle non seulement dans le monde des musées, mais aussi à travers les sociétés savantes françaises qui ont mis en contact des érudits de différents pays.
Au sein de ces collections, on constate la présence d’objets[11] extra-européens bien avant la création du musée d’ethnographie de Paris. La province n’a rien à envier à Paris, car au XIXe siècle des items inuit sont présents dans les musées municipaux, souvent associés aux collections d’histoire naturelle. En parallèle, des objets sont collectionnés par des particuliers.
L’accroissement de ce type de collections à Paris, incite d’ailleurs le ministre de l’Instruction publique à envisager la création d’un musée ethnographique dont le projet est maintes fois reporté depuis le début du siècle, mais qui s’avère incontournable dans les années 1870 (Hamy 1890). Le musée d’Ethnographie du Trocadéro, sous la tutelle du ministère de l’Instruction publique, ouvre ses portes en 1878 et regroupe, entre autres, toutes les collections extra-européennes conservées principalement à Paris.
Figure 1
Le Palais du Trocadéro à Paris, bâtiment construit pour l’exposition universelle de 1878
Il est attesté que, dès les années 1880, une collection « esquimaude » est exposée et qu’elle se situe entre les collections américaines et asiatiques (Dias 1991, 180)[12]. Ces collections sont arrivées par diverses voies officielles : la galerie d’anthropologie du Muséum national d’Histoire naturelle, le cabinet d’Histoire naturelle du Roi de France, le musée du Louvre, le musée de la Marine, la bibliothèque de Versailles, la Bibliothèque nationale, la bibliothèque Sainte-Geneviève, le musée de Saint-Germain-en-Laye (Jacquemin 1994 ; Dias 1991 ; Le Fur 2009 ; Dupaigne 2013). Le rôle de Théodore Hamy (1842-1908), nommé au poste de conservateur du musée d’Ethnographie du Trocadéro, est capital en ce qui concerne les collections américaines. Son rôle dépasse celui de simple conservateur[13], il est à l’origine, avec le prince Roland Bonaparte, de la création de la Société des américanistes en 1895, alors que l’américanisme connaît une grande vogue depuis les années 1880. Toutefois, les Inuit, là encore, semblent être en périphérie, la société s’intéressant plus particulièrement à l’Amérique centrale et à l’Amérique du Sud. Les Inuit sont considérés comme un peuple apparenté à la famille des langues asiatiques sur le continent américain[14]. Bien que les successeurs d’Hamy gardent un oeil attentif sur les peuples de l’Arctique, il faut attendre les années 1930 pour que des missions ethnographiques régulières s’effectuent au Groenland, et en 1942 pour qu’un département Arctique soit créé au musée de l’Homme[15] remplaçant le musée d’Ethnographie du Trocadéro. Lors des premières années d’activité du musée d’Ethnographie du Trocadéro, il ne semble pas y avoir eu de responsables pour les collections arctiques, pourtant déjà présentes en grand nombre. À peine 20 ans après son ouverture, plus de mille artefacts arctiques, provenant de l’Alaska au Groenland, sont présents dans les réserves. Les collections sont en grande partie arrivées via des échanges ou des dons avec d’autres institutions similaires européennes et américaines[16]. Il semblerait qu’avant-guerre, les départements Asie et Europe soient liés. Leur rôle est important dans l’élaboration du département des Arctiques, qui englobera tous les peuples du cercle circumpolaire mais également les peuples d’Europe du Nord.
En France, à la fin du XIXe siècle, il est très courant de retrouver les mêmes noms associés à des expéditions tantôt en direction du pôle Nord, tantôt en direction du pôle Sud. Le docteur Jean-Baptiste Charcot fait partie de ces quelques grandes figures françaises de la conquête des pôles. Connu pour ses missions en Antarctique, à partir des années 1920, il sillonne les mers arctiques à bord du Pourquoi pas ? Au cours d’un voyage, en 1934, Charcot dépose Paul-Émile Victor (1907-1995) et Robert Gessain (1907-1986) au Groenland. Ces derniers sont véritablement, en France, à l’origine des études arctiques françaises[17].
Les collections nord-américaines et groenlandaises
Ce n’est qu’à partir du XVIIIe siècle que se généralise la présence d’objets d’Amérique du Nord sur le marché européen. Mais, par manque d’informations écrites, il est extrêmement difficile de les dater et de connaître leur provenance exacte. En ce qui concerne les artefacts inuit, les contacts entre les Autochtones, les baleiniers et les marins scandinaves, néerlandais, basques, anglais et français sont avérés depuis le XVIe siècle. Il est vraisemblable que des objets inuit soient arrivés sur le sol national par l’intermédiaire de marins français et basques, lesquels ont pu avoir en leur possession de tels objets[18]. Il va sans dire que la culture matérielle des Inuit intéresse peu les navigateurs à la recherche de produits plus lucratifs, comme les pierres précieuses et l’huile de baleine. Des vêtements en peaux se trouvaient dans les collections privées, malheureusement le caractère périssable de ces matériaux n’a pas favorisé leur conservation.
Par ailleurs, les régions polaires ne sont pas totalement inconnues des curieux, car si les habitants de ces contrés lointaines demeurent bien mystérieux, il n’en va pas de même de la faune. Très vite, on trouve dans les cabinets des spécimens animaliers, mais aussi des raisons de confirmer certains mythes tenaces. Le cas de la licorne[19], animal fabuleux (mi-cheval mi-cerf pourvu d’une « corne » sur le front) est intéressant, car sa « corne » est censée avoir des vertus contre les poisons, d’où sa valeur inestimable. Il s’agit en fait d’une défense de narval ou parfois de morse. L’objet est très recherché et le prix en est extrêmement élevé. Toutefois, dès la fin du XVIIe siècle, les pêches plus nombreuses et plus lointaines font chuter les prix car les pêcheurs rapportent plus fréquemment ces mammifères. Un énorme trafic de fausses « cornes » de licornes fait s’interroger certains scientifiques[20] qui dénoncent la supercherie.
Localisation des collections arctiques canadiennes et groenlandaises
Bien que l’État français n’ait pas eu d’ambitions territoriales à l’égard des régions les plus septentrionales du globe, des artefacts inuit prirent place dans les collections dès la création des premiers musées publics français au début du XIXe siècle. Ils furent conservés non seulement dans des villes portuaires[21] mais aussi dans des villes à l’intérieur du pays[22], sans être systématiquement répertoriés et catalogués. Ils forment actuellement un ensemble de plus de 4700 artefacts recensés arrivés sur le territoire français avant 1937[23].
Ces micro-collections réparties sur le territoire sont en général, isolées au sein des musées, c’est pourquoi, dans la majorité des cas, lorsqu’elles sont exposées, elles s’inscrivent souvent dans un discours didactique élaboré par les conservateurs par rapport à l’ensemble des collections dont ils disposent. Encore aujourd’hui, il existe peu de dossiers d’oeuvres exhaustifs pour ce type d’artefacts dans les centres de documentation des musées.
Bien que l’histoire des peuples arctiques ne soit pas placée au centre d’une réflexion collective, on constate au cours du XIXe siècle, dans des carnets de voyage d’officiers, dans des illustrés de voyages destinés au grand public, ainsi que dans des revues scientifiques, qu’il en est fait mention. Plusieurs discours cohabitent à propos des peuples du Nord. Ils ne s’inscrivent pas dans les mêmes perspectives et n’ont pas le même impact auprès du public et des scientifiques[24]. Durant la première moitié du XIXe siècle, les Inuit figurent dans des ouvrages consacrés aux sciences naturelles et principalement dans les travaux de Buffon et de ceux des philosophes du XVIIIe siècle, mais aussi dans les rapports de missions d’exploration rédigés par des officiers de marine. Dans ce dernier cas, les documents sont souvent destinés à leur ministère de rattachement. On les retrouve dans le Moniteur Universel, dans les Annales Maritimes, mais aussi dans le Bulletin de la Société de Géographie.
Figure 2
Villes françaises possédant des artefacts arctiques au XIXe siècle
À partir de années 1860, les Inuit sont vus et perçus à travers le prisme de l’anthropologie physique, de l’archéologie puis, de l’ethnographie mais rarement comme sujet principal. Les descriptions naturalistes sont encore très présentes. La diffusion des nouvelles disciplines n’est pas homogène dans les musées français, car elle dépend en grande partie des qualifications des conservateurs qui donnent une impulsion à l’acquisition d’un objet ou d’un autre. En ce qui concerne les artefacts arctiques, le musée est donc témoin de ces différents discours liés aux sciences humaines, mais n’en n’est jamais l’initiateur[25].
Collecteurs, donateurs, pourvoyeurs : distinctions entre les différents modes d’acquisitions
On distingue plusieurs modes d’acquisition : en tout premier lieu, les dons puis les échanges entre personnalités et enfin, plus rarement, les achats. Au début du XIXe siècle, des collections de notables et d’aristocrates confisquées durant la Révolution française, parmi lesquels se trouvent des artefacts inuit, intègrent les collections publiques[26]. On trouve encore la trace d’un petit nombre d’entre eux dans les collections actuelles : le kayak conservé au musée des Beaux-Arts de Rennes appartenait, sans doute, au parlementaire Christophe-Paul Gaultron de Robien (Aubert 2001, 213).
Après la Révolution, les artefacts arctiques parviennent en règle générale au musée par l’intermédiaire de particuliers qui les déposent souvent dans les villes dont ils sont originaires. Ce fait est très clairement illustré, dès 1836, par René de Cornulier (1811-1886), lieutenant de vaisseau, et Eugène Le Brettevillois, commis de marine, revenant du Groenland à bord de la corvette La Recherche et qui rapportent chacun un kayak avec ses accessoires, dans leur ville respective, Nantes et Cherbourg.
Pendant notre séjour à Frederikshaab, chaque officier voulut avoir une kaïak [kayak], pour en doter le musée de sa ville natale ; mais les pauvres Esquimaux n’étaient pas disposés à se démunir d’un meuble à la fois si utile pour eux et si difficile à remplacer ; il fallut beaucoup de vêtements, beaucoup de chemises pour les tenter et les engager à nous les céder. Nous parvînmes, cependant, non-seulement à nous en procurer plusieurs, mais encore à les apporter en France en très-bon état.
J’essayai inutilement de me couler dans une kaïak [kayak] : mes genoux ne pouvaient y passer. Le domestique des officiers seul y parvint ; il fit plusieurs fois le tour du bâtiment ; mais, perdant tout à coup l’équilibre, il chavira, la tête en bas, et se serait infailliblement noyé si les Esquimaux qui le suivaient ne l’eussent redressé.
Méquet 1852, 139
Figure 3
D’après un dessin R. de Cornulier in Mayer M.A., Voyage en Islande et au Groenland exécuté pendant les années 1835-1836… 1842
L’importance de la marine est essentielle durant le XIXe siècle, car c’est à travers elle que les artefacts arctiques, encore conservés aujourd’hui, sont arrivés sur le sol français, puis dans les musées. Pourtant peu de missions d’exploration sont intégralement commanditées par l’État français. Le voyage de La Recherche au Groenland, réalisé en 1836, pour retrouver le navire La Lilloise de Jules de Blosseville, en est l’un des rares exemples. Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’un voyage d’exploration, les officiers qui s’arrêtent à Paamiut, au Groenland, durant une quinzaine de jours, se procurent, à titre privé et pour le compte du ministère[27], des artefacts qui leur semblent caractéristiques de la culture groenlandaise. Ces objets sont rapportés à la fois comme de simples souvenirs de voyage et comme des témoins matériels d’une autre culture.
Il est utile de noter l’absence totale d’artefacts déposés par des armateurs ou des matelots français dont la présence en grand nombre aux abords du Groenland, de l’Islande et du Labrador, est attestée depuis le XVIe siècle. Il semblerait qu’à l’inverse des musées néerlandais, anglais et danois, les élites françaises, regroupées dans des sociétés savantes – et parfois en relation avec les musées – n’ont pas tenu compte des dires de la marine marchande, ni considéré avec intérêt les objets rapportés par de simples matelots. Pourtant, nous savons que, dès le XVIIIe siècle, des notables et des antiquaires se procuraient, dans les villes portuaires, des « curiosités » venues agrandir les collections de leurs cabinets. Comment se fait-il que ces artefacts n’aient pu être intégrés aux collections nationales ?
Les dons des particuliers restent le principal mode d’acquisition d’artefacts arctiques par les musées. Dans la première moitié du XIXe siècle, ils proviennent exclusivement d’officiers de marine qui ont pu dans des cas exceptionnels les acquérir directement auprès des populations locales, mais aussi les acheter ou les échanger, lors de rares escales dans des ports, auprès d’autres marins ou chez des marchands. S’ajoute aux marins comme de la Roncière le Noury (don en 1877 à Évreux)[28] ou Honoré Jacquinot (don en 1865 à Varzy), une autre catégorie de particuliers dont un grand nombre demeure encore anonyme malgré de longues recherches : par exemple, le Dr. Roullin de Saint-Germain-en-Laye ou M. Gilet de Rennes. Pourtant, le fait d’effectuer un don indique que les donateurs sont insérés dans le tissu social de la ville et qu’ils appartiennent, d’une certaine manière, à l’élite. Il pourrait s’agir d’industriels, de commerçants, de scientifiques.
Au sein des musées, les échanges ont été favorisés par des personnes partageant des intérêts communs qui dépassaient le cadre de l’Arctique et qui relevaient d’une mise en avant de sphères d’influences politiques et académiques. Il est évident que ces dons ont bien souvent été réalisés dans un cadre privé ou semi-privé. Ainsi, il arrive que certains objets ne soient pas consignés, à leur arrivée sur le registre des entrées, comme les kayaks grandeur nature du Muséum d’Histoire naturelle de Nantes, du Muséum d’Histoire naturelle de Lyon (dont les collections se trouvent désormais au musée des Confluences), ainsi que les artefacts groenlandais du Muséum d’Histoire naturelle de Rouen. Il est évident que les conditions d’acquisition de certains artefacts restent encore difficiles à saisir pour les chercheurs actuels qui ne disposent pas d’une parfaite connaissance de l’histoire locale[29]. Enfin, l’apparition de ces objets dans les collections est révélatrice de l’intérêt des conservateurs et des représentants des municipalités d’alors.
À partir de la deuxième moitié du XIXe siècle et jusque dans les premières décennies du XXe siècle, les donateurs ne sont plus uniquement français. Des particuliers étrangers, notamment danois, offrent à des musées français divers artefacts. Les conditions des échanges restent mal connues dans la mesure où il existe peu, voire pas, de traces d’une correspondance entre les donateurs et l’administration des musées. Pourtant, il est permis d’être optimiste quant à la poursuite de ces recherches sur les collections. Certaines hypothèses ont pu être confirmées, concernant notamment l’origine des deux kayaks du danois Bistrup, de l’ensemble du Fram du norvégien Ringnes, mais aussi de celui d’Adsersen dont les artefacts sont conservés, pour les deux premiers au musée national de la Marine et pour le dernier, au musée des Confluences de Lyon et au musée du quai Branly-Jacques Chirac.
Figure 4
Kayak, qajaq de Nantes, no MHNN.E.42.1 à l’exposition Canoës & kayaks, la découverte d’un nouveau monde, au musée Adrien Mentienne de Bry-sur-Marne. 2004
Figure 5 et 6
Détails du visage du mannequin, ainsi que d’une moufle à l’exposition Canoës & kayaks, la découverte d’un nouveau monde, musée national de la Marine. 2004
Des échanges ont lieu également entre des participants à des congrès internationaux. Le conservateur du musée national de Copenhague, Carl Steinhauer et le Suédois Adolf-Erik Nordenskiöld offrent, respectivement en 1869 et 1874, au conservateur du Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, Alexandre Bertrand, des artefacts groenlandais dont certains sont très anciens (Guigon 2004, 254). Il est fort probable que les rassemblements de scientifiques et d’amateurs éclairés, à travers les réseaux de sociétés savantes et lors des congrès scientifiques qui se tenaient dans certaines villes de France, aient été à l’origine de la plupart des dons[30]. Ceci explique en partie que les collections soient disséminées sur tout le territoire.
D’autre part, bien qu’il existe, à partir de 1878, un musée d’Ethnographie au Palais du Trocadéro à Paris, des dons parvenaient toujours aux musées à vocation encyclopédique. Il est évident que les donateurs, malgré leurs affectations en France et à l’étranger, restaient attachés à leur région d’origine et y déposaient des objets.
Une catégorie sociale n’est pourtant pas représentée parmi les donateurs, ni à la fin du XIXe siècle ni au début du XXe siècle, celle des missionnaires de la congrégation des Oblats de Marie Immaculée[31], probablement les seuls Français à avoir séjourné longuement en terre inuit. Le plus connu de son vivant fut sans doute Émile Petitot (1838-1916) qui a officié de 1862 à 1883 dans le vicariat d’Athabaska-Mackenzie[32]. Bien que la majeure partie de son travail concerne les Tchiglit, les Dènè-dindjié et les Algonquiens, il fut parfois en contact avec les Inuit. Il collecta un grand nombre d’informations concernant la vie sociale des groupes qu’il rencontrait, ainsi que des témoins matériels et des renseignements d’ordre toponymique. Dès 1875, lors d’un séjour d’un an en France, il se mit en rapport avec des sociétés savantes françaises. Cette même année, à la suite de la publication de sa carte de la région du Mackenzie, la Société de géographie de Paris lui décerne une médaille d’argent. Certains objets ayant appartenu à Petitot ont été acquis par le musée d’Ethnographie de Neuchâtel, en 1910. Ce n’est qu’à partir de 1949, qu’apparaissent, dans les collections publiques, des artefacts archéologiques et ethnographiques donnés par un missionnaire –certes, archéologue et anthropologue– Guy Mary-Rousselière (1913-1994), au Musée de l’homme.[33] On retrouve également au musée des Confluences de Lyon des artefacts acquis en 1979 et collectés à l’origine par Monseigneurs Grandin, Bernard et Laverlochère. Ces collections appartenaient à l’association de la Propagation de la foi et étaient utilisées lors d’expositions mettant en scène l’évangélisation de ces lointains territoires.
Les achats sont peu nombreux, on notera qu’en 1870, le musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye acquiert un lot incluant deux armes. À Rennes, l’achat en 1920 d’un lot d’un certain Galicier comprend une majorité d’artefacts arctiques ; il semblerait que ces derniers aient été en fait associés à l’origine au kayak déposé une année auparavant. Elles s’intègrent parfaitement dans les collections inuit déjà présentes au musée. Ces rares achats étant effectués dans un souci de mise en valeur de pièces déjà présentes. Récemment, l’origine d’une collection importante arrivée au musée d’ethnographie du Trocadéro a été découverte. Il s’agit de plus de 200 objets du Labrador[34] rassemblés par un tourneur de spectacles ethnographiques, dans des conditions très particulière[35]. Bien que cette collection compte des pièces archéologiques et ethnographiques, aucune étude n’avait été réalisée sur cette collection afin de comprendre d’où provenaient exactement ces objets et dans quelles conditions ils étaient parvenus en Europe.
Dès la première moitié du XIXe siècle, ce type d’objets est conservé par les Européens par crainte de leur disparition imminente sous la pression de la civilisation occidentale. Les collecter était donc un moyen d’en conserver la trace tout en les intégrant aux discours scientifiques en construction, lesquels étaient imprégnés des théories évolutionnistes en vogue à partir du milieu du siècle :
De nombreuses peuplades dans l’Amérique et dans l’océan ont déjà renoncé à leurs habitudes natives et à leur civilisation indigène, pour adopter les coutumes dont le modèle leur a été porté par les navigateurs européens. Chaque jour voit effacer quelques-uns des traits natifs qui distinguaient les habitants primitifs des différentes parties du globe. Dans quelques années, peut-être, il sera trop tard pour retrouver les traces de leurs habitudes nationales, et l’on ne pourrait plus présenter d’une manière complète le tableau moral et intellectuel de toutes les familles du genre humain.[36]
Bulletin de la Société de Géographie 1836, 94
Ce discours reste inchangé durant tout le siècle. En 1841, dans son Essai sur la construction navale des peuples extra-européens, le Vice-Amiral François-Edmont Pâris (1806-1893), conservateur au musée Naval, insiste sur le besoin de conserver des artefacts extra-européens :
La côte orientale de l’Amérique du Nord, occupée maintenant par une nation civilisée, n’offre que ce que nous voyons tous les jours dans nos ports, et ce n’est que vers les régions boréales dont le climat éloigne les Européens que l’on retrouve des hommes encore sauvages, ayant une industrie à part.
Pâris 1841, 305
Cinquante ans plus tard, Jean Destrem, conservateur lui aussi au musée Naval (désormais musée national de la Marine), mentionne, dans le catalogue du musée de 1909, l’intérêt de conserver dans les collections les embarcations provenant de pays lointains :
Nous avons réuni, sous ce titre (Bâtiments exotiques), la très curieuse collection de pirogues et de bâtiments exotiques que possède le Musée et qui peut nous donner une idée de ce que fut la navigation aux premiers âges de l’humanité. […] D’autant qu’avec les progrès de la civilisation, plusieurs de ces pirogues ou bateaux ont cessé d’exister et qu’il est impossible d’obtenir sur place les renseignements qui les concernent et que le musée est seul à posséder aujourd’hui.
Destrem et Clerc-Rampal 1909, 363
Typologie de ces objets et tentatives d’explications
La très grande homogénéité des collections du XIXe siècle retient l’attention. La majorité des pièces proviennent de la côte ouest du Groenland. Parmi celles-ci, un grand nombre concerne les moyens de transport ainsi que l’armement utilisé par les Inuit. Ces artefacts ont été collectés puis présentés selon leur usage. Néanmoins, leur rareté, l’exotisme de leur forme, de leur matière et de leur utilisation ont certainement favorisé leur mise en exposition. On se trouve face à une démarche qui est encore proche des collections de curiosités d’antan, car l’objet est peu ou pas contextualisé. Le mode de classification opéré est soit d’ordre géographique, soit lié à la nature des objets (Dias 1991, 130). En prenant uniquement en compte des artefacts conservés au sein des musées, on constate que la vision de la culture matérielle des Inuit est extrêmement fragmentaire. Peu d’artefacts sont présentés au public, car il s’agit principalement de micro-collections qu’il est très difficile de mettre en exposition. Cependant, les pièces les plus spectaculaires sont exposées.
C’est le cas des kayaks qui, dès leur arrivée dans les musées, prennent place dans les salles d’exposition. Il est néanmoins important d’insister sur le fait que ces objets sont toujours accompagnés d’un cartel extrêmement général.
Le kayak n’est pas la seule embarcation utilisée par les Inuit, mais il demeure la plus étrange. En avançant dans le siècle, apparaît l’idée que l’objet doit être de conception « purement inuit », c’est-à-dire venir d’un lieu sans contact suivi avec la civilisation occidentale. Cette vision est restrictive, dans la mesure où elle n’implique ni emprunt, ni influence à d’autres groupes fussent-ils inuit : « Pour que l’Esquimau devienne tout à fait intéressant, il faut, autant que possible, le dépouiller des éléments étrangers qui, du reste, ne tiennent que superficiellement à sa nature. » (Edmond 1857, 301).
Le kayak est perçu comme un esquif purement inuit[37], alors que l’umiaq (embarcation collective) s’apparente probablement, sur un plan typologique, à des embarcations déjà connues. En outre, le fait que l’umiaq était utilisé par les inspecteurs danois lors de leurs tournées dans les différents établissements côtiers en a certainement éloigné les collecteurs qui l’associaient à une pièce empreinte d’influences européennes. Il semblerait que l’on ait voulu privilégier le caractère unique de ces pièces, ce qui est un paradoxe car elles provenaient probablement, dans une grande majorité des cas, d’établissements connus pour être des lieux de passage des navires de tous les pays. Le jeune officier de marine Bellot indique, comme d’autres, que les Inuit qu’il rencontre à Upernavik sont métissés :
Le 12 juillet, nous arrivâmes à Uppernavik, l’établissement le plus septentrional sur la côte ouest du Groënland. Il y a une trentaine d’années, on y voyait encore des pierres couvertes d’inscriptions runiques, qui semblaient indiquer que les Islandais et autres insulaires, auxquels on attribuait dernièrement la découverte de l’Amérique, poussaient au moins fort loin leurs courses dans le nord. […] Il [l’établissement] renferme seulement quelques centaines d’individus, la plupart métis, issus du commerce des naturels avec la race blanche.
Bellot 1854, 6
Si les conservateurs au XIXe siècle, n’ont eu de cesse de conserver et de répertorier les artefacts qu’ils leur semblent impératif de protéger malgré de très petits moyens, rares sont ceux qui se sont intéressés à ces pièces au-delà d’une brève description. Dans le meilleur des cas, ils se sont appuyés sur des écrits danois et anglais. L’absence d’informations sur les pièces indique que même du vivant du donateur, les conservateurs ne se sont pas souciés de leur demander des renseignements sur la provenance et le contexte d’acquisition. Les artefacts ont été vus comme participant au processus évolutif des différentes civilisations.
Au musée Naval (actuel musée national de la Marine), les collectes rehaussaient le prestige de la marine française. On peut donc comprendre que les régions des mers du Sud aient été favorisées et qu’elles se trouvent mieux documentées. Pâris, en 1841, fait référence à l’ouvrage du frère morave Crantz, ouvrage qui date de 1767 et dont l’action se situe dans une région proche de celle d’où provient le kayak conservé au musée.
Figure 7
Vue de l’entrée du muséum de Nantes. 2002
À Nantes et à Rennes, l’empreinte des sciences naturelles est très forte. En 1876, dans le catalogue du musée de Rennes, Auguste André qui en est le directeur, cite un ouvrage de presque 100 ans du naturaliste Valmont de Bomare, qui prouve que l’auteur ne s’est pas intéressé à la culture des Inuit. À Cherbourg, le kayak s’inscrit, au début du XXe siècle, dans un programme muséographique rattaché à l’ethnographie. À Lyon, en revanche, nous ne savons pas dans quelles conditions sont arrivés et ont été montrés, les artefacts inuit parmi lesquels se trouvait un kayak grandeur nature. On pourrait supposer que cela est en lien avec l’ouverture de la galerie d’Anthropologie en 1879 au muséum.
Dans le cas du musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, le propos est clairement énoncé, les artefacts sont présentés et exposés à titre de matériel de comparaison avec les collections archéologiques : « La salle de Mars a cessé d’être un magasin ; […] elle répond entièrement à son nouveau nom en ce sens qu’on y expose, à titre exclusif, des objets de provenance non gauloise, pouvant éclairer, par comparaison, ceux d’origine indigène. » (Reinach 1921, 48).
La comparaison établie entre la culture matérielle des Inuit et celle des peuples préhistoriques au XIXe siècle, pertinente pour un archéologue de l’époque, est, en revanche, confuse pour une majorité de visiteurs qui établit un parallèle entre les Inuit et les hommes « de l’âge de pierre », comme si ceux-ci étaient restés dans un état statique, a-historique durant des milliers d’années[38].
Il s’avère que pour le corpus arctique, les objets rapportés par les différents collecteurs sont en grande majorité des armes. Peut-on y voir une première explication du fait que ce sont des hommes qui les ont rapportés ? Il ne faut pas également négliger le fait que les contacts avec les Inuit étaient effectués sur des durées extrêmement courtes et que le but premier de ses voyages n’était pas de collecter des objets. On peut néanmoins s’interroger sur la quasi-absence d’objets à caractère chamanique ou social, comme les tambours, les jouets d’enfants ou les artefacts relatifs au travail des femmes : par exemple, le ulu, couteau semi-circulaire des femmes pourtant utilisé de l’Alaska au Groenland. Au XIXe siècle, les artefacts conservés en France sont finalement assez révélateurs de leur mode d’acquisition. Malgré la diffusion d’ouvrages connus, le savoir sur la culture des Inuit est totalement absent des musées. Le fait qu’il s’agisse de micro-collections réparties sur tout le territoire n’a pas favorisé leur étude jusqu’à aujourd’hui. On peut dire que les connaissances de la culture inuit sont extrêmement fragmentaires au XIXe siècle. En outre, la culture matérielle inuit exposée, ou présente dans les réserves, ne rend pas compte de l’étendue des témoins matériels disponibles. Il faut attendre la création du musée de l’Homme à Paris pour que la culture matérielle des Inuit soit prise en compte, au sein du musée, dans son ensemble grâce à la mission de Paul-Émile Victor dans le district d’Ammassalik[39] permet au musée de conserver la plus vaste collection ethnographique arctique en France, soit plus de 3700 artefacts.
Figure 8
Entrée principale du musée nationale de la Marine et du musée de l’Homme. 2004
On note également que les artefacts, dans la grande majorité des cas, ne portent pas de traces d’utilisation. Il est plus que probable que dès leur fabrication, ces artefacts aient été destinés à être échangés ? Ces échanges s’effectuaient-ils dans un contexte clairement établi lors de brèves escales ? Une étude systématique des pièces serait la bienvenue pour éclairer ce point. Il serait pertinent de s’intéresser à la notion même d’échange pour déterminer si, dans certains cas, les Inuit répondaient à une demande régulière ou s’il s’agissait d’échanges d’objets usuels utilisés quotidiennement[40].
Intérêt des musées contemporains pour leur patrimoine extra-européen
De nombreux musées français ont une politique active de récolement[41] des collections, dites « ethnographiques ». Depuis 2002, l’État français a imposé à tous les musées bénéficiant de l’appellation « musée de France », de procéder tous les dix ans au récolement des collections (Art. 12 de la Loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)[42]. Un récolement implique que chaque artefact présent dans les collections doit avoir un marquage spécifiant son numéro d’inventaire, être clairement localisé en réserve ou exposé en salle. Il doit être inscrit dans le registre d’inventaire et dans la mesure du possible, être associé à une documentation (dossiers d’oeuvres, catalogue, archives diverses). Cette décision émanant du ministère de la Culture a eu un impact important et profond sur l’histoire des collections sur le territoire français. Elle a de plus permis une redécouverte de certains artefacts isolés au sein de collections encyclopédiques désormais répertoriés sur support informatique. Un grand nombre de musées ont pu mettre en ligne une partie de leurs collections. Dans ces nombreux lieux, les objets et les documents ne sont pas toujours disponibles, pour cause de déménagements ou de rénovations de grande ampleur, ce qui explique parfois une certaine lenteur pour accéder aux collections et à leur documentation. Néanmoins, on peut constater un intérêt croissant pour ce type de collections, aujourd’hui beaucoup plus marqué qu’il ne l’était au début même de ma recherche en 1999.
Bien que les artefacts conservés s’inscrivent dans une démarche scientifique, le type de présentation, ainsi que les commentaires sont plus ou moins identiques dans chaque lieu. On constate qu’ils sont exposés dans les espaces permanents de façon semblable et que les conservateurs se sont heurtés bien souvent aux mêmes difficultés de contextualisation des pièces.
L’intérêt actuel pour les collections, dites « ethnographiques », s’inscrit dans une nouvelle approche de l’objet, résultant de la dynamique de valorisation de tous les patrimoines conservés. On constate qu’il est de plus en plus commun pour les conservateurs de faire appel à des spécialistes du monde arctique dans le cadre d’exposition temporaire[43] mais également pour participer à des projets de plus grandes envergures[44]. L’élaboration collective d’identification des artefacts englobe toutes les disciplines des sciences humaines et sociales et dépasse les frontières nationales, il devient donc impératif de réunir les moyens nécessaires pour la réussite de ce type de recherche qui demande un minutieux travail de coordination pour être mené à terme.
L’histoire des artefacts arctiques ne s’arrête donc pas à la porte du musée, elle continue et est renouvelée par les différents discours qui leur sont appliqués et l’intérêt que les scientifiques leur portent. Les objets ont une vie à l’intérieur du musée, lequel doit être plus que jamais pensé comme un lieu en mouvement, en lien avec les différents types de collections conservées. L’artefact n’a pas qu’une simple valeur utilitaire, il s’inscrit dans une perspective plus large de découverte de l’autre. Il est plus que certain que les présentations futures prendront en considération le patrimoine immatériel et développer des partenariats pluridisciplinaires et internationaux tous en créant des liens nouveaux sans cesse renouvelés avec les principaux intéressés : les Inuit et les Kalaallit.
Appendices
Remerciements
Je tiens à rendre hommage à mes deux directeurs de thèse, Michèle Therrien (†) et André Desvallées, qui ont eu le courage d’accepter de diriger ce type de recherche, qui n’était alors pas un sujet dans l’air du temps. J’aimerais également remercier profondément Vladimir Randa, chargé de cours à l’Institut national des langues et civilisations orientales durant ma thèse, dont les conseils et les corrections avisés ont beaucoup apporté au résultat final. Je suis profondément reconnaissante à tous les archivistes et bibliothécaires, que j’ai eu l’occasion de rencontrer en France, leur humilité et leur abnégation ont été une source d’inspiration au quotidien. Je pense tout particulièrement à Sylvie Devers, Responsable du Fonds polaire-Jean Malaurie, au MNHN jusqu’en 2007, qui m’a apporté de précieuses suggestions bibliographiques tout au long de mes recherches, toujours avec un enthousiasme et une grande générosité qui la caractérise. J’adresse également mes remerciements les plus sincères aux conservateurs et attachés de conservation qui m’ont accordé leur confiance durant ma thèse et bien au-delà, et plus particulièrement à : André Delpuech, désormais directeur du musée de l’Homme ; Paz Núñez-Regueiro, actuelle responsable de l’unité patrimoniale Amérique, au musée du quai Branly-Jacques Chirac ; et Elikya Kandot, actuelle directrice du musée de Boulogne-sur-Mer. Ce numéro n’aurait pu voir le jour sans l’obstination et le dévouement de Murielle Nagy. J’aimerais également remercier chaleureusement Aurélie Maire pour avoir mené à terme ce numéro malgré de nombreux contretemps. Enfin, je tenais à remercier les deux évaluateurs pour leurs commentaires constructifs.
Notes
-
[1]
Le présent article est une synthèse de mon mémoire de recherche de 3e cycle à l’École du Louvre intitulé Historique et présentation des collections inuit dans les musées français au XIXe siècle, dirigé par Michèle Therrien, professeur des Universités, Institut national des langues et civilisations orientales et André Desvallées, conservateur général honoraire du Patrimoine, 2006. Bien qu’exclusivement consacré aux items du Groenland et du Canada oriental présents dans les musées au XIXe siècle, cette recherche a permis d’identifier les institutions muséales possédant des artefacts Inuit (de l’Alaska au Groenland) au niveau national et de constituer une liste exhaustive des lieux. Cette recherche a perduré de 2007 à 2012 dans le cadre de plusieurs missions réalisées au sein du Musée du quai Branly-Jacques Chirac.
-
[2]
Cette recherche s’articulait autour de deux axes : d’une part, l’étude, dans une perspective historique, des objets au sein des musées. Dans ce cadre, l’intérêt fut de rassembler des documents originaux provenant de sources variées (périodiques scientifiques, presses locales, archives administratives, etc.) et de les confronter aux informations existant dans les musées. Puis d’autre part, un inventaire analytique des collections encore conservées a été élaboré en m’inspirant des divisions définies par André Leroi-Gourhan (1971, 1973) pour constituer un classement des collections :
Les témoins matériels relatifs aux techniques d’acquisition : moyens de transport, armes ;
Les témoins matériels relatifs aux techniques de fabrication : matières premières, outils ;
Les témoins matériels relatifs aux techniques de consommation : les vêtements, ustensiles de cuisine ;
Les témoins matériels relatifs à la vie sociale : la vie profane et la vie spirituelle (jeux, amulettes, etc.).
-
[3]
Dépouiller de nombreux périodiques et revues datant principalement de la deuxième moitié du XIXe siècle fut primordial. Citons, par exemple : Le Journal de la Société des Américanistes, la Revue d’Ethnologie, les Matériaux pour l’histoire primitive et naturelle de l’Homme, La Revue d’Anthropologie.
-
[4]
Bien qu’au XIXe siècle le terme « Esquimaux » soit systématiquement usité, je lui ai préféré l’ethnonyme « Inuit » qui signifie « les êtres humains » en langue inuit. D’autre part, suivant l’exemple de nombreux linguistes et anthropologues, j’ai choisi de le mentionner sans marque de genre ou de nombre dans la mesure où il s’agit déjà d’un pluriel.
-
[5]
Buffon n’est pas le premier à avoir parlé des Inuit. Néanmoins, c’est sous sa plume que sont rassemblées et compilées toutes les connaissances exploitables dans le domaine des sciences humaines au XVIIIe siècle. Son travail sur l’Histoire naturelle… dura plus de 30 ans et il n’hésita pas, à de nombreuses reprises, à réactualiser ses écrits.
-
[6]
Pourtant depuis 1721, les Danois sont présents au Groenland.
-
[7]
Le Traité de Paris, signé le 10 février 1763, met fin à la guerre de Sept ans. Il est conclu entre la Grande-Bretagne, la France et l’Espagne. La France perd, entre autres, ses possessions canadiennes (Article 4). La Grande-Bretagne lui cède les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon pour servir d’abri aux pêcheurs français (Article 6).
-
[8]
Comme le commandant de Villeneuve, dans l’avant-propos de son essai « L’exploration du Pôle Nord par la lumière », en 1875 (notice 1027 : SG-carton VI-VU, Archives nationales, département des Cartes et Plans).
-
[9]
Le conflit franco-prussien opposa la France de Napoléon III et le royaume de Prusse soutenu par une coalition d’États Allemands de juillet 1870 au 28 janvier 1870. La défaite de la France renforça l’entreprise du chancelier Otto Von Bismarck de fédérer les États de l’Allemagne du Nord autour de la Prusse.
-
[10]
À partir du XVIe siècle, se constituent des collections variées regroupées dans des cabinets. Ce phénomène d’ampleur européenne concerne des princes et des érudits dont la volonté est de rassembler, dans un espace clos, des objets qui sortent de l’ordinaire. Le terme français « cabinet de curiosité » trouve dans les autres pays européens des équivalents. En italien, on utilise le terme studiolo qui désigne une chambre d’étude propre à la réflexion. En revanche, en allemand le terme wunderkammer « chambre des merveilles » semble lui être préféré, alors qu’en néerlandais, on parle de rariteiten kabinet. À travers les différents termes utilisés en Europe, nous voyons se profiler une combinaison intéressante de ce que l’on peut trouver et faire dans un lieu si particulier. Un cabinet de curiosité est avant tout un lieu de réflexion personnelle, dont les objets sont des supports de la connaissance et de la rêverie sur le monde, voire du monde propre au collectionneur.
-
[11]
Dans le cadre de cet article, j’emploie sans distinction le terme « objet » ou « artefact ». Pour désigner les créations inuit, le terme « artefact » me semble plus approprié qu’« objet » ou « objet d’art », qui implique une échelle de valeur correspondant à des critères occidentaux, mais le fait qu’il soit fréquemment employé en France par rapport aux vocabulaires archéologiques en réduit le sens. André Desvallées en donne la signification suivante dans son glossaire publié en 1998 : « Artefact n.m. – Assimilable à l’ancien terme latin Artificialia, le terme « artefact », d’abord surtout utilisé par les anglophones, sert à désigner de nos jours tout « objet » fabriqué par l’homme, et notamment ceux pour lesquels il use de procédés techniques » (Desvallées 1998, 206).
-
[12]
Une coupure du journal Le Globe, datée du lundi 21 juin 1880 concernant l’ouverture du musée ethnographique du Trocadéro est signée par Jacques Caupian : « Après avoir admiré les objets de la Colombie, du Guatélama [dans le texte], de l’Uruguay, des Etats-Unis, du Canada, etc., nous pénétrons dans les régions polaires, et vivons un peu avec les Esquimaux. » (cote F17 3846 1, dossier « Musée ethnographique du Trocadéro », Archives nationales).
-
[13]
Ernest Théodore Hamy est membre de diverses sociétés savantes tout au long de sa carrière : enseignant au Muséum d’Histoire naturelle ; membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres ; délégué du ministère de l’Instruction publique dans les Congrès d’anthropologie et d’archéologie préhistorique, etc.
-
[14]
Jusqu’en 2004, au musée de l’Homme, l’étude des sociétés arctiques dans leur ensemble (Russie septentrionale, Alaska, Canada oriental, Groenland, Europe du Nord) dépendait du département des Arctiques et n’était pas rattachée au département des Amériques. Lors du transfert des collections ethnographiques au sein du musée du quai Branly-Jacques Chirac, le département des Arctiques a disparu, les collections ont donc été séparées : les items sibériens étant désormais dans l’unité patrimoniale « Asie » et les items alaskiens, canadiens et groenlandais, rattachés à l’unité patrimoniale « Amériques ».
-
[15]
Ce département est dirigée par Éveline Lot-Falck (Lévi-Strauss 1973, 39-44).
-
[16]
Citons, notamment : le national Museet de Copenhague (coll. no 71.1881.56), la Smithsonian Institution (coll. no 71.1885.88 ; coll. no 71.1886.127 ; coll. no 71.1886.128 ; coll. no 129 ; coll. no 71.1886.130 ; 71.1886.132 ; coll. no 71.1886.133 ; no 71.1887.34 ; no 71.1896.69.3 Arc), le musée de Stockholm (coll. no 71.1884.12).
-
[17]
Tasilaq fut, depuis 1929, et d’une manière continue, le terrain privilégié des chercheurs français liés au musée de l’Homme de Paris. Le musée possédait d’ailleurs l’une des plus grandes et complètes collections au monde, relative à cette région qui se trouve désormais au musée du quai Branly-Jacques Chirac et au musée de l’Homme.
-
[18]
Étant pour la plupart illettrés, peu de témoignages écrits attestent de l’historique de ces objets sur notre territoire. Néanmoins, nous savons que des collectionneurs, à l’instar de l’apothicaire néerlandais Albertus Seba (1665-1736) – possesseur d’un cabinet réputé consacré aux sciences naturelles – avaient l’habitude de se procurer des objets auprès des marins à leur retour de voyage.
-
[19]
Le terme « licorne » provient de l’italien alicorno (1385), une déformation du terme latin unicornis « qui n’a qu’une corne », selon Pline. Au Moyen Âge, la licorne symbolise la virginité et la pureté.
-
[20]
Notamment Ole Worm, naturaliste de Copenhague, mentionne dans son catalogue l’origine des « cornes de licornes » (Worm 1655, 182).
-
[21]
Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Caen, Cherbourg, La Rochelle, Le Havre, Morlaix, Nantes, Rouen, etc.
-
[22]
Angoulême, Annecy, Avignon, Douai, Évreux, Lille, Lyon, Paris, Nancy, Orléans, Saint-Germain-en-Laye, Toulouse, Varzy, etc.
-
[23]
En incluant la collection de l’expédition française dirigée par Paul-Émile Victor, de 1934 à 1935, qui comprend plus de 3700 items. Il s’agissait d’une équipe de jeunes chercheurs français, dont Paul-Émile Victor, alors ethnologue et élève de Marcel Mauss. Il était accompagné de son ami, Michel Perez, géologue de la mission, de Fred Matter-Steveniers, cinéaste, et de Robert Gessain, médecin et anthropologue, futur directeur du musée de l’Homme en 1958.
-
[24]
Les discours varient selon qu’il s’agit d’un article de journal destiné à des spécialistes, au grand public, à des autorités étatiques ou religieuses.
-
[25]
Pour avoir une vision exhaustive de l’époque, il faudrait prendre en compte les collections particulières, les écrits des missionnaires, les catalogues des maisons de vente, ainsi que des maisons commerciales lesquelles, à l’instar de la maison Révillon Frères, ont eu des contacts privilégiés avec les Inuit.
-
[26]
Il est aussi permis d’imaginer qu’un certain nombre d’objets, aujourd’hui disparus, soient parvenus chez des collectionneurs privés français avant la Révolution.
-
[27]
Il est probable qu’un officier ait été commissionné pour le compte de Paul Gaimard, premier chirurgien à bord lors des deux voyages de la corvette La Recherche, de rapporter des items, car ce dernier responsable de la mission scientifique en Islande, lors du deuxième voyage est chargé de rapporter, pour le compte du ministère de la Marine, des témoins de la culture matérielle des peuples qu’il rencontre. Gaimard est chargé des observations médicales et zoologiques. Il est déposé en Islande, en 1835, lors du premier voyage, alors que l’état-major continue en direction du Groenland. Ceci explique peut-être pourquoi Paul Gaimard n’a pas été en mesure de transmettre des informations précises au musée Naval.
-
[28]
On peut ajouter à cette première catégorie, Alice Crova, archéologue amatrice, dont le mari fut officier de marine (don de 1934, à Lyon).
-
[29]
Au XIXe siècle, on se heurte à des problèmes spécifiques et récurrents liés à la désignation de l’objet, au numéro d’inventaire et à l’orthographe, parfois imprécise, du nom du donateur. Si dans le cadre de la peinture ou de la sculpture, l’objet est immédiatement définissable, pour les artefacts à caractère ethnographique, il en va autrement.
-
[30]
La circulation des artefacts n’obéit pas à des règles pré-établies.
-
[31]
La présence des missionnaires oblats dans l’Arctique est établie à partir de 1860 dans la région de l’embouchure du fleuve Mackenzie, puis à partir de 1873, sur la côte nord de l’Alaska depuis la pointe Barrow jusqu’à l’île Saint-Michel. Dès 1875, ils tentent en vain de pénétrer la côte du Labrador (Duchaussois 1926). Ils arrivent dans l’actuel Nunavut (Canada) dès les années 1930.
-
[32]
Ce vicariat exista de 1862 à 1901, date à laquelle il fut scindé en deux.
-
[33]
Guy Mary-Rousselière a déposé, à trois reprises, des artefacts au Musée de l’Homme, désormais conservés au Musée du quai Branly-Jacques Chirac dans les collections: n° 71.1949.39, n°71.1957.73 et n°71.1968.42.
-
[34]
C’est d’ailleurs par ce biais qu’une collection, restée jusqu’à nos jours inconnue, vient d’être en partie identifiée (Rivet 2014).
-
[35]
Voir l’article de France Rivet dans ce numéro.
-
[36]
Le Bulletin de la Société de Géographie publie, en 1836, un extrait d’un « rapport de la commission nommée par M. le ministre du Commerce et des Travaux publics pour examiner la convenance de la formation d’un Musée ethnographique à Paris ». Ce rapport, daté du 1er nov. 1831, est signé par sept personalités de l’époque : Cuvier, Keratry, Burnouf, Duparquet, Jomard et Remusat qui en était le rapporteur.
-
[37]
On sait pourtant que les Inuit de la côte ouest du Groenland, d’où proviennent les kayaks conservés en France, utilisaient du bois d’importation, ainsi que des outils européens pour réaliser l’armature de leurs esquifs.
-
[38]
Si par manque de données, les scientifiques au XIXe siècle ont pu l’imaginer, cela n’est plus recevable aujourd’hui. Pourtant malgré les avancées spectaculaires des études arctiques au cours du XXe siècle, les informations disponibles pour le public sont encore très insatisfaisantes.
-
[39]
Tassilaq, connue sous le nom d’Ammassalik en France a été fondée en 1894. Le changement de nom officiel a eu lieu en 1997.
-
[40]
« La notion d’échange s’exprime, linguistiquement, en nunavimmiutitut (et dans d’autres dialectes) par la base tauqsi- qui donne naissance à quelques dérivés tels tauqsiguti, l’objet donné en échange et tauqsiaq, l’objet reçu. Ces termes évoquent l’idée de compensation, de substitution pour des objets le plus souvent d’égale valeur ou d’égale nature. » (Therrien 1993, 105-06).
-
[41]
Il faut souligner qu’une politique d’inventaire sans un récolement systématique et simultané de chaque artefact est à l’origine de nombreuses erreurs dans les registres d’inventaire ; erreurs qu’il est très difficile de rectifier par la suite.
-
[42]
Circulaire no 2006/006 du 27 juillet 2006 relative aux opérations de récolement des collections des musées de France (décret no 2002-852 du 2 mai 2002 et arrêté du 25 mai 2004 publié au JORF du 12 juin 2004).
-
[43]
Il s’agit notamment de présenter des oeuvres contemporaines comme cela fut le cas au château-musée de Boulogne-sur-Mer dans le cadre de l’exposition Alaska : passé/présent (Ramio 2016) qui eut lieu du 25 juin au 5 décembre 2016 ; ou l’exposition My Winnipeg : guide de la seine artistique, présentée à La maison rouge- fondation Antoine de Galbert à Paris, du 23 juin au 25 septembre 2011. On peut également mentionner l’exposition Inuit, quand la parole prend forme (Côté 2002) qui s’est tenue au Muséum d’histoire naturelle de Lyon, du 17 décembre 2002 au 18 mai 2003 (les collections sont désormais conservées au musée des Confluences).
-
[44]
Par exemple, le partenariat entre le château musée de Boulogne-sur-Mer et le Alutiiq Museum de Kodiak dont l’une des premières réalisations fructueuses a donné lieu à une exposition en 2009 au Château musée de Boulogne puis à l’Alutiiq Museum de Kodiak ainsi qu’à un catalogue raisonné comprenant les masques de la collections Pinart conservés à Boulogne et à Paris (Haakanson et Steffian 2009).
Références
- ANDRÉ, Auguste, 1876 Catalogue raisonné du Musée d’Archéologie de la ville de Rennes. Rennes : Leroy fils.
- AUBERT, Gauthier, 2001 Le président de Robien, gentilhomme et savant dans la Bretagne des Lumières. Rennes : Presses Universitaires de Rennes.
- BELLOT, Joseph René, 1854 Journal d’un voyage aux mers polaires exécuté par le lieutenant de vaisseau de la Marine française J.R. Bellot à la recherche de Sir Franklin, en 1851-1852. Paris : Perrotin.
- BUFFON, Georges-Louis Leclerc (comte de), 1777 Histoire naturelle, générale et particulière. Supplément. Tome quatrième. Paris : Imprimerie royale.
- CÔTÉ, Michel (dir.), 2002 L’exposition Inuit : Quand la parole prend forme. Paris, Glénat. Catalogue d’exposition, Muséum d’histoire naturelle de Lyon.
- CRANTZ, David, 1767 The History of Greenland : including an account of the mission carried on by the United Brethren in that country, London : the Brethren’s Society.
- DESTREM, Jean et CLERC-RAMPAL Georges, 1909 Catalogue raisonné du musée de Marine. Paris : Dangon.
- DESVALLÉES, André, 1998 « Cent quarante termes muséologiques ou petit glossaire de l’exposition. » In M.-O. de Bary et J.-M. Tobelem (dir.), Manuel de muséographie, p. 205-251. Biarritz : Séguier et Option Culture.
- DIAS, Nélia, 1991 Le Musée d’ethnographie du Trocadéro (1878-1908). Anthropologie et Muséologie en France. Paris : CNRS.
- DUCHAUSSOIS, R.P., 1926 Aux glaces polaires. Indiens et Esquimaux. Paris : SPES, Oeuvre des missions O.M.I.
- DUPAIGNE, Bernard, 2012 « La maturation du Musée d’ethnographie au tournant du XXe siècle ». Outre-Mers 99 (376-377) : 529-52.
- EDMOND, Charles, 1857 Voyage dans les mers du Nord à bord de la corvette La Reine – Hortense. Paris : Michel Lévy frères.
- GEORGEL, Chantal (dir.), 1994 La jeunesse des musées : Les musées de France au XIXe siècle. Catalogue d’exposition, 7 février-8 mai 1994, au musée d’Orsay. Paris : Réunion des musées nationaux/Spadem.
- GRAN-AYMERICH, Ève, 1998 Naissance de l’archéologie moderne, 1798-1945. Paris : CNRS.
- GUIGON, Gwénaële, 2004 « Historique des collections inuit (Arctique canadien et Groenland) du département d’archéologie comparée du musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye ». Antiquités nationales 36 : 251-59.
- GUIGON, Gwénaële, 2006 Historique et présentation des collections inuit dans les musées français au XIXe siècle. Thèse de doctorat. École du Louvre.
- HAAKANSON Sven et Amy STEFFIAN (dir.), 2009 Giinaquq, like a face : Suqpiaq masks of the Kodiak archipelago. Fairbanks : University of Alaska Press.
- HAMY, Ernest-Théodore, 1890 Les origines du Musée d’Ethnographie. Paris : Ernest Leroux
- JACQUEMIN, Sylviane, 1994 « La collecte des objets des mers du Sud ». In Chantal George, La jeunesse des musées : les musées de France au XIXe siècle, p. 278-286. Paris : Réunion des musées nationaux/Spadem
- LEJEUNE, Dominique, 1993 Les sociétés de géographie en France et l’expansion coloniale au XIXe siècle. Paris : Albin Michel,collection Histoire.
- LE FUR, Yves (dir.), 2009 Musée du quai Branly ; la Collection. Paris : Musée du quai Branly, Skira-Flammarion.
- LESSON, P., 1837 « Jules de Blosseville », Journal de Cherbourg, dimanche 19 février 1837.
- LEROI-GOURHAN, André, 1971 L’homme et la matière. Paris : Albin Michel.
- LEROI-GOURHAN, André, 1973 Milieu et techniques. Paris : Albin Michel.
- LÉVI-STRAUSS, Claude., 1973 « Éveline Lot-Falck (1918-1974) ». In École pratique des hautes études, Sciences religieuses. Annuaire. 5e section, tome 82, fascicule II, p. 39-44. Paris : École Pratique des Hautes Études.
- LYON, George Francis, 1824 The Private Journal of Captain G.F. Lyon, of H.M.S. Hecla, During the Recent Voyage of Discovery Under Captain Parry. London : John Murray.
- MÉQUET, Eugène, 1852 Voyage en Islande et au Groënland exécuté pendant les années 1835 et 1836 ; sur la corvette La Recherche commandée par M. Tréhouart dans le but de découvrir les traces de La Lilloise ; publié par ordre du gouvernement. Journal du Voyage. Paris : Arthus Bertrand.
- NAGY, Murielle, 2013 « Devil With the Tace of an Angel : Physical and Moral Descriptions of Aboriginal People by Missionary Émile Petitot ». In Murielle Nagy (dir.), Indigenous Bodies : Reviewing, Relocating, Reclaiming, p. 85-98. Albany : SUNY Press.
- PÂRIS, François-Edmont, 1841 Essai sur la construction navale des peuples extra-européens ou collection des navires et pirogues construits par les habitants de l’Asie, de la Malaisie, du Grand Océan et de l’Amérique dessinés et mesurés par M. Pâris, capitaine de Corvette, pendant les voyages autour du monde de l’Astrolabe, la Favorite et l’Artémise, Atlas : Vol. 2. Paris, Arthus Bertrand. [non-paginé].
- PARRY, William Edouard, 1822-1824 Voyage fait en 1819 et 1820, sur les vaisseaux de S.M.B., l’Hécla et le Griper, pour découvrir un passage du nord-ouest de l’Océan Atlantique à la mer Pacifique… 2 vol. Paris : Gide Fils.
- RAMIO, Céline (dir.), 2016 Alaska : passé/présent. Catalogue d’exposition. Boulogne-sur-Mer : Musée de Boulogne-sur-Mer.
- REINACH, Salomon, 1921 Catalogue illustré du Musée des Antiquités Nationales au château de Saint-Germain-en-Laye. Tome 2. Paris : Musées Nationaux.
- RIVET, France, 2014 Sur les traces d’Abraham Ulrikab. Les événements de 1880-1881. Gatineau, QC : Horizons Polaires.
- ROSS John, 1835a Relation du second voyage fait à la recherche d’un passage au Nord-Ouest. Tome I. Paris : Bellizard, Barthès, Dufour et Lowell.
- ROSS John, 1835b Relation du second voyage fait à la recherche d’un passage au Nord-Ouest. Tome II. Paris : Bellizard, Barthès, Dufour et Lowell.
- THERRIEN, Michèle, 1993 « Membres de la Direction Revillon Frères et chefs de poste : Deux points de vue sur la traite de la fourrure ». Étude Inuit Studies 17 (2) : 97-111.
- VEYSSIERE, Laurent, Philippe JOUTARD et Didier POTON (dir.), 2016 Vers un nouveau monde atlantique ; Les traités de Paris. 1763-1783. Rennes : Presses universitaires de Rennes.
- WORM, Ole, 1655 Museum Wormianum. Seu, historia rerum rariorum, tam Naturalium, quam Artificialium, tam Domefticarum, quam Exoticarum, quae Hafniae Danorum in aedibus Authoris fervantur. Amsterdam : Ludovicum et Dalielem Elzevirios.
List of figures
Figure 1
Le Palais du Trocadéro à Paris, bâtiment construit pour l’exposition universelle de 1878
Figure 2
Villes françaises possédant des artefacts arctiques au XIXe siècle
Figure 3
D’après un dessin R. de Cornulier in Mayer M.A., Voyage en Islande et au Groenland exécuté pendant les années 1835-1836… 1842
Figure 4
Kayak, qajaq de Nantes, no MHNN.E.42.1 à l’exposition Canoës & kayaks, la découverte d’un nouveau monde, au musée Adrien Mentienne de Bry-sur-Marne. 2004
Figure 5 et 6
Détails du visage du mannequin, ainsi que d’une moufle à l’exposition Canoës & kayaks, la découverte d’un nouveau monde, musée national de la Marine. 2004
Figure 7
Vue de l’entrée du muséum de Nantes. 2002
Figure 8
Entrée principale du musée nationale de la Marine et du musée de l’Homme. 2004