Abstracts
Résumé
Les recherches sur les services médicaux, les services sociaux et la protection de la jeunesse au Nunavik sont depuis plusieurs années animées par une volonté d’« autochtoniser » la prestation de soins en laissant une plus grande place aux travailleurs inuit et en documentant les inégalités de pouvoirs entre les professionnels allochtones et les bénéficiaires inuit. Peu d’études se sont toutefois penchées sur l’histoire de l’organisation de ces services en territoire nordique, en particulier l’histoire des relations entre les différents acteurs du système de soins au Nunavik. Cette note de recherche vise à mettre en lumière l’état des connaissances actuelles et la littérature existante sur l’histoire des services de santé, des services sociaux et de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) au Nunavik. En nous appuyant sur l’historiographie et sur les résultats préliminaires d’entretiens conduits entre 2021 et 2022 auprès d’anciens membres du personnel inuit et non inuit, nous souhaitons mettre en valeur les voix des personnes ayant contribué aux services et comprendre l’évolution de ces dernières à travers la perspective des professionnels et de la clientèle. Nous présentons un portrait chronologique des ressources en santé et en services sociaux au Nunavik depuis la première moitié du XXe siècle. Au-delà d’une histoire institutionnelle, les récits de vie nous permettent de documenter la contribution historique du personnel soignant inuit à l’ensemble des services de santé, des services sociaux et des services de protection de la jeunesse au Nunavik et de tracer l’histoire des relations entre les soignants allochtones et la clientèle inuit.
Mots-clés :
- Nunavik,
- santé,
- ressources,
- système de soin,
- relations,
- Inuit,
- allochtones
Abstract
Research on medical services, social services and youth protection in Nunavik has been driven for several years by a desire to “indigenize” the delivery of healthcare by giving more space to Inuit workers and by documenting the inequalities of power between non-Native professionals and Inuit beneficiaries. Few studies, however, have examined the history of the organization of these services in the North, particularly the history of the relationships between the different actors in the health care system in Nunavik. The purpose of this paper is to highlight the current state of knowledge and literature on the history of health and social services and the Youth Protection Branch (YPB) in Nunavik. Based on historiography and on the preliminary results of interviews conducted between 2021 and 2022 with former Inuit and non-Inuit staff members, we intend to highlight the voices of those who have contributed to the services and to understand the evolution of these services through the perspective of professionals and clients. We present a chronological portrait of health and social services resources in Nunavik since the first half of the 20th century. Beyond an institutional history, the oral stories allow us to document the historical contribution of Inuit caregivers to the overall health, social services and youth protection services in Nunavik and to trace the history of the relationship between non-Aboriginal caregivers and Inuit clients.
Keywords:
- Nunavik,
- health,
- resources,
- healthcare,
- relationship,
- Inuit,
- non-Native
Article body
Depuis les dernières années, le concept de « sécurisation culturelle » alimente grandement la recherche académique effectuée au Québec, en particulier au Nunavik (Fournier et Oiseau 2021 ; Tremblay et Echaquan 2022). Concept politique pensé par l’infirmière maorie Irihapeti Merenia Ramsden en 2002, la sécurisation culturelle « représente l’effort de faire prendre conscience aux professionnels de la santé du rôle des relations de pouvoir dans la création des iniquités. » (Fletcher et Riva 2017, 8). Une autre dimension de cette vision implique la place qu’occupent les peuples autochtones au sein des systèmes qui les desservent, en particulier les soins de santé et les services sociaux. En 2015, le rapport de la Commission d’enquête nationale de Vérité et Réconciliation appelait à « l’accroissement du nombre de travailleurs autochtones dans le domaine de la santé et à leur maintien en poste » (CVR 2015, 3 ; Plourde-Léveillée et Fraser 2021, 677). Le rapport de la Commission d’enquête provinciale sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (aussi connue comme étant la Commission Viens), en 2019, constatait d’emblée que l’intégration des travailleurs communautaires constitue un pas essentiel vers la décolonisation des services (Commission d’enquête provinciale sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 2019 ; Plourde-Léveillée et Fraser 2021, 677). Bien que l’objectif d’« autochtoniser » les services de santé soit porté par les chercheurs depuis plus de 50 ans (Bérubé, Bolduc et Proulx 1971, 13 ; Labbé 1987, 10 ; Fletcher et Riva 2017), très peu d’études se sont penchées sur l’histoire de ces services et surtout, à l’histoire des relations entre les différents acteurs du système de soin au Nunavik (Morantz 2010 et 2016 ; Fraser et al. 2016 ; Fournier 2017).
Cette note de recherche vise à mettre en lumière l’état des connaissances actuelles et littérature existante sur l’histoire des services de santé, des services sociaux et de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) au Nunavik. L’exploration du sujet s’insère dans un projet de recherche de la Chaire de recherche Sentinelle Nord sur les relations avec les sociétés inuit, dirigée par Caroline Hervé, professeure au département d’anthropologie de l’Université Laval. Le projet[1] a pour but de mieux connaître les relations entre les Inuit et les professionnels de la santé, des services sociaux et de la DPJ au Nunavik. Il comporte trois objectifs principaux : 1) explorer l’histoire de ces relations et leurs transformations au cours du siècle dernier jusqu’en 1996 ; 2) connaître les perspectives et les souvenirs des Inuit vis-à-vis des services et des professionnels ; 3) et enfin, documenter les perspectives et la nature des expériences vécues par les anciens professionnels de ces services. Tout en explorant la littérature existante sur le sujet, l’équipe a effectué des recherches au sein des archives (Archives nationales du Québec et Institut culturel Avataq) et a réalisé des entretiens avec d’anciens membres du personnel, Inuit et non inuit, des services ciblés. Le croisement de ces sources, qui constitue la prochaine étape du projet, nous permettra d’établir les grandes lignes d’une histoire institutionnelle des services de santé au Nunavik tout en mettant en lumière les récits, expériences et perspectives de ceux et celles qui les ont connus.
Dans le cadre du bilan de la littérature, une exploration a été effectuée dans différentes bases de données académiques (JSTOR, Érudit, ProQuest, Embase, PsycNet, Science Direct, Web of Science), sur la plateforme Ariane (Sofia) et à la bibliothèque de l’Université Laval. Toutes les études portant sur l’histoire des trois services dans la région ont été retenues et une attention particulière fut portée à celles mettant en lumière l’expérience du personnel de la santé et des services sociaux et leurs relations avec les Inuit. Nous avons écarté les études qui portaient uniquement sur les pratiques thérapeutiques traditionnelles inuit (chamanisme, sages-femmes, etc.), sur la conception de la santé par les Inuit ou sur leur état de santé, en particulier lorsqu’elles n’abordaient pas les services médicaux ou sociaux. Nous nous sommes également limitées aux services médicaux et services sociaux institutionnels qui s’établissent au Nunavik au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, jusqu’à la fin des années 1990, soit avant la création de la Régie régionale en 1996. Enfin, nous nous sommes également concentrées sur les acteurs et actrices qui se situaient au premier plan de la prestation des services : les infirmières, les médecins, les travailleuses sociales, les interprètes, et les travailleurs communautaires. Bien que la prestation de services spécialisés (psychiatrie, pédiatrie, etc.) soit abordée dans l’étude, nous n’avons pas creusé l’histoire des relations entre ces professionnels et les Inuit.
L’un des objectifs derrière ce projet de recherche est la mise en valeur des voix de ceux et celles qui ont contribué aux services médicaux et sociaux et de comprendre l’évolution de ces derniers à travers la perspective des professionnels et de la clientèle. Ainsi, au-delà d’une histoire institutionnelle, les récits de vie nous permettent de documenter la contribution historique du personnel soignant inuit à l’ensemble des services de santé, des services sociaux et des services de protection de la jeunesse au Nunavik. C’est dans cette ligne d’idée qu’ont été conduits les 27 entretiens avec d’anciens membres du personnel médical et des services sociaux entre mars 2021 et mai 2022[2]. Cette note de recherche s’appuie sur les résultats préliminaires de l’analyse et de la codification des entretiens, qui est toujours en cours.
Sur les 15 participants non-Inuit interrogés, dix ont commencé à travailler dans le Nord dans les années 1970, trois dans les années 1980 et une dans les années 1990. La durée de la pratique du Nord varie d’un participant à un autre, mais la plupart sont restés près d’une décennie ou plus au Nunavik (87%). Nous avons rencontré trois médecins, sept infirmières, quatre travailleuses sociales et un agent administratif. Sur les 12 participants inuit interrogés, dix ont travaillé dans les services de santé et les services sociaux à titre d’interprètes. Au cours de leur parcours professionnel, quelques-uns ont pris des postes administratifs, d’intervention ou ont poursuivi leurs études. Deux participantes ont témoigné à titre de clientèle. La majorité des Inuit rencontrés étaient toujours actifs au sein des services médicaux et sociaux. Dans le cadre de cet article, nous présenterons un portrait chronologique des ressources en santé et en services sociaux au Nunavik depuis la première moitié du XXe siècle. Bien que nous ayons fait le choix de présenter les services en deux sections distinctes, il est à noter que les professionnels de ces services ont souvent collaboré sur le terrain. À travers notre exploration de la littérature, les principales thématiques qui sont ressorties touchent les évacuations et l’hospitalisation des Inuit au Sud et la centralité du personnel infirmier et inuit sur le terrain.
D’une « assistance-survie » à un service médical organisé : historique des services de santé au Nunavik (1920-1996)
La première assistance médicale au Nunavik est apportée par des missionnaires, des commis de postes traite ou des docteurs américains en visite dans la région dès le XIXe siècle (Labbé 1987, 34 ; Mesher 1995, 31). Une première Direction des services médicaux est créée en 1905 au sein du ministère canadien des Affaires indiennes et dès 1922, le Nunavik est desservi annuellement par la Eastern Arctic Patrol, une patrouille médicale et de ravitaillement qui dessert les Inuit se rassemblant le long des côtes de la Baie d’Hudson et de la Baie l’Ungava par le navire Nascopie, puis le C.D. Howe dès 1950 (Labbé 1987, 34 ; Morantz 2010, 258). Jusqu’en 1969, elle effectue des visites dans les principaux postes de traite[3] (Mackinnon 1991 ; Morantz 2016, 141-142). Jusqu’aux années 1950, l’assistance médicale au Nunavik se limite, malgré tout, à des services sporadiques et irréguliers. C’est ainsi que Bernard Gauthier, dans son étude des impacts socio-économiques des politiques gouvernementales sur les Inuit, en vient à caractériser l’activité fédérale[4] dans la région d’« assistance-survie » (Gauthier 1985, 31).
Ce n’est qu’à partir de la fin des années 1940 qu’un service médical s’organise et se structure au Nunavik. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Service de Santé des Indiens (SSI), ou Indian Health Services[5], est réorganisé au sein du ministère de la Santé nationale et du Bien-Être social (MSNBES). Dans l’objectif d’atteindre un maximum de populations, il étend son réseau médical aux régions excentrées et nordiques en s’appuyant sur la construction de dispensaires. C’est à Port Harrison (Inukjuak) en 1947 et à Fort Chimo (Kuujjuaq) en 1949 que sont construits les premiers postes infirmiers sous la juridiction du fédéral (Jenness 1964). Au début des années 1960, Kuujjuaq dessert la côte de l’Ungava et une infirmière fait la tournée des villages en juillet-août. Sur la côte de la baie d’Hudson, des postes médicaux et dispensaires fédéraux sont en place à Salluit, Kuujjuarapik, Inukjuak et Puvirnituq (DGNQ 1964, 52). À l’époque, le programme du SSI priorise la prévention, l’immunisation et l’enseignement de l’hygiène publique. Le combat de la tuberculose se positionne comme la priorité dans les années 1950-1960, tandis qu’une attention plus particulière est portée aux maladies des voies respiratoires, les otites et les maladies oculaires à partir des années 1970 (Gauthier 1985, 50).
La prestation de services de santé se complexifie lors de la mise en oeuvre, par le Québec, de politiques et de services provinciaux au Nouveau-Québec avec la création de la Direction générale du Nouveau-Québec (DGNQ) en 1963 (Affaires indiennes et du Nord 2006 ; Hervé 2015, 232). À partir des années 1960, le fédéral cède au provincial la responsabilité des soins dans la baie d’Ungava. Cette entente s’étend à la région de la baie d’Hudson en 1981, à la suite de l’accord de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) signé en 1975. Un double réseau de santé se développe ainsi sur le territoire et des dispensaires provinciaux sont construits dans les villages jusque-là non desservis. L’arrivée de la DGNQ annonce aussi l’établissement d’un petit hôpital de 11 lits à Kuujjuaq en 1967, où sont offerts des services de deuxième ligne. Jusqu’à l’arrivée d’un médecin permanent en 1968, Kuujjuaq est desservi par deux infirmières en santé publique (Bérubé, Bolduc et Proulx 1971, 11).
C’est dans le cadre de l’application de la CBJNQ que sont créés en 1978 le Conseil Kativik de santé et de services sociaux (CKSSS) et la Société Makivik (Gauthier 1985, 50). Au même moment, un partenariat avec le département de santé communautaire du Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL) se met en place : le Projet Nord (Labbé 1987, 38). Au sein de cette entente, le CHUL obtient le rôle de « prêter assistance à l’hôpital de Kuujjuaq dans divers secteurs, dont l’accessibilité aux soins spécialisés pour les Inuit, le recrutement et la formation du personnel à la programmation en santé communautaire » (Labbé 1987, 38-39). Les dispensaires d’Ivujivik et de Puvirnituq sont administrés directement par le CHUL, en raison de la position dissidente de ces villages face à la CBJNQ (Gauthier 1985, 53). Projet Nord s’occupe aussi d’organiser les tournées de spécialistes dans la région (ophtalmologie, pédiatrie, etc.) et du service aux patients évacués au Sud (Boivin 1989, 42). Vers la fin des années 1980, les responsabilités de Projet Nord en matière de soins sont transférées à Kuujjuaq et à Montréal. Le Module du Nord québécois, sous chapeauté par l’Université McGill, voit ainsi le jour. Enfin, en 1996, le mandat du CKSSS est transféré à la nouvelle Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN), qui assure encore aujourd’hui la prestation de soins aux villages des deux côtes (Lessard et al. 2008, 5; Affaires indiennes 2006).
En nous fiant à la carte de Gauthier (Figure 1), nous constatons qu’au début des années 1980, tous les villages du Nunavik – sauf Umiujaq, fondé en 1986 – sont desservis par un dispensaire et un personnel sanitaire qui varie selon la taille de la communauté. Dans tous les villages, les services de première ligne, y compris la prévention, sont assurés par une ou deux infirmières licenciées allochtones et parfois une infirmière auxiliaire inuit. (Labbé 1981, 72) Au besoin, le médecin est consulté par radio ou par téléphone, et lorsque nécessaire, le malade est transporté à Kuujjuaq ou dans le Sud où l’on retrouve des services de deuxième et de troisième ligne. (Gauthier 1985, 52) Les médecins de la région font des visites périodiques dans les villages et certains spécialistes – dentistes, pédiatres, psychiatres, etc. – effectuent des visites bisannuelles dans les plus grandes communautés. (Gauthier 1985, 52).
Figure 1
Carte de la « Répartition des ressources sanitaires au Nouveau-Québec et dates d’implantation en 1983 » (Gauthier 1985, 50)
Puisque la plupart des villages du Nunavik n’ont accès qu’à des soins de première ligne, le personnel infirmier occupe une place centrale dans la prestation de services auprès des Inuit et ce, dès la fin des années 1940. À leur arrivée au Nord, les infirmières reçoivent une formation de 15 jours par un médecin à l’hôpital de Kuujjuaq. Elles sont préparées à « toute éventualité », puisqu’elles doivent être en mesure d’assumer un rôle élargi en dispensaire et faire des examens, des diagnostics et des traitements, ainsi que des accouchements en cas d’urgence ou d’absence du médecin dans le poste (Bérubé, Bolduc et Proulx 1971, 12 ; Labbé 1987, 80). Jusqu’à la construction du centre de santé Innulitsivik à Puvirnituq en 1983, les accouchements, les soins spécialisés et les visites périodiques de la baie d’Hudson sont assurés par l’hôpital de Kuujjuaq ou l’hôpital de Moose Factory (Ontario), qui dessert les villages de la côte jusqu’à Salluit. Les cas d’urgence et de tuberculose sont référés à des établissements hospitaliers et sanatoriums du Sud (Morantz 2010, 258 ; Labbé 1987, 36).
Du Nord au Sud : hospitalisations et évacuations médicales
Les premières hospitalisations d’Inuit au Sud sont directement liées aux campagnes de dépistage de la tuberculose que le SSI met en place dès 1946 dans l’ensemble du Canada (Labbé 1987, 35). Tous les étés, une équipe ambulante de médecins, infirmières, techniciens en radiologies et autres spécialistes, font la tournée des villages à bord de la patrouille médicale, le C.D. Howe. Une fois les résultats des tests de tuberculose reçus, les cas positifs sont retenus à bord et les personnes sont transférées dans un établissement du Québec (Gaspé, Roberval ou Québec), de l’Ontario ou des provinces maritimes. Au plus fort de la campagne de dépistage, « un Inuk sur sept est hospitalisé au Sud pour la tuberculose » (Labbé 1987, 35). Les tournées médicales sont aussi l’occasion d’offrir des soins dentaires, d’effectuer les vaccinations et pour les infirmières, et de faire de la prévention (DGNQ 1964, 52). Cette approche reste au coeur du programme du SSI jusqu’à ce que les médicaments pour traiter la tuberculose deviennent accessibles, vers la fin des années 1960 (Sandyford1994, 64 ; Morantz 2016,192).
En 1941, un système d’identification par numéro (E-numbers) est mis en place par le gouvernement fédéral canadien pour recenser les Inuit et faciliter la gestion des services de santé (Anderson et Bonesteel 2010, 151). Jusqu’en 1970, les Inuit qui reçoivent des soins au Nord, tout comme au Sud, doivent porter à leur cou un petit disque d’argile où un numéro est inscrit : ce numéro les assigne à l’une des deux baies : E8 pour l’Ungava et E9 pour l’Hudson (Morantz 2016,149). Dans ses mémoires, Dorothy Mesher, une aînée de Kuujjuaq, souligne toutefois que les Inuit ne les portaient qu’en cas de départ pour le Sud :
There were so many problems over “names”, so eventually the government solved that by giving everyone necklace. It was like a dog tag with a number. People didn’t actually wear those things unless they were sent South to the hospital. Most of us just put them away somewhere until they were needed, but we all remembered our number. (If you forget my name, feel free to just call me E8-224).
Dorothy Mesher 1995, 51
La littérature entourant les évacuations des Inuit au Sud avant les années 1980 est assez critique à l’égard de l’intervention gouvernementale et des effets que ces séjours prolongés dans le Sud ont eu sur les Inuit. Le croisement de sources orales et archivistiques par Pat Sandiford G. nous offre d’ailleurs des perspectives inuit de cette importante partie de leur histoire. Tout en dénonçant les effets dévastateurs des politiques gouvernementales en matière de santé, elle brosse un portrait de la gestion de la tuberculose par le SSI à partir de la première moitié du XXe siècle (Sandiford G. 1994). Selon elle, le départ en sanatorium annonce une coupure avec les proches, le territoire et le mode de vie. Les complications s’accroissent d’emblée en ce qui concerne les enfants, qui peuvent oublier la langue de leurs parents et rencontrer des difficultés à se réadapter au milieu nordique à leur retour (Sandiford G. 1994, xxii). Au Québec, les Inuit sont majoritairement envoyés dans des hôpitaux francophones entre 1950-1980. (Ibid : 154).
Selon Toby Morantz, le traitement des patients tuberculeux et de leur famille fut marqué par un manque de communication, de planification et par une insensibilité (Morantz 2010, 73). Elle rapporte que des Inuit se sont plaints de ne pas avoir d’interprètes lors des examens ou de devoir enlever leur pantalon sans aucune explication. Plusieurs craignaient aussi les dépistages du C.D. Howe, puisqu’ils étaient souvent retenus à bord et qu’ils n’avaient pas la possibilité de faire leurs adieux à leurs proches (Beauvais 2017, 72-73). En 1955, 130 Inuit d’Akulivik ont été envoyés à Puvirnituq pour des examens et 50 d’entre eux ont été hospitalisés dans le Sud sans pouvoir avertir leur famille (Morantz 2010,71). Plusieurs Inuit sont aussi décédés sans que leur corps ne soit rapatrié au Nord (Sandiford G. 1994 ; Tremblay 2016).
En plus des soins pour la tuberculose, des services spécialisés ou des soins de longue durée ont mené à l’hospitalisation d’Inuit au Sud. En 1979, on comptait 258 évacuations de patients inuit vers Québec ou Montréal pour des soins spécialisés (Labbé 1981, 73). En 1965, la DGNQ met en place un Service d’accueil aux patients au CHUL pour les Inuit devant recevoir des soins à Québec (Tremblay 2016, 263). Ce service, qui va de pair avec le Projet Nord, est responsable d’accompagner les patients inuit jusqu’à la fin des années 1980. Composé de trois infirmières et de deux interprètes inuit, l’équipe du Service s’assure d’accueillir les patients et de les placer dans des familles d’accueil pour la durée de leur séjour. Elle s’occupait également de faire les suivis nécessaires avec les établissements de soins (entretien avec une ancienne infirmière du Service d’accueil [anonyme], 2 novembre 2021). Par la suite, le service d’accueil est transféré entièrement à Montréal. En 2016, le Centre de santé Ullivik, destiné spécifiquement à une clientèle inuit, ouvre ses portes à Dorval.
À partir des années 1960, les évacuations hors communauté pour la naissance augmentent considérablement au Canada. Ce phénomène de médicalisation de la maternité et de l’accouchement affecte particulièrement les femmes du Nunavik (O’Neil et Kaufert 1990 ; Jasen 1997 ; Gref 018). Les naissances hors-communauté, que ce soit à Kuujjuaq ou dans le Sud, et leurs impacts sur les femmes inuit, ont ainsi générées un nombre important d’études à partir des années 1970 (Bérubé, Bolduc et Proulx 1971 ; Bélanger 1990 ; Gref 2018). Selon Tremblay, si les infirmières étaient responsables des accouchements en dispensaires, l’arrivée de médecins et les standards imposés par les spécialistes au début des années 1970 ont contribué à l’évacuation plus fréquente des femmes en milieu hospitalier pour donner naissance (Tremblay 2016, 90). Ce séjour à l’extérieur pour l’accouchement entraîne une importante séparation entre la mère, sa famille et ses activités quotidiennes, ce qui entraîne des bouleversements culturels. (Bérubé, Bolduc et Proulx 1971).
La construction du Centre de santé Innulitsivik et de sa maternité marque un tournant dans l’histoire des soins de santé au Nunavik, puisque dès sa fondation en 1986, l’établissement axe sa mission sur la mise en place d’un programme de formation pour sages-femmes sur et une intervention plus inclusive et culturellement compétente (Bélanger 1990 ; Paulette 1995 ; Hogdings 1994, 144). Plus récemment, Peggy Bedon soulève d’ailleurs que le programme de formation des sages-femmes vise la conciliation des approches « médicale » et « traditionnelle », amenant ainsi un travail collaboratif entre une équipe multidisciplinaire (Bedon 2008).
Les services sociaux et la protection de la jeunesse au Nunavik
L’histoire de l’organisation des services sociaux et de la protection de la jeunesse au Nunavik s’insère dans les transformations et les réformes que connaissent ces secteurs au Québec dans la deuxième moitié du XXe siècle, puisque ces derniers deviennent une responsabilité provinciale au début des années 1970 (Dire les choses 1998, 31). Jusque-là, les gouvernements fédéraux et provinciaux se concentraient essentiellement sur la prestation de services médicaux et de services d’urgence au Nunavik. Si une travailleuse sociale s’ajoute à l’équipe de la patrouille médicale annuelle dès 1957 (Morantz 2010, 73), le premier poste de service social permanent est ouvert par la DGNQ à Kuujjuaq en 1971 (Dire les choses 1998, 31). Selon Christopher Fletcher, « l’organisation contemporaine des services sociaux au Nunavik trouve ses origines dans le rapport de la Commission Castonguay en 1972 » (Fletcher 1996,15). À la suite de ce rapport, l’application systématique du modèle de services dans les régions plus éloignées comme le Nunavik aurait généré « a reduction of the regional and cultural variations which were present in the religious – community level organization formely in place. » (Fletcher 1996, 15).
La signature de la CBJNQ, en 1975, et la création de l’Administration régionale Kativik (ARK),, en 1978 marquent la mise en oeuvre de deux centres de services sociaux (CSS) – qui deviennent des centres de protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) (Morin 2004, 27). Au cours des années 1970-1980, les Centres de santé Tullatavik et Innulitsivik (1986) deviennent progressivement des établissements multi-vocationnels et se dotent d’une Direction de la protection de la jeunesse (Dire les choses 1998, 132-133). En vigueur depuis 1979, la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) « s’applique à un enfant dont la sécurité et le développement est ou peut-être considéré comme compromis. » (Bélanger 1992, 36) Graduellement, des CLSC s’implantent dans les villages et deviennent une porte d’entrée pour les services de première ligne, agissant en complémentarité avec les autres établissements du réseau (Grenier et Bourque 2014, 8).
La CBJNQ engendre un changement d’approche dans la gestion des services de santé et des services sociaux, le gouvernement étant amené à « […] favoriser la participation des communautés locales dans les décisions et les activités concernant leur milieu. » (Gauthier 1985, 32). Cette volonté se traduit par la mise en place de mécanismes de consultation et par la création de comités locaux de citoyens (Ibid.), mais également par le recrutement de travailleurs et travailleuses communautaires inuit (TCI) dès le début des années 1980 (Mastronardi 1991, 1). Responsables d’appliquer la LPJ dans les villages, ils sont des figures de premier plan dans l’organisation des services sociaux et les services de protection de la jeunesse au Nunavik. Ils et elles sont également amenés à intervenir dans les villages des deux côtes, tout en étant supervisés des travailleurs sociaux allochtones (Boivin 1989, 42 ; Mastronardi 1991, 95). Lors de l’enquête Health and What Affects it in Nunavik: How is the Situation Changing ? en 1994, on retrouve, dans chacun des dispensaires de la baie d’Hudson, un travailleur communautaire (aaniasiurtiapiit), associé au programme de maternité Innulitsivik et qui offre un suivi pré et postnatal (Hodgins 1997, 146). Dans les années 1990, des formations en travail social sont également offertes au Nunavik par l’Université McGill (Mastronardi 1991, 80).
En ce qui a trait aux services en santé mentale, les premiers soins sont essentiellement offerts par des tournées de spécialistes organisées dans les villages une fois par année (Boivin 1989, 21). Lors de son terrain dans les villages de la baie d’Hudson en 1963, l’anthropologue Frank G. Vallée effectue l’une des premières enquêtes sur la santé mentale des Inuit (Vallée 1966). À cette époque, les Inuit nécessitant des soins de longue durée sont référés à Ottawa et sont pris en charge par le Département des Affaires du Nord (Vallée 1966, 59).
À la fin des années 1980, les services sociaux offerts au Nunavik « comprennent l’application des règlements de protection de la jeunesse, l’application des règlements pour l’adoption, l’assistance aux vieillards, la coordination du service de maintien à domicile pour les vieillards et les personnes handicapées, l’intervention en cas de crise et les services aux patients souffrant de troubles mentaux » (Boivin 1989, 42). Un centre d’hébergement pour les jeunes ainsi qu’un réseau de foyers (foster homes) sont également mis en place (Hodgins 1997, 150). Dans les années 1990, on retrouve un centre d’hébergement pour femmes à Kuujjuaq et des centres de traitement pour la toxicomanie à Inukjuak et Kuujjuaq. (Mesher 1995, 72 ; Hodgins 1997, 150) Selon Lessard et ses collègues, le développement des services sociaux et de la LPJ au Nunavik s’active à partir des années 1990, notamment avec la décentralisation des services par le gouvernement provincial et le dépôt d’un premier plan d’action en santé mentale en 1991 mettant de l’avant « […] l’importance de développer et d’offrir les services basés sur une approche globale et ancrée dans la communauté […] » (Lessard et al. 2008, 26, 11 ; Bertrand 2017, 31).
L’étude de Lessard et de ses collègues offre un aperçu des ressources en santé mentale au Nunavik en 2008, tout en mettant en lumière leur évolution au cours des 15 dernières années. Leur étude illustre un manque de connaissance de la population des services offerts en santé mentale et la méfiance de certaines personnes envers la qualité des services, ainsi que le manque de soutien et d’outil culturellement adaptés pour les intervenants et intervenantes de première ligne (Lessard et al. 2008, 11). La méconnaissance des ressources disponibles et leur inadéquation vis-à-vis les besoins des Inuit ont également été constatées chez les plus jeunes générations dans une plus récente étude (Perreault-Sullivan 2015, 71).
Perspectives critiques sur la médicalisation et les services sociaux au Nunavik
En 1983, le sociologue Gérard Duhaime rapprochait le phénomène des évacuations médicales au processus de sédentarisation des Inuit du Nunavik. (Duhaime 1983, 35) Selon lui, les transferts au Sud ont eu des conséquences sur le plan quantitatif, liées à un phénomène de « migration obligée » d’une grande amplitude. Ainsi, les transferts « présentent de nombreux problèmes parce que plusieurs évacués ne reviendront plus et parce que beaucoup d’autres restent absents pendant de longues périodes. […] La plupart des malades étaient partis plus d’une année et, même qu’une fois guéris, ils devaient parfois attendre le dégel pour rentrer. » (Ibid., 36).
La nécessité de rester à proximité d’une infirmière ou du dispensaire pour recevoir des traitements réguliers restreint aussi une personne à retourner sur le territoire. (Ibid., 86) En 1971, Bérubé, Bolduc et Proulx faisaient déjà le même constat. Selon eux, l’un des facteurs du rassemblement des Inuit en village fut la présence d’une infirmière, d’une infirmerie et de tout autre service de santé, ce qui résonne avec l’hypothèse de Duhaime (Bérubé et al. 1971, 20).
Si la sédentarisation forcée des Inuit s’est déployée sous plusieurs interventions par les gouvernements, notamment la relocalisation ou la déportation de familles sur d’autres territoires (Audlaluk 2020 ; Commission Royale sur les Peuples autochtones 1994), la construction de dispensaires et d’écoles dans les villages peut également être considérée comme un facteur de sédentarisation au Nunavik : « Si l’incidence des maladies contagieuses et des évacuations a eu des effets de sédentarisation, l’implantation des dispensaires ou des infirmières sur l’ensemble du territoire, dans une période tellement propice au développement des maladies, incitera les Inuit à s’en approcher. » (Duhaime 1983, 38).
D’un autre côté, bien qu’elle ait permis un meilleur accès à des soins de santé, la sédentarisation a amené des problèmes de santé physique et mentale, notamment le diabète, la dépression et le suicide (Anderson et Bonesteel 2010, 160). Selon Tester et Kulchyski, qui ont publié un ouvrage sur les politiques gouvernementales de relocalisation des Inuit dans l’ensemble du Nord canadien, les mesures sociales mises en place par l’État canadien à l’égard des Inuit à partir des années 1940 « […] resulted in many ‘tammarniit’ (mistakes) that led to social disruption, cultural disintegration, and even contributed to death among Inuit. » (Tester et Kulchyski 1994, 48). Ce système représentait pour les Inuit une forme de surveillance paternaliste et l’imposition d’une administration inflexible et étrangère au contexte culturel inuit. (Anderson et Bonesteel 2010, 151).
Dans la même veine, au sein de son mémoire sur le point de vue des intervenants sociaux et judiciaires allochtones sur les jeunes Inuit et Cris, et leur relation avec le système de justice, Danièle Bélanger s’est intéressée aux défis de l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse dans le Nord. Elle souligne entre autres les questions linguistiques, le délai de réaction de l’appareil judiciaire en cas de crise et les grandes distances qui marquent le territoire (Bélanger 1992, 42-46). Avant l’implantation de la Loi sur la protection de la jeunesse dans le Nord, la protection des enfants était une responsabilité communautaire et l’intervention reposait sur des décisions et des actions collectives dans le groupe familial et la parenté (Mastronardi 1991, 58-59). Fletcher soulève que l’extension des services sociaux au Nunavik a été perçue par certains comme une intrusion de l’État dans la vie des Inuit (Fletcher 1996, 15). Plusieurs auteurs constatent ainsi que la prise en charge institutionnelle et l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse dans les communautés ont déstabilisé les réseaux d’entraide familiaux et communautaires, tout en les remplaçant graduellement (Mastronardi 1991, 59 ; Bélanger 1992, 149 ; Morin 2004, 28). Ces mécanismes « informels » de contrôle propres à la culture inuit (comme le soutien par les aînés ou par les proches), ont été relégués au second plan à la suite de l’arrivée des institutions du Sud. (Morin 2004, 28) Dans son étude sur l’intervention sociale des Allochtones et des Inuit en CPEJ et CLCS, Morin souligne ainsi que les initiatives des réseaux informels apparaissent intéressantes pour réduire « le monopole de l’intervention institutionnelle et [augmenter] l’utilisation des ressources naturelles. » (Morin 2004, 39). Malgré les volontés d’employer des approches mixtes qui donnent une place imortante aux savoirs traditionnels, Lessard et ses collègues constatent aussi que les approches occidentales ont « éclipsé au fil du temps les approches traditionnelles en santé mentale » (Lessard et al. 2008, 26).
La plupart des services sociaux et services de protection de la jeunesse développés sont offerts au Nunavik. À la fin des années 1980, les Nunavimmiut ayant besoin de soins en santé mentale d’urgence sont évacués vers un hôpital de Montréal ou de Québec. (Boivin 1989, 21). Contrairement à la prestation de soins spécialisés médicaux, le transfert de patients Inuit vers le Sud pour des soins en santé mentale ou dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse ne se pose pas comme des thématiques très explorées dans la littérature. En 1992, Bélanger fait toutefois état d’un centre jeunesse à Val-d’Or accueillant des Inuit et des Cris (Bélanger 1992). Les intervenants allochtones qu’elle a interrogés étaient d’avis que les services devraient s’orienter vers le maintien des jeunes Inuit dans leurs milieux de vie et le transfert des services dans le Nord, puisque le déplacement au Sud exige une plus grande adaptation de leur part (Bélanger 1992,94 et 128). Pour s’adapter davantage aux particularités des cultures cries et inuit, le centre d’accueil a élaboré un programme « autochtonisé » et offre, à travers son programme de réadaptation, des activités traditionnelles de chasse, pêche, artisanat, etc. (Bélanger 1992, 119).
« She would teach me one on one. Then I would teach people ». Infirmières et interprètes inuit : des figures clés dans la prestation de soins et l’intervention sociale
Bien que les infirmières soient indispensables dans la prestation des services de santé dans les villages du Nunavik, très peu d’études se sont intéressées à leur expérience soignante et leurs rapports avec les Inuit, sur un plan historique. Le nombre plus important d’études sur le Nunavik à partir des années 1970 et les récits autobiographiques qu’ont laissés certains professionnels de la santé nous permettent toutefois de brosser un portrait général de leur pratique et de leur expérience au Nord (Beauvais 2017 ; Talbot 2015 ; Tremblay 2016).
Cette lacune dans la littérature touche aussi le personnel inuit – interprètes, travailleurs communautaires, etc. – qui ont été, et sont toujours, des intermédiaires et des actrices de premier plan dans les interventions sociales, la prévention et le traitement de la clientèle inuit. Les Inuit ont toujours eu un rôle clé d’intermédiaires dans la prestation de soins aux Nunavimmut. Dès la mise en place des premiers dispensaires à la fin des années 1940, les Inuit accompagnent les infirmières lors des consultations et des suivis. Ils s’impliquent rapidement dans les services à titre de « support staff », « handyman », interprète, ou aide-infirmière (Sandiford G. 1994, 82 ; Bérubé, Bolduc et Proulx 1971, 13). Des comités de santé formés de six membres du village assurent le lien entre la communauté et les services de santé et facilitent l’implantation des programmes (Gauthier 1985, 52 ; Boivin 1989, 41).
Si la littérature scientifique est peu parlante sur l’histoire des travailleurs inuit, nous pouvons porter notre regard sur les écrits de femmes inuit ayant partagé leur mémoire et celle de leurs proches. Par exemple, certains Inuit ont travaillé pour les services médicaux à titre d’interprètes à la suite d’une hospitalisation pour la tuberculose ou d’autres problèmes de santé. C’est le cas de Minnie Aodla Freeman, qui a publié le livre Life Among Qallunaat en 1978 (réédité en 2015) racontant son expérience personnelle et professionnelle au Sud (Freeman 2015). Signant un article dans le Makivik Magazine, Minnie Grey rappelle aussi la mémoire de sa tante Maggie qui a travaillé à l’hôpital d’Hamilton, en Ontario. Elle a été envoyée dans le Sud à l’âge de 8 ans et a dû y rester pour d’importants problèmes de santé (Grey 2003).
L’un des premiers constats tirés des entretiens est l’importance qu’ont eue les Inuit dans la prestation de soins et l’intervention sociale dès les premières décennies du réseau de santé au Nunavik. En effet, en plus de faire le pont entre les professionnels allochtones et la clientèle inuit, ils ont aussi assumé un « rôle élargi » auprès des bénéficiaires. Bien que le contexte des postes isolés et le manque de ressources matérielles et humaines aient été des facteurs importants dans cette prise de responsabilité, nous soulevons l’hypothèse qu’elle est aussi le résultat de relations de confiance entre le personnel allochtone et les interprètes inuit.
Une infirmière postée à Tasiujaq entre 1976 et 1982 nous a ainsi parlé de son approche de la prévention et de sa collaboration avec l’interprète locale :
[…] on a très bien travaillées ensemble […] moi, mon attitude c’était : bon, premièrement, de faire de la prévention, donc pas juste être là, parce qu’à Tasiujaq [il n’]y avait pas tant de travail que ça, moi je voulais améliorer la santé et ma façon c’était de donner des cours, qu’on appelait dans ce temps-là, sur la santé, aux Inuit sur différents sujets que je trouvais peut-être prioritaires. P[u]is ma façon de faire, c’était de donner le contenu à Pasha [l’interprète], m’assurer qu’elle comprenait bien, p[u]is que ce soit elle qui le donne, avec moi, mais pas traduire tout ce que je disais pour les cours. P[u]is ça, c’était vraiment gagnant !
Entretien avec Colette Couture, 10 novembre 2022
Nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec cette interprète lors de notre passage à Tasiujaq, en mai 2022. Au cours de l’entrevue, elle avait des souvenirs positifs de son travail auprès de l’infirmière et nous en a appris davantage sur l’éventail des tâches qu’elle accomplissait au cours de ces années et celles qui ont suivi – lors de notre entretien, elle venait tout juste de prendre sa retraite. Son travail au dispensaire l’a amenée à prendre les signes vitaux des mères enceintes et à faire les suivis pré- et postnataux. Elle a également été l’une des premières éducatrices à la sexualité en visitant les écoles pour faire de la prévention contre les ITSS et la protection. L’infirmière ayant pris l’initiative et le temps de lui montrer, elle a pu transmettre l’information aux jeunes Inuit et aux mères en inuktitut et à sa manière, et ce, pendant de nombreuses années : « […] she would teach me one on one. Then I would teach to people. » (Entretien avec Pasha Berthe, 10 mai 2022).
Dans ses mémoires, l’infirmier Daniel Beauvais consacre un chapitre aux interprètes et s’insère dans cette même ligne d’idée :
À plusieurs d’entre elles, mes collègues et moi avons enseigné comment prendre une pression artérielle et comment lire un thermomètre. Nous avons appris à certaines autres à faire des pansements simples et à nous aider à juguler une hémorragie. Elles n’étaient donc pas de simples plantons qui traduisaient nos propos et ceux de nos patients, elles participaient activement au soin.
Beauvais 2017, 347
La même approche semble avoir primé dans le secteur des services sociaux. C’est du moins ce que nous a confié la première travailleuse sociale permanente à Kuujjuaq, Francine Tremblay, entrée en poste en 1971 :
[…] moi, je ne faisais jamais très peu d’intervention, soit individuelle ou en groupe ou en communautaire sans la ressource, la ressource de la travailleuse communautaire qui interprétait ou qui à un moment donné, moi j’allais dans beaucoup de réunions, je pouvais passer des heures, des soirées de temps, j[e ne] disais pas un maudit mot, mais j’étais là si jamais ils voulaient que, alors c’est de les respecter […] Même chose en entrevue, on préparait nos entrevues avec les gens donc on préparait nos entrevues. Donc l’intervenante, la travailleuse communautaire inuit, elle était formée p[u]is elle savait, elle savait comment s’entretenir, comment aller chercher l’information, comment aller plus loin. Tu sais parce qu’on [ne] parle pas la langue, on [ne] parle pas la langue, même si on parlait la langue, p[u]is on est Blancs, on reste issus d’une culture qui n’est la même là tu sais, fait que les relations, c’est ça. Ben je pense en tout cas.
Entretien avec Francine Tremblay, 14 novembre 2021
Dans un entretien réalisé dans le cadre de l’étude de Fraser et ses collègues (2016), une Inuk confie que dans le passé, la structure des services « lui permettait d’aider plus de personnes, et ce, plus efficacement. Elle mentionne aussi la plus grande présence de travailleurs inuit auparavant, ce qui, selon elle, était un avantage :
Quand je travaillais pour la protection de la jeunesse il y a 20 ans, nous avions des case loads, des listes d’attentes et tout. Mais nous pouvions travailler beaucoup plus vite avec les familles inuit parce que nous étions nous-mêmes Inuit. J’avais un collègue qui était Inuit aussi, et des elders expérimentés qui travaillaient avec nous en tant que travailleurs communautaires. Nous allions visiter les familles, nous cognions aux portes et nous travaillions avec la police. C’était beaucoup plus orienté vers la communauté.
Gagnon 2018, 42
Céleste Fournier a aussi relevé cette transformation de l’approche et du rôle communautaire dans les entretiens qu’elle a effectués avec d’anciennes infirmières. Avant la présence de travailleurs sociaux, c’était à elles d’assumer un rôle social dans les villages. Au cours des années 1970-1990, le dispensaire faisait partie intégrante du village et les infirmières s’intégraient plus facilement à la communauté. La population était moins nombreuse et la situation psychosociale, moins difficile. Ainsi, le rôle communautaire et infirmier était dominant (Fournier 2017, 198-199). Les années 1990-2000 semblent marquées par plus de problèmes psychosociaux et de situations d’urgence. Le fort roulement de personnel, la méfiance de la population et les changements dans l’organisation des services amènent les infirmières à se distancer de la communauté et à privilégier un rôle médical (Ibid., 203).
C’est également ce que nous a confié Elena Labranche, Directrice des valeurs et des pratiques inuit à la RRSSN : « I think it was easier in the past because like I said, they were more stable staff so, you know, we just worked together, but now with more population or more people coming up, they don’t know the history, they don’t know the culture, so it’s more teaching that you need to do with non-natives that come up […] » (Entretien avec Elena Labranche, 16 mai 2022).
Le rôle élargi s’est transformé à travers les années en raison de diverses variables : hausse des problèmes psychosociaux, hausse de la population dans les villages, présence plus systématique des médecins, mise en place de guides thérapeutiques, de protocoles de soins et d’ordonnances collectives, mais aussi place de l’infirmière au sein du système social que représente le village (Fournier 2017, 324).
Les chercheurs ayant interrogé des intervenants inuit constatent qu’ils sont également confrontés à plusieurs défis. Les travailleurs communautaires, par exemple, ne sont pas accrédités professionnellement comme des travailleurs sociaux. À l’exception de ceux qui travaillent à Kuujjuaq, ils pratiquent seuls dans leur communauté, à temps partiel (Mastronardi 1991, 3). Selon Mastronardi, le travail des travailleurs communautaires inuit (TCI) n’est pas reconnu et l’absence d’une identité professionnelle limite leur capacité à résister à la définition administrative du travail (Mastronardi 1991, 46). Ses entretiens avec des TCI l’amènent à critiquer les contraintes bureaucratiques et à rappeler que le paternalisme et le colonialisme sont encore très présents dans les interactions entre les services sociaux et les TCI (Ibid., 50), un constat qui demeure présent dans les études récentes sur le sujet (Plourde-Léveillée et Fraser 2021) Dans son étude en 1996, Christopher Fletcher soulève que les travailleurs communautaires inuit, coincés dans une large technocratie et le racisme institutionnel des services du Sud, sont maintenus dans « […] une double subordination dans leur pratique, ce qui laisse peu de place à des innovations ou des réponses culturellement appropriées à la détresse sociale » (Fletcher 1996, 17, trad. libre).
Il ressort des études que les responsabilités des TCI sont mal définies et très étendues, ce qui entraîne des confusions et rend difficile pour les travailleurs d’établir les limites de leur rôle (Mastronardi 1991, 3) Dans son étude, Mastronardi rapporte que les TCI reçoivent des demandes pour des services qui ne tombent pas dans l’éventail de leurs tâches, par exemple, d’autres professionnels (médicaux, juridiques) ou résidents vont aller vers eux pour qu’ils agissent à titre d’interprète, un rôle faisait traditionnellement partie de l’aidant. (Mastronardi 1991, 67) Ces défis sont rapportés par d’autres auteures (Bélanger 1992 ; Morin 2004 ; Fraser et al. 2021). Plus récemment, la Commission d’enquête provinciale sur les relations entre les Autochtones et certains services publics soulève toutefois l’exacerbation des difficultés de recrutement du personnel autochtone depuis l’application de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines (PL-21) en 2009, qui redéfinit et réserve à certains professionnels l’exercice d’activités « considérées à haut taux de préjudice » (Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ; Commission d’enquête provinciale sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 2019, 426-427).
Enfin, notre étude comporte ses limites, en particulier dans sa représentation des intervenants inuit ayant participé à la prestation de soins à titre d’infirmières ou de travailleurs sociaux. Le recrutement d’anciens professionnels ayant pratiqué dans les villages de la baie d’Hudson a également été plus difficile, rendant notre analyse des deux côtes et de leur spécificité historique plus laborieuse. L’achèvement de l’analyse des entretiens et leur croisement aux archives consultées nous permettront toutefois de mettre en lumière le rôle qu’ont eu les Inuit dans la prestation des services médicaux, des services sociaux et de la protection de la jeunesse au Nunavik. En croisant les entretiens effectués avec d’anciens membres du personnel et les archives dépouillées, nous pourrons également porter un regard nouveau sur l’histoire institutionnelle du réseau de santé, mais également sur les relations qui se sont établies entre les professionnels allochtones et les Inuit.
Appendices
Notes
-
[1]
Le projet s’intitule Transformation et nature des relations entre les Inuit et les professionnels des services de santé, des services sociaux et de la Direction de la protection de la jeunesse. Il est financé par le Fonds de recherche du Québec Société et culture, à travers le programme Soutien à la relève professorale (2019-2022).
-
[2]
Un total de 27 entretiens a été réalisé au Sud et au Nunavik. Au Nord, cinq villages ont été visités dans le cadre d’un séjour de trois semaines en mai 2022 : Kuujjuaq, Kangirsuk, Tasiujaq, Puvirnituq et Inukjuak.
-
[3]
Les premiers postes de traite du Nunavik sont actifs dès le XIXe siècle : Kuujjuarapik (1756, puis 1857), Kuujjuaq (1830), Salluit (1903), Inukjuak (1909), Puvirnituq et Kangirsuk (1910). Voir Hervé (2017, 129-130).
-
[4]
Le Nunavik est légalement intégré dans la Province du Québec à partir de 1912. Lors d’une controverse en 1939, le Québec affirme toutefois que l’administration des Inuit est une compétence fédérale, puisqu’ils sont considérés « Indiens » au sens juridique. Le jugement de la Cour Suprême Re Eskimo met fin au débat en laissant l’administration au fédéral (Hervé 2017, 133).
-
[5]
L’administration des Services fédéraux est réorganisée en 1955 au sein du Services de Santé des Indiens et du Nord et en 1961, « Medical Services » et au Nord « Northern Health Services » mais fait partie des Medical Services (Affaires indiennes et du Nord, 2006).
Références
- Affaires indiennes et du Nord du Canada. 2006. « Les Relations du Canada avec les Inuit–Histoire de l’élaboration des politiques et des programmes ». Consulté sur Internet, https://www.canada.ca/fr/affaires-autochtones-nord.html, le 6 septembre 2019.
- Anderson, E. et S. Bonesteel. 2010. « A Brief History of Federal Inuit Policy Development : Lessons in Consultation and Cultural Competence », Aboriginal Policy Research Consortium International (APRCi) 70 : 147-173.
- Auclair, G. et M. Sappa. 2012. « Mental Health in Inuit Youth from Nunavik : Clinical Considerations on a Transcultural, Interdisciplinary, Community-oriented Approach », Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry|Journal de l’Académie canadienne de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 21 (2) : 124-126.
- Audlaluk, L. 2020. What I remember, What I Know. The Life of a High Arctic Exile, Iqaluit, Inhabit Media Inc.
- Beauvais, D. 2017. Mémoire de glace : Récit d’un infirmier dans le Grand Nord, Québec, Les Presses de l’Université Laval.
- Bedon, P. 2008. Pratiques traditionnelles chez les sages-femmes autochtones du Nunavik et programme de formation, Mémoire de Maîtrise, Département de médecine sociale et préventive, Université de Montréal.
- Bélanger, D. 1990. Grossesses et naissances dans deux populations inuit du Nouveau-Québec, Mémoire de Maîtrise, Département de médecine, Université Laval.
- Bélanger, D. 1992. « Point de vue des intervenants sociaux et judiciaires sur la problématique des jeunes autochtones en contact avec le système de justice des mineurs », Mémoire de Maîtrise, École de criminologie, Université de Montréal.
- Bertrand, J. 2017. The Mapping of Organizations Delivering Mental Health Services in Nunavik. Ungava Bay Area, Mémoire de maîtrise, Politique et services en santé mentale, Université NOVA de Lisbonne.
- Bérubé, R., M. Bolduc et J.-F. Proulx. 1971. Grossesse et services de santé chez les Esquimaux de l’Ungava, Département de médecine sociale, Université Laval.
- Boivin, H. 1989. « La santé mentale des Autochtones au Québec », Travail présenté au Secrétariat du Comité de la Santé mentale du Québec, Baccalauréat en sciences sociales, Université Laval.
- Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (cssspnql). 1998. Dire les choses comme elles sont. Consultation sur le contenu et l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse et de la loi sur les jeunes contrevenants dans les communautés des Premières Nations. Vers un cadre politique et une loi d’aide et de protection de l’enfance, de la jeunesse et de la famille pour et pal les Premières Nations. Rapport et recommandations, Présentés au ministre de la santé et des services sociaux du Québec. Montréal, cssspnql.
- Commission d’enquête nationale de Vérité et Réconciliation du Canada. 2015. Commission de vérité et réconciliation du Canada :Appels à l’action. Winnipeg, Commission de vérité et réconciliation du Canada. Consulté sur Internet, https://nctr.ca/wp- content/uploads/2021/04/4-Appels_a_l-Action_French.pdf, le 4 décembre 2022.
- Commission d’enquête provinciale sur les relations entre les Autochtones et certains services publics. 2019. Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : Écoute, réconciliation et progrès. Rapport final, Québec, Commission d’enquête provinciale sur les relations entre les Autochtones et certains services publics.
- Duhaime, G. 1983. « La sédentarisation au Nouveau-Québec inuit », Études Inuit Studies 7 (2) : 25-52.
- Commission Royale sur les Peuples autochtones. 1994. La réinstallation dans l’Extrême-Arctique. Un rapport sur la réinstallation de 1953-1955, Ottawa, Commission royale sur les peuples autochtones.
- Fletcher, C. 1994. The Innuulisivik Maternity Centre: Issues Around the Return of Inuit Midwifery and Birth to Povungnituk, Quebec. Document préparé pour le Research Program of the Royal Commission on Aboriginal Peoples.
- Fletcher, C. 1996. Custom Adoption and Youth Protection in Nunavik, Final Report, Québec et Kuujjuaq, Ungava Social Service.
- Fletcher C. et Riva M. 2017. « Introduction : La santé des Inuit », Études Inuit Studies 40 (1) : 5-13.
- Fournier, C., 2017. Parcours d’apprentissage et processus de structuration des compétences-clé en milieu extrême : Le cas des infirmières dans les dispensaires du Nunavik, Thèse de doctorat, HEC Montréal.
- Fournier, C. et E. Oiseau. 2021. « La sécurité culturelle et ses effets sur la pratique infirmière au sein des communautés autochtones. Le cas des infirmières dans le Grand Nord Canadien », 31e Congrès de l’AGRH, Tours.
- Fraser, S.L. et L. Nadeau. 2015. « Experience and Representations of Health and Social Services in a Community of Nunavik », Contemporary Nurse 51 : 2-3.
- Fraser, S., C. Rousseau, R. Kasudluak, P. Burmester et M. José Arauz. 2015. « Culturally Appropriate Care— A Multicultural Task: Assessing the Needs of Inuit Youth in the Care of Child Welfare Service », Journal of Aboriginal Health 9 (2) : 38-49.
- Fraser, S., R. Rouillard, L. Nadeau, L. D’ostie Racine et R Mickpegak. 2016. « Collaborating to improve child and youth mental health in Nunavik », Études Inuit Studies 40 (1) : 23-41.
- Fraser S.L., L. Moulin, D. Gaulin et J. Thompson. 2021. « On the Move: Exploring Inuit and Non-Inuit Health Service Providers’ Perspectives about Youth, Family and Community Participation in Care in Nunavik », BMC Health Services Research 21 (94) : 1-18. Consulté sur Internet, https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-021-06058-3, le 4 décembre 2022.
- Freeman, M. A. 2015 [1978]. Life Among the Qallunaat, Winnipeg, University of Manitoba Press.
- Gagnon, L. 1998. Signification pour les aînés inuit du soin offert par leurs proches, Mémoire de Maîtrise, Département des sciences de la santé, Université de Montréal.
- Gagnon, D. 2018. Exploration des manifestations d’altérisation entre les différents acteurs du système de soins du Nunavik. Mémoire de Maîtrise, École de psychoéducation, Université de Montréal.
- Gauthier, B. 1985. Évaluation des impacts socio-économiques des politiques gouvernementales sur les Inuit du Nouveau-Québec. Mémoire de Maîtrise, Université Laval.
- Grenier, J. et M. Bourque. 2014. Évolution des services sociaux du réseau de la santé et des services sociaux du Québec : Le NPG ou le démantèlement progressif des services sociaux, Coalition Solidarité Santé, Université du Québec en Outaouais.
- Gref, K., 2018. « Decolonizing Childbirth : Inuit Midwifery and the Return of Delivery to the Canadian North», Mémoire de Maîtrise, Université de Dalhousie. Consulté sur Internet, https://dalspace.library.dal.ca/bitstream/handle/10222/74142/Gref-Katharina-MA-INTD-August-2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y, le 4 décembre 2022.
- Grey, M. 2003. « A Tribute to an Aunt », Makivik Magazine 64 : 17.
- Herring, A. D., K. B. Waldram et T. K. Young. 2006 [1995]. Aboriginal Health in Canada. Historical, Cultural and Epidemiological Perspectives, Toronto, University of Toronto Press.
- Hervé, C. 2015. Le pouvoir vient d’ailleurs. Leadership et coopération chez les Inuits du Nunavik, Québec, Presses de l’Université Laval.
- Hervé, C. 2017, « Wrapped in Two Flags : The Complex Political History of Nunavik ». American Review of Canadian Studies 47 (2) : 127-147.
- Hodgins, S. 1997. Health and What Affects it in Nunavik: How is the Situation Changing?, Département de la Santé publique, Régie régionale de la Santé et des Services sociaux du Nunavik.
- Hordyk, S. R., M. E. Macdonald et P. Brassard. 2017. « End-of-Life Care in Nunavik, Quebec : Inuit Experiences, Current Realities, and Ways Forward », Journal of Palliative Medicine 20 (6 ): 647-655.
- Hordyk, S. R., M. E. Macdonald et P. Brassard. 2017. « Inuit Interpreters Engaged in end-of-life Care in Nunavik », International Journal of Circumpolar Health 76 (1) : 1-9.
- Jenness, D. 1964. Eskimo Administration: II. Canada, Washington, Arctic Institute of North America.
- Labbé, J. 1981. « La santé au Nouveau-Québec inuit. Réflexions sur les problèmes de santé et le système mis en place pour les régler », Études Inuit Studies 5 (2) : 63-81.
- Labbé, J. 1987. Les Inuit du Nord québécois et leur santé. Québec, Ministère de la santé et des services sociaux.
- Lazure, G. 2002. La nature de la pratique infirmière en régions éloignées et/ou isolées au Québec, Faculté des sciences infirmières, Université Laval.
- Lessard, L. 2015. Troubles mentaux courants et soins de santé en région isolée : Évaluation des soins offerts dans les services de santé de première ligne aux personnes avec un trouble dépressif ou anxieux au Nunavik. Thèse de doctorat, Département de santé communautaire, Université Laval.
- Lessard, L. et L. Fournier. 2015. « Améliorer le continuum de soins pour les personnes présentant un trouble mental courant au Nunavik », Quintessence 7 (3 ) : 1-2.
- Lessard, L., O. Bergeron, L. Fournier et S. Bruneau. 2008. Étude contextuelle sur les services de santé mentale au Nunavik. Québec, Institut national de santé publique du Québec. Consulté sur Internet, https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/868_SanteMentalNunavik.pdf, le 4 décembre 2022.
- Mastronardi, L., 1991. « Inuit Community Worker’s Experience of Youth Protection », Mémoire de Maîtrise, École de travail social, Université McGill.
- Mesher, D. 1995. Kuujjuaq: Memories and Musings (avec Ray Woollam). Duncan, BC, Unica.
- Morantz, T. 2012. « Les politiques colonialistes fédérales et provinciales dans le Nord québécois, 1945-1970 », in A. Beaulieu et S. Chaffay (dir.), Représentation, métissage et pouvoir: la dynamique coloniale des échanges entre Autochtones, Européens Et Canadiens (XVIe-XXe siècle), p. 153-173, Québec, Presses de l’Université Laval.
- Morantz, T. 2010. Relations on Southeastern Hudson Bay. An Illustrated History of Inuit, Cree and Eurocanadian Interaction, 1740-1970. Montréal, Institut culturel Avataq.
- Morantz, T. 2016. Relations on Ungava Bay. An Illustrated History of Inuit, Naskapi and Eurocanadian Interaction, 1800-1970. Montréal, Institut culturel Avataq.
- Morin, E. 2004. « Pratique sociale des intervenants inuit et allochtones en CLSC et en CPEJ auprès des enfants victimes d’agression sexuelle dans trois communautés du Nunavik : Représentations et points de vue ». Mémoire de Maîtrise, Département de criminologie, Université de Montréal.
- Morin, G. 2018. Travailler dans des contextes complexes : une exploration des profils d’intelligence culturelle de gestionnaires du Nunavik. Mémoire de Maîtrise, Administration publique, École nationale d’administration publique.
- O’Neil, J. D. 1989. « The politics of Health in the Fourth World: A Northern Canadian Example » in Kenneth S. Coates et William R. Morrison (Dir.). Interpreting Canada’s North: Selected Readings, p. 279-298. Toronto, Copp Clark Pitman.
- Thouez, J.-P., P. Foggin et A. Rannou. 1990. « Correlates of Health-Care Use: Inuit And Cree Of Northern Quebec”, Social Science Med, 30, 1 : 25-34.
- Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, 2022. Le Projet de Loi 21, consultée sur Internet, https://www.otstcfq.org/, le 4 décembre 2022.
- Paulette, L. 1995. Midwifery in The North. A Research Paper Submitted to The Royal Commission on Aboriginal Peoples.
- Perreault Sullivan, G. 2015. « Étude qualitative de la vision et des besoins des jeunes Inuit du Nunavik en matière de santé mentale et aperçu de la réponse fournie par les organismes du milieu », Mémoire de Maîtrise, Psychoéducation, Université du Québec à Trois-Rivières.
- Plourde-Leveillée, L. et S. Fraser. 2021. « Vers une décolonisation des ressources de soins et services sociaux : Les travailleurs communautaires locaux au Nunavik », Canadian Journal of Public Health 112 : 676-684.
- Sandiford Grygier P., 1994. A Long Way from Home. The Tuberculosis Epidemic Among the Inuit, McGill’-Queen’s University Press.
- Talbot, E. et B. Roy (dir.). 2015. Le Nord à bras-le-coeur : Récits d’infirmières et d’infirmiers. Québec, Presses de l’Université Laval.
- Tran, N. et C. Lévesque, 2017. « Les dépendances chez les Inuit du Nunavik », Québec, Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics.
- Tremblay, M-C. et S. Echaquan. 2022. « Fostering Cultural Safety in Health Care Through a Decolonizing Approach to Research with, for and by Indigenous Communities », Global Handbook of Health Promotion Research 1, 115-126.
- Tremblay, N. 2016. Qingaujaaluk : Médecine et aventures dans le Grand Nord québécois. Montréal, GID.
List of figures
Figure 1
Carte de la « Répartition des ressources sanitaires au Nouveau-Québec et dates d’implantation en 1983 » (Gauthier 1985, 50)

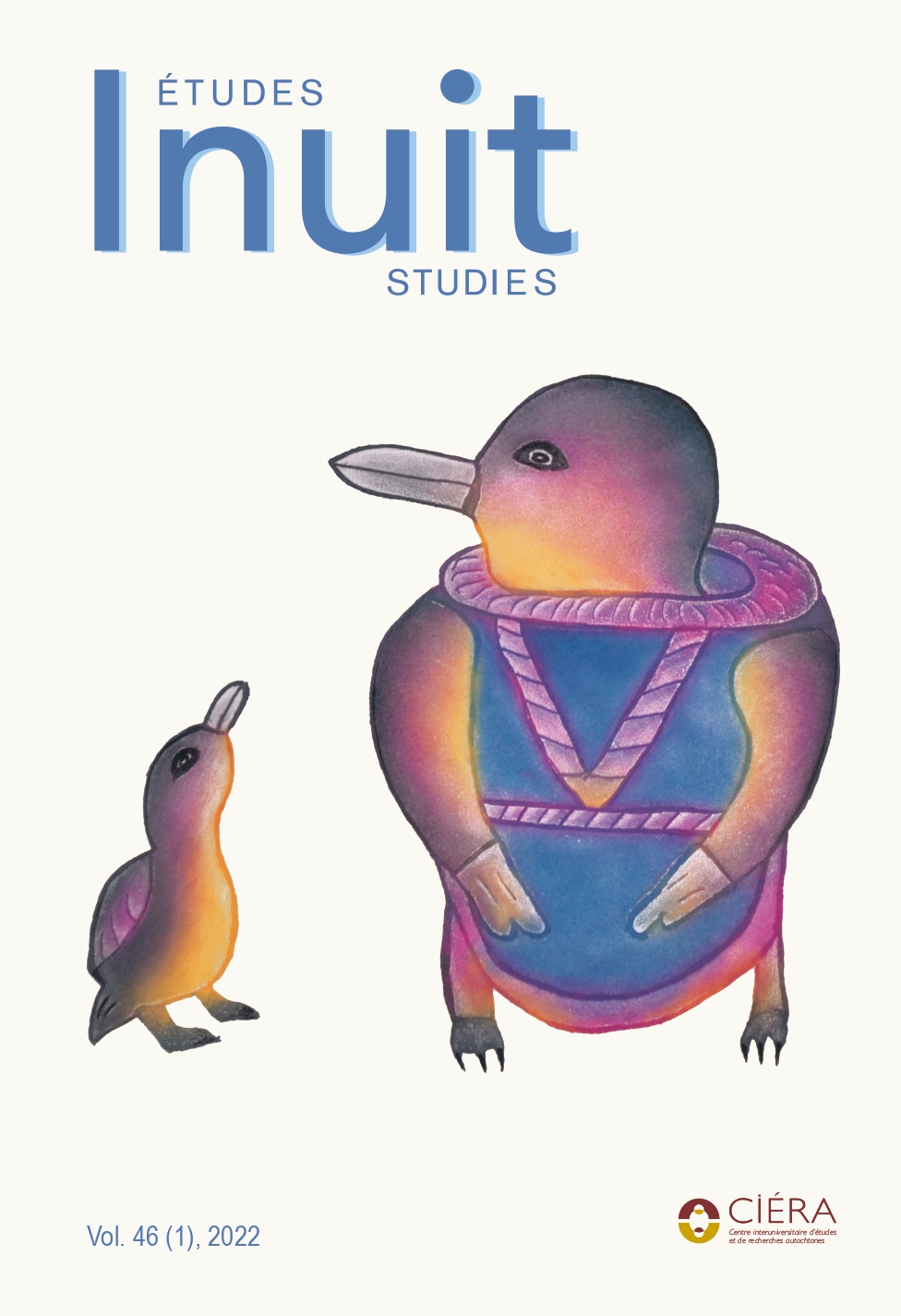

 10.7202/1040142ar
10.7202/1040142ar