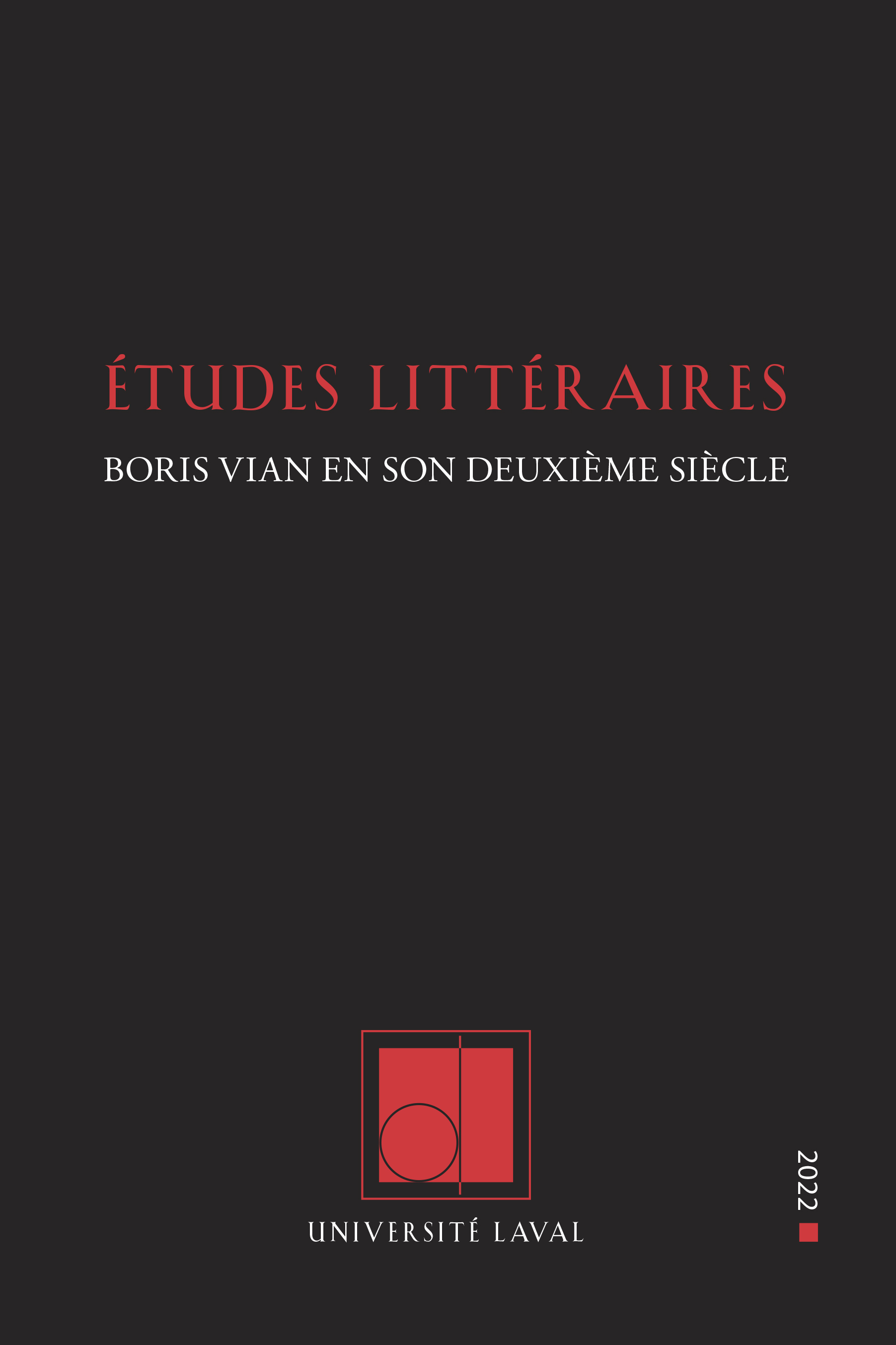Abstracts
Résumé
Il s’agit ici de corréler l’oeuvre de Boris Vian et, au-delà, sa double vie anthume et posthume à des structures culturelles spécifiques à la France de son temps, à commencer par une nouvelle configuration à la fois médiatique (presse écrite et maisons d’édition) et artistique (cabarets Rive-gauche, « caves » de jazz, « petits théâtres », « jeunes compagnies »), caractéristique de l’Après-guerre. On rappelle à ce stade qu’une des originalités culturelles françaises fut – et reste encore aujourd’hui – de fonctionner comme centrale internationale de légitimation (« artification ») des formes jusque-là jugées illégitimes – alias « mauvais genres » – : cinéma, roman policier, science-fiction, chanson, jazz, rock… Sur ce terrain on met en lumière le rôle originel du réseau pataphysicien et on affine la chronologie du kairos de la légitimation posthume de Vian autour de la séquence 1963-1968 – y compris au travers d’un témoignage personnel de l’auteur de cet article.
Abstract
This article focuses on correlating Boris Vian’s work and, beyond that, his double life as an anthologist and posthumous artist, to cultural structures specific to the France of his time, starting with a new configuration of both media (written press and publishing houses) and art (Left Bank cabarets, jazz cellars, small theaters, young companies), characteristic of the post-war period. We recall at this point that one of the French cultural originalities was - and still remains today - to function as an international center of legitimization (“artification”) of the forms until then judged illegitimate – alias “bad genres” – : cinema, detective novels, science fiction, song, jazz, rock… On this ground we highlight the original role of the pataphysics’ network and refine the chronology of the kairos of Vian’s posthumous legitimization around the sequence 1963-1968 – including through a personal testimony of the author of this paper.
Article body
Ce texte est dédié à Marc Lapprand, qui m’a offert ce kairos
Boris Vian n’est pas par hasard le contemporain d’une petite révolution culturelle dont la France et l’après-guerre furent un espace et un temps privilégiés. Cette homologie se vérifie de son vivant mais plus encore après sa mort.
Une certaine révolution culturelle
Cette révolution – le mot, on espère en convaincre le lecteur, n’est pas un abus de langage – se situe sur une histoire longue de plus d’un siècle puisque remontant, pour le moins, au Romantisme, et est confirmée à l’échelle d’une histoire courte, répondant au nom redoutable d’« Après-guerre ».
Tradition de la légitimation
La participation de la France à la longue histoire des successives dominations culturelles n’a guère besoin d’être démontrée. On connaît toutefois moins le rôle pionnier que ce pays a joué dans l’écriture d’une contre-histoire, celle de la légitimation des cultures dominées, remisées initialement dans les sous-catégories corrélées au « populaire » ou à la « masse », au « mineur » ou au « sauvage », au « décoratif » ou à l’« industriel », etc. C’est en Occident, lieu central de la domination culturelle moderne, que prend forme, à l’époque romantique, la valorisation du folk-lore (« trésor du peuple », William Thoms, 1846), des « arts lointains » (Félix Fénéon, 1920) ou des « arts et traditions populaires », con- cept développé en France pendant l’Entre-deux-guerres au sein de l’Organisation internationale de Coopération intellectuelle, ancêtre de l’UNESCO[1]. La sociologie culturelle française a forgé au début du XXIe siècle le concept d’artification[2] pour rendre compte du « passage à l’art » des productions jusque-là illégitimes, qui apparaît bien comme une des grandes tendances culturelles des temps modernes – affaire de technologie, sans doute, d’économie, assurément, mais surtout d’idéologie. La « reproductibilité technique », pour parler comme Walter Benjamin, a joué son rôle, tout comme l’urbanisation et l’industrialisation, mais il paraît clair que le facteur essentiel aura été la grande révolution de la souveraineté populaire, conduisant les élites, qu’elles soient chrétiennes ou libérales, démocrates ou socialistes, à tout à la fois évangéliser selon leurs valeurs respectives par le recours à la scolarisation et, la marche vers le suffrage universel étant engagée, à accorder une attention croissante aux formes culturelles jusque-là dominées.
Vieux pays d’État, à la fois catholique et laïque, la France du XIXe siècle est connue pour la visibilité et, en effet, l’importance qu’à partir de la génération romantique elle a accordées à ces deux investissements, à la fois financiers et symboliques, dans le système scolaire et dans la valorisation des cultures dites successivement « populaires » (au XIXe) et « de masse » (au XXe). Sous la République désormais bien installée de la Fin-de-siècle les successives avant-gardes qui se reconnaissent dans le Mercure de France puis la Revue blanche, qui lisent Rimbaud et Jarry, qui bientôt découvriront le futurisme, lancé en France et en français par Marinetti, seront aussi celles qui vont inventer – au sens étymologique du terme – le Douanier Rousseau et le Facteur Cheval et qui, sous la plume d’un Guillaume Apollinaire ou d’un Max Jacob, commencent à chanter les louanges du roman-feuilleton, de l’imagerie populaire ou du cinématographe. Le mouvement que je qualifierai de « philique » (cinéphilie dans les années 20, jazzophilie dans les années 30, en attendant la suite) naît en France, et non pas aux États-Unis. Qu’on suive ou pas la définition du romantisme proposée par Michael Löwy et Robert Sayre comme révolte moderne contre la modernité[3], il n’est pas interdit de lire le surréalisme, sans doute la principale contribution française à l’histoire culturelle du XXe siècle, comme une résurgence du romantisme, le romantisme des nouveaux temps. Dans de telles conditions, on n’est pas autrement surpris de découvrir dans la France de 1945, politiquement et économiquement dominée, un réel dynamisme « contre-culturel », repérable à d’innombrables signes[4], et qui apparaît sur ce plan, avec le recul, nettement en avance sur l’évolution culturelle ultérieure de la planète.
Après-guerre
Le chrononyme « Libération », attaché à cette époque, est susceptible de bien des gloses et de bien des déclinaisons. Pour la question qui nous occupe, l’ébranlement consécutif à la Seconde guerre mondiale se sera traduit, en terrain français, par une série de remembrements propices au surgissement de nouveaux médias et types de médiation, dont on peut avancer l’hypothèse qu’ils ont déterminé homologiquement des formes d’expression appropriées. L’époque va produire de nouveaux titres de presse (de quotidiens de référence comme Combat ou Le Monde ou de revues qui ne le sont pas moins comme Les Temps modernes, mais aussi de magazines dits « populaires » comme Constellation ou France-dimanche, etc.), mais aussi, plus significatives encore, de nouvelles maisons d’édition et, là aussi, le clivage s’installe. Certaines maisons, portées par la conjoncture politique vont s’installer durablement, comme les Éditions de Minuit, qui joueront le rôle que l’on sait dans le lancement de l’école du Nouveau roman ; d’autres, à l’image initiale beaucoup moins flatteuse, entreprendront d’accompagner – avec, au final, plus de liberté de mouvement qu’avant la guerre – un mouvement « contre-culturel » que l’on peut interpréter comme la revanche posthume d’un groupe surréaliste en train de disparaître en tant qu’avant-garde organisée mais désormais en voie de consécration[5]. Deux noms résument cette nouvelle ambiance, très différente de celle de l’avant-guerre, Jean-Jacques Pauvert (né en 1926) et Éric Losfeld (né en 1922), éditeurs des « mauvais genres », du fantastique à l’érotisme en passant par l’humour, menant pendant une vingtaine d’années une guérilla – remportée sur le plan culturel mais perdue sur le plan économique – contre la justice officielle et les ligues de vertu, lutte qu’ils ont aussi, par leurs mémoires, parus à l’époque de leur triomphe posthume, contribué à mythifier[6].
Au-delà de ces deux cas remarquables et remarqués, c’est bien toute une époque qui bascule. L’Après-guerre se révèle ainsi le moment où en France un espace s’entrouvre pour de petites unités de production artistique, en même temps que le moment où le mouvement philique, esquissé avant-guerre dans des cercles restreins, conquiert désormais des positions de pouvoir d’où il ne sera plus délogé. Ainsi le phénomène des petites maisons d’édition « contre-culturelles » ne se limite-t-il pas au couple Pauvert-Losfeld. Plus petits et plus fragiles encore apparaissent un Jean D’Halluin (Éditions du Scorpion) ou un Maurice Girodias (Obelisk Press puis Olympia Press). Ces deux itinéraires d’héritiers, à la fois opposés et convergents, disent beaucoup sur l’époque puisque si le second est le fils d’un éditeur américain non-conformiste (disparu en 1939, Jack Kahane, sorte de prototype, en plus radical encore, de ce nouveau type éditorial) et creuse un sillon analogue[7], le premier – ce fait semble peu connu – est le fils d’un leader politique d’extrême-droite qui avait eu, là aussi avant-guerre, son heure de gloire, Henri d’Halluin, dit Dorgères, par rapport auquel on peut avancer l’hypothèse que Jean d’Halluin s’affirma en s’opposant[8]. Ainsi le monde théâtral français de l’époque, relu a posteriori comme un âge d’or illustré par des noms comme ceux d’Arthur Adamov, Samuel Beckett ou Eugène Ionesco, est-il, du côté du théâtre public, celui des « jeunes compagnies » et, du côté du théâtre privé, des « petits théâtres ». Dans la première catégorie figurent un André Reybaz ou un Jo Tréhard – celui-ci sera, en 1968, le premier homme de théâtre victime de la répression municipale contre les établissements culturels publics soupçonnés de sympathies « gauchistes ». Dans la seconde, l’époque verra l’apogée de plusieurs jeunes troupes privées, telles celles de Jacques Fabbri ou de Michel de Ré, et des petites salles de théâtre de la rive gauche – par opposition aux plus grandes salles du théâtre de boulevard, sur la rive droite –, telles les éphémères Théâtre de Babylone ou Théâtre des Noctambules. Notons à ce propos que lorsque L’Équarrissage pour tous est donné dans la seconde salle, en avril 1950, c’est un mois avant la création, dans le même lieu, de La Cantatrice chauve, et que lorsque Mademoiselle Julie l’est dans la première, en septembre 1952, c’est moins de cinq mois avant la création, dans le même lieu, d’En attendant Godot. Le metteur en scène de L’Équarrissage, André Reybaz, synthétise quant à lui remarquablement les deux milieux puisque, de part et d’autre de cette expérience dans le privé, il est en amont le premier lauréat, en 1949, du prestigieux concours d’État « des jeunes compagnies » et sera en aval, comme Tréhard, le directeur d’un « centre dramatique national » en région.
Notons au passage que les Noctambules, futur cinéma « d’art et d’essai », avant d’être pendant une quinzaine d’années une salle où firent leurs débuts les trois plus grands noms de la mise en scène théâtrale française de l’après-guerre, à savoir Roger Blin, Jean-Marie Serreau et Jean Vilar, avaient été jusqu’en 1939 un cabaret, et que c’est autour de ce mot que va graviter, pendant une génération, la partie la plus populaire de la jeune création française, qu’elle soit théâtrale ou chantée. Des notions historiquement délimitées comme celle de « chanson rive-gauche » (Georges Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré, Juliette Gréco…) ou celle de « cave de jazz » (le Tabou, le Club Saint-Germain…) s’affirment dans les médias. Des auteurs associant un certain esprit avant- gardiste à une réelle verve populaire, tels un Jacques Prévert ou un Raymond Queneau, issus du surréalisme mais éloignés de Breton, vont faire le lien. Là aussi les sources sont antérieures au Débarquement (Agnès Capri, de la bande à Prévert, sur la rive droite, avant-guerre ; Jacques Canetti et ses Trois baudets d’Alger à partir de 1943…) mais c’est dans le Paris de la Libération que cette sensibilité va rencontrer son public. Canetti est, sur ce plan, une personnalité capitale puisqu’après avoir rouvert un Trois-baudets parisien à Montmartre en 1947, il devient directeur artistique chez Philips l’année suivante, qui se trouve être aussi celle, historique, de la mise au point du « disque microsillon » (33 et 45 tours). Toute la jeune chanson – et aussi tout l’humour de scène de l’époque – passera par lui, pendant qu’en parallèle sur la rive gauche le cabaret de La Rose rouge, ouvert aussi en 1947, voit converger vers lui un art de la scène alliant fantaisie et plaisir du texte qui annonce le « café-théâtre » de la fin des années 60. Cet équilibre est bien résumé en la personne du directeur artistique de La Rose rouge entre 1949 et 1953, Yves Robert, issu d’une des jeunes troupes privées de l’époque (Grenier-Hussenot), qui monte aussi bien le Queneau des Exercices de style que le Vian de Cinémassacre, mais il n’est pas sans signification que le propriétaire du cabaret La Grande Séverine, où sera créé, de manière posthume, Le Dernier des métiers, soit un certain Maurice Girodias. Le disque et la radio – particulièrement les stations les plus populaires, comme Paris-Inter, Radio Luxembourg et, à partir, de 1955, Europe numéro 1, qui introduit sur les ondes francophones le modèle américain music and news – vont décupler l’audience de cette production.
Que cet univers culturel recomposé produise de la recomposition culturelle, on serait tenté de l’affirmer, et de voir, en effet, dans cette période un temps tout à la fois de lancement de genres nouveaux et d’accélération de l’artification. Si le roman-photo, apparu en Italie en 1947 et importé massivement en France deux ans plus tard, n’a – jusqu’à présent et malgré divers « détournements », situationnistes ou autres – pas réussi à briser le plafond de verre de la reconnaissance, la bande dessinée se retrouve baptisée sous ce nom au même moment[9], alors que jusque-là ce qui allait recevoir moins de vingt ans plus tard le nom de « neuvième art » – sur le modèle du cinéma, rebaptisé « septième art » au début des années 20 – n’avait tout simplement aucun nom. Vian sera le témoin et souvent l’acteur de l’entreprise de respectabilisation, ici du cinéma, autour du triangle constitué par la Cinémathèque française, les nouvelles fédérations de ciné-clubs et les nouvelles revues cinéphiliques, là du jazz, autour de diverses revues, dominées par Jazz-hot, et du réseau des hot-clubs. Rien de plus significatif de ce changement de statut que la « guerre du jazz », déclenchée officiellement à l’automne 1947, qui voit Charles Delaunay, tenant des seconds, exclu du Hot-Club de France par le fondateur de celui-ci Hugues Panassié : une querelle esthétique entre « Anciens » et « Modernes » comme le monde des arts établis en connaissait depuis plusieurs siècles.
Ce point une fois acquis, il paraît difficile de ne rattacher cette vogue « contre-culturelle » qu’à un réseau périphérique. On n’en veut pour preuve que ce détail qui surprend beaucoup de nos contemporains mais concerne éminemment Boris Vian : la place qu’occupe dans ces stratégies anticonformistes un lieu de pouvoir culturel aussi nationalement et internationalement reconnu que sont les éditions Gallimard. Le rôle moteur de cette maison – qui n’a rien, pour le coup, de la « petite maison d’édition » – se repère, pour se limiter à ces trois exemples, dans le lancement de trois formules de rupture, appelées à s’installer durablement dans les configurations nouvelles : série noire, à partir de 1945, sous l’égide d’un ancien surréaliste du groupe Prévert d’avant-guerre, Marcel Duhamel, occasion de définir un espace spécifique aussi bien sur le terrain de la littérature que sur celui du cinéma (« film noir » apparaît un an plus tard, dans la littérature cinéphilique française) ; art brut, toujours en 1945, sous l’égide de Jean Dubuffet, relayé rapidement par les deux principales autorités de la maison, Jean Paulhan et Raymond Queneau ; et enfin, au début des années 50, science-fiction, d’autant plus aisément reprise de l’anglais que les deux mots sont d’origine et de compréhension françaises. Dans ce dernier cas il est intéressant de noter que le premier texte en langue française repéré par les lexicographes comme ayant accueilli le terme nouveau est un article dont l’auteur – un familier de Paulhan – s’interroge sur la substitution du « roman “fantastique” » au « roman “noir” »[10] ; il l’est plus encore de constater qu’il précède de quelques mois le lancement, en 1951, de la première collection, projetée dès 1949, mettant en avant la « SF » et que celle-ci est éditée par Gallimard[11].
Carrefour Vian
Tout ce qui précède n’a pas besoin d’être plus développé sous l’angle des corrélations entre ces tendances collectives et le destin individuel de Boris Vian. Celles-ci sont, en effet, impressionnantes par leur quantité. Encore faut-il en préciser la nature. La position de Vian, toute remarquable soit-elle, ne tient pas, en effet, seulement à son omniprésence, repérable sur tous les terrains de la culture illégitime : la chanson et le jazz dès 1937, le cinéma dès 1941, le roman noir dès 1946, la science-fiction dès 1951 ou le rock n’roll dès 1956. Elle tient, plus encore, aux rôles qu’il y joue, aux fonctions qu’il y exerce, multiples et, parfois, simultanées – au risque de passer, dans le regard de beaucoup de ses contemporains, pour un touche-à-tout et un dilettante. Mais il y a pire encore.
Le pire tient d’abord à l’importance qu’occupent les « mauvais genres » dans son oeuvre : le roman estampillé noir en tant que Vernon Sullivan, dont les quatre arbres cachent sa forêt de textes à ambition « littéraire »[12], les textes théâtraux, souvent réduits par la critique – voire par leur auteur – à l’état de « sketches », ou encore les centaines de chansons dont il est, à de rares exceptions près, le parolier – on serait tenté de dire, en cet Après-guerre où s’affirme, face à la figure prédominante antérieurement de l’interprète, celle de l’« auteur- compositeur-interprète » (ACI) : seulement le parolier. Le pire tient aussi, et plus profondément, au caractère second de la plupart de ces engagements. Car, loin de se limiter à un rôle de créateur, ne voilà-t-il pas que notre homme multiplie les postures de médiation ? Chroniqueur de l’actualité musicale à la revue Jazz-hot de 1946 à sa mort, il donne ici et là quelques textes d’analyse culturelle – et précisément sur ce que l’on appellera quelque temps l’« infra- littérature » –, qu’il ne cherche pas développer. Écrivain de livres qui passent – quand ils paraissent sous son nom – inaperçus, il consacre une partie non négligeable de son énergie à la traduction, et, une fois de plus, sur des objets à l’époque illégitimes – même si on découvre a posteriori qu’il s’agit de deux romans de Chandler et d’un roman de Van Vogt. À la fin de sa courte vie, il n’échappe à aucun des contemporains qui le connaissent que sa principale raison sociale est désormais celle de producteur de disques. Enfin le pire du pire tient sans doute, pour les mêmes, au fait qu’il entre dans le cercle artistique, entre 1942 et 1947, comme instrumentiste – de surcroît de jazz, et de surcroît avec, dans le milieu, une image d’amateur – et qu’il en sort dix ans plus tard comme interprète de chansons (1954-1956) : on ne saurait s’éloigner plus des deux grandes figures de la religion culturelle, celle de l’« auteur », possédé par son oeuvre, et celle de l’intellectuel, voué aux grandes causes et animé par les grands principes.
Il n’entre évidemment là aucun système. Avançons l’hypothèse que la curiosité, la générosité et le talent ont tenu le cap. Mais reconnaissons qu’au moment de sa mort – dont les circonstances contribuaient, de surcroît, à le rabattre, une dernière fois, sur l’encombrant Sullivan – Vian avait réussi à cumuler délégitimation culturelle et délégitimation politique. Rien de plus opposé à l’esprit des temps (modernes) que l’insolence des Chroniques du menteur. Rien de plus incohérent que les épaves laissées après sa mort et réunies sous le titre – menteur – de Traité du civisme. L’antimilitarisme récurrent de l’auteur, qui débouche sur le pacifisme de ses chansons les plus connues peut, à la rigueur, être étiqueté « anarchiste », mais la nécessaire mise en relation de la seconde délégitimation avec la première – celle-là même qui amène des compagnons de route du Parti comme un Roger Boussinot ou une Elsa Trolet à discréditer Vian en voulant le confondre avec Sullivan – conduit à une conclusion plus radicale : en pulvérisant avec constance (c’est là son seul système) l’esprit de sérieux, Vian s’est mis dans le cas d’être, comme son contemporain Hugo, le héros des Mains sales, « non récupérable ».
Boris sauvé du néant
Cette im-pertinence aurait pu, on le comprend, être fatale à sa mémoire. Elle va se retourner positivement[13].
Transcendance et satrapie
Un réseau joua un rôle essentiel dans ce retournement : le Collège de ’Pataphysique. Son fondateur, plus que les Latis, Jean-Hugues Sainmont et autres Irénée-Louis Sandomir dont les noms circulent dans les premières manifestations et publications du Collège à partir de l’année 1948 (25 Palotin 75 de l’ère pataphysique), était (in)connu sous celui d’Emmanuel Peillet, entré discrètement dans l’histoire culturelle quatre années plus tôt (10 juillet 1944) pour avoir diffusé dans le cercle de ses élèves du lycée de Reims le premier recueil de poèmes de Prévert. Comme souvent dans l’histoire de cette institution ce fut le Collège qui alla vers Vian, et non le contraire. L’intermédiaire capital aura été une personnalité peu connue, Henri Robillot, « Provéditeur » et donc, à ce titre, gérant de la revue du Collège, mais dont il importe ici de dire qu’il fut le grand traducteur français de Dashiel Hammett, Raymond Chandler, James Hadley Chase, Chester Himes ou William Irish et aussi, dans la collection Présence du futur, de Ray Bradbury. Le Collège a inventé – sous l’Oulipo – la formule, féconde, du « plagiat par anticipation » : en 1946, huit ans avant d’entrer au Collège, Vian, grand amateur d’Alfred Jarry, a publié son premier livre, Vercoquin et le plancton, dans une collection dirigée par un des futurs patrons de l’institution, Raymond Queneau. Pendant son septennat au Collège, de son entrée comme « Équarisseur de première classe » à son occultation de juin 1959 (vulg.) celui qui fut très vite (11 mai 1953 vulg., 22 palotin 80 de l’ère pataphysique), élevé au rang de « Transcendant Satrape » s’investit beaucoup dans la vie et l’oeuvre dudit Collège, payant de sa personne en participant à ses publications comme à ses rites, à commencer – ou plutôt, compte tenu de la date (11 juin 1959 vulg.), à finir – par l’« Acclamation » du nouveau Vice-Curateur du Collège, le Baron Mollet. Celle-ci eut en effet lieu sur la Terrasse des Trois Satrapes, autrement dit 6 bis, Cité Véron, chez Vian lui-même, qui établit certains détails de la cérémonie, restée dans les annales de l’institution.
Cet engagement, le Collège le lui rendit au centuple, en jouant un rôle décisif dans sa vie posthume. Après avoir été le seul lieu qui lui rendît un hommage documenté (la nécrologie qui sort dès l’été dans les Dossiers du Collège est datée par son auteur, Latis, du 25 juin 1959, soit deux jours après la mort de Vian), elle prend un an plus tard la forme d’un numéro entier de la revue, fort de cent soixante-huit pages. Dès cette année-là les pataphysiciens s’engagent dans un travail systématique dont tout laisse à penser que, par sa promptitude et son ampleur, il n’a pas son équivalent dans l’histoire littéraire, s’agissant d’un auteur oublié de son vivant, dont la majorité de l’oeuvre est difficilement accessible et l’image profondément adultérée. En 1962 c’est encore un Dossier du Collège qui sert de première édition au Goûter des généraux et c’est un des Satrapes, Jean Ferry, qui met en relation Ursula Vian et Jean-Jacques Pauvert, ouvrant ainsi la voie à une série d’éditions posthumes ciblées : romans et nouvelles[14], théâtre[15], poèmes[16]. À partir de cette date les préfaciers, les postfaciers, les éditeurs des éditions qui vont, en très peu de temps, faire passer Vian d’une marginalité vaguement honteuse à des tirages de best-seller sont presque tous des membres actifs du Collège : le régent François Caradec pour Les Lurettes fourrées de 1962 et L’Automne à Pékin de 1964, le dataire Jacques Bens pour L’Écume des jours de 1963. Enfin c’est le Satrape Noël Arnaud qui, dès le milieu des années 1960, propose la glose originelle sur « les vies parallèles » de Vian[17] – problématique dans l’espace retravaillée dans le temps par Michel Fauré en 1975[18] et par l’auteur de ces lignes en 1984[19] – comme c’est lui qui est le grand ordonnateur des deux colloques de Cerisy fondateurs de 1967 et 1976[20].
L’effet de réseau trouve sa confirmation dans le rôle joué en ces premières années posthumes par les deux frères ennemis de l’édition « contre-culturelle ». Losfeld, qui reste le grand éditeur du surréalisme dans sa phase finale, est le premier rééditeur posthume de Vian (Les Fourmis[21]) mais c’est, une fois de plus, Pauvert qui ramasse la mise en rééditant L’Écume des jours en 1963. La mesure du rapport de forces est bien donnée par le destin de la grande revue Bizarre, lancée par Losfeld mais reprise dès 1955, après deux numéros, par Pauvert – celle-là même qui accueillera l’étude pionnière d’Arnaud.
Le moment décisif
Ce volontarisme ne suffit pas. En histoire il n’y a pas de « causes », rien que des « effets ». Ce travail d’exhumation et de résurrection n’a d’importance que parce qu’il a rencontré une demande sociale, qu’ipso facto il transforma en attente. Dans mon article de 1984 j’essayais de délimiter la fenêtre chronologique – le kairos – qui a correspondu au moment où la figure de Vian est sortie du cercle de ses amis et amateurs pour toucher aux profondeurs d’une société. À cet égard l’année-pivot aura été 1963, avec, coup sur coup, la sortie de L’Écume des jours en collection de poche et celle du disque des Chansons possibles, et impossibles. Deux rééditions (celle du disque reprend pour l’essentiel une production Canetti de 1956) : tout est dit d’une résurrection.
Ce terminus a quo imprime l’image inédite d’un « écrivain » qui serait aussi un « chanteur », que d’autres publications confirmeront – la réédition en poche de L’Automne à Pékin l’année suivante, contemporaine de la sortie du disque à grand succès d’un nouveau chanteur, l’acteur Serge Reggiani. Le lien avec la génération montante d’un public jeune est assuré par cette co- présence, par le rôle de Jacques Canetti dans le lancement de Reggiani et le choix des chansons de Vian – ce disque est vraiment un disque de producteur – et enfin par le rattachement de l’écrivain à la modernité littéraire et politique au travers de la collection de poche en question : « 10/18 », collection – dirigée par Michel-Claude Jalard, connu par ailleurs pour son expertise jazzistique – exemplaire de toute la culture de « Mai 68 », avant même sa reprise, en 1968, par Christian Bourgois.
L’accueil des médias dit tout. Le Monde, qui est devenu, aux lieu et place de Combat, le quotidien des élites intellectuelles, écrit le 24 août 1963, sous la signature de la responsable de sa rubrique littéraire, Jacqueline Piatier : « L’heure a sonné pour Boris Vian ». Le 11 février 1965 la consécration viendra cette fois de l’hebdomadaire de référence symétrique, aux lieu et place de L’Express, à savoir Le Nouvel observateur, qui titre sur « L’année Vian ». Encore un an et une troisième « preuve de consécration » est apportée par l’entrée de Vian dans la prestigieuse collection « Poètes d’aujourd’hui » des éditions Seghers[22]. Le terminus ad quem a moins d’importance mais la date de 68 ne serait pas un choix arbitraire puisque c’est cette fois un magazine littéraire (le Magazine littéraire, précisément) qui, renchérissant sur le Monde de 63 et le Nouvel Observateur de 65, en fait désormais « peut-être le mythe le plus grand qu’ait créé le monde littéraire français au cours des vingt-cinq dernières années[23] ». La force posthume de Vian est suffisante pour que, si le premier film inspiré par son oeuvre – puisque le précédent l’avait été par celle de Vernon Sullivan – passe, cette année-là, inaperçu, le journal Action – qui fut le seul périodique né au coeur du mouvement de Mai 68, et, au reste, mort immédiatement après – puisse publier, le 14 juin, aux côtés de dessins de Siné, un poème inédit de l’auteur du Déserteur. Mais toute sa richesse non moins posthume s’illustre dans le fait que cette même année 1968-là avait vu aussi Henri Salavador sortir une compilation de chansons dont Vian avait été le parolier – et, pour la première fois, sous un titre mettant en avant non plus le compositeur-interprète mais l’écrivain désormais à la mode : Salut Boris !
L’Océan des jours
À partir de là, tout est-il dit ? Assurément pas. Pour un auteur, la consécration suprême, qui l’installe dans la durée, est celle qui permet de vérifier sa présence sur trois terrains décisifs : l’Université, l’Art et le Public – majuscules comprises.
Sur le premier point les vianistes auront déjà noté que l’ouvrage de Michel Rybalka, Boris Vian. Essai d’interprétation et de documentation, est sorti en 1969 et, mieux encore, que la toute première monographie, signée W. David Noakes, date de 1964. Ils auront aussi remarqué que les deux auteurs sont de vivants symboles de la culture franco-américaine : la monographie de Noakes est, d’abord, un travail universitaire – sur Boris Vian « témoin d’une époque » – présenté à NYU et dirigé par Germaine Brée et Tom Bishop ; l’essai de Rybalka suit d’un an un article du même auteur, publié dans une revue savante américaine et non française[24], qui est sans doute le tout premier de la bibliographie vianienne. La contemporanéité avec la chronologie française, en même temps que sa différence de style, dit beaucoup sur la dialectique de cette reconnaissance : limitée mais classique aux États-Unis, plus large mais « contre-culturelle » en France.
Cette dernière dimension éclaire la manière dont la société artistique française va se situer par rapport à ce camarade paradoxal : déjà disparu mais à la vie posthume de plus en plus riche, comme un fantôme amical venu rejoindre la surprise-partie des vivants, et bien décidé à ne plus la quitter. Dans le numéro spécial de L’Arc déjà mentionné, Serge Gainsbourg, dans une « conversation sur Vian » dont des extraits sont reproduits par son interlocuteur Noël Simsolo, témoignera de sa première rencontre avec lui, en 1955, au cabaret Milord l’Arsouille :
Là, j’en ai pris plein la gueule… il avait une présence hallucinante, vachement « stressé », pernicieux, caustique… les gens étaient sidérés… ah mais, il chantait des trucs terribles… Moi, j’ai pris la relève…. Enfin, je crois… De toute façon, c’est parce que je l’ai entendu que je me suis décidé à tenter de faire quelque chose d’intéressant dans cet art mineur[25]…
On ne saurait mieux dire, et trois ans plus tard, quelques mois avant sa mort, Vian pouvait être encore l’auteur de l’article révélant aux lecteurs du Canard enchaîné ce jeune auteur dont le succès, s’ajoutant, une génération plus tard, à celui des poulains de Jacques Canetti, n’a pas peu fait pour la légitimation en France de la chanson comme forme moderne de la poésie.
Reste que le gage ultime de la reconnaissance et la résultante de toutes ces tendances se situent encore ailleurs, au plus profond d’un lectorat, c’est-à-dire d’une société : on ne reconnaît, en termes de légitimité, que ce en quoi on se reconnaît, en termes d’identité. Le Monde, Le Nouvel Observateur, les amoureux du surréalisme : certes ; mais tout cela ne fait pas ce qu’on appelle un « phénomène de société », mesurable ici à l’ampleur des ventes des livres et des disques. Au-delà des jeunes adultes des Trente Glorieuses, qui aiment la chanson rive-gauche et le jazz des années 50, la Nouvelle vague et les premiers « cafés-théâtres » des années 60, qui achètent de Vian les premiers livres-clubs (le prestigieux Club français du livre publie le premier, dès 1965), il faut l’irruption d’une plus jeune classe d’âge, qui va fournir les gros bataillons des lecteurs-auditeurs, qui achètent les livres de poche et les disques 33-tours.
On sait que le plus grand événement français des années 50 et 60 est moins la Guerre d’Algérie ou le retour du général de Gaulle au pouvoir que le Baby-boom, imprévu par les démographes puisque, étendu sur une trentaine d’années, il a déployé ses effets bien au-delà du phénomène, déjà connu, du boom démographique d’après-guerre. On me permettra de sortir, pour finir, de mon rôle d’analyste pour prendre celui de témoin et d’acteur : né en 1948, je peux témoigner de la rumeur surprenante – sans précédent dans ma génération, qui s’enflammait plutôt pour d’autres objets que la littérature, tels le cinéma (français), la musique (anglo-saxonne) et/ou la politique (mondiale) – qui se répandit dans les cours et les galeries de mon lycée de province, pendant les années scolaires 1963-64 et 1964-65 : « As-tu lu L’Écume des jours ? », « Il faut lire L’Écume des jours… » Comme je l’ai écrit en 1984 : « En 1963-65, ces natifs-là atteignent l’âge des héros de Vercoquin, en 1968, celui des héros de L’Écume des jours[26] ». J’ajouterai un détail qui n’est pas négligeable : l’un des canaux facilitateurs de la diffusion de cette vogue au sein de cette vague[27] fut celui des jeunes professeurs de français des lycées – eux-mêmes submergés depuis le début des années 60 par le Baby-boom –, soucieux d’ouvrir leur enseignement à de nouveaux auteurs pas encore au programme – mais, après tout, dans le cas de Vian, déjà morts... L’un d’entre eux, qui fut l’un de mes enseignants et que j’ai interrogé encore récemment sur ce point, m’a confirmé ce rôle, et souligné la force de conviction dont disposait, aux yeux des élèves, un auteur présent à la fois sur le terrain de la littérature romanesque, de la poésie et du théâtre, avec une réputation antimilitariste très valorisante en ces lendemains d’Algérie.
On l’aura compris : type achevé de l’auteur posthume, sauvé de l’anéantissement par une mort précoce et des amis fidèles, Vian a aussi, par la multiplicité de ses talents, joué un rôle de premier plan dans l’ouverture du champ culturel aux illégitimes. Les tenants d’une conception cléricale du champ en question – lecteurs de Jean-Paul Sartre et non de Jean-Sol Partre –, qui disposent du moyen infaillible de distinguer le vrai du faux, le laid du beau et le sérieux du futile, ne lui pardonneront jamais ce don de passe-muraille : sa fortune critique jusqu’au coeur du XXIe siècle en témoigne éloquemment. De sa Terrasse, le Transcendant Satrape se contente de leur adresser un sourire énigmatique.
Appendices
Note biographique
Membre de l’Académie française, Pascal Ory est professeur émérite d’histoire à la Sorbonne (Paris 1). Il a aussi enseigné à Sciences Po Paris, à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et à New York University (NYU). Il est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages portant sur l’histoire culturelle et l’histoire politique des sociétés modernes, parmi lesquels : L’Histoire culturelle, (PUF [Que sais-je ?], 2004) ; Les Intellectuels en France de l’affaire Dreyfus à nos jours avec Jean-François Sirinelli, (Armand Colin, 1986) ; La Belle Illusion. Culture et politique sous le signe du Front populaire, 1935-1938 (Plon, 1994) ; L’Entre-deux-Mai. Histoire culturelle de la France, mai 1968-mai 1981 (Éditions du Seuil, 1983) ; Qu’est-ce qu’une nation ? Une histoire mondiale (Gallimard, 2020) ; Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France, qu’il a dirigé (Robert Laffont [Bouquins], 2013) ; De la Haine du Juif (Bouquins, 2021) ; Ce Côté obscur du peuple (Bouquins, 2022).
Notes
-
[1]
Pascal Ory, La Belle Illusion. Culture et politique sous le signe du Front populaire, Paris, CNRS Éditions, 2016 [1994].
-
[2]
Cf., entre autres, Roberta Shapiro et Nathalie Heinich (dir.), De l’artification : enquêtes sur le passage à l’art, Paris, EHESS (Cas de figure), 2012.
-
[3]
Michael Löwy et Robert Sayre, Révolte et mélancolie. Le romantisme à contre-courant de la modernité, Paris, Payot, 1992.
-
[4]
Pascal Ory, « Le temps où les surréalistes eurent raison. Quelques notes sur la respectabilisation des avant-gardes », Mélusine, Cahiers du Centre de recherches sur le surréalisme, n° XI (1990), p. 17-28. La première histoire du surréalisme – celle de Maurice Nadeau – paraît en 1945.
-
[5]
Pascal Ory, « Le temps où les surréalistes eurent raison », art. cit.
-
[6]
À chacun son style : Losfeld écrit ses mémoires à chaud, et in extremis (Endetté comme une mule, Paris, Belfond, 1979), Pauvert avec plus de recul et de calcul (La Traversée du livre, Paris, Viviane Hamy, 2004). La figure de Pauvert a été complexifiée par Chantal Aubry (Pauvert l’irréductible, Paris, L’Échappée, 2018).
-
[7]
Girodias aussi a publié ses mémoires : Une Journée sur la terre, Paris, La Différence, 1990, 2 vol.
-
[8]
Dorgères fut dans les années 30 le créateur du mouvement dit de « La Défense paysanne », d’inspiration mussolinienne. Propagandiste rural du régime de Vichy, il terminera sa carrière politique nationale comme député « poujadiste » (populiste), entre 1956 et 1958. Cf. Pascal Ory « Le dorgérisme. Institution et discours d’une colère paysanne », Revue d’Histoire moderne et contemporaine, t. XXII, n° 2 (1975), p. 168-190. Notons qu’en 1959, le fils, sans doute désormais rapproché d’un père sur le déclin, en publiera, au Scorpion, les mémoires (Au XXe siècle dix ans de jacquerie).
-
[9]
L’érudition bédéphilique repère dans la presse la formule « bande dessinée » en 1938 puis la voit ressurgir, épisodiquement, en 1949 et au long des années 1950, avant une généralisation dans les années 60.
-
[10]
Claude Elsen, « Le roman fantastique va-t-il tuer le roman noir ? », Figaro littéraire, 8 avril 1950.
-
[11]
« Le Rayon fantastique », en co-édition avec Hachette. Pour être exact les éditions Stock lancent dès cette année-là, à l’automne, une collection intitulée, précisément, « Science-fiction » – mais elle avorte tout de suite, ne dépassant pas son premier titre. Rien d’étonnant, dans ces conditions, si, dix ans plus tard, le lieu de naissance du mouvement bédéphilique se situe dans le milieu des amateurs de SF.
-
[12]
Et on tuera tous les affreux est, de surcroît, en partie prépublié dans les colonnes de l’hebdomadaire « populaire » (et très méprisé des intellectuels, au point de devenir la métonymie du « vulgaire » et du « mauvais goût ») France-dimanche.
-
[13]
Pascal Ory, « Tentative d’explication d’une légende », L’Arc, n° 90 (1984), p. 85-88.
-
[14]
Boris Vian, L’Arrache-coeur / L’Herbe rouge / Les Lurettes fourrées, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1962.
-
[15]
Boris Vian, Théâtre, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1965.
-
[16]
Boris Vian, Je voudrais pas crever, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1962.
-
[17]
Et cela au travers du numéro 39-40 de février 1966 de la revue Bizarre, développé en un volume spécifique quatre ans plus tard. Suivra, en 1976, le numéro spécial (n° 8-9) de la revue Obliques.
-
[18]
Michel Fauré, Les Vies posthumes de Boris Vian, Paris, UGE (10/18), 1975.
-
[19]
Pascal Ory, « Tentative d’explication d’une légende », art. cit.
-
[20]
Intitulés « Littérature et paralittérature » et « Boris Vian ».
-
[21]
Boris Vian, Les Fourmis, Paris, Le Terrain vague, 1960.
-
[22]
Jean Clouzet, Boris Vian, Paris, Seghers (Poètes d’aujourd’hui), 1966. Notons qu’en 1963, ladite collection venait de franchir un pas – qui l’effraya elle-même, d’où un recul ultérieur – en admettant Georges Brassens en son sein.
-
[23]
« Vie et survie de Boris Vian », Le Magazine littéraire, n° 17 (1968), p. 6.
-
[24]
Michel Rybalka, « Boris Vian et le monde sensible », The French Review, vol. 41, n° 5 (1968), p. 669-674.
-
[25]
Serge Gainsbourg, « J’ai pris la relève ! », L’Arc, n° 90 (1984), p. 61.
-
[26]
Pascal Ory, « Tentative d’explication d’une légende », art.cit, p. 87.
-
[27]
N’oublions pas que la formule « Nouvelle vague » fut d’abord lancée, par la journaliste Françoise Giroud, en 1957, pour parler des premiers baby-boomers.
Références
- Aubry, Chantal, Pauvert l’irréductible, Paris, L’Échappée, 2018.
- Clouzet, Jean, Boris Vian, Paris, Seghers (Poètes d’aujourd’hui), 1966.
- Elsen, Claude, « Le roman fantastique va-t-il tuer le roman noir ? », Figaro littéraire, 8 avril 1950.
- Fauré, Michel, Les Vies posthumes de Boris Vian, Paris, UGE (10/18), 1975.
- Gainsbourg, Serge, « J’ai pris la relève ! », L’Arc, n° 90 (1984), p. 61-63.
- Girodias, Maurice, Une Journée sur la terre, Paris, La Différence, 1990, 2 vol.
- Losfeld, Éric, Endetté comme une mule, Paris, Belfond, 1979.
- Löwy, Michael et Robert Sayre, Révolte et mélancolie. Le romantisme à contre-courant de la modernité, Paris, Payot, 1992.
- Ory, Pascal, La Belle Illusion. Culture et politique sous le signe du Front populaire, Paris, CNRS Éditions, 2016 [1994].
- Ory, Pascal, « Le temps où les surréalistes eurent raison. Quelques notes sur la respectabilisation des avant-gardes », Mélusine, Cahiers du Centre de recherche sur le surréalisme, n° XI (1990), p. 17-28.
- Ory, Pascal, « Tentative d’explication d’une légende », L’Arc, n° 90 (1984), p. 85-88.
- Ory, Pascal, « Le dorgérisme. Institution et discours d’une colère paysanne », Revue d’Histoire moderne et contemporaine, t. XXII, n° 2 (1975), p. 168-190.
- Pauvert, Jean-Jacques, La Traversée du livre, Paris, Viviane Hamy, 2004.
- Rybalka, Michel, « Boris Vian et le monde sensible », The French Review, vol. 41, n° 5 (1968), p. 669-674.
- Shapiro, Roberta et Nathalie Heinich (dir.), De l’artification : enquêtes sur le passage à l’art, Paris, EHESS (Cas de figure), 2012.
- Vian, Boris, Théâtre, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1965.
- Vian, Boris, Je voudrais pas crever, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1962.
- Vian, Boris, L’Arrache-coeur / L’Herbe rouge / Les Lurettes fourrées, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1962.
- Vian, Boris, Les Fourmis, Paris, Le Terrain vague, 1960.
- « Vie et survie de Boris Vian », Le Magazine littéraire, n° 17 (1968), p. 6-27.