Article body
Lise Gauvin analyse dans cette étude huit oeuvres qui constituent l’objet mis en relief sur la scène de l’écriture sans cesse en mouvement, déconstruite, reconstituée, vibrante, en projet et en résurgence dans l’urgence permanente de ce qui apparaît comme l’avenir des langues haletantes, des cultures et des hommes en Afrique, en Amérique du Nord et dans d’autres parties du monde qui n’ont en commun que l’impatience de jeunes nations accouchées au forceps de l’Occident après la précipitation d’un formidable débordement de l’Histoire. Comment formuler le traitement de choc et décrire ses conséquences en moins de 200 pages que la concision ne réduise pas à la plus sèche érudition ? Ce qui semble relever du défi ne peut que suivre les écarts tissés dans des textes dont la lecture met en relation huit écritures disséminées entre le Québec, Haïti, l’Acadie, les Antilles et les Caraïbes, autant dire aux quatre coins de la terre, des Mille et une nuits à l’enfer dantesque ou rimbaldien, au fil de trois civilisations – Jérusalem, Rome, Médine. L’échelle des paradigmes linguistiques, narratifs, sociaux, éthiques et géopolitiques court en filigrane sous les pages de cette somme révolutionnaire de l’intranquillité qui ne se limite pas au simple retour du balancier, mais qui remet en cause le centre de gravité du monde et l’équilibre international. Rien de moins. Quel vecteur prépondérant, s’il en est, traverse les confluences et les divergences observées de Patrick Chamoiseau à Réjean Ducharme, d’Asia Djebar à Maryse Condé, d’Alain Mabanckou à Dany Laferrière, de France Daigle à Marie-Claire Blais ?
Chacune des oeuvres gigognes s’élabore à même la déperdition ou le recouvrement d’une diaspora dont les témoignages de détresse et d’espoir ont déjà résonné plus d’une fois, répercutés depuis le cri cinglant du Cahier d’un retour au pays natal (1939) d’Aimé Césaire, avant les théories nuancées d’Édouard Glissant s’entretenant, peu avant sa mort, de « L’Imaginaire des langues[1] » avec Lise Gauvin. L’amplitude de ces littératures mineures écrites dans une langue majeure peut-elle servir à mesurer la maturation, aussi ardue que percutante, de ce qui ne cesse de nous interpeller ? Dès l’introduction, Le Roman comme atelier présente le circuit de « parcours marqués [...] par la récurrence de récits éclatés, aux frontières indécises entre le réel et la fiction ou entre divers niveaux de réel, se jouant des catégories génériques comme autant de pistes à transgresser. » Ces récits sont du coup renommés à nouveaux frais :
Je propose plutôt de les désigner comme « des romans performatifs » [...] mettant en scène des figures diffractées d’auteurs ou de romanciers fictifs appliqués à décrire, sous forme de projet en gestation, le texte que le lecteur a sous les yeux. Romans qui par leur inachèvement même sollicitent l’intervention du lecteur invité à poursuivre l’itinéraire et la réflexion[2].
Les espaces francophones se relaient dans l’écho amplifié qui pénètre la conque du Tout-Monde conceptualisé par Glissant comme une oreille résiliente où puiser, par exemple chez Patrick Chamoiseau, la
multiplication vertigineuse des délégués à la parole [à tel point que] chaque figure d’écrivain devient les maillons d’une chaîne ininterrompue, comme les variantes inépuisables d’une Histoire / histoire à la fois collective, au sens de récit commun, et singulière, au sens des histoires fictives et des destins individuels racontés par les narrateurs successifs en posture d’écrivain.
RCA, p. 11-12
Entraînés par cet axe aux extensions inextricables, les lecteurs sont plongés au creuset où se meuvent des univers diversifiés qui tantôt se heurtent et s’ignorent, tantôt se rencontrent et s’absorbent en mêlant les poussières de leur durée aux contrepoids de leurs variations. Ces univers polymorphes, loin de se dissoudre, se refondent en une éventuelle genèse sous les visées théoriques dont sont passibles les transports d’idées, de lois, de violences et de pouvoirs qui affluent au gré des courants migratoires. Les êtres écorchés dans leur humanité au ras du sol ne sont pas épargnés dans les sociétés confiées aux États fragiles modelés par la décolonisation qui a parfois décuplé, faute de savoir y mettre fin, les exactions de colonisateurs avant tout avides de domination.
Ce qu’on apprend en lisant ce corpus élargit significativement la connaissance et surtout la conscience de malheurs qui, à un autre niveau, nous affectent tous au long des vagues consécutives de la pandémie qui déferle sur le monde depuis deux ans. Mais que dire de ces littératures natives aux révélations encore plus déconcertantes ? Chacune d’elles a dû soulever plus que sa part du fardeau des plus horribles souffrances étalées sur des siècles dont un seul épisode aurait suffi à briser les courages les mieux trempés. La dynamique contenue dans ces constellations imaginaires s’inscrit résolument dans une perspective universelle, bien que localement soudée à des lectorats inégaux en nombre, arrimés à leurs terreaux originels. Jusqu’à quel point peut-on présumer, et avec quel degré de certitude, que la nouvelle région du monde dessinée par la pensée d’Édouard Glissant s’approche aujourd’hui, plus que jamais au cours de son histoire, des libertés qu’elle promet ? Il y a lieu de le supposer à travers la plurielle oralité qui circule sous la langue des métafictions.
L’un des concepts fondamentaux susceptible de contribuer à la réponse se trouve dans le parcours qui demeure au coeur des réflexions de Lise Gauvin depuis les décennies qu’elle scrute le carrefour des écritures francophones à la croisée des langues » (RCA, p. 5), problématique qui présente le double avantage de la flexibilité et du renouvellement de la pensée acculée à une mine de paradoxes de tous ordres. Il convient de suivre la discussion en termes linguistiques, puisqu’il s’avère que rien du corpus qui nous occupe ne s’impose aussi fortement sans l’aiguillage d’une conjonction-disjonction inhérente à la croisée des langues, sans laquelle on risque de réduire les littératures francophones aux sous-produits du post-colonialisme, quitte à recommencer l’indénouable procès de l’ethnocentrisme dont Claude Lévi-Strauss a voulu conjurer le spectre, au second versant du siècle dernier, dans un court essai qui repose sur le principe global invoqué au lendemain de deux guerres mondiales séparées d’à peine plus de vingt ans – de 1918 à 1939 : « La civilisation mondiale, affirmait en 1952 le père du structuralisme, ne saurait être autre chose que la coalition, à l’échelle mondiale, de cultures préservant chacune son originalité[3]. » Cette simple phrase, encore faut-il assumer pleinement le savoir capable de la comprendre comme indication de la manière dont peuvent se conjuguer les cultures naguère si promptes à s’affronter jusqu’à dépouiller l’Homme de son humanité par l’usage des armes les plus létales accessibles aux puissances belliqueuses depuis le venin, la pierre, le fer, la poix et la poudre. Je ne prétends nullement m’évader par la digression d’une indignation incompressible. L’essentiel recours est de m’appuyer sur la conviction que des huit auteurs étudiés par Lise Gauvin, aucun, me semble-t-il, ne sourcillerait à l’inscription de Race et Histoire en guise de préambule incontournable à ce qu’ils ont écrit et qui pointe dans une seule et même direction :
C’est le fait de la diversité qui doit être sauvé, non le contenu historique que chaque époque lui a donné et qu’aucune ne saurait perpétuer au-delà d’elle-même. Il faut donc écouter le blé qui lève, encourager [...] une attitude dynamique, qui consiste à prévoir, à comprendre et à promouvoir ce qui veut être.
RH, p. 85
D’Un dimanche au cachot de Patrick Chamoiseau, Lise Gauvin remarque : « Si les enfants s’ennuient le dimanche, les romanciers, eux, en profitent pour laisser tomber les masques et s’adonner à [...] des ego imaginaires et multiformes » (RCA, p. 20). Aussi le sentiment de tristes dimanches me serre-t-il la gorge au signalement des enfances enclines aux morosités dominicales après la messe obligatoire. Je ressens d’autant mieux à ce détour mélancolique l’empreinte de Crusoé évoquée par le narrateur livrant à la première personne son aptitude d’insulaire appliqué « à lire / copier / coller / récrire des textes » dans la démarche chancelante de l’écrivain « sans profession » qui n’est pas sans rappeler les personnages de Réjean Ducharme, « Nul écrivain n’a[yant] su mieux que Chamoiseau composer le roman comme atelier, en renouvelant chaque fois les formes de la fiction » (RCA, p. 28-29). Raphaël Confiant le soulignait en invoquant la
musicalité de la langue créole, liée à son oralité fondamentale [qui] va donc très logiquement nourrir la littérature antillaise de la fin des années quatre-vingt et du début des quatre-vingt-dix et, en particulier, le mouvement de la créolité, dont l’une des principales figures de proue, le romancier Patrick Chamoiseau, obtint le prix Goncourt en 1992[4].
L’effroi des deuils chroniques de femmes broyées, d’épouses dont la parole en sursis dit une Algérie sans fard, tel est le tableau non flatté des livres d’Assia Djebar. La narratrice d’Oran, langue morte (1997) déclare : « Oran m’est devenue mémoire gelée, et langue morte[5] ». Car à Oran, on oublie, confie la narratrice en annonçant qu’elle quitte la ville : « Oubli sur oubli. Ville lessivée ; mémoire blanchie » (RCA, p. 41). Ailleurs ce sera un autre exil : « Pour nous, » écrit Dany Laferrière, « l’Exode, c’était de quitter l’Afrique pour l’Amérique. »[6] Le départ permet le recueil scripté de l’héritage du silence mortifère des héroïnes d’Oran, langue morte : « Je pars car je ne veux plus rien voir, Olivia. Ne plus rien dire : seulement écrire. Écrire Oran en creux dans une langue muette, rendue enfin au silence. Écrire Oran ma langue morte » (RCA, p. 41). Ainsi se recoud le conte effroyable de la « Femme en morceaux » : « Je n’ai qu’à me taire, à questionner par mon regard, par un sourire, ou un demi-geste » afin de transcrire l’histoire terrible racontée par la « Schéhérazade des Cévennes » (RCA, p. 42). Dans ce roman, « la parole est muselée, proscrite, parole qui s’écrit plus qu’elle ne s’écrie, qui doit s’écrire faute de pouvoir s’écrier » (RCA, p. 45). Ce mutisme forcené éclate cependant dans les livres de Djebar pour témoigner de « l’écriture [...] présentée comme une activité rendue nécessaire par la violence de l’Histoire et l’effacement programmé des langues et des cultures » (RCA, p. 56).
Dans une forme plus proche du roman historique, Moi, Tituba sorcière... Noire de Salem, Maryse Condé délègue à la narratrice éponyme la doublure renversée de la sorcellerie blanche du village de Salem, près de Boston, vers la fin du XVIIe siècle. Le récit illustre un propos que la romancière livrait à Lise Gauvin dans un entretien : « En général on ne fait pas tellement attention à ce que les femmes disent. Ce qu’elles disent dérangent et on a tendance à ne pas les écouter. Leur parole ne répond jamais aux canons de la littérature en vigueur[7]. » Difficile de ne pas songer ici aux vies tumultueuses des fictions d’Anne Hébert, notamment les destins tragiques des personnages des Fous de Bassan (1982). La violence est extrême sous la charge vindicative de la dénonciation féministe du racisme doublé d’esclavagisme par les excès des pèlerins réformés du Mayflower. Mais un écrivain, tel que défini par Dany Laferrière, c’est justement
celui qui le devient en balayant tout sur son passage. Il ne peut faire autrement, dévoré par une passion aussi dévastatrice que le pouvoir. Dans ce métier, le caractère est plus important que le talent. Il faut avoir beaucoup de caractère pour poursuivre ce voyage quels que soient les obstacles rencontrés sur la route, tout en étant d’une faiblesse absolue face à ce monstre sans visage qui vous pousse à écrire pendant que votre ville tombe.
APP, p. 137
La seule chose dont les planteurs de canne à sucre n’auront pu déposséder leurs esclaves est la langue créole qui a résisté à la sinistre déportation des ancêtres africains. Le récit de Tituba en témoigne éloquemment. Mais que peut vraiment l’écriture pour contrer ou freiner le taux de mortalité des langues qui s’accélère au tournant du XXe siècle ? Or, la privation de la langue représente depuis toujours la plus intolérable cruauté qui se puisse infliger à la parole humaine. Voici quelques questions qui se posent au plus près de la vitalité langagière à partir de certains faits relevés par Claude Hagège dans Halte à la mort des langues :
[L]es langues possèdent une propriété tout à fait singulière : celle d’être des systèmes virtuels qui, certes, passent à l’état d’actes dès qu’ils sont mis en paroles, mais qui, cependant, n’ont pas besoin d’être mis en paroles pour exister. [...] La mort d’une langue n’est que celle de la parole. Les langues en tant que système de règles ne sont donc pas mortelles, bien qu’elles n’aient pas de vie par elles-mêmes, et ne vivent que si des communautés les mettent en parole(s)[8].
L’auteur cite sur ce point précis le cas patent des langues créoles :
L’exemple des créoles parlés dans la zone des Caraïbes montre clairement de quoi il s’agit. Leurs usagers sont les descendants d’esclaves arrachés à leurs villages africains, et transportés durant les XVII et XVIIIe siècles en particulier, dans les plantations antillaises. Les relexificateurs ont été les langues des planteurs et négriers blancs, c’est-à-dire, principalement, l’anglais et le français (d’où notamment, sur la base de ce dernier, les créoles martiniquais, guadeloupéen et guyanais), ainsi que quelques autres idiomes européens.
HML, p. 330
Partout où la France a essaimé en étendant l’influence prégnante de sa langue et de ses institutions, des peuples furent assujettis avant d’avoir choisi d’intégrer à leurs propres traditions les surgeons retenus et réifiés dans le sillage du colonisateur. Avec le temps l’implantation a ramifié des racines profondes dans les territoires d’outre-mer. Ce sont donc « des littératures françaises hors de France » (RCA, p. 6). Les nations européennes avaient d’abord rivalisé d’ingéniosité pour se partager le monde au gré d’alliances politiques, sans négliger la voix des armes, depuis les voyages de Christophe Colomb. Puis, aussi soudainement qu’ils s’étaient empressés de dépecer des pays par morceaux, les maîtres du monde devaient finir par s’entendre pour se retirer des colonies lointaines. La mise en oeuvre de la décolonisation au milieu du siècle dernier allait se hâter de substituer de nouveaux États indépendants dévolus aux élites de populations subitement pourvues de gouvernements souverains à peine émoulus de l’emprise métropolitaine, alors que les peuples dotés de ces instruments sophistiqués n’auraient plus qu’à compléter sur le tas une éducation menée la bride sur le cou. Les littératures francophones sont plus que d’autres confrontées aux situations résultant de ces bouleversements et des pénibles questionnements susceptibles de les dénouer. La réflexion lucide d’Édouard Glissant le rappelait avec force dans Une Nouvelle Région du monde :
Les langues mortes et les langues du secret (à décrypter) composent des réserves, un matériau de l’inconscient, entre les langues qui sont parlées puis écrites et les langues chantées, ou orales, d’une part, et d’autre part les langages, qui sont là structurés puis rapportés. Loin des pistes des langues, tout au fond des brousses des mots, ces réserves sont vouées à la survie langagière de tous, elles nous font ressouvenir que même disparues, les langues ont laissé des traces en nous, et que peut-être veillent déjà en nous des langues qui vont venir, qui sont nos différences du futur[9].
Après avoir relevé qu’« une littérature qui compte des noms comme ceux de Gracq, Butor ou Le Clézio ne saurait être dite sans ampleur », l’essayiste poursuit :
Il est difficile, quand on a régi la vue et l’énoncé du monde, qu’on dominait, d’y retrouver ensuite ou d’y accepter sa place avec justesse, parmi d’autres. Mais la littérature, et dans tous les pays, a toujours procédé par bonds et ruptures et soudainetés. Il en sera probablement ainsi, une fois de plus. Vous vous délectez des trésors hier accumulés par cette langue française. Elle en inventera d’autres. Elle ne domine pas le monde, elle s’y partage, souhaitons-le-lui du moins.
NRM, p. 172-173
Il convient tout à fait d’achever l’excursion parmi des littératures francophones par les derniers romans de Marie-Claire Blais, comme le fait d’ailleurs Lise Gauvin : « Dans un lieu idéal, une île du golfe du Mexique identifiée à plusieurs reprises comme paradis, se déploient les cercles d’une ronde infernale qui rappelle celle de la Divine Comédie de Dante. [...] Malgré le climat anxiogène du roman [...] émergent des îlots d’espoir et d’humanité... » (RCA, p. 146 et 152). C’est à bon droit qu’il y a lieu de célébrer le dernier volet du cycle des dix romans de Soifs :
Aucune romancière n’aura réussi à mettre en regard de cette façon, dans une île devenue microcosme de l’univers, le présent des consciences et les grands événements qui ont marqué l’Histoire des dernières décennies, chacun de ces événements étant recadré dans la perspective d’un destin singulier.
RCA, p. 159-160
Avant de terminer, je lis Tout bouge autour de moi de Dany Laferrière parlant du tremblement de terre de magnitude 7 qui bouleverse son pays d’origine au début de 2010, comme si coups d’État, dictatures, famines et pauvreté n’étaient pas assez. La verve coutumière du romancier fait place à une prose serrée qui vaut son précis d’histoire : « les deux plus grandes populations francophones en Amérique » sont celles du Québec et d’Haïti, et « Le XXIe siècle a commencé en Haïti le 12 janvier 2010 à 16h53. On ne peut être plus précis. C’est un événement dont les répercussions seront aussi importantes que celle de son Indépendance, le 1er janvier 1804[10]. » Je retiens certes la dignité de ce peuple dont l’exemple devrait souvent nous édifier :
Finalement, on n’a pas eu ces scènes de débordement que certains journalistes (ça fait vendre) ont appelées de leurs voeux. [...] Au lieu de cela, on a vu un peuple digne, dont les nerfs sont assez solides pour résister aux plus terribles privations. Quand on sait que les gens avaient faim avant le séisme, on se demande comment ils ont fait pour attendre si calmement l’arrivée des secours.
TBM, p. 83
Cette retenue se fera-t-elle aussi patiente jusqu’au bout de l’enquête en cours pour trouver et mettre en accusation les responsables de l’assassinat du président Moïse tué dans son palais il y a deux mois ?
On ne saurait surestimer l’avantage du lecteur admis dans la boutique des créateurs où se déploie un horizon autrement inaccessible. Nous pressentons ainsi sous sa lumière la plus crue et la plus accablante la grandiose aventure dont la clé n’est nulle part offerte sans risque. Mais qui voudrait d’une police d’assurance bétonnée sans clause de préemption à terme ? Le Roman comme atelier est un travail exceptionnel qui permet de prendre part à l’expérience de la percée remarquable des littératures francophones dans la nuée des angoisses de l’époque que nous traversons. Je me suis prêté à l’exercice du débat-recension parce que l’occasion m’a semblé propice à explorer le grand récit en partie esquivé par le contexte exigu de la seule notion de littérature nationale qui a semblé suffire à l’émergence des premiers écrivains québécois du XIXe siècle, mais au premier quart du XXIe, le bassin de lecteurs de fiction tendue au-delà des divisions génériques ne saurait se contenter de niches cloisonnées pour parler de sa quête d’identité respective. S’il n’est pas donné aisément d’ébaucher les rapports entre les continents fractaux de ce corpus, celui de la francophonie, dont les oeuvres s’imposent partout à l’attention et au respect du monde, il n’en reste pas moins impérieux de dépasser le simple constat, comme nous y invite Patrick Chamoiseau réfléchissant à voix haute aux questions de Lise Gauvin dans l’entretien reproduit à fin du volume sous la rubrique « DOCUMENT » :
Nous sommes de plus en plus des individus qui doivent opérer [...] à une échelle qui n’est plus [celle] d’un pays, d’une langue, d’une peau etc., mais à l’échelle du monde. Nous sommes aujourd’hui en face d’un horizon complètement chaotique, imprévisible qui est la mise en relation des peuples et des cultures. Et cela demande un autre imaginaire. [...] Toutes les horreurs que nous connaissons dans le monde sont liées à des agencements identitaires qui sont [...] exclusifs de l’autre.
RCA, p. 174-175
Quant à nous, provinciaux comme avant sur les terres qualifiées de « pays incertain », selon l’euphémisme de Jacques Ferron aggravé par Pierre Vadeboncoeur dans le titre posthume de sa correspondance avec Hélène Pelletier-Baillargeon : Le pays qui ne se fait pas, que pouvons-nous ajouter, dis-je, aux très fines analyses de Lise Gauvin ? Sans plus surseoir à l’attente d’une conclusion pendante, je prête l’oreille au bruit de ma ruelle où un quidam dépenaillé jette pêle-mêle des canettes vides dans un sac plastifié tintinnabulant au ras du pavé. Je crois discerner au-dessus de la friture du vacarme les mots détachés d’une sorte de mantra récité par une voix éraillée : « [O]n est tous des ignorants / mais personne n’ignore la même chose / moi je m’encourage là-dessus. »
Appendices
Notes
-
[1]
Lise Gauvin, « L’imaginaire des langues. Entretien avec Édouard Glissant », Études françaises, vol. 28, n° 2-3 (1992), p. 11-22.
-
[2]
Lise Gauvin, Le Roman comme atelier. La scène de l’écriture dans les romans francophones contemporains, Paris, Karthala, 2019, p. 10 ; Le Roman comme atelier sera désormais signalé dans le corps du texte par l’abréviation RCA, suivie du numéro de page.
-
[3]
Claude Lévi-Strauss, Race et Histoire, Paris, Gonthier (Médiations), 1961, p. 77 ; désormais les renvois à cette oeuvre se feront dans le corps du texte par l’abréviation RH suivie du numéro de page.
-
[4]
Raphaël Confiant, L’Écrivain et la musique. Communications de la XXIe Rencontre québécoise internationale des écrivains à Sainte-Adèle et à Montréal du 20 au 24 avril 1993, Montréal, L’Hexagone, 1994, p. 46.
-
[5]
Assia Djebar, Oran, langue morte, Arles, Actes Sud, 1997, p. 13.
-
[6]
Dany Laferrière, L’Art presque perdu de ne rien faire, Montréal, Boréal (Boréal compact), 2013, p. 137 ; désormais les renvois à cette oeuvre se feront dans le corps du texte par l’abréviation APP suivie du numéro de page.
-
[7]
Lise Gauvin, D’un monde à l’autre. Tracées des littératures francophones, Montréal, Mémoire d’encrier, 2013, p. 137.
-
[8]
Claude Hagège, Halte à la mort des langues, Paris, Odile Jacob (Poches), 2002, p. 42 ; désormais nous ferons référence à cette oeuvre dans le corps du texte par l’abréviation HML, suivie du numéro de page.
-
[9]
Édouard Glissant, Une Nouvelle Région du monde, Paris, Gallimard, 2006, p. 68-69 ; désormais, les références à cette oeuvre seront signalées dans le corps du texte par l’abréviation NRM suivie du numéro de page.
-
[10]
Dany Laferrière, Tout bouge autour de moi, Montréal, Mémoire d’encrier, 2010, p. 71 et 110 ; désormais, les références à cette oeuvre seront signalées dans le corps du texte par l’abréviation TBM suivie du numéro de page.
Références
- Confiant, Raphaël, L’Écrivain et la musique. Communications de la XXIe Rencontre québécoise internationale des écrivains à Sainte-Adèle et à Montréal du 20 au 24 avril 1993, Montréal, L’Hexagone, 1994.
- Djebar, Assia, Oran, langue morte, Arles, Actes Sud, 1997.
- Gauvin, Lise, Le Roman comme atelier. La scène de l’écriture dans les romans francophones contemporains, Paris, Karthala, 2019.
- Gauvin, Lise, D’un monde à l’autre. Tracées des littératures francophones, Montréal, Mémoire d’encrier, 2013.
- Gauvin, Lise, « L’imaginaire des langues. Entretien avec Édouard Glissant », Études françaises, vol. 28, n° 2-3 (1992), p. 11-22.
- Glissant, Édouard, Une Nouvelle Région du monde, Paris, Gallimard, 2006.
- Hagège, Claude, Halte à la mort des langues, Paris, Odile Jacob (Poches), 2002.
- Laferrière, Dany, L’Art presque perdu de ne rien faire, Montréal, Boréal (Boréal compact), 2013.
- Laferrière, Dany, Tout bouge autour de moi, Montréal, Mémoire d’encrier, 2010.
- Lévi-Strauss, Claude, Race et Histoire, Paris, Gonthier (Médiations), 1961.

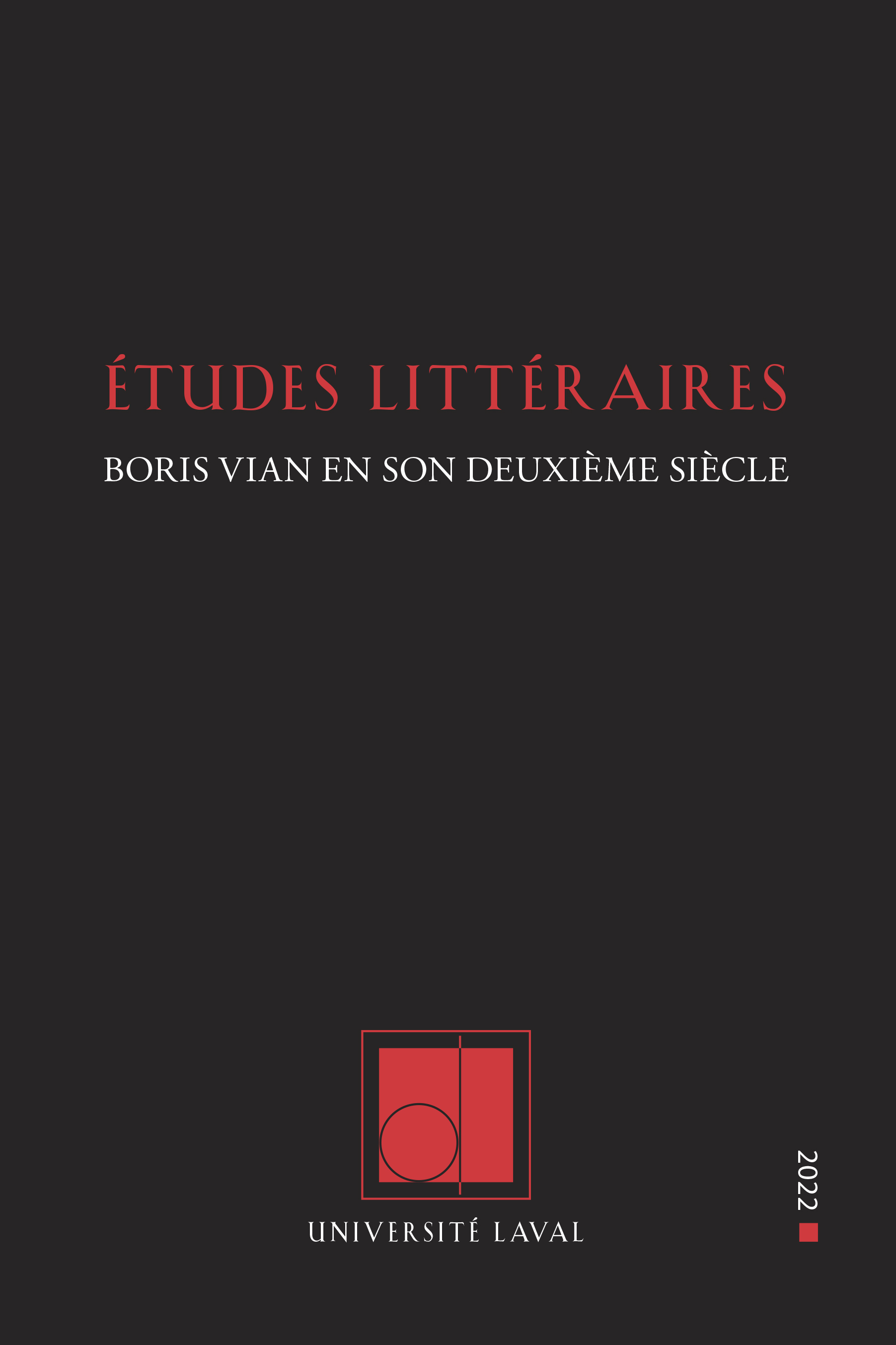
 10.7202/035877ar
10.7202/035877ar