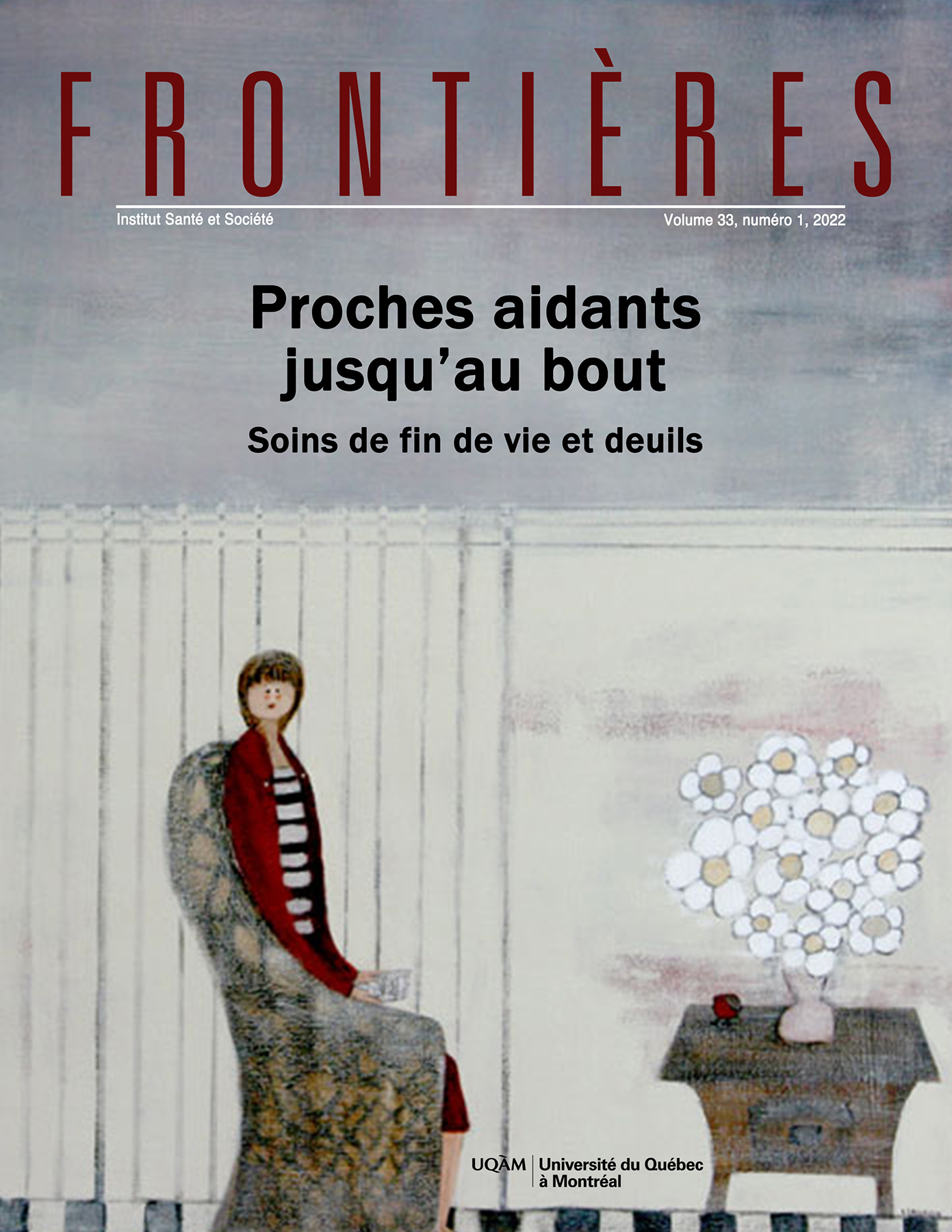Abstracts
Résumé
Cet article propose d’examiner une situation particulière au sein d’une unité de soins palliatifs (USP) parisienne : la décision de mettre fin à l’alimentation d’un patient en fin de vie. L’enquête a montré que ce moment, qui correspond plutôt à un processus, fait régulièrement l’objet de tensions entre proches et professionnels de santé. Nous verrons que ces tensions comportent des enjeux plus généraux autour de la « bonne mort » (Castra, 2003) et des rapports autour du mourant. En observant plus attentivement les proches présents « jusqu’au bout » auprès des malades, nous chercherons à montrer qu’au-delà des enjeux intimes et de la difficulté relative à la situation elle-même se profilent des enjeux politiques de reconnaissance de compétences et de place auprès du patient.
Mots-clés :
- soins palliatifs,
- sociologie,
- proches,
- famille,
- fin de vie,
- soignants
Abstract
This article proposes to examine a specific situation in a Parisian palliative care unit: the decision to stop feeding a patient in end-of-life care. The survey showed that this moment, which is also a process, is regularly the subject of tension between relatives and health professionals. We shall see that these tensions involve more general issues around the meaning of a ‘good death’ (Castra, 2003) and the relationship with the dying patient. By looking more closely at the relatives who are present ‘until the end’ with the sick, we will try to show that, beyond the intimate issues and the difficulty related to the situation itself, there are political issues surrounding the recognition of skills and the roles around the patient.
Keywords:
- palliative care,
- sociology,
- close ones,
- family,
- end-of-life care,
- caregivers
Resumen
Este artículo propone examinar una situación particular en una unidad de cuidados paliativos parisina: la decisión de interrumpir la alimentación a un paciente al final de la vida. La encuesta mostró que este momento, que corresponde más bien a un proceso, es regularmente objeto de tensiones entre los familiares y los profesionales de la salud. Veremos que estas tensiones implican cuestiones más generales en torno a la « buena muerte » (Castra, 2003) y la relación con el moribundo. Al profundizar en los familiares que están presentes « hasta el final » con los pacientes, trataremos de mostrar que, más allá de las cuestiones íntimas y de la dificultad relativa a la propia situación, también surgen cuestiones políticas relacionadas con el reconocimiento de competencias y de lugar en relación con el paciente.
Palabras clave:
- cuidados paliativos,
- sociología,
- familiares,
- final de la vida,
- cuidadores
Article body
Les questions de fin de vie animent depuis plusieurs années en France un débat social où se confrontent des positions politiques a priori antagonistes. Les « affaires » largement médiatisées autour de Vincent Humbert, Chantal Sébire, et plus récemment Anne Bert ou Vincent Lambert en témoignent. Pour aborder ces problématiques délicates, nous avons fait deux choix : celui d’observer les pratiques in situ, au sein d’une unité de soins palliatifs parisienne et celui de centrer notre travail sur les relations entre les professionnels de cette spécialité médicale et les proches des patients. Les pratiques d’accompagnement d’un malade nous intéressent en ce qu’elles révèlent les différentes tensions qui peuvent exister autour du mourant entre les professionnels et les proches présents « jusqu’au bout ». Ces derniers sont entendus comme acteurs véritables, directement et personnellement concernés et non réduits au seul rôle de « représentants du mourant » – comme y incite de fait la notion juridique de « personne de confiance » (Théry, 2012). Ils sont à la fois mandataires et critiques du soin, capables d’influencer indirectement le geste professionnel et de dénoncer ce qui, à leurs yeux, constitue des fautes (Boisson, 2020). Or, s’il existe une littérature importante depuis quelques années sur le rôle des proches « aidants » à domicile (Tchokote, 2020; Kane, Brignon et Kivits, 2018; Cresson, 2014; Garrido et Prigerson, 2014; Hortonéda, 2014; Ponet, Puyuelo et Roucoules, 2014; Ennuyer, 2013), il existe beaucoup moins d’enquêtes sociologiques sur leurs expériences dans le cadre hospitalier et encore moins dans le cadre de la fin de vie et des soins palliatifs. Les études qui font exception touchent à la fonction de représentation du patient par les proches (Brzak, Papadaniel et Berthod, 2016), se déroulent au sein de services pédiatriques (Gisquet, 2006) ou de réanimation (Legrand, 2010; Kentish-Barnes, 2010, 2007). En France, les thèses de sociologie portent davantage sur le travail des équipes des soins palliatifs et leurs pratiques que sur le point de vue des familles (Ollivier, 2021; Boisson, 2020; Blondet, 2019; Launay, 2019; Castra, 2003). C’est aussi – semble-t-il – le cas au Canada (Simard, 2013; Therrien, 2001; Pothier, 1994) ou en Suisse (Domeisen Benedetti, 2018; Foley, 2012). Les proches paraissent surtout intéresser les professionnels dans le domaine de la santé (soins infirmiers, médecine, psychologie, éthique, assistance sociale…) que ce soit en France (Tran, Martinez et Cantin, 2019; Simonet et Baudry, 2018; Burucoa, Milon et Ferreol, 2014; Belgacem et al., 2013; Joublin, 2010, 2007; Fantino et al., 2007; Fedor et Leyssene-Ouvrard, 2007), en Belgique (Goldbeter-Merinfeld, 2016; Delvaux, 2006), en Suisse (Zulian, 2019; Vannotti et Vannotti, 2009), en Angleterre (Mélin et al., 2020; Payne, Smith et Dean, 1999), en Suède (Axelsson et Sjödén, 1998), au Japon (Morita, Chihara et Kashiwagi, 2002), au Canada (Wadhwa et al., 2013; Côté, 2011; Morin, 2011; Gagnier et Roy, 2006; Ouellet, 2005; Beaulé, 1999; Chassé, 1998; Boisvert, 1995). Cet article cherche donc à éclairer un aspect peu investi par la littérature sociologique : la place des proches en tant qu’acteurs de la fin de vie dans un cadre hospitalier spécifique, celui d’une unité de soins palliatifs.
Le principal terrain sur lequel repose cet article est une observation socio-ethnographique de trois semaines réalisée début 2019 dans une unité universitaire de l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) spécialisée en éthique, en douleur chronique et en soins palliatifs[1]. Les « soins palliatifs » est le nom donné à une discipline spécialisée dans la prise en charge des patients en fin de vie. Elle s’est développée en Angleterre dans les années 1960, puis en France dans la seconde moitié des années 1970 (Castra, 2003). Institutionnalisés en 1986 (circulaire ministérielle du 26 août), ces soins sont définis par la loi du 9 juin 1999 comme des « soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire, en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage » (loi no 99-477 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs). Ils n’ont donc pas pour vocation d’être curatifs et visent principalement à soulager et à améliorer la qualité de vie d’un malade affligé d’une maladie incurable et ce, jusqu’au décès. De manière générale, une unité fixe de soins palliatifs (USP) est dédiée, selon la loi, « à la pratique des soins palliatifs et de l’accompagnement. Elle réserve sa capacité d’admission aux situations les plus complexes et/ou les plus difficiles. Elle assure [en théorie] une triple mission de soins, de formation, enseignement et de recherche[2] ». En France, il doit y avoir au moins une USP par région.
La structure étudiée est relativement connue. Elle publie régulièrement des études et des recommandations à diffusion nationale. C’est une unité de référence (parmi d’autres) en matière d’application des soins palliatifs mais elle n’est pas représentative des unités hospitalières de soins en général car elle dispose de moyens privilégiés, notamment en termes de personnel. Elle accueille une population généralement financièrement aisée et les patients, durant notre séjour, étaient âgés de 49 à 92 ans. Les proches avaient tous un lien de parenté avec les patients et cet article porte précisément sur les proches présents quasi quotidiennement dans l’USP, soit une minorité de familles – la plupart des malades n’ayant pas été accompagnés ou ne l’ayant été que de manière ponctuelle. L’enquête comporte donc un biais en ce qu’elle ne peut porter que sur les proches présents régulièrement et qui entretiennent, de fait, des relations serrées avec les professionnels.
L’enquête a montré que, selon les professionnels de la santé de l’unité, l’une des principales sources de tensions entre ces derniers et les proches présents auprès des malades découle de la décision d’arrêt de l’alimentation en situation de fin de vie[3]. Pour mieux comprendre ces tensions, nous détaillerons la place des proches dans la prise en charge en unités de soins palliatifs et les raisons mobilisées par les professionnels pour mettre fin à l’alimentation avant d’examiner plus attentivement ce qui semble poser problème aux proches.
Accompagner les proches dans le processus décisionnel d’arrêt de l’alimentation
Une étude de 2013 réalisée par l’Observatoire national de la fin de vie[4] en France estime que 49 % des USP consacrent au moins deux heures par jour de présence auprès des familles des patients[5]. Les professionnels cherchent ainsi à prévenir les deuils difficiles et luttent du même coup contre l’abandon médical et social de l’individu gravement malade. L’accompagnement des proches fait partie de la prise en charge proposée et prend la forme d'interactions quotidiennes informelles et d’entretiens formels (accueil dans l’unité, nuitées, entretien dit « d’aggravation » de la maladie ou de l’état du malade et de « décès »). Ces différents temps de parole sont conçus comme des soins à part entière et revêtent différentes finalités thérapeutiques : apaisement des souffrances, personnalisation de la prise en charge, mise en place d’une relation de confiance et construction d’une réalité commune par la « synchronisation » des différentes temporalités – du service, des professionnels, de la maladie, du malade et de ses proches. Pour les professionnels, ces différents temps relationnels sont autant d’occasions de désamorcer les potentielles tensions. Ainsi, les problèmes rencontrés peuvent être abordés à des heures différentes, de manière formelle ou informelle et par différentes personnes. Enfin, les familles peuvent séjourner à l’unité, pensée pour les accueillir nuit et jour (chambres spacieuses, lit d’appoint, réfrigérateurs à disposition…).
Au sein de ces services, les proches ont donc une place particulière. Si les professionnels accompagnent les malades, ils et elles accompagnent aussi les proches qui, à leur tour, accompagnent les malades. Les proches ont une « double place » : de patients et de travailleurs (Castra, 2010, 2003), d’accompagnés et d’accompagnants (Launay, 2019), et donc de bénéficiaires et d’émetteurs de soins. Pour complexifier ce tableau général, ajoutons qu’accompagner les proches fait partie de l’accompagnement des malades pour les professionnels. Cette multiplicité, voire confusion, des rôles entre les uns et les autres est un point important pour comprendre les potentielles tensions qui peuvent exister entre proches et professionnels autour de la décision d’arrêt de l’alimentation et ce, malgré les dispositifs d’accompagnements mis en place dans l’unité.
En toute fin de vie, les professionnels peuvent évoquer de multiples raisons d’arrêter l’alimentation (Daoût, 2005a). Elles sont généralement (mais pas toujours) mobilisées lorsqu’un patient présente des difficultés pour s’alimenter : il n’arrive plus à déglutir ou n’a plus d’appétit. Quoique fréquentes, ces situations ne sont pas anodines. Elles font d’ailleurs régulièrement l’objet de controverses et d’importantes réflexions interdisciplinaires. En témoigne une abondante littérature internationale dans les disciplines touchant à la santé (Foureur et Fournier, 2020; Lecoeur, 2016; Leheup et al., 2015; Pérotin, 2015; Furstenberg, 2014; Aubry et Daydé, 2013; Hellmann et al., 2013; Mangum et Buckley, 2012; Senesse et al., 2012; Lacroix, 2011; Preiser et Berré, 2010; Monturo, 2009; Devalois, Gineston et Leys, 2008; Verspieren, 2008; Daoût, 2005b; Castaings-Pelet et al., 2000). Ces articles révèlent les dimensions non seulement éthiques de la décision d’arrêt de l’alimentation pour les professionnels mais aussi légale (éviter le double écueil de l’acharnement thérapeutique et de l’euthanasie passive), symbolique (liée à l’idée qu’il faut manger pour vivre), sociale et culturelle (le moment du repas rythme les journées et peut être considéré comme un moment de plaisir et de convivialité), morale (attachée aux notions de solidarité et de responsabilité de nourrir autrui) et psychologique (accepter l’arrêt de l’alimentation ferait partie du processus de deuil). Les professionnels rencontrés lors des différents terrains mobilisent eux aussi des explications d’ordre psychologique et social pour expliquer les difficultés des proches qui sont souvent jugés « dans le déni » et pour qui accepter l’arrêt de l’alimentation correspondrait à accepter la mort. Aussi valables et pertinents soient ces registres, nous aimerions montrer ici que les tensions entre proches et professionnels qui peuvent advenir autour de la décision d’arrêt de l’alimentation revêtent également une dimension micropolitique (Béliard et al., 2015). Elles mènent à se demander qui peut légitimement être auprès du patient, décider pour son « bien » et à quel moment. Ce sont des moments d’incertitude qui conduisent les acteurs à clarifier leurs positions (Hennion et Vidal-Naquet, 2015). Comme nous allons le voir, la décision d’arrêt de l’alimentation prend la forme d’un processus.
Pour les patients concernés par cette problématique (car tous ne le sont pas), les professionnels doivent d’abord reconnaître les signes d’une aggravation, en discuter entre eux, souvent aussi avec la famille pour les prévenir et les préparer. Ensuite, et seulement après concertation, le médecin prend la décision d’arrêt de l’alimentation et doit l’annoncer aux proches. Un des risques fréquemment soulevés lors de mes observations est celui de provoquer une fausse route pouvant mener au décès « accidentel » et prématuré[6] du patient ce qui, pour les professionnels, entre en contradiction avec leur objectif de prévenir les deuils difficiles. Les professionnels de l’unité cherchent à ce que les proches souscrivent d’eux-mêmes à la nécessité d’arrêter l’alimentation. Ils préfèrent généralement éviter de devoir imposer cette décision, conscients des difficultés que les proches peuvent rencontrer et de la place qu’occupe le moment du repas dans la poursuite d’une forme de routine à laquelle ils peuvent être attachés. Pour l’infirmière Y, « ça les occupe ». Les repas, me dit-elle, ça rythme aussi la vie. Le chef de service est de son avis : « ça meuble, sinon il n’y a plus rien à se dire ». Certains proches racontent en entretien le corps altéré de l’être aimé qu’ils ne parviennent plus toujours à reconnaître. Petit à petit, la personne malade cesse d’être un humain comme les autres, elle ne marche plus, ne peut plus partager des activités, ne peut plus manger, parfois ne peut plus boire non plus et ne peut plus communiquer – du moins de manière traditionnelle. Pour accompagner les proches dans ce processus et les aider à redéfinir les modalités de leur relation avec le malade, les professionnels peuvent leur proposer des solutions de remplacement (passer un bâtonnet imbibé d’une substance agréable dans la bouche de la patiente ou du patient, jouer avec les odeurs…). Finalement, « bien » accompagner le mourant nécessite que les proches changent leurs manières d’être (prendre soin, c’est désormais accepter de ne plus nourrir) et leurs manières de définir ce qui constitue des moments de qualité (généralement associés aux repas).
Ainsi, l’enjeu pour les professionnels est de trouver le « bon » moment à la fois pour la temporalité du patient et de sa maladie, et pour celles de ses proches qu’ils cherchent à accompagner dans leur cheminement. Or, il arrive que ces deux exigences entrent en contradiction lorsque les proches, malgré leurs efforts, contestent le choix du moment pour arrêter l’alimentation ou la décision en elle-même. Dans ce cas, s’accorder sur le « bon » moment implique de savoir comment et par qui sont définies les capacités et les envies du malade à continuer de s’alimenter. Ces questions sont souvent d’autant plus prégnantes qu’elles interviennent lorsque le patient ne peut plus exprimer sa volonté et qu’elles comportent pour les proches des enjeux relationnels, de place au sein du cercle intime du patient et de reconnaissance de compétences. Pour illustrer ce point, nous mobiliserons extensivement un entretien d’aggravation avec la famille Caron[7] qui nous semble particulièrement bien illustrer quelques enjeux des difficultés rencontrées par certains proches à faire reconnaître, auprès des professionnels et parfois des autres proches, leurs compétences et leur place autour du mourant.
Le patient, Monsieur Caron, est atteint d’une maladie dégénérative au développement rapide. Sa femme s’est occupée de lui à domicile avant son hospitalisation et elle l’accompagne nuit et jour à l’unité. Ses six enfants viennent régulièrement (voire quotidiennement pour certains) lui rendre visite. L’objectif de l’entretien que nous allons analyser, mené par la Docteure X, est de faire comprendre aux Caron qu’alimenter le patient – au-delà de la problématique du risque – n’est pas nécessaire ni souhaitable. La Docteure X explique que lorsque Monsieur Caron a des petites phases d’éveil, « c’est peut-être un peu dommage que ça soit centré sur l’alimentation et que ce ne soit pas quelque chose que vous habitiez vraiment dans la relation ». Ici, la médecin ne propose pas seulement des solutions de remplacement, elle fait une proposition relationnelle. Les professionnels en soins palliatifs cherchent à favoriser les « moments de qualité » avec la personne mourante, c’est la condition pour que puisse se faire le « cheminement intérieur ». La Docteure X parle plus loin d’un « apprentissage » à faire, d’une autre manière d’être en relation avec le malade qui soit « véritable », « d’une communication qui devient autre » et qui serait donc davantage de l’ordre de la présence attentive et émotionnelle, plutôt que de l’action orientée par un objectif : nourrir. Ces nouvelles modalités relationnelles présentent des enjeux pour les proches que nous aimerions développer.
Du côté des proches : entre accélérations temporelles et enjeux de reconnaissance
Nous avons identifié trois sources potentielles de tensions que nous pouvons séparer en deux ensembles qui entretiennent des liens étroits : celles qui sont relatives à la relation avec les professionnels de santé et celles relatives à la situation de mort imminente d’un proche. Pour celles et ceux qui se sont occupés du malade à domicile, arriver en unité de soins palliatifs constitue un changement de statut, de proche aidant, à proche accompagnant. Or, nous postulons que cette place d’aidant est non seulement une manifestation du lien qui unit celui qui donne le soin à celui qui le reçoit mais aussi, d’une certaine forme de responsabilité envers la personne malade et de l’acquisition d’un certain nombre de compétences à la fois intime et de care. Ensuite, le processus d’arrêt de l’alimentation correspond pour les proches à une accélération. Enfin, nous reviendrons sur la proposition des professionnels de réinvention d’une relation dans une nouvelle temporalité, une relation sans geste de nutrition.
Les proches sont parfois des « aidants » au sens juridique du terme : « Le proche aidant est en général l’époux(se), partenaire de Pacs [En France, contrat conclu entre 2 personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune], concubin, parent ou allié ou personne résidant ou entretenant des liens étroits et stables, qui vient en aide à une personne régulièrement ou fréquemment, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne de cette personne[8] ». Les proches aidants peuvent avoir de grandes connaissances du malade, de sa maladie, de ses traitements. Leur rôle est parfois si prenant qu’il arrive qu’un malade soit hospitalisé en unité de soins palliatifs principalement pour soulager le proche qui s’en occupe. Les proches qui en font le choix ou en ont la possibilité nourrissent, font la toilette ou aident à la faire, soignent. Ils « entretiennent la vie », pour reprendre l’expression de Marie-Françoise Collière citée par Geneviève Cresson (2014)[9]. Pour cette dernière, « il ne faudrait pas sous-estimer le plaisir qu’on peut prendre [au travail profane], le sentiment d’une vie qui a du sens, la création de relations fortes et humainement signifiantes, la reconnaissance par les autres personnes de l’entourage de ses compétences » (Cresson, 2006, p. 24).
L’unité de soins palliatifs, par l’offre qu’elle propose de care et non de cure, est un cadre qui, comme nous l’avons évoqué, contient des ambiguïtés de rôles. Les professionnels prennent soin sans ambition de guérir et soulagent, comme les proches, dans un registre plus technique mais également relationnel. Les proches aidants sont à la fois déchargés du « prendre soin » technique et contraints d’y renoncer au fur et à mesure que la maladie progresse. Si cette contrainte n’est pas toujours vécue comme telle, bien au contraire, les difficultés que peuvent rencontrer les proches à accepter l’arrêt de l’alimentation peuvent parfois lui être imputées. En entretien d’aggravation, Madame Caron et trois de ses enfants cherchent à convaincre la Docteure X qu’elles savent faire, qu’elles ne sont pas « à côté de la plaque », qu’elles ont respecté, elles aussi, le « rythme » et les envies du patient. Elles ont arrêté de lui donner de la viande, sont passées à la compote, à la glace, elles le remettent droit pour manger, vérifient qu’il déglutit comme il faut. Comme le souligne Justine, l’une des filles, « on fait pas n’importe quoi en fait. Moi, c’est ça que j’entends là ». Elles revendiquent leur capacité à « prendre soin » de leur mari ou de leur père en vertu du fait qu’elles le connaissent mieux que n’importe quel professionnel :
Docteure X : On est témoins comme vous de l’évolution de la maladie.
Notes de terrain, « entretien » entre la famille Caron et la Docteure X
Justine : Oui mais nous on y est habitués (elle le dit fort).
La médecin essaie de répondre quelque chose mais les filles se mettent à rire.
Justine, une des filles Caron : En fait!
Les autres filles acquiescent : Ouais…
Justine : Non mais c’est vrai, fin c’est très sérieux ce que je dis. Ben si! […]
Madame Caron : Non mais j’ai l’impression que vous voyez… enfin… on voit qu’il s’enfonce, mais j’ai l’impression qu’on peut faire… qu’il est encore capable de plus de choses que ce que vous pensez. […]
Justine : Oui moi je dis, pour lui c’est nécessaire, il a toujours kiffé la bouffe [c’est-à-dire « aimer » ou « prendre du plaisir »], il a qu’une envie c’est de bouffer, mais enfin [elle se claque les cuisses] on est sa famille, on est ses gosses, on sait, je suis désolée mais ON SAIT CE QU’IL VEUT en fait. Voilà c’est tout, et il y a un moment où tu lui apportes de la glace, il bouffe sa cuillère et il rouvre la bouche c’est bien qu’il veut de la glace.
Justine revendique ici un savoir fondé sur un lien intime, inscrit sur le temps long. Elle connaît son père, sait qu’il aime manger et sait reconnaître les signes qui indiquent chez lui qu’il en veut encore. Ce qui se joue ici pour la famille Caron est la reconnaissance de leur savoir profane et de leur compétence qui révèlent leur place et l’ancienneté de leur relation avec le patient. On perçoit ici une différence fondamentale entre professionnels et proches : les premiers ont un horizon temporel restreint à celui de la prise en charge au sein de l’unité, les seconds viennent avec leur passé et la manière dont se déroule le présent engage leur futur. Pour ne pas perdre leur « place » auprès du patient, la famille Caron demande à apprendre les techniques permettant d’éviter la fausse route :
Docteure X : Quand vous le positionnez soyez vigilantes de ne pas tout de suite le rallonger, il faut qu’il reste encore bien redressé par exemple, vous voyez? Ça fait partie des conseils…
Notes de terrain, « entretien » entre la Docteure X et la famille Caron
Madame Caron : Ben alors donnez-nous tous les conseils!
Docteure X : Mais oui mais c’est pour ça que c’est important aussi qu’on voit dans quelle position vous l’avez installé.
Madame Caron : Ben comme ça et comme ça (elle prend sa fille comme cobaye)
Docteure X : Oui en fait vous nous faites signe comme ça nous on vient.
Aude : Oui ben pas tout le temps, pas plein de fois quoi, une fois c’est ça?
Docteure X : Oui…
Madame Caron : Non, non, non, [Docteure X] elle disait plein de fois, à tous les coups.
Docteure X : Non, non, pas à tous les coups… qu’on puisse déjà faire une fois, voilà une, deux…
Madame Caron revendique ici la reconnaissance de son statut d’aidante, liée à son statut d’épouse et à ce titre, la prise en charge des derniers instants de conscience de son mari. En résistant à la demande des professionnels de leur « faire signe » lorsqu’elle nourrit son mari, Madame Caron refuse en quelque sorte deux choses : leur céder sa responsabilité du prendre soin et partager le temps qui lui reste avec l’homme qu’elle aime et dont elle s’est occupée pendant plusieurs semaines avant qu’il soit hospitalisé. Cela est d’autant plus prégnant que le temps leur est compté et que le futur sans se rapproche.
Cet aspect de l’expérience des proches confrontés à l’arrêt de l’alimentation est particulièrement important. Ces moments correspondent à des accélérations. En l’absence de nourriture, et parfois d’eau, le décès se rapproche dangereusement[10]. En entretien, Madame Caron dit et redit qu’elle voit son mari diminuer de jour en jour : « Il s’est altéré tellement vite ». Elle ajoute : « Moi j’ai vraiment le sentiment que ces moments qui sont importants pour lui et pour nous, si je dois appuyer sur la sonnette, ils n’existeront plus. On le privera de ces moments et on nous privera de ces moments ». C’est aussi ce qui ressort de l’extrait cité plus haut. Ces instants où le patient est suffisamment éveillé pour être nourri, Madame Caron n’a pas envie de les partager et redoute de les perdre en n’accordant pas toute son attention à son mari. La présence de professionnels, dans ces moments que la disparition prochaine rend extrêmement précieux, s’apparente pour elle à de la surveillance. Elle est d’autant plus pénible que ce temps lui échappe. Le sociologue Marc Bessin relève l’ambiguïté autour de cette notion de présence, « entre “veiller sur” et “surveiller” » utilisée dans les métiers de la santé ou dans le travail social, mais aussi dans les domaines du sécuritaire comme la police et la surveillance (2020, p. 7). En cherchant à faire reconnaître son droit en tant qu’épouse d’être elle-même gardienne de la fin de vie de son mari et de savoir ce qui est bon pour lui, en cherchant à s’en occuper encore, Madame Caron demande à la fois de la reconnaissance et du temps – qu’elle tente de ralentir.
Pour Edouard Gardella, « le modèle de l’accompagnement est mis en crise, non pas quand le temps est court ou long, mais quand les acteurs ont le sentiment de ne pas avoir la maîtrise du temps intrinsèque à la relation qu’ils construisent » (2009, p. 8). Dans cette perspective, ce n’est pas le fait de cesser d’alimenter qui est l’objet de tensions entre les proches et les professionnels mais bien celui de pouvoir décider du moment opportun. Ce choix du « bon moment » peut être l’objet d’une lutte, assimilable à un rapport de force. Citant Hartmut Rosa, Gardella souligne que « le fait de savoir qui définit le rythme, la durée, le tempo, l’ordre de succession et la synchronisation des événements et des activités est l’arène où se jouent les conflits d’intérêts et la lutte pour le pouvoir » (2014, p. 5). Dans cette perspective temporelle, on peut davantage comprendre pourquoi certains proches continuent d’alimenter des patients qui ne sont plus capables de déglutir[11]. Comme le souligne Bessin (1998), les individus qui vivent dans des temporalités imposées, que ce soit celle de l’unité de soins palliatifs ou de la maladie en elle-même, génèrent tout de même des temporalités qui leur sont propres. Par leurs pratiques ordinaires – pouvant être interprétées comme des formes de résistance – ils utilisent, contournent et manipulent le cadre temporel de l’unité. Ainsi définies, ces luttes de pouvoir entre professionnels et proches sont à mettre en lien avec ce changement de rôle, d’aidant-soignant à aidant-accompagnant, désormais tenu de ne plus être soignant. Nous ajouterons que ces pratiques sont précisément constituées de gestes de soins « techniques » et qu’en fin de vie, nous l’avons vu, ceux-ci ont tendance à s’amenuiser.
Le temps en unité non seulement se restreint, mais il peut donner l’impression de se vider. La relation construite avec l’être aimé passe aussi par des gestes – gestes comme nous l’avons dit qui s’apparentent à de l’entretien de la vie dans le cas de maladies graves à domicile. Ces gestes peuvent avoir une valeur presque magique. C’est en tout cas l’adjectif utilisé par le fils de Monsieur Moca, un patient atteint d’un cancer accompagné par sa femme et ses deux fils qui se relayaient à ses côtés. Très présente dans l’unité, cette famille n’a pas rencontré de difficulté particulière à l’arrêt de l’alimentation. Leur prise en charge a d’ailleurs été jugée exemplaire par le chef de service pour qui « la confiance a été construite dès le premier entretien ». S’il est certain qu’une bonne relation entre proches et professionnels joue un rôle important dans l’acceptation des propositions médicales, il se trouve aussi que, contrairement à Monsieur Caron, Monsieur Moca a gardé des moments de conscience presque jusqu’au bout. Lors d’un entretien individuel, sa femme et ses fils rapportent qu’ils parviennent encore à communiquer avec lui, par des sourires et des caresses. Pour Madame Caron, non seulement « la bouffe » a beaucoup d’importance dans leur famille mais c’est aussi « la seule interaction qu’on a avec lui ». Elle ajoute que « c’est pratiquement le seul lien qu’on a quoi, parce que la parole on l’a plus. Moi j’ai encore la main… il arrive encore à me serrer la main mais j’ai l’impression que le regard il y est plus… ». Une part de la difficulté réside dans la difficulté à ritualiser, au sens de pratiques ayant une valeur symbolique, avec un répertoire de gestes qui se restreint ou doit se réinventer dans un temps parfois très limité. Pour atténuer ces effets de ruptures, il n’est pas rare de voir les proches se réunir autour du malade à l’heure des repas, prolongeant ainsi des habitudes héritées de l’avant. Ajoutons que ces gestes de nourrir et d’abreuver sont des gestes éminemment relationnels lorsque le malade n’est plus en mesure de le faire seul. Nous pourrions même avancer que nourrir, se nourrir, c’est ce qui nous insère dans l’univers. C’est une « technique du corps » au sens où l’entend Marcel Mauss (1936 [1934]). Tout au long de la vie, lorsque nous tombons malades, nous adaptons notre alimentation, certes, mais nous devons manger pour reprendre des forces et combattre la maladie. Dans l’unité étudiée, en toute fin de vie, « prendre soin » du malade c’est aussi parfois savoir cesser de l’alimenter et même de l’hydrater. Il y a donc un changement de paradigme qui nécessite de réinventer la relation avec le mourant.
Comprendre les demandes des proches, reconnaître leurs capacités
Avant de conclure, nous aimerions souligner l’intérêt de considérer les proches comme des acteurs véritables de la fin de vie plutôt que seulement comme accompagnants des patients, voire des bénéficiaires de soins. Par exemple, lorsque Michel Castra, dans une partie de sa thèse consacrée au travail profane et intensification des liens sociaux (2003, p. 152-160) montre la place significative accordée par les professionnels aux bénévoles et aux proches, il place ces deux groupes dans un même système d’attentes au sens maussien du terme développé par Irène Théry (2009)[12]. Pour ce chercheur, ces deux groupes ont pour fonction première « d’apporter un soutien ou un réconfort » au patient, empêchant ainsi « tout sentiment d’isolement ou d’abandon » (2003, p. 152). Ils sont incités à accomplir un travail profane auprès des malades et sont considérés comme des alliés et partenaires de l’équipe. Plus encore, Castra souligne qu’il s’agit de « redonner une responsabilité à la famille », donc qu’« une infirmière peut quitter un patient qui nécessite une surveillance et en confier la responsabilité de manière plus ou moins explicite à un parent » (2003, p. 157-158).
Malgré l’intérêt de ces développements, on peut aussi penser qu’adopter seulement le point de vue des professionnels mène à une confusion sur le rôle des familles. La notion de « transfert de responsabilité », utilisée par Pierre Nocérino (Mazé et Nocérino, 2017), nous aidera à éclairer ce point. Dans l’extrait cité plus haut, Castra montre que les professionnels peuvent organiser un transfert de responsabilité (limité) en laissant les proches surveiller le malade à leur place, ou en les laissant nourrir le malade, tâche qui peut s’avérer fastidieuse. Néanmoins, nous proposons de considérer que ce sont d’abord les proches, particulièrement les proches « aidants » qui confient la responsabilité du malade aux professionnels. Comme le souligne Marine Boisson (2020), tout mandat professionnel procède d’un processus de délégation qui sera ensuite mis en cause ou légitimé dans la mise en oeuvre du soin, directement sur le lieu de travail. Si bénévoles et proches des patients peuvent avoir la même fonction aux yeux des professionnels, il nous semble que les premiers n’ont pas de responsabilité antérieure envers les personnes malades, ni même la capacité de déléguer la prise en charge du patient à des professionnels, ni la même relation temporelle. Cette distinction apporte un éclairage différent à l’analyse des tensions autour de l’arrêt de l’alimentation. Les proches peuvent être confrontés, lors d’une fin de vie en unité de soins palliatifs, à une situation où ils doivent revendiquer leur place et leur capacité à s’occuper du mourant. Ces revendications sont d’autant plus prégnantes que, comme le remarque une étude réalisée en Suisse, le statut de proche « ne donne aucune prérogative pour “intégrer” de facto la relation qui unit le parent malade et les soignants » (Brzak, Papadaniel et Berthod, 2016, p. 54).
Ainsi, par l’observation d’une USP parisienne, cet article a cherché à montrer les enjeux essentiels qui peuvent se jouer pour les professionnels et les proches confrontés au décès imminent. Pour les premiers, la question du confort du patient est le guide de l’action et elle peut commander à un certain moment l’arrêt de l’alimentation. Pour les seconds, l’alimentation est parfois « tout ce qui reste » d’un lien concret de care, manifeste de leur engagement envers la personne mourante, et y renoncer est difficile à mesure que le temps se restreint. Mais l’intérêt de cette enquête, certes modeste, est de montrer que les tensions entre proches et professionnels ne sont peut-être pas uniquement imputables aux difficultés relatives à la situation de perte d’un être cher. Plus précisément, la décision d’arrêter l’alimentation n’est pas seulement difficile pour les proches au sens où elle semble accélérer la mort du patient, mais aussi parce qu’elle peut impliquer une « mort sociale », d’une certaine façon, en mettant fin au rôle qu’ils jouaient auprès du patient. C’est, selon nous, ce qu’il faut comprendre pour saisir l’enjeu politique lié à la demande des proches de reconnaissance de leur place auprès du patient et de leurs capacités à savoir eux aussi ce qui est « bon » pour le mourant.[13]
Appendices
Notes
-
[1]
Nous avons également réalisé deux autres observations, de deux semaines chacune, au sein d’équipes mobiles de soins palliatifs mais l’enquête a révélé que, pour observer les relations entre les professionnels et les proches, l’observation continue en unité de soins palliatifs était plus adaptée. La compréhension du sujet a été également enrichie par l’observation de cours magistraux d’un diplôme universitaire de soins palliatifs, du Congrès international de la Société Française d'Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP) et d’entretiens exploratoires avec des professionnels des soins palliatifs (8) et des proches endeuillés (8).
-
[2]
Circulaire DHOS/O 2/DGS/SD 5 D no 2002-98 du 19 février 2002 relative à l’organisation des soins palliatifs et de l’accompagnement, en application de la loi no 99-477 du 9 juin 1999, visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs (https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2002/02-12/a0121073.htm).
-
[3]
Un résultat similaire a été trouvé concernant les familles suisses et américaines (Mpinga, Chastonay et Rapin, 2006) et c’est aussi ce que remarque Pauline Launay dans sa thèse en France (2019, p. 408).
-
[4]
L’Observatoire national de la fin de vie, créé par décret le 19 février 2010 à l’instigation du ministère des Affaires sociales et de la Santé avait pour principale mission la production d’études servant à mieux connaître les conditions de la fin de vie en France. Il a été remplacé en janvier 2016 par le Centre National des Soins Palliatifs (ONSP).
-
[5]
Elles sont 7 % à leur consacrer 30 min, 17 % à leur consacrer 1h, 18 % 3h et 7 % 4h (Observatoire national de la fin de vie, 2013, p. 2).
-
[6]
La fausse route caractérise le fait qu’un aliment ou une particule alimentaire sont inhalés au lieu de passer par l’oesophage. Il existe plusieurs types de fausses routes, certaines sont immédiates et la personne peut s’étouffer, d’autres sont plus difficiles à repérer. Une particule alimentaire peut arriver jusqu’aux poumons et provoquer une infection qui peut s’avérer fatale en fin de vie.
-
[7]
L’ensemble des noms et prénoms des enquêtés ont été anonymisés.
- [8]
-
[9]
Cresson rappelle que « la notion de soin est très englobante, puisqu’elle désigne aussi bien des préoccupations, des soucis, des efforts, des traitements médicaux, qu’une responsabilité vis-à-vis de quelqu’un » (2014). C’est pourquoi nous privilégions le terme de professionnels – celui de soignants ayant l’inconvénient d’exclure les proches de cette catégorie.
-
[10]
Précisons tout de même que c’est bien la maladie qui cause la mort d’un patient. Le fait d’arrêter l’alimentation ou l’hydratation en est une conséquence.
-
[11]
Il est arrivé plusieurs fois qu’une infirmière remarque la présence d’aliments coincés au fond de la gorge d’un patient ou d’une patiente.
-
[12]
Cette approche dite « relationnelle » développée par Irène Théry considère que l’être humain est toujours inscrit (ne serait-ce qu’à la marge) au sein d’un système relationnel investi de significations, de valeurs ou d’attentes. Pour le dire autrement, les individus interagissent toujours avec d’autres en référence à des règles plus ou moins explicites d’action sociale : « une relation sociale humaine est médiée par des statuts relatifs et relationnels de la parenté qui expriment la dimension des droits et devoirs qui dessinent nos attentes mutuelles » (2009, p. 31).
-
[13]
Je souhaiterais remercier l’équipe de Frontières pour son accompagnement, ainsi que les évaluatrices et évaluateurs externes dont les commentaires ont permis d’améliorer significativement ce travail. Je souhaiterais également remercier Marine Jeanne Boisson, Valentin Rio et Maëlle Partouche pour leurs relectures attentives. Ce travail leur doit beaucoup.
Bibliographie
- AUBRY, R. et M.-C. DAYDÉ (2013). Soins palliatifs éthique et fin de vie (2e éd.), Rueil-Malmaison, Lamarre.
- AXELSSON, B. et P.-O. SJÖDÉN (1998). « Quality of life of cancer patients and their spouses in palliative home care », Palliative Medicine, vol. 12, no 1, p. 29-39.
- BEAULÉ, M. (1999). L’expérience des proches qui accompagnent un malade atteint d’une maladie terminale et hospitalisé en soins palliatifs dans un hôpital de soins de courte durée, Mémoire de maîtrise, Université Laval.
- BELGACEM, B., C. AUCLAIR, M.-C. FEDOR, D. BRUGNON, M. BLANQUET, O. TOURNILHAC et L. GERBAUD (2013). « A caregiver educational program improves quality of life and burden for cancer patients and their caregivers: A randomised clinical trial », European Journal of Oncology Nursing, vol. 17, no 6, p. 870-876.
- BÉLIARD, A., A. DAMAMME, J.-S. EIDELIMAN et D. MOREAU (2015). « “C’est pour son bien”. La décision pour autrui comme enjeu micro-politique », Sciences Sociales et Santé, vol. 33, no 3, p. 5-14.
- BESSIN, M. (1998). « Le Kairos dans l’analyse temporelle », Cahiers lillois d’économie et de sociologie, no 32, p. 55-73.
- BESSIN, M. (2020). « Les présences parentales dans le parcours de vie : une approche temporaliste et féministe », https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02977497, dans (à paraître) M. BESSIN et C. NÉGRONI, Le parcours de vie : une analyse des tensions entre les logiques individuelles, collectives et institutionnelles, Presses du Septentrion.
- BLONDET, V. (2019). Les pratiques sédatives en unités de soins palliatifs, entre travail du care et négociation, Thèse de doctorat, Université de Strasbourg (France).
- BOISSON, M. J. (2020). Mourir en moderne. Une sociologie de la délégation, Thèse de doctorat [document non publié], École des hautes études en sciences sociales (France).
- BOISVERT, C. (1995). Vécu de la famille dont un des membres adultes reçoit des soins palliatifs dans une unité de soins de courte durée, Mémoire de maîtrise, Université Laval.
- BRZAK, N., Y. PAPADANIEL et M.-A. BERTHOD (2016). « Les proches au coeur des décisions médicales de fin de vie : anticiper, représenter, hésiter », Anthropologie & Santé, no 12. https://doi.org/10.4000/anthropologiesante.2009
- BURUCOA, B., J. MILON et M. FERREOL (2014). « Etude prospective sur l’accompagnement des proches en Unité de soins palliatifs (USP) », Revue internationale de soins palliatifs, vol. 29, p. 33-40.
- CASTAINGS-PELET, S., V. LOZANO, M. GUATTERIE, B. BURUCOA, B. PATERNOSTRE et M. BARAT (2000). « Prise en charge des troubles de la déglutition dans un service d’accompagnement et de soins palliatifs », Annales de Réadaptation et de Médecine Physique, vol. 43, no 2, p. 74-77.
- CASTRA, M. (2003). Bien mourir. Sociologie des soins palliatifs, Paris, Presses universitaires de France.
- CASTRA, M. (2010). « 13. Les familles en unité de soins palliatifs : acteurs ou objets de la prise en charge de la fin de vie à l’hôpital? », dans G. CRESSON (dir.), Famille et santé, Rennes, Presses de l’EHESP, p. 203-211.
- CHASSÉ, F. (1998). Étude descriptive des facteurs de stress et des stratégies d’adaptation chez les soignants naturels impliqués dans les soins palliatifs à domicile, dans le contexte de l’hôpital extra-mural de la région de Frédéricton, au N.-B., Mémoire de maîtrise, Université Laval.
- CÔTÉ, C. (2011). Évaluation de la satisfaction des proches des usagers de soins palliatifs à domicile au regard des soins et services reçus sur le territoire du centre de santé et des services sociaux de la Vieille-Capitale, Mémoire de maîtrise, Université Laval.
- CRESSON, G. (2006). « La production familiale de soins et de santé. La prise en compte tardive et inachevée d’une participation essentielle », Recherches familiales, vol. 3, no 1, p. 6-15.
- CRESSON, G. (2014). « Les rôles et les tâches multiples de l’entourage des patients », Sciences Sociales et Santé, vol. 32, no 1, p. 65-70.
- DAOÛT, C. R. (2005a). « La nutrition artificielle en fin de vie : nécessité d’une approche éthique individualisée », Médecine palliative, vol. 4, no 6, p. 299-308.
- DAOÛT, C. R. (2005b). « L’alimentation et l’hydratation artificielles en fin de vie : réflexion pluridisciplinaire d’une équipe de soins palliatifs », InfoKara, vol. 20, no 1, p. 7-13.
- DELVAUX, N. (2006). « L’expérience du cancer pour les familles », Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, vol. 36, no 1, p. 81-101.
- DEVALOIS, B., L. GINESTON et A. LEYS (2008). « Controverse “Peut-on ou non discuter d’un éventuel arrêt de la nutrition/hydratation médicalement assistée ou doit-on les considérer comme des soins ‘de base’? ” », Médecine palliative, vol. 7, no 4, p. 222-228.
- DOMEISEN BENEDETTI, F. (2018). Kommunikation und Interaktion am Lebensende - eine Betrachtung der institutionalisierten Palliative Care [traduction libre : Communication et interaction en fin de vie – une réflexion sur les soins palliatifs institutionnalisés], Thèse de doctorat, Université de Saint-Gall (Suisse).
- ENNUYER, B. (2013). « Les aidants familiaux. En finir avec l’idéologie de l’aide naturelle des familles auprès de leurs parents dits “âgés dépendants” », dans La famille : ressource ou handicap?, Toulouse, Érès, p. 91-102.
- FANTINO, B., J.-P. WAINSTEN, M. BUNGENER, H. JOUBLIN et C. BRUN-STRANG (2007). « Représentations par les médecins généralistes du rôle de l’entourage accompagnant le patient », Santé publique, vol. 19, no 3, p. 241-252.
- FEDOR, M.-C. et C. LEYSSENE-OUVRARD (2007). « “L’intégration des familles à l’hôpital” : quelles attentes et quelles réticences de la part des patients, proches, et soignants? Une étude en cours au CHU de Clermont-Ferrand », Recherche en soins infirmiers, vol. 89, no 2, p. 58-75.
- FOLEY, R.-A. (2012). Les temporalités du médicament. Trajectoires en soins palliatifs à l’hôpital, Thèse de doctorat, Université de Lausanne (Suisse).
- FOUREUR, N. et V. FOURNIER (2020). « (Se) nourrir ou mourir : un nouveau dilemme éthique du grand âge? », Gérontologie et société, vol. 42/3, no 163, p. 171-185.
- FURSTENBERG, C. (2014). « La procédure collégiale en pratique en soins palliatifs au domicile à Saint-Laurent du Maroni, Guyane », Revue internationale de soins palliatifs, vol. 29, no 3, p. 89-95.
- GAGNIER, J.-P. et L. ROY (2006). « Souffrance et enjeux relationnels dans le contexte de la maladie grave », Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, vol. 36, no 1, p. 69-79.
- GARDELLA, E. (2009). « Au rythme de l’accompagnement. L’expérience éthique du travail de rue dans l’urgence sociale », dans C. FELIX et J. TARDIF (dir.), Actes éducatifs et de soins, entre éthique et gouvernance, Actes du colloque international, Nice, 4-5 juin. http://revel.unice.fr/symposia/actedusoin/index.html?id=558.
- GARDELLA, E. (2014). « L’urgence comme chronopolitique », Temporalités, no 19. http://journals.openedition.org/temporalites/2764
- GARRIDO, M. M. et H. G. PRIGERSON (2014). « The end-of-life experience: Modifiable predictors of caregivers’ bereavement adjustment », Cancer, vol. 120, no 6, p. 918-925.
- GISQUET, E. (2006). « Vers une réelle ingérence des profanes? Le mythe de la décision médicale partagée à travers le cas des décisions d’arrêt de vie en réanimation néonatale », Recherches familiales, vol. 3, no 1, p. 61-73.
- GOLDBETER-MERINFELD, É. (2016). « Familles, soignants et maladie grave. Introduction », Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, vol. 57, no 2, p. 5-8.
- HELLMANN, J., C. WILLIAMS, L. IVES-BAINE et P. S. SHAH (2013). « Withdrawal of artificial nutrition and hydration in the neonatal intensive care unit: Parental perspectives », Archives of Disease in Childhood. Fetal and Neonatal Edition, vol. 98, no 1, p. 21-25.
- HENNION, A. et P. A. VIDAL-NAQUET (2015). « “Enfermer Maman!” Épreuves et arrangement : le care comme éthique de situation », Sciences Sociales et Santé, vol. 33, no 3, p. 65-90.
- HORTONÉDA, J. (2014). « De la méconnaissance à la reconnaissance », Empan, vol. 94, no 2, p. 62-70.
- JOUBLIN, H. (2007). La condition du proche de la personne malade : 10 études de proximologie, Montreuil, Aux lieux d’être.
- JOUBLIN, H. (2010). « Le proche de la personne malade et l’univers des soins », dans Traité de bioéthique, Toulouse, Érès, p. 270-285.
- KANE, H., M. BRIGNON et J. KIVITS (2018). « 3. Le rôle des proches de malades atteints d’un cancer : construction institutionnelle et expériences personnelles », dans R. AMSELLEM et P. BATAILLE (dir.), Le cancer : un regard sociologique, Paris, La Découverte, p. 39-54.
- KENTISH-BARNES, N. (2007). « “Mourir à l’heure du médecin”. Décisions de fin de vie en réanimation », Revue française de sociologie, vol. 48, no 3, p. 449-475.
- KENTISH-BARNES, N. (2010). « Cultures de fin de vie en réanimation », dans Traité de bioéthique. III - Handicaps, vulnérabilités, situations extrêmes, Toulouse, Érès, p. 527-537.
- LACROIX, C. (2011). « Soins palliatifs gériatriques : comment évaluer les besoins et décider des moyens de la prise en charge nutritionnelle », Médecine palliative, vol. 10, no 5, p. 251-256.
- LAUNAY, P. (2019). La fabrique de la fin de vie : ethnographie d’une Unité de Soins Palliatifs, Thèse de doctorat [document non publié], Université de Caen Normandie (France).
- LECOEUR, L. (2016). Représentations et pratiques des médecins généralistes concernant l’alimentation des patients en soins palliatifs, Thèse de doctorat, Université Nice-Sophia-Antipolis (France).
- LEGRAND, E. (2010). « Quand la réanimation échoue : l’expérience des familles », Sciences Sociales et Santé, vol. 28, no 1, p. 43-70.
- LEHEUP, B. F., E. PIOT, C. GOETZ, D. QUILLIOT, J.-V. NIEMIER, B. WARY et X. DUCROCQ (2015). « Withdrawal of artificial nutrition: Influence of prior experience on the perception of caregivers », American Journal of Hospice and Palliative Medicine, vol. 32, no 4, p. 401-406.
- MANGUM, B. P. et W. BUCKLEY (2012). Ethics of Nutrition and Hydration in the Critically Ill Patient, Rochester (NY), Social Science Research Network.
- MAUSS, M. (1936 [1934]). « Les techniques du corps », Journal de Psychologie, vol. 32, no 3-4.
- MAZÉ, L. et P. NOCERINO (2017). « Analyser l’accueil des personnes âgées en institution. De l’autonomie aux transferts de responsabilité », ethnographiques.org, no 35. https://doi.org/10.25667/ethnographiques/2017-35/002
- MÉLIN, M., H. AMIEVA, M. FRASCA, C. OUVRARD, V. BERGER, H. HOARAU, C. ROUMIGUIÈRE, B. PATERNOSTRE, N. STADELMAIER, N. RAOUX, V. BERGUA et B. BURUCOA (2020). « Support practices by an interdisciplinary team in a palliative-care unit for relatives of patients in agonal phase », BMC Palliative Care, vol. 19, no 1. https://doi.org/10.1186/s12904-020-00680-4
- MONTURO, C. (2009). « The artificial nutrition debate: Still an issue… After all these years », Nutrition in Clinical Practice, vol. 24, no 2, p. 206-213.
- MORIN, L. (2011). Qualité de vie et soutien social des aidantes de conjoints atteints d’un cancer en phase palliative, Thèse de maîtrise, Université de Moncton.
- MORITA, T., S. CHIHARA et T. KASHIWAGI (2002). « Family satisfaction with inpatient palliative care in Japan », Palliative Medicine, vol. 16, no 3, p. 185-193.
- MPINGA, E. K., P. CHASTONAY et C.-H. RAPIN (2006). « Conflits et fin de vie dans le contexte des soins palliatifs : une revue systématique de littérature », Recherche en soins infirmiers, vol. 86, no 3, p. 68-95.
- OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA FIN DE VIE (2013). Les Unités de Soins Palliatifs en 2013. Tableau de bord national. https://reseaux-sante-ca.org/IMG/pdf/les_usp_en_2013.pdf
- OLLIVIER, F. (2021). Au nom de la solidarité nationale : importation de soins “personnalisés” à l'hôpital public. Enquête auprès de professionnel.le.s de soins palliatifs, Thèse de doctorat [document non publié], École doctorale de l’École des hautes études en sciences sociales (France).
- OUELLET, S. (2005). Élaboration et validation d’une stratégie de l’étude des besoins et des attentes des personnes-soutien en soins palliatifs : cas de la Régie de la santé ACADIE-BATHURST, Thèse de doctorat, Université de Montréal.
- PAYNE, S., P. SMITH et S. DEAN (1999). « Identifying the concerns of informal carers in palliative care », Palliative Medicine, vol. 13, no 1, p. 37-44.
- PÉROTIN, V. (2015). « Aspects éthiques de la nutrition en fin de vie », Médecine palliative, vol. 14, no 4, p. 261-269.
- PONET, B., R. PUYUELO et A. ROUCOULES (2014). « Les aidants… une question pour les institutions », Empan, no 94, p. 11-12.
- POTHIER, E. (1994). Au chevet de la mort : ethnographie de soins palliatifs, Mémoire de maîtrise, Université Laval.
- PREISER, J.-C. et J. BERRÉ (2010). « Nutrition artificielle en fin de vie : aspects éthiques », Réanimation, vol. 19, no 8, p. 730-733.
- SENESSE, P., P. BACHMANN, R. J. BENSADOUN, I. BESNARD, I. BOURDEL-MARCHASSON, C. BOUTELOUP, P. CRENN, F. GOLDWASSER, O. GUÉRIN, P. LATINO-MARTEL, J. MEURIC, M. MICHALLET, M. P. VASSON et X. HÉBUTERNE (2012). « Nutrition chez le patient adulte atteint de cancer : textes courts », Nutrition clinique et métabolisme, vol. 26, no 4, p. 151-158.
- SIMARD, J. (2013). Mourir en paix : ethnographie d’une maison de soins palliatifs québécoise, Mémoire de maîtrise, Université de Montréal.
- SIMONET, N. et S. BAUDRY (2018). « La participation des familles aux soins en réanimation », La revue de l’infirmière, vol. 67, no 245, p. 27-28.
- TCHOKOTE, E. C. (2020). « Vécu des aidants familiaux prodiguant des soins à leurs parents atteints d’un accident vasculaire cérébral au Cameroun : analyse interprétative phénoménologique », Recherche en soins infirmiers, vol. 140, no 1, p. 97-106.
- THERRIEN, N. (2001). Voyage au bout de la vie : une ethnographie du mourir au Québec, Mémoire de maîtrise, Université Laval.
- THÉRY, I. (2009). « Autour d’un livre la distinction de sexe. Une nouvelle approche de l’égalité “famille et distinction de sexe : une approche relationnelle” Conférence-débat dans le cadre des universités des familles le 11 avril 2008 », Recherches familiales, vol. 1, no 6, p. 143-161.
- THÉRY, I. (2012). « L’agonisant et le triangle des proches. Pour une approche relationnelle de la fin de vie », La Vie des idées, 17 octobre. https://laviedesidees.fr/L-agonisant-et-le-triangle-des.html
- TRAN, R., L. MARTINEZ et B. CANTIN (2019). « Souffrance des proches de patients atteints d’une maladie en phase terminale : identifier pour mieux accompagner en milieu hospitalier », Revue internationale de soins palliatifs, vol. 34, no 4, p. 129-133.
- VANNOTTI, M. et M. VANNOTTI (2009). « Soins pour la famille ou avec la famille? », InfoKara, vol. 24, no 3, p. 141-146. https://doi.org/10.3917/inka.093.0141
- VERSPIEREN, P. (2008). « Controverse “L’alimentation : un traitement ou un soin? ”. Réflexion éthique », Médecine palliative, vol. 7, no 4, p. 229-233.
- WADHWA, D., D. BURMAN, N. SWAMI, G. RODIN, C. LO et C. ZIMMERMANN (2013). « Quality of life and mental health in caregivers of outpatients with advanced cancer », Psycho-Oncology, vol. 22, no 2, p. 403-410.
- ZULIAN, G. (2019). « C’est peut-être le temps des proches », Revue internationale de soins palliatifs, vol. 34, no 4, p. 108-108.
- Circulaire DGS/3D du 26 août 1986 « relative à l’organisation des soins et à l’accompagnement des malades en phase terminale ».
- Loi 2016-87 du 2 février 2016 « créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie », JO no 0028 du 3 février 2016, texte no 1.
- Loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 « relative à l’adaptation de la société au vieillissement », JO no 0301 du 29 décembre 2015.
- Loi 2002-303 du 4 mars 2002 « relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé », JO du 5 mars 2002, page 4118, texte no 1.
- Loi 99-477 du 9 juin 1999 « visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs », JO no 132 du 10 juin 1999.